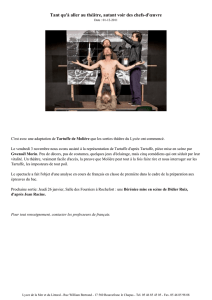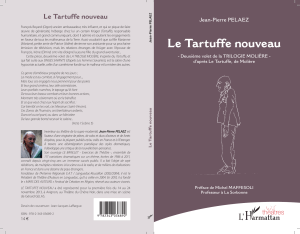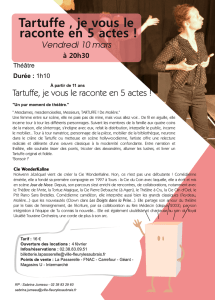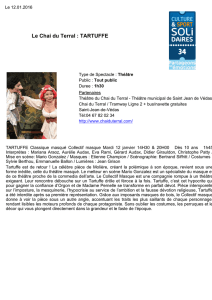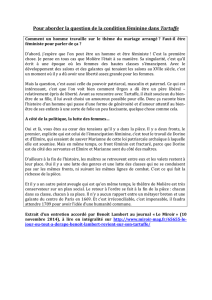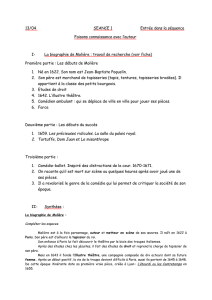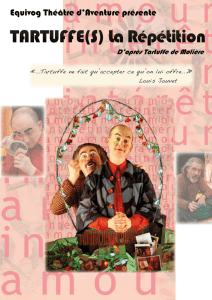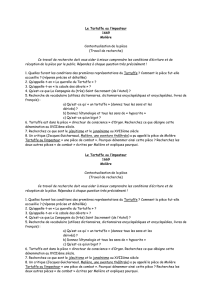caThEriNE aNNE jOëL pOmmEraT shakEspEarE a 450 aNs

Lettre No 9
Odéon-Théâtre de l’Europe mars 2014
OD ON
UNE ANNÉE SANS ÉTÉ
CATHERINE ANNE
JOËL POMMERAT
Une pièce de jeunesse(s)
LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON
SHAKESPEARE A 450 ANS
Colloque international / rencontres
TARTUFFE
TARTUFFE
MOLIÈRE
LUC BONDY
En attendant Tartuffe

2 3
sommaire
p. 2 à 5
EN ATTENDANT TARTUFFE
TARTUFFE
Molière
Luc Bondy
p. 6
FLEURY EN SCÈNE
LE VESTIAIRE
p. 7 à 10
LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON
SHAKESPEARE A 450 ANS
p. 11 à 12
UNE PIÈCE DE JEUNESSE(S)
UNE ANNÉE SANS ÉTÉ
Catherine Anne
Joël Pommerat
p. 13
LE TEMPS DE LA CRÉATION
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART
LE CERCLE DE L'ODÉON
p. 14
AVANTAGES ABONNÉS
Invitations et tarifs préférentiels
p. 15
ACHETER ET RÉSERVER
SES PLACES
Qui est-il, ce monsieur Tartuffe? Que
veut-il, que vaut-il? Depuis qu'Orgon
l'a rencontré, sa piété tranquille est
devenue fanatisme, et son amitié pour
Tartuffe a tout d'une passion. Comment
donc un père de famille apparemment
sans histoires, soudain aliéné et comme
dévoré de l'intérieur par un effroyable
parasite, a-t-il pu succomber à une telle
emprise, jusqu'à faire don de tous ses
biens et vouloir livrer sa propre fille à un
inconnu rencontré par hasard quelques
semaines plus tôt? Et jusqu'où devra
aller Elmire, son épouse, pour lui ouvrir
les yeux? Il y a peu, Luc Bondy a signé
l'adaptation d'un Tartuffe en version
allemande dont l'épaisseur balzacienne
et la vivacité digne de Lubitsch ont fait
l'un des grands succès du printemps
2013 à Vienne. Il revient aujourd'hui à
l'original pour explorer les mécanismes
intimes, familiaux et sociaux qui rendent
possible le succès de l'imposture, tout
en nous mettant sous les yeux, entre
farce et terreur, le portrait génial d'un
incroyable aveuglement.
En mai 2013, Luc Bondy a présenté à
l'Akademietheater, qui est la deuxième
salle du Burgtheater de Vienne, un
Tartuffe dont il cosignait la version
allemande avec Peter Stephan Jungk.
Bondy choisit de saisir dans cette
nécessité de traduire l'occasion d'une
libération. La réussite du spectacle a
tenu pour une bonne part à ce refus
initial de se laisser dicter d'avance les
moindres détails de la mise en scène
au nom d'une fidélité trop littérale à
l'original. Tant dans le fond que dans
la forme, la traduction, d'une grande
cohérence, jouait franchement la carte
de la transposition. Bondy et son colla-
borateur ont renoncé d'emblée à resti-
tuer le vers moliéresque pour s'en tenir
à une prose contemporaine, confir-
mant l'ancrage de l'action dans une
époque qui pourrait être la nôtre. Chez
Molière, Madame Pernelle reproche à
sa bru d'aller «vêtue ainsi qu'une prin-
cesse»; à Vienne, au XXI
e
siècle, Elmire
s'est retrouvée «attifée comme une
diva» (aufgedonnert wie eine Diva).
Cette décision de privilégier la vivacité
moderne de l'expression explique éga-
lement que le rythme des échanges ait
été généralement accéléré. Lorsque
Madame Pernelle allonge un souf-
flet à Flipote pour la presser de sor-
tir, il lui faut deux vers et demi (trente
syllabes, donc) pour commenter son
geste; il ne lui en faut que neuf dans
l'adaptation allemande. Cependant,
à quelques détails et coupes près,
l'enchaînement des répliques ainsi
que leur teneur étaient rigoureuse-
ment respectés. L'actualisation et
l'explicitation du sens, délivré de sa
gangue historique, ne visaient qu'à
rendre plus accessibles les enjeux de
chaque scène, sans jamais affecter
la logique du développement drama-
tique. Même sans connaître l'alle-
mand, un bon connaisseur de l'original
pouvait donc reconnaître sans mal la
plupart des grands moments de la
comédie et leurs mouvements carac-
téristiques. Et apprécier l'humour qui
sous-tendait certains écarts. Chez
EN ATTENDANT
TARTUFFE
(VOYAGE DE MONSIEUR MOLIÈRE
DE VIENNE À PARIS)
(suite p.4)
À Vienne au
XXIe siècle,
Elmire est
«attifée
comme une
diva»...
Le fait
théâtral
obéit à ses
propres lois.
Le retour
au français
s'imposait.
Mais lequel ?
Il se trouve
toujours
des artistes
pour aimer
prendre des
risques.
Ce Tartuffe
sera
empreint de
romanesque.
26 mars – 1er juin / Berthier 17
e
TARTUFFE
de Molière
mise en scène
Luc Bondy
création
décor
Richard Peduzzi
costumes
Eva Dessecker
lumière
Dominique Bruguière
maquillages/coiffures
Cécile Kretschmar
avec
Françoise Brion
Gilles Cohen
Victoire Du Bois
Jean-Marie Frin
Laurent Grévill
Clotilde Hesme
Yannik Landrein
Micha Lescot
Yasmine Nadifi
Fred Ulysse
Pierre Yvon
(distribution en cours)
production
Odéon-Théâtre de l'Europe
avec la participation du
jeune théâtre national
rencontre avec l'équipe artistique
dimanche 18 mai à l'issue de
la représentation
de l’OdéOn
Molière, Madame Pernelle n'entre en
scène et ne lance la pièce qu'avec
la ferme intention d'en sortir au plus
vite, à toutes jambes s'il le faut; selon
Bondy, elle est clouée dans une chaise
roulante, et le tempo qui en découle
donne à toute l'exposition un relief
assez inattendu... Le public viennois,
lui, n'avait garde de comparer des
textes. Emporté par le plaisir du jeu,
il adhérait d'autant plus volontiers au
contrat proposé qu'il n'est pas fami-
lier autant que nous le sommes (ou que
nous sommes censés l'être) d'un texte
qui à nos yeux est un classique.
Lorsqu'il s'est demandé comment
compenser la perte irréparable du
Comme il vous plaira que devait monter
Patrice Chéreau, Luc Bondy a songé à
son Tartuffe. Il ne pouvait cependant
pas être question de programmer
huit ou dix semaines durant un spec-
tacle en langue allemande, même au
Théâtre de l'Europe. Le retour au fran-
çais s'imposait – mais lequel? La ten-
tation était grande de réintroduire la
liberté, la fraîcheur, la légèreté de ton
de la version viennoise dans la recréa-
tion parisienne. Autrement dit, d'adap-
ter à son tour l'adaptation de Bondy
et Jungk.
Le geste pourrait surprendre, voire
choquer certains spectateurs. Il ne
serait pourtant pas sans exemple,
puisqu'il reviendrait en somme à trai-
ter Molière comme le sont souvent les
grands maîtres du répertoire étranger.
Shakespeare, Tchekhov ou les tra-
giques grecs ont fourni plus d'une
fois un matériau théâtral que les
metteurs en scène ajustent à leur
guise, en s'autorisant d'ailleurs des
interventions autrement plus radi-
cales que celles de Bondy abordant
Molière. Si personne n'y trouve à
redire, sans doute est-ce pour deux
raisons. D'abord, parce que le public
aujourd'hui a moins de réticence à
admettre que le fait théâtral obéit à
ses propres lois, et que s'il plie par-
fois le texte à ses exigences, le livre,
après tout, n'y perd rien : l'autorité
reste à l'auteur, la reconnaissance du
rôle créateur du metteur en scène est
à peu près acquise, et chacun reste
maître chez soi tout en négociant
au coup par coup ces imprévisibles
trêves armées que sont les spectacles.
Ensuite, parce que dans le cas du
répertoire étranger, les licences que
le théâtre s'accorde avec les mots qui
l'animent (et qu'il anime) se trouvent
être comme imposées d'entrée de
jeu, pour un public français, par le
fait brut de la traduction – condition
préalable, inévitable, de toute entrée
en rapport avec le texte quand on n'en
parle pas soi-même la langue. Nous
ne sommes pas dépositaires de la
lettre de Shakespeare; ce n'est pas
au français qu'en est confiée la garde.
Mais nous pouvons faire de nécessité
vertu, et puisant dans cette non-res-
ponsabilité (ou dans cette irrespon-
sabilité, comme on voudra) une autre
chance, nous pouvons tirer de la dis-
tance même qui nous sépare des mots
originaux l'espace d'une liberté, d'une
aisance qu'on ne s'accorderait peut-
être pas aussi facilement dans l'idiome
du poète.
Pourquoi dès lors ne pas envisager
Molière comme si les siècles avaient
creusé de nous à lui une distance
analogue, et l'approcher avec toute
la latitude de jeu que l'on s'accorde
avec Shakespeare, Eschyle ou même
Tchekhov? Ce serait tout à fait envi-
sageable. Certains puristes, nombreux
peut-être, se récrieront au motif que
l'œuvre originale de Molière est inscrite
dans notre langue: n'a-t-on pas tout à
perdre à réécrire un tel chef-d'œuvre?
Mais il ne s'agit pas de supplanter un
original; il n'est pas question de l'effa-
cer sous un nouveau texte, mais d'en
proposer un autre abord. Une telle
approche offre d'ailleurs aux clas-
siques un bain de jouvence que bien des
auteurs historiquement plus proches de
nous pourraient leur envier(la mise en
scène de certains grands dramaturges
du XX
e
siècle, verrouillée dans des limites
strictes par leurs ayant-droit, contribue-
t-elle à préserver dans sa première jeu-
nesse un «bon» sens primitif fixé une fois
pour toutes, ou plutôt à en accélérer le
vieillissement?).
Cette liberté, comme toujours, ne va
pas sans risques. Supposons pour-
tant qu'on veuille les prendre – et il
se trouve des artistes pour aimer en
prendre. Alors il faudrait marquer net-
tement, ce serait bien le moins, qu'il
ne s'agit plus d'une œuvre de Molière,
mais d'après Molière. Faute de quoi ce
qui était une information exacte et de
bonne foi sur une affiche autrichienne
(Molière a beau être traduit de façon
très particulière, on peut admettre
qu'il s'agit d'une version de son texte)
deviendrait sur une affiche française
une inexactitude, sinon une tromperie.
En outre, quand bien même on produi-
rait un tel spectacle – qui s'appelle-
rait, par exemple, «Un Tartuffe, d'après
Molière» – il faudrait espérer que le
public saisisse clairement les impli-
cations d'un tel intitulé, accepte de
se détacher des formules originales,
renonce à des comparaisons inop-
portunes pour mieux se concentrer
sur la restitution vivante d'un drame
sur le plateau, dans des formes et
des rythmes contemporains, en des
termes qui ne fassent pas écran à une
perception non savante du spectacle.
On comprend dans ces conditions
pourquoi Luc Bondy s'est finalement
résolu à repartir, pour ce nouveau tra-
vail, du texte de Molière. Combler le
trou laissé dans notre saison par la dis-
parition de Patrice Chéreau lui impo-
sait de trouver une solution d'urgence,
et cette même urgence lui interdisait
non seulement de consacrer à l'écriture
d'une adaptation moderne du Tartuffe
tout le temps nécessaire, mais de s'en
expliquer suffisamment à l'avance, de
façon à éviter tout malentendu sur la
nature du projet.
Repartir de Molière ne signifie pas
pour autant que ce nouveau Tartuffe
selon Bondy manquera de fantai-
sie ni de profondeur romanesque.
Et pas davantage que le metteur en
scène s'interdira d'apporter au texte
quelques aménagements, ici pour
effacer un archaïsme, là pour inquié-
ter le rythme de l'alexandrin. En atta-
quant ce nouveau travail, Bondy est
fort de l'expérience du spectacle vien-
nois. Il en reprend le décor, conçu
Décor du Tartuffe, mis en scène par Luc Bondy à l'Akademietheater de Vienne – mai 2013 –,
réalisé par Richard Peduzzi © Ruth Walz

4 5
Tartuffe
© Ruth Walz
Une première version de Tartuffe (qui
selon certaines sources s'intitulait
L'Hyp o c r i te) a été créé à Versailles le
soir du 12 mai 1664 dans le cadre des
trois journées de fête qui composaient
Les Plaisirs de l'île enchantée. Louis XIV
semble avoir apprécié la comédie, qui
compte alors trois actes. Moins de qua-
rante-huit heures plus tard, il fait cepen-
dant savoir à Molière qu'il n'en autorise
pas la représentation publique. Il ne
s'oppose pas pour autant à des lectures
privées, auxquelles il lui arrive même
d'assister (par exemple chez Monsieur,
frère unique du roi et protecteur officiel
de la troupe de Molière, qui la fait jouer
à Villers-Cotterêts fin septembre 1664).
Ce premier Tartuffe est représenté une
dernière fois au château de Raincy le
29 novembre, en présence du prince de
Condé. Molière a-t-il déjà entrepris de
retravailler sa pièce ? Un an plus tard,
toujours à Raincy, il semble bien que le
Grand Condé ait assisté à une version en
quatre actes. Mais il faut attendre le 5 août
1667 pour que soit créée au Palais-Royal,
sous le titre de L'Imposteur, une comédie
en cinq actes dont le héros, rebaptisé
Panulphe, n'est plus un dévot mais un
«homme du monde» se faisant hypocri-
tement passer pour tel. Il est impensable
que ce Tartuffe remanié ait été donné
au public sans l'aval de Louis XIV (qui
peut en avoir découvert les «adoucisse-
ments» – le terme est de Molière – vers
la mi-juillet, au cours d'une représen-
tation privée). Mais au lendemain de la
première, coup de théâtre: alors que le
roi est retenu loin de Paris par le siège
de Lille, le premier président du Parle-
ment de Paris fait interdire L'Imposteur.
Et moins d'une semaine plus tard, avant
que le souverain ait pu répondre favo-
rablement au placet que le dramaturge
lui a aussitôt adressé, l'archevêque de
Paris en prohibe à son tour toute repré-
sentation ou lecture, privée ou publique,
sous peine d'excommunication.
Le Tartuffe définitif, le seul dont nous
possédions le texte, est finalement créé
le 5 février 1669. Le prototype de 1664
a disparu. Malgré l'absence de docu-
ments, les érudits se sont employés
à reconstituer son aspect à par-
tir des polémiques qu'il a suscitées,
de quelques allusions de Molière lui-
même dans ses placets, et d'indices
dramaturgiques.
Quelques années après la mort de
Molière, ses proches tentèrent d'ac-
créditer une pieuse légende : le pre-
mier Tartuffe aurait été une œuvre
encore inachevée dont seuls les trois
premiers actes furent présentés au roi.
Les représentations publiques de la
pièce n'auraient donc pas été interdites
mais simplement ajournées sur ordre de
Louis XIV, «jusqu'à ce qu'elle fût entière-
ment achevée et examinée par des gens
capables d'en juger». Michelet fut le pre-
mier à mettre en doute cette version des
faits quelque peu invraisemblable
et à supposer que seule une comédie
Orgon aux
aguets erre
comme un
spectre dans
sa propre
maison...
LE SCANDALE
DU MONDE EST
CE QUI FAIT
L'OFFENSE,
AH! SI D'UN TEL REFUS
VOUS ÊTES EN
COURROUX, QUE LE
CŒUR D'UNE FEMME EST
MAL CONNU DE VOUS!
L'HOMME EST, JE
VOUS L'AVOUE, UN
MÉCHANT ANIMAL !
par Richard Peduzzi, et Dominique
Bruguière est à nouveau chargée de
l'éclairer. Ces deux collaborateurs
devaient travailler avec Chéreau sur
Comme il vous plaira, ce qui n'a certai-
nement pas été étranger à la décision
de Bondy de revenir à son Tartuffe,
où il a aussi tenu à confier des rôles à
Clotilde Hesme, Gilles Cohen et
Laurent Grévill. Le cadre général, les
intentions de cette recréation pari-
sienne seront donc les mêmes qu'à
Vienne. Recréation et non pas simple
reprise en langue française, car Bondy
l'a déjà annoncé à ses nouveaux inter-
prètes : il s'agira bien pour eux de
réinventer en sa compagnie les per-
sonnages qu'ils incarneront.
Avec ce Tartuffe, Bondy présente le
troisième volet d'une sorte de trip-
tyque secret, après Le Retour et Les
Fausses Confidences. A-t-on remar-
qué, à cet égard, que Micha Lescot et
Louis Garrel se sont comme partagé
le travail? Dans la première pièce, ils
jouaient deux frères, l'un beau parleur
et l'autre tout en muscles ; dans la deux-
ième, c'est Louis Garrel qui tient le rôle
de l'intrus brûlant de désir; c'est Micha
Lescot qui s'en charge dans la troi-
sième, dont il interprète le rôle-titre.
La pièce de Molière, comme celles de
Marivaux et de Pinter, est en effet une
histoire de corps étranger introduit dans
un intérieur et une étude des pertur-
bations qui s'ensuivent au sein d'une
famille dysfonctionnelle... Tartuffe,
plus encore que Dorante, est un homme
qui part de loin et cherche à grimper
à l'échelle sociale. Dans sa situation,
les scrupules moraux seraient un luxe:
comme le monde auquel il s'attaque ne
lui fera jamais la moindre place, il n'a
d'autre ressource que de la conqué-
rir à tout prix (pour Bondy, Tartuffe
est ce qu'on appelle aujourd'hui un
winner). Et pour conquérir cette place,
il lui faut d'abord l'inventer. Selon les
Évangiles, «la vérité vous rendra libre»,
mais il n'est pas écrit, et pour cause,
qu'elle vous rendra riche ou puissant...
Tartuffe se met donc à une place où
il n'est pas, mais qui est la seule à lui
donner accès auprès d'Orgon. Il ne
peut pas ne pas être hypocrite, car
l'hypocrisie est son «moyen de parve-
nir». Il lui faut assumer un rôle (et s'il
était sincèrement dévot, ne serait-ce
pas encore pire ?). Stendhal s'en sou-
viendra quand il composera Le Rouge
et le Noir. Mais là où Dorante et Julien
Sorel ont aussi la ressource de jouer
du meilleur costume : leur propre
corps, d'une beauté telle qu'elle équi-
vaut à une richesse, Tartuffe est obligé
de nier le sien – ce pauvre corps dési-
rant, maladroit, envahissant, qui l'em-
barrasse tellement dans le rôle qu'il a à
jouer, est comme un acte manqué à lui
tout seul! Mais tel est le prix que doit
payer Tartuffe s'il veut espérer trouver
enfin une place. Voire occuper toute la
place. Héritier à la place de son fils et
époux de sa fille, il serait le succes-
seur absolu d'Orgon – et sur un versant
plus intime, plus dangereux, il le sup-
planterait tout bonnement en devenant
l'amant de sa femme et le propriétaire
de sa maison.
À Vienne, le corps de Tartuffe sem-
blait déborder sans cesse du cadre
que son maître (?) tentait de lui assi-
gner: le front luisant, les mains moites,
Joachim Meyerhoff semblait toujours
se surveiller, obsédé par le contrôle
le plus rigoureux, vérifiant à tout ins-
tant la correction de sa coiffure, scru-
tant le prochain signe de désir qui
finirait fatalement par échapper à
son organisme animé d'une intenable
ambition... Sa façon de manger sans
manger, de grignoter des grissini du
bout des dents, comme s'il ne pouvait
se permettre une jouissance qu'à la
condition que la matière en soit maigre
et sèche, répondait au regard de bête
traquée, angoissée du grand Gerd
Voss dans le rôle d'Orgon, lui aussi
aux aguets, errant comme un spectre
dans sa propre maison dont il explo-
rait les recoins à la fois pour y retrou-
ver son cher Tartuffe et y débusquer
on ne sait quels espions fantoma-
tiques, prêts à bondir sur lui dès qu'il
trahirait ses lourds secrets incons-
cients... Ces corps d'hommes, dans ce
Tartuffe, semblaient vouloir se nier
eux-mêmes tout en s'épaulant l'un
l'autre dans leur épuisant vertige
de négation, jusqu'à ce qu'Elmire y
mette bon ordre en rendant un sexe à
Tartuffe et des yeux à son mari pour lui
faire enfin voir à quelle place Tartuffe
aspire: à la sienne, tout simplement...
Comment Gilles Cohen entrera-t-
il dans la peau d'Orgon et Clotilde
Hesme dans celle d'Elmire ? Quel
Tartuffe Micha Lescot va-t-il inven-
ter, quelles inflexions toute la troupe
apportera-t-elle au roman viennois
de Bondy? L'expérience est en cours.
Réponse dans quelques semaines aux
Ateliers Berthier.
Daniel Loayza, 16 janvier 2014
ET CE N'EST PAS
PÉCHER QUE PÉCHER
EN SILENCE.
complète en trois actes avait pu être
représentée en 1664.
L'examen de la structure du Tartuffe de
1669 confirme cette hypothèse. L'acte
II, qui forme un intermède quasiment
indépendant du reste de l'action, s'or-
ganise autour d'un type de scène dont
Molière était familier: le «dépit amou-
reux». Quant à l'acte V, il repose tout
entier sur un ultime rebondissement qui
ne fait que retarder la défaite définitive
de l'imposteur démasqué. Restent les
actes I, II et IV. À quelques détails près,
il s'avère qu'ils constituent un tout cohé-
rent du point de vue dramaturgique, et
qui ne manque pas d'antécédents roma-
nesques ou théâtraux dans la litté-
rature médiévale ou la commedia dell'
arte: «(I) un mari dévot accueille chez
lui un homme qui semble l'incarnation
de la plus parfaite dévotion; (II) celui-
ci, tombé amoureux de la jeune épouse
du dévot, tente de la séduire, mais elle
le rebute tout en répugnant à le dénon-
cer à son mari qui, informé par un témoin
de la scène, refuse de le croire; (III) la
confiance aveugle de son mari pour le
saint homme oblige alors sa femme à
lui démontrer l'hypocrisie du dévot en
le faisant assister caché à une seconde
tentative de séduction, à la suite de quoi
le coupable est chassé de la maison»*.
On l'aura noté, Mariane n'a pas de rôle à
jouer dans une telle histoire. En donnant
une sœur à Damis et une fille à Orgon
(lequel peut dès lors songer à lui faire
épouser Tartuffe), Molière ne s'est pas
seulement ménagé un élément d'intrigue
pour son acte II: il a aussi transformé le
caractère de son protagoniste. En 1664,
Tartuffe devait être un dévot véritable,
d'une stricte chasteté; son hypocrisie
n'était pas un choix stratégique préa-
lable mais un masque adopté à la suite
de sa rencontre avec Elmire, une atti-
tude que lui imposait son incapacité à
résister aux tentations de la chair. En
1667, en revanche, Panulphe devait déjà
présenter l'aspect du Tartuffe que nous
connaissons: loin d'être un croyant sin-
cère que sa faiblesse contraint à jouer
la comédie, il est désormais un aven-
turier arriviste et tout à fait disposé à
épouser la fille de son protecteur pour
parvenir à ses fins. La modification du
titre, de L'Hypocrite à L'Imposteur, sou-
ligne donc que la conception même du
personnage a changé, ce que l'acte V
achève de mettre en relief: Tartuffe n'est
qu'un «fourbe renommé», un ambitieux
sans scrupules pour qui la religion n'est
qu'un déguisement – un impie d'autant
plus dangereux pour les familles, pour
l'État et pour l'Église qu'il se couvre des
apparences de la piété.
Daniel Loayza, 22 janvier 2014
* Alain Riffaud et Georges Forestier : «Le Tartuffe, ou
l'Imposteur : notice», in Molière : œuvres complètes,
Gallimard, coll. de la Pléiade, 2010, t. II, p. 1375. Nous
empruntons toutes nos informations à ces auteurs.
Acte IV, scène 5, vv. 1411-1412
«Hors contexte, cette réplique me fait bondir!» C'est pourtant celle que Clotilde Hesme choisit de distinguer. Car ce contexte,
l'actrice le connaît bien: il s'agit du moment où le personnage qu'elle va incarner se fait à son tour comédienne pour prendre
Tartuffe au piège et lui rendre la monnaie de sa pièce. À hypocrite, hypocrite et demie. En usant contre l'imposteur du vieux
préjugé masculin selon lequel le «non» des femmes peut vouloir dire «oui», Elmire endort sa méfiance; en l'amenant à se
croire désiré d'elle, elle exacerbe son désir pour achever de l'aveugler – unique moyen pour elle d'ouvrir les yeux de son mari...
Acte IV, scène 5, vv. 1505-1506
Sans s'être concerté avec sa partenaire de jeu, c'est également à la scène 5 de l'acte IV que Micha
Lescot emprunte son distique préféré. Il est sensible à la contradiction entre la solennité du ton
(cette réplique, dit-il, est «formulée comme un prêche des plus profonds») et la totale «absence de
morale et de culpabilité» dont elle témoigne: pas vu, pas pris! Le grand style sert ici de parure à
un cynisme glacial qui semble presque s'abolir à l'instant même où il se manifeste, racheté par la
noblesse spécieuse de l'expression. Un peu comme si la sentence de Tartuffe mimait la leçon qu'elle
affirme: est-ce encore être une crapule que l'être aussi éloquemment?
Acte V, scène 6, v. 1847
Gilles Cohen, sans le savoir, a retenu
l'un des vers favoris de Luc Bondy.
Orgon vient d'apprendre que Tartuffe,
non content de le déloger de chez lui,
l'a dénoncé aux autorités. On pourrait
donc croire que «l'Homme» en ques-
tion est le traître qui veut le faire jeter
en prison. La majuscule de l'édition de
1682 indique qu'il n'en est rien. Comme
toujours, Orgon cède à ses «emporte-
ments» et généralise : devant l'ignomi-
nie de Tartuffe, c'est bien l'humanité
entière qu'il condamne. Bondy a donc
eu raison de lui faire dire à Vienne : Der
Mensch [et non Der Mann], das muss
ich sagen, ist wirklich ein gemeines
Tier !
TARTUFFE
DE 3 À 5
Clotilde Hesme © Rudy Waks/modds
Gilles Cohen © DR
Micha Lescot © DR

6 7
Comment est né l'atelier de théâtre créa-
tif que vous animez à Fleury-Mérogis?
Au début, c'était un atelier d'écriture
créative. Mais en prison, l'écrit n'est pas
toujours maîtrisé et fait peur à beaucoup.
Je me suis vite aperçue que la pratique lit-
téraire de la langue provoquait finalement
plus de frustration que de plaisir, plus de
rivalités que d’harmonie. Avec l’équipe du
service culturel, nous avons réfléchi au
moyen de rendre cet atelier plus attractif.
J’ai formalisé ce que je pratiquais déjà de
temps en temps : écrire du théâtre à par-
tir d’improvisations. Peu importait si on
savait écrire ou non, il fallait juste imagi-
ner, construire aussi. J’aimais aussi l’idée
d’une œuvre collective.
Plus concrètement, comment procédez-
vous ?
C’est un peu magique. Il y a des jours avec
et des jours sans. J’apporte des idées qui
fonctionnent comme des déclencheurs
et je les fais improviser là-dessus. Je n’ai
pas de magnéto, juste un cahier et un
crayon, je dois écrire vite. On reprend le
texte ensemble, il y a des participants plus
créatifs que d’autres, nous rebondissons
sur nos propositions, je lance des idées,
des répliques mais ils sont capables de
s’en emparer, les mettre à leur sauce. Je
travaille en amont et en aval. Chez moi,
je restitue ce qui s’est dit en éliminant les
lourdeurs, je polis, je cisèle. Mais quand
je leur rapporte mes transcriptions, je
leur dis toujours «Enlevez ces mots-là,
c'est les miens, mettez les vôtres...» Je
ne connais pas leur argot, je ne pourrais
pas l'inventer, il est plein de trouvailles.
Leur langue à eux, c'est celle de la marge,
un territoire que je ne connais pas et qu'ils
habitent. Ils règnent dessus, personne ne
peut les en déloger. Je les aide à donner
des lettres de noblesse à cette langue-là
rien qu'en la mettant par écrit. Ça ne leur
déplaît pas de voir leurs paroles prendre
de l'épaisseur sur le papier à mesure que
le texte s'élabore. Il y a une poésie dans le
langage des prisonniers et de tous ceux
qui veulent échapper aux règles, j’adore
leur humour, leur distance. Peut-être
parce que la vie s'est moquée d'eux, ils
se moquent de la vie et d'eux-mêmes. Ils
sont malheureux, à quoi bon en rajouter
en parlant du malheur ? Ils ne s'apitoient
pas sur eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs
l'humour assez vache, ils s'envoient de
sacrées vannes.
Quelle sera l'histoire en 2014?
Cette année, le fil conducteur, c'est le
foot. Le travail s'appelle Le Vestiaire.
Un espace très masculin, très fermé...
et très émotionnel. D'abord, avant un
match, entre une grosse équipe et des
amateurs. On voit ensuite les entraîneurs
qui coachent leur équipe. Et pour finir, le
vestiaire après le match, côté amateurs:
contre toute attente, ils ont gagné. C’est
une histoire pleine d’espoir qui se produit
parfois en vrai.
Combien de participants?
Six par groupe. Comme il était d'emblée
prévu de sortir pour présenter le travail
au Théâtre de l'Odéon, il a fallu limiter le
nombre de participants.
Et comment se présente ce nouveau
travail?
On est reparti sur les mêmes bases que
l'an dernier: découpage en dix scènes,
écriture, relecture, gros travail à la table.
Mais je ne les fais plus bouger dans l'es-
pace. Ils aiment souvent le sport mais
ont un problème avec cet aspect du tra-
vail théâtral. Les assouplissements, les
bras en l'air, ça les gêne un peu et ils n’en
comprennent pas forcément l’intérêt, ça
reste un peu «intello».
Et puis, nous n’avons pas non plus beau-
coup de temps. Au total six mois pour
créer cette pièce. Il faut travailler vite.
Comment s'élabore l'intrigue?
La difficulté, c'est la fin : du moment
que les amateurs reviennent victorieux,
qu'est-ce qui reste à raconter, puisque
tout est joué ? On travaille à remettre
du conflit là-dedans. Par exemple, les
vainqueurs refont le match entre eux,
et revoilà les problèmes ! Que ce soit
en prison, dans un vestiaire de stade
ou ailleurs, un groupe offre toujours un
potentiel de conflit.
Et les personnages, comment se
développent-ils?
Chacun tricote le sien, mais parfois je
leur demande de lire le rôle des autres.
Tout le monde dit une réplique, sans
souci d'ordre ni de cohérence. C'est très
important, d'abord parce qu'on ne sait
pas qui sera finalement là le jour de la
représentation, et puis parce que ça enri-
chit. Peu à peu, les personnages accu-
mulent ainsi des strates différentes. L'an
dernier, il y avait un Chinois qui ne parlait
pas un mot de français. Je lui ai demandé
comment il s'appelait, il m'a répondu par
un monosyllabe, et c'est devenu un per-
sonnage. Lui n'est pas resté, mais son
personnage, oui. On lui a fait parler une
langue étrangère totalement imagi-
naire et loufoque. Je me suis dit: il ne
faut pas que j'oublie ça, cette façon dont
les personnages sont inspirés par les
uns, travaillés par d'autres, passent de
l’un à l'autre comme des témoins dans
une course de relais. Chacun laisse sa
marque... Mais cela dit, j'impose tou-
jours des types. Je tiens en particulier à
ce qu'il y ait un intellectuel. L'année der-
nière, ils ont écrit tout un dialogue entre
un religieux et un scientifique. Cette fois-
ci, dans l'acte I, on a un syndicaliste qui
veut faire grève avant le match. Et dans le
dernier il y a «Einstein», un fort en maths.
Personnellement, qu'est-ce que vous
leur apportez?
Il me semble que je les aide à sortir, expri-
mer ce qu’ils portent en eux, dont ils n’ont
parfois même pas conscience. Certains
ont vraiment du talent et se révèlent dans
ces séances. Ils prennent confiance en
eux. Et puis nous vivons des instants
de grande complicité sans lequel il n’y
aurait pas de création collective. Nous
rions énormément ensemble!
Est-ce que vous sentez une évolution de
leur regard au fil des semaines?
Ils analysent mieux. Ils sont plus sen-
sibles à la manière. Ils voient l'envers,
la construction de tous ces films qu’ils
regardent à la télé. La façon dont l'au-
teur travaille. Et ils saisissent mieux leurs
propres idées. Je leur fais beaucoup tra-
vailler le «pitch»: réduire une situation
à une phrase simple, sujet-verbe-com-
plément. Tant qu'on n'arrive pas à se la
formuler comme ça, avec cette netteté,
c'est qu'il y a quelque chose qui échappe.
J'y reviens tout le temps : dites-moi, avec
vos mots, comment la scène est arti-
culée, d'où elle part, où elle arrive. Le
plus simplement possible. C'est un tra-
vail fructueux. Voilà pour le sens de la
construction. Et du côté de l'imagina-
tion, ça marche aussi. Quand on écrit,
on ne peut pas toujours attendre que
les Muses viennent nous visiter. On doit
faire appel à des ruses, à des trucs. Par
exemple, prenez un groupe d'hommes
où ça ne bouge plus beaucoup. Il suffit
de faire surgir une femme là-dedans et
aussitôt ça réagit! Ils ont inventé une cer-
taine Lili. Elle est devenue un fil rouge qui
traverse toute la pièce...
Pensez-vous que cet atelier est utile pour
leur réinsertion ?
Bien sûr.Cet atelier leur permet de porter
un projet de A à Z. Il y a tellement d'ate-
liers de théâtre où l'animateur, le profes-
seur, arrive avec des scènes qu'ils n'ont
pas choisies, les distribue dans des rôles
en fonction de ses propres intérêts, et
que ce soit un emploi ou un contre-
emploi n'y change rien. On ne trouve
d'ailleurs jamais «la» pièce qui corres-
pondrait au groupe. Là, ils doivent se
prendre en charge, s'ils veulent que leur
rôle soit bien, à eux de se creuser la cer-
velle... Et puis il y a le collectif. Moi, je
trouve que la réinsertion, c'est déjà leur
apprendre ça, travailler avec les autres.
Qu'est-ce qu'une présentation publique
représente à leurs yeux?
Un bel enjeu. Il y a un gars formidable
qui n'arrête pas de dire que même s'il est
libéré, il sera là le 29. Les autres le char-
rient, mais lui ne se laisse pas démon-
ter. Et pourtant Paris l'intimide. Il nous a
raconté – c'était très drôle – que tout ce
qu'il connaissait de Paris, il l'avait vu à
travers le grillage du fourgon cellulaire,
pendant les fêtes de fin d'année. C'est la
seule image qu'il ait de la ville: les déco-
rations, les guirlandes qui défilaient dans
la petite fenêtre.
Comment envisagez-vous les trois
derniers mois de travail?
Ils vont devoir vraiment prendre garde
à ne pas se disperser, et moi avec eux...
Mais c'est toujours ainsi. Il faut tenir
des projets raisonnables. Faire avec les
contraintes. Celles qui sont liées à la pri-
son mais aussi au théâtre. Ils s'en font
une idée très classique, très «au théâtre
ce soir»: pour eux, il faudrait les trois
coups, le rideau, un décor, sans quoi ils
ne reconnaissent pas «le» théâtre. Dans
nos séances, ils doivent aussi apprendre
que c'est à eux de tout représenter, de
tout faire passer sur une scène minus-
cule. De faire tout avec rien. C'est en soi
un défi qu'ils seront certainement fiers
de relever devant un vrai public. Et cette
fierté peut, je l'espère, leur donner un
nouvel élan.
Propos recueillis par Daniel Loayza
le 12 décembre 2013
* Enseignante et comédienne, Sylvie
Nordheim anime depuis 2010 des ateliers
d’écriture créative à la Maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis. En 2012, elle a ajouté une
dimension théâtrale à cette activité an de la
rendre également accessible aux personnes
détenues qui ne maîtrisent pas l’écrit, ni par-
fois notre langue.
«FAIRE TOUT AVEC RIEN»
entretien avec Sylvie Nordheim*,
animatrice de l'atelier de théâtre de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
LES
BIBLIOTHÈQUES
29 mars – 7 mai 2014
OD ON
© Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
FLEURY EN SCÈNE
SAMEDI 29 MARS / 15h et 18h
LE VESTIAIRE
au Théâtre de l'Odéon – salon Roger Blin
tarif unique 6€
01 44 85 40 40 – theatre-odeon.eu
en partenariat avec le SPIP de l’Essonne, la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, l’association
Léo Lagrange Île-de-France, la Fondation la Poste et la Fondation SFR
en collaboration avec Lilian Thuram et sa Fondation Éducation contre le racisme
William Shakespeare. Gravure publiée en frontispice du recueil d’œuvres édité à Londres en 1623 par Isaac Jaggard et Edward Blount.

8 9
Daniel Loayza – Pourriez-vous nous
dire deux mots de la Société que vous
présidez?
Dominique Goy-Blanquet – La Société
Française Shakespeare va fêter ses
quarante ans l'an prochain, entre
les deux grandes commémorations
shakespeariennes. Elle a été fon-
dée par un groupe d'universitaires,
dont Jean Jacquot, l'auteur de
Shakespeare en France, qui a été un
peu le pionnier, au CNRS, de ce qu'on
appelle aujourd'hui les études théâ-
trales. On a tendance à oublier qu'à
l'époque où j'étais étudiante, on trai-
tait encore les textes de théâtre
comme des objets littéraires parmi
d'autres, sans particularité notable.
Il y avait aussi Richard Marienstras,
dont je viens d'éditer chez Gallimard
une importante œuvre posthume :
Shakespeare et le désordre du monde,
Marie-Thérèse Jones-Davis, Robert
Ellrodt, Henri Fluchère... L'idée était
de créer un lieu de rencontre et de
discussion qui prendrait en compte
tous les aspects de la recherche et de
la création autour de Shakespeare.
D'où l'idée d'organiser des congrès,
et d'inviter non seulement des pro-
fesseurs ou des critiques, français et
étrangers, mais aussi des praticiens:
scénographes, metteurs en scène,
acteurs, dramaturges, ou d'autres
personnalités, des psychanalystes,
par exemple... Au début, les relations
n'étaient pas toujours simples... Mais
la SFS a toujours lutté contre une cer-
taine tradition très française de cloi-
sonnement, de division. En Angleterre,
les relations entre la scène et l'uni-
versité sont depuis toujours beau-
coup plus ouvertes et cordiales. Il est
vrai que là-bas, les grands acteurs et
metteurs en scène shakespeariens, à
commencer par Peter Brook, sont eux-
mêmes très souvent issus de l'univer-
sité. D'ailleurs, la pratique théâtrale y
est tout naturellement implantée dans
le cursus secondaire. Sur ce terrain,
les choses ont commencé à bouger en
France, mais beaucoup reste à faire.
La SFS y a contribué et entend bien
continuer. Et si j'avais un souhait pour
l'avenir, ce serait que notre Société
s'ouvre encore davantage. Je pense
en particulier aux enseignants du
secondaire. De ce côté-là, on a lancé
plusieurs initiatives, notamment avec
l'appui de Françoise Gomez, une ins-
pectrice très énergique et enthou-
siaste toujours en première ligne dès
qu'il s'agit de théâtre. J'invite donc
tous ceux qui veulent en savoir plus à
nous visiter sur notre site. Vous pour-
rez y consulter les actes de nos précé-
dents congrès. Tout le monde peut être
membre de la SFS. Nous ne sommes
pas une enclave d'universitaires, ni
même d'anglicistes!
D. L. – Votre Congrès 2014 doit d'ail-
leurs s'ouvrir à l'Odéon-Théâtre de
l'Europe...
D. G.-B. – Ce sera une belle occasion
de toucher un public plus large, lors
d’une semaine qui célèbrera le 450e
anniversaire de Shakespeare, la date
officielle de sa naissance étant le 23
avril, fête de Saint Georges, patron
SHAKESPEARE A 450 ANS
21 AVRIL COLLOQUE INTERNATIONAL
29 - 30 AVRIL / 6 - 7 MAI SHAKESPEARE DANS L'ATELIER ROMANESQUE
SHAKESPEARE, RACINE DU ROMANTISME
entretien avec Dominique Goy-Blanquet*, présidente de la Société Française Shakespeare
de l'Angleterre. Notre journée inaugu-
rale se tiendra au Théâtre de l'Odéon.
Beaucoup d'autres manifestations
sont prévues, en Sorbonne, au Musée
Delacroix, au Musée Victor Hugo, à
l'Auditorium Saint-Germain, au cinéma
le Louxor. Entre autres!
D. L. – Quelles sortes de fils thématiques
avez-vous déjà dégagés?
D. G.-B. – Avec Florence Naugrette, qui
est une spécialiste du théâtre roman-
tique, nous avons de la matière pour un
mois de lectures, et nous continuons à
en trouver tous les jours. Par exemple,
il y a eu autour d'Hamlet et d'Ophélie
une production énorme de documents
qui s'enchaînent au fil des années et
des différentes mises en scène. On
peut observer comment le personnage
d'Ophélie évolue tout au long du XIXe
siècle, de Théophile Gautier à Joris-Karl
Huysmans. Même chose pour ce qu'on
peut appeler l'hamlétisme: très vite, le
prince du Danemark est assimilé à une
figure du poète ou du penseur, dont on
peut suivre les avatars jusqu'à Mallarmé,
Laforgue, Claudel et au-delà. Autre
exemple, la création fin 1829 du More de
Venise, la version d'Othello qu'a donnée
Alfred de Vigny. Elle a donné lieu à une
véritable bataille. Toute la jeune géné-
ration romantique est impliquée. Dès le
lendemain de la première, Victor Hugo
rencontre Sainte-Beuve et revendique la
victoire: grâce à eux, lui dit-il, tout s'est
passé au mieux. Quelque temps après,
Hugo écrit au même Sainte-Beuve pour
lui faire part de ses griefs: tous comptes
faits, Vigny n'est qu'un ingrat – alors que
lui, Hugo, l'avait soutenu de ses applau-
dissements frénétiques, et qu'il avait
laissé passer Le More avant Hernani,
qui était prévu pour le précéder à l'af-
fiche! Si je parle de bataille, c'est qu'il
s'agit manifestement d'un épisode de la
guerre que se mènent, dans ces années-
là, depuis le Racine et Shakespeare de
Stendhal, les défenseurs de la tradition
française et les admirateurs du dra-
maturge anglais. Alexandre Dumas en
parle bel et bien comme d'un combat
où la jeune troupe romantique compo-
sée, dit-il, de «fils de généraux» brûlant
d'en découdre pour une noble cause,
aurait eu grand besoin d'un meneur
d'hommes plus inspiré et engagé que
Vigny, ce condottiere qui ne touchait
pas le sol... Le langage est extrême-
ment militaire! On est quasiment dans
une répétition générale de ce qui sera
la grande bataille du romantisme nais-
sant, celle d'Hernani, quatre mois plus
tard. On retrouve les mêmes querelles,
y compris sur les questions de forme.
On critique les choix de Vigny, qui a osé
maintenir dans sa version des acces-
soires aussi vulgaires et triviaux que
le mouchoir de Desdémone ou l'oreil-
ler avec lequel Othello l'étouffe! Les
classiques réclament le respect du
décorum, tandis que les romantiques
revendiquent le mélange des genres
qu'on leur reproche. Cette discus-
sion-là s'engage à l'orée du roman-
tisme naissant et va déterminer toute
la suite.
D. L. – Tout bascule en 1830, avec la
Révolution de Juillet...
D. G.-B. – Oui. C'est un tournant majeur
dans notre histoire politique et esthé-
tique. Voilà aussi pourquoi nous
tenions tant à organiser ces séances
à l'Odéon, qui est en 1827 le lieu où
commence véritablement la passion
française pour Shakespeare lors d’une
représentation de Hamlet. Dans ces
années-là, l'influence du dramaturge
a été séminale. On le retrouve un peu
partout. Je relisais tout récemment
Mademoiselle de Maupin – non seule-
ment Comme il vous plaira intervient au
milieu du roman, mais c'est toute l'in-
trigue qui tourne autour d'une jeune et
belle héroïne déguisée en homme... Ce
qui se passe en amont, entre 1800 et
1825, est moins connu mais non moins
intéressant. Nous avons prévu de par-
ler des débuts de la vogue shakespea-
rienne en France. Et de l'influence de
certains passeurs. Chateaubriand
est le plus vénérable, mais on le sent
encore réticent, imprégné de classi-
cisme. Comme Charles Nodier, qui
dans un premier temps se montre à
la fois fasciné et réservé devant cer-
tains aspects de l'œuvre. Ce qui n'em-
pêche pas celui qui fut le mentor du
jeune Hugo de poser très tôt, dès avant
Stendhal, les enjeux du conflit à venir.
D. L. – Finalement, cet atelier
s'avère être plus romantique que
romanesque?
D. G.-B. – Je comprends que vous
ayez l'impression que le roman-
tisme domine: je vous ai citéDumas,
Hugo ou Gautier. Il y a aussi Flaubert
qui intervient dans la deuxième soi-
rée, «du grotesque au sublime»... Je
ne vous ai pas tout raconté! Saviez-
vous que Flaubert, au moment où
il écrit Madame Bovary, est plongé
dans la lecture de Shakespeare? Cela
revient constamment dans sa corres-
pondance. Son traitement de la mort
d'Emma est manifestement influencé
par sa façon d'appréhender le mélange
shakespearien du grotesque et du
pathétique. Et à propos d'empoison-
nement, Alexandre Dumas fournit
un autre bel exemple dans La Reine
Margot – je pense à ce chapitre intitulé
«la sueur de sang», où le roi Charles IX
à l'agonie impose sa volonté à sa mère,
Catherine de Médicis... Cette soirée-
là commencera avec la préface de
Cromwell, elle-même très nourrie
de Nodier et des travaux de Guizot –
Hugo affiche une grande hostilité à son
égard, mais en fait, il s'en est beau-
coup servi et inspiré. On croisera aussi
Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-
Adam – il y a dans ses Contes Cruels un
texte merveilleux, «Le Désir d'être un
homme»... Les romanciers sont donc
bien là. Proust est du nombre, et Gide, et
Yourcenar. Nous pensons terminer avec
un très joli passage d'elle sur le rêve.
Cela dit, l'influence de Shakespeare
décroît très sensiblement au XXe siècle.
Après 1945, Shakespeare semble inté-
resser surtout les universitaires et les
gens de théâtre. On trouve beaucoup
moins de traces de lui chez les plasti-
ciens, les compositeurs, les danseurs,
alors que jusqu'au début du XXe, les
Vie et opinions de Tristram Shandy,
gentilhomme est un roman de
Laurence Sterne, publié en neuf
volumes, les deux premiers à York
(Angleterre) en 1759, les sept autres
dans les dix années suivantes. Il parut
en France pour la première fois en 1776.
Ce roman, relativement peu connu en
France, est pourtant considéré comme
l'un des plus importants de la littérature
occidentale.
Claro*, quand avez-vous lu ce livre pour
la première fois ? Racontez-nous les
circonstances de cette lecture.
L'adolescence est ce moment où les
livres s'invitent dans votre vie en cou-
rants d'air. Portés par des rumeurs,
annoncés comme le Messie ou l'Anté-
christ, ils tournent souvent autour de
vous sans oser se poser sur votre table
de chevet. On les essaie parfois comme
des vêtements empruntés à un ami,
pour parader plus que pour se vêtir.
Tristram Shandy a longtemps fait par-
tie pour moi de ces livres qu'on ne lit
pas en entier mais dont on n'hésite
pas à vanter l'excellence, la folie bref
de ces livres que l'adolescent se sent
en droit de célébrer sans pourtant avoir
eu la patience de s'y laisser engloutir.
J'ai donc dû le lire en contrebandier,
ou plutôt en taupe, y creusant des tun-
nels au détriment de certaines galeries,
sans cesse aspiré par cette fameuse
page noire qui vaut pour le jeune lec-
teur comme le monolithe de Kubrick
pour l'apprenti cinéphile. Tant il est vrai,
aussi, que Vie et opinions de Tristram
Shandy se feuillette, afin d'en goûter,
du bout de l'œil, les multiples variations
typographiques, les insolites composi-
tions, la pléthore de tirets finissant par
se convulsionner à la fin du livre VI en
lignes sismiquement facétieuses. Les
grands livres sont souvent de «grands
ivres» : ils titubent dans notre expé-
rience de lecteur avant de nous dévoiler
leur complexe et grisante géographie.
Nous reproduisons ici, avec l'aimable auto
risation de Flammarion, un extrait de l'in-
terview qui gure dans l'édition de la GF,
mise à jour en 2014. © Flammarion
shakespeareanniversary.org/shake450
GOÛTER,
DU BOUT DE
L'ŒIL, LES
MULTIPLES
VARIATIONS
TYPOGRA-
PHIQUES
mardi 8 avril / 18h
Pourquoi aimez-vous?
Tristram Shandy de Laurence Sterne
en présence de Claro
rencontre animée par Daniel Loayza
lundi 7 avril / 20h
Exils, conversation avec Paula Jacques
Lawrence Durrell / Mathias Énard
textes lus par Olivier Cruveiller
en partenariat avec France Inter
Lawrence Durrell par Daniel Berland,
libraire
Il existe des romans si extraordinaires
que leur découverte embellira et mar-
quera à tout jamais l’âme et la vie de
leurs futurs lecteurs. L’œuvre maî-
tresse de Lawrence Durrell, Le Quatuor
d’Alexandrie, est l’un d’eux. Enraciné
dans l’histoire, Le Quatuor d’Alexandrie
est une quête de l’art en même temps
qu’une quête amoureuse. Les chas-
sés-croisés sentimentaux sur fond de
préoccupations sociales et géopoli-
tiques dans l’Alexandrie de l’entre-deux-
guerres forment la colonne vertébrale
de cette œuvre polyphonique de plus
d’un millier de pages. Darley, person-
nage principal du Quatuor, semble
voué à osciller en permanence entre
le désir et le rejet, le bien et le mal, la
constance et le caprice. Cette valse des
sentiments se déploie sur le grandiose
théâtre, en scène et en coulisses, de la
magique Alexandrie, «comme dans un
grand congrès d’anguilles enchevê-
trées dans la matière visqueuse d’un
complot.» Lentement, au terme d’une
sorte d’initiation truffée de rebondis-
sements, Darley apprendra l’amour et
accédera à sa maturité d’homme et d’ar-
tiste. Et puisqu’il est des œuvres qu’un
simple résumé déflore et appauvrit, je
m’arrête ici et exhorte chacun des lec-
teurs de cet article à se (re)plonger dans
cette époustouflante merveille de la lit-
térature mondiale.
Écrit dans les années 1930 et interdit par
son auteur à toute publication de son
vivant, Petite musique pour amoureux
retrace la vie d’un jeune garçon britan-
nique, Clifton Walsh, de son enfance
en Inde jusqu’à son retour dans une
Angleterre qui le mettra au pied du mur
de ses contradictions et des déchire-
ments auxquels le confronte sa double
culture. Ce roman d’apprentissage lar-
gement autobiographique apparte-
nait depuis longtemps au domaine de
la légende. Les initiés s’arrachaient
sous le manteau les très rares tapus-
crits à prix d’or, la plupart des copies
de l’ouvrage ayant été détruites dans
un incendie durant les bombardements
de l’Axe sur Londres. De la liberté des
grands espaces de son Himalaya natal
jusqu’aux étroits corridors conven-
tionnels d’une Angleterre décadente et
étriquée, l’auteur, plein d’une fraîche et
franche naïveté, s’y raconte en toute inti-
mité. Un roman de jeunesse dans lequel
on sent déjà poindre à chaque page le
lumineux génie de l’auteur du Quatuor.
La première édition française de ce
texte mythique devrait constituer l’un
des événements littéraires majeurs du
printemps. Citrons acides a été inspiré
à Lawrence Durrell par son passage à
Chypre entre 1953 et 1956, alors que l’île
est en pleine guerre de décolonisation
contre l’Empire britannique. Très éloi-
gné d’une démarche politique, Durrell
réserve toute la maîtrise de son art à la
peinture de personnages plongés dans
les tourmentes de l’histoire. «Je voudrais
que ce livre soit tenu pour un monument
utile élevé à la paysannerie chypriote et
aux paysages de l’île.» déclare l’auteur
dans sa préface. Lawrence Durrell est
mort en France en 1990, il aurait fêté ses
100 ans en 2012. J’envie ceux qui ne l’ont
encore jamais lu et sont sur le point de
sauter le pas en s’absorbant dans les
méandres inoubliables de son œuvre.
APPRENDRE
L'AMOU R
créateurs étaient encore imprégnés
de son univers. Et le disaient. Il y a de
superbes exceptions, bien sûr: Valère
Novarina, Yves Bonnefoy... À l'occa-
sion du congrès «Shakespeare 450», j'ai
demandé à des écrivains qui avaient une
relation manifeste à son œuvre d'écrire
une lettre à Shakespeare. Le livre va
paraître en mars aux éditions Thierry
Marchaisse. Peut-être en lirons-nous
quelques extraits: le genre épistolaire
se prête bien à la lecture !
Propos recueillis par Daniel Loayza
le 13 janvier 2014
*Christophe Claro, plus connu sous
le simple nom de Claro, est écrivain,
auteur entre autres de Livre XIX
(Verticales), Plonger les mains dans
l’acide (Inculte), Madman Bovary,
CosmoZ, Tous les diamants du ciel
(Actes Sud), et traducteur (Thomas
Pynchon, Salman Rushdie, William
T. Vollmann, Hubert Selby...). Il
a accepté de répondre au ques-
tionnaire «Pourquoi aimez-vous
Tristram Shandy ?» pour la GF.
Les Bibliothèques de l'Odéon 9
Premières éditions françaises de Justine, Balthazar,
Mountolive et Clea (Le Quatuor d'Alexandrie).
Lawrence Durrell. éd. Buchet/Chastel, 1957-1960.
Shakespeare 450 grande salle
Coordonné par Dominique Goy-Blanquet
Colloque international lundi 21 avril
Introduction par Michel Bataillon
11-12h conférence d'Yves Bonnefoy, «Pourquoi Shakespeare»
12-13h conférence d'Andreas Höfele, «Elsinore, Berlin : Hamlet in the Twenties»
15-16h entretien avec Luc Bondy conduit par Georges Banu
16-17h débat avec David Bobée, Thomas Jolly, Vincent Macaigne, Gwenaël Morin, animé par
Leila Adham et Jean-Michel Déprats
17h30-19h master class dirigée par Philippe Calvario, Vincent Dissez et Émeric Marchand
> ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 01 44 85 40 40 / THEATRE-ODEON.EU
Shakespeare dans l’atelier
romanesque salon Roger Blin
Avec Dominique Goy-Blanquet, Florence Naugrette, Daniel Loayza
Textes lus par Jacques Bonnaffé
Le doute et les ombres mardi 29 avril / 18h
Comment les romantiques français découvrirent-ils Shakespeare en France? Quelle
stature philosophique donnèrent-ils à Hamlet, incarnation du devoir de vengeance
et de l’artiste rêveur, et à Ophélie, figure de la douce démence et de l’amour contra-
rié? À quelles parodies et critiques l’«hamlétisme» a-t-il donné lieu?
Textes de Chateaubriand, Hugo, Vigny, Dumas, Musset, Sainte-Beuve, Flaubert,
Banville, Baudelaire, Laforgue, Mallarmé, Claudel, Gide…
Du grotesque au sublime mercredi 30 avril / 18h
La réversibilité du grotesque et du sublime s’alimente de nombreux modèles shakes-
peariens, dont Richard III, Falstaff et Caliban, incarnations de l’ivresse, de la déme-
sure, du mensonge, de la difformité, de la bestialité, de la monstruosité physique ou
morale, ou d’un mal qui n’inspire pas seulement l’horreur mais aussi le rire ou la pitié.
Textes de Chateaubriand, Stendhal, Hugo, Gautier, Dumas, Flaubert, Renan, Barbey
d’Aurevilly, Jarry, Ionesco, Novarina.
Passions funestes, crimes et vengeance
mardi 6 mai / 18h
Le couple Macbeth, Othello, le roi Lear font partie des figures à la fois terrifiantes
et pitoyables à l’origine de nombreux portraits et situations romanesques: du bon-
heur dans le crime à l’autodestruction sacrificielle, en passant par la volonté de
puissance, l’obsession de la culpabilité, la jalousie morbide, la soif de vengeance, la
rupture des liens familiaux.
Textes de Dumas, Hugo, Vigny, Balzac, Gautier, Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Proust,
Claudel, Vercors, Céline, Ionesco.
Masques et dédoublements mercredi 7 mai / 18h
Découverte tardivement en France, la comédie shakespearienne plaît par sa fantai-
sie, son inventivité scénographique, sa capacité à exalter les pouvoirs du théâtre,
ses potentialités romanesques, et la richesse de son questionnement existentiel
sur la nature de l’homme, viala comédie des erreurs et le motif du travestissement.
Textes de Madame de Staël, Nodier, Stendhal, Hugo, Gautier, Sand, Rimbaud, Copeau,
Artaud, Beauvoir, Aragon, Yourcenar.
> TARIF 6€ 01 44 85 40 40 / THEATRE-ODEON.EU
*Dominique Goy-Blanquet est également
professeur émérite de littérature élisabé-
thaine à l'Université de Picardie et membre
du comité de rédaction de La Quinzaine
Littéraire.
La revue Page des libraires s’associe à
l’Odéon-Théâtre de l'Europe pour vous
proposer le regard des libraires indépen-
dants sur l’œuvre des auteurs program-
més dans le cadre des Bibliothèques de
l’Odéon.
La revue Page des libraires œuvre depuis
25 ans à diffuser au plus grand nombre
l’avis des libraires indépendants sur l’ac-
tualité littéraire. En lisant les titres avant
parution et en sélectionnant les ouvrages
qu’ils ont aimés, les 1200 libraires du
réseau Page, acteurs clé de la chaîne du
livre, témoignent de leur expertise et de
leur plaisir à partager leurs lectures avec
les lecteurs, tous les deux mois en librairie.
ci-contre : Pages tirées de la première
édition de l'œuvre The Life and Opinions
of Tristram Shandy, Gentleman (1759 à
1767) publiée à Londres par Ann Ward
(volumes 1-2 en 1759), Dodsley (3-4 en
1761) et Becket and DeHondt (5-6 en
1762, 7-8 en 1765, 9 en 1767).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%