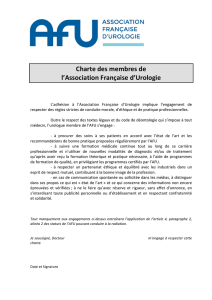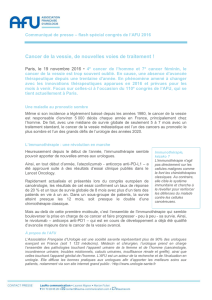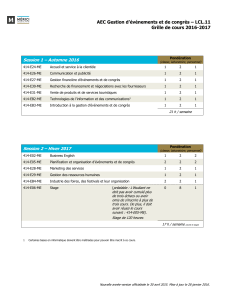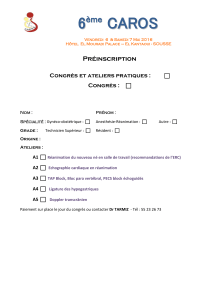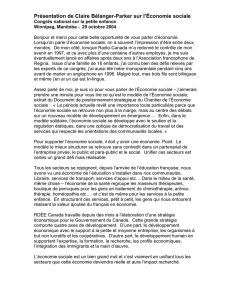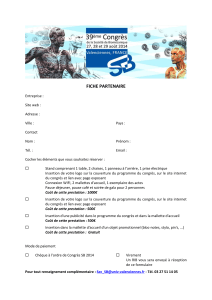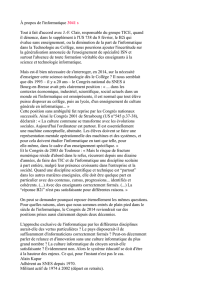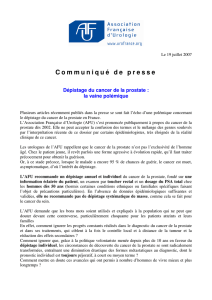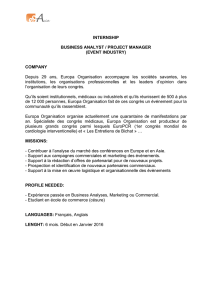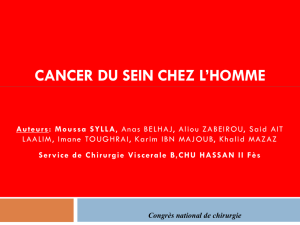Essentiel du Congrès, AFU 2002

- Tous les PSA faits dans la
région Centre pendant un an
ont été évalués. Les urologues
ne font que 10% des prescrip-
tions alors qu’ils ne sont qu’1%
des prescripteurs. Il y a
quelques déviances pour les
urologues mais ce sont eux qui
prescrivent le plus en harmo-
nie avec les recommandations
(Figure 1). En revanche, ce sont
surtout les généralistes qui
font des exceptions aux règles
de prescription. Par exemple,
f a i re un PSA l i b re à des
patients déjà connus pour un
cancer ou sans PSA total de
référence ou chez des gens qui
ont un PSA total très élevé. Il y
a donc du travail pédagogique
à faire, un peu pour nous mais
beaucoup pour les généralis-
tes. Un mot aussi, les cardiolo-
gues représentent la troisième
spécialité qui prescrit le PSA, le
plus souvent hors recomman-
dation.
-Une autre étude a été faite de
façon exhaustive, sur les
fichiers de la Caisse Nationale
à propos des biopsies prosta-
tiques pendant trois mois.
Toutes les biopsies sont recen-
sées, quelque soit le prescrip-
teur. On remarque par rapport
aux recommandations qu’il
existe des non conformités de
la part des urologues et des
pathologistes. De la part des
urologues, ils ne respectent pas
la transmission des données
cliniques et du PSA vers le
pathologiste ; le respect n’est
présent que dans 2% des cas. Il
y a une sous-re p r é s e n t a t i o n
des biopsies réalisées en
consultation au profit des
réalisation au cours d’une
hospitalisation. De la part des
pathologistes, les descriptifs
souhaités sont peu exhaustifs.
- Concernant le traitement à
visée radicale dans la région
centre pendant un an (radio-
thérapie ou chirurgie), tous les
dossiers et tous les patients ont
été revus à deux ans. Ces
patients représentaient seule-
ment 40% de l’ensemble des
patients porteur d’un cancer
de prostate, pendant la même
période pour les six départe-
ments. Le traitement se répar-
tissait à moitié/moitié pour
radiothérapie ou pour chirur-
gie (Figure 2). Par rapport aux
recommandations, le bilan pré-
thérapeutique était souvent en
défaut par excès ou par défaut.
Par exemple, quand on traite à
visée radicale et que le PSA est
supérieur à 10 ou le grade de
Gleason supérieur ou égal à 4,
il est recommandé de faire sys-
tématiquement une scintigra-
phie, un scanner et une lym-
phadémectomie. En pratique,
il existe des non respects dans
40% soit par excès, soit par
défaut (ce qui est peut-être
plus grave).
Les patients qui ont été traités
(radiothérapie ou chirurgie) ont
tous été revus par un médecin et
ont tous répondu à des question-
naires. Parmi ces questionnaires:
l’un sur la sexualité, l’autre sur
l’incontinence (Figure 3). Les com-
plications sont plus élevées que ce
qui est habituel de dire ou de voir
dans les différentes communica-
tions.
I. ETUDE EN DONNÉES
RÉELLES
Prescription du PSA, réalisa-
tion des biopsies pro s t a-
tiques, traitements des cancers
de prostate
16
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel du Congrès,
AFU 2002 - Compte-Rendu. Ess
e
n
t
i
e
l
du
Cong
r
è
s
,
A
FU
2002
-
Co
m
p
t
e
-
R
e
ndu
.
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-
Rendu.
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel
du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Ess
e
n
t
i
e
l
du
Cong
r
è
s
,
A
FU
2002
-
Co
m
p
t
e
-
R
e
ndu
.
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-
Rendu.
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu.
Pr Y. Lanson Service d’Urologie, CHU Brotonneau - Tours
N°4 Decembre 2002

-François Desgranchamps nous
a parlé de l’étude AFU sur la
curiéthérapie qui est en cours.
Des biopsies prostatiques ont
été faites et actuellement elles
ne sont plus pratiquées.
Commentaire sur l’IPSS : il y a
une montée importante et rapi-
de des symptômes et même si
ces derniers s’améliorent, il
reste une aggravation par rap-
port à la période avant traite-
ment (Figure 4). Sur le PSA, sur
un an, le contrôle est très satis-
faisant. Sur la sexualité, les
résultats sont globalement
satisfaisants comparativement
à la prostatectomie radicale
(Figure 5). Ceci étant, ils sont
moins brillants que ceux qui
étaient claironnés dans les étu-
des précédentes.
Le club sur l’ablaterm. Les procé-
dures se sont un peu modifiées et
Albert Gelet nous a dit qu’actuel-
lement le RTUP était de rigueur
pour éviter les ennuis connus pré-
cédemment. Par ailleurs, il y a
maintenant des études plus
ciblées sur les érections avec
modification éventuelle des
protocoles mais aussi des critères
d’inclusion. Résultats préliminai-
res de l’étude AFU (Figure 6). Bien
entendu, il est impossible de
conclure compte-tenu d’un recul
encore très modeste. Cette tech-
nique est innovante, fiable, l’ap-
p rentissage semble simple, elle
est bien tolérée pour la grande
majorité des patients, elle appa-
raît contrôler la maladie au plan
biologique avec un recul qui est
pour l’instant tout-à-fait insuffi-
sant pour conclure.
Tout le monde a en mémoire que
les différents médicaments peu-
vent altérer la sexualité dans un
pourcentage de 0 à 8%. Quant aux
micro-ondes et au procédé Tuna,
ils ont vieilli, passé de mode, ils
étaient également re s p o n s a b l e s
d’altération de la sexualité et
pourtant vendus et pro m u s
comme des traitements donnant
moins d’ennuis iatrogènes que les
autres méthodes thérapeutiques.
La chirurgie peut, on le sait altérer
l’éjaculation. C’est retrouvé par-
tout mais dans des proportions
tout-à-fait variables. Peu d’études
c o m p a rent des populations du
même âge non opérées avec les
opérés prostatiques, il n’y a fina-
lement pas de différence quant à
la sexualité en-dehors de l’anéja-
culation. Il y a des opérés qui,
après traitement vont mieux,
d’autres vont moins bien. Il faut
souligner que la majorité des étu-
des, quel que soit le traitement,
sont mal conduites, hétérogènes,
avec des évaluations tout-à-fait
discutables et que beaucoup reste
à faire.
Pierre Teillac nous a montré diffé-
rents systèmes de santé dans le
monde. La population vieillit par-
tout alors que les côtisants dimi-
nuent en nombre. Récemment, on
a appris que le nombre de méde-
cins allait continuer de chuter
d’une façon importante, de même
que celui des infirmières. Il existe
une augmentation considérable
des urgences et cela pose des pro-
blèmes de fonctionnement des
hôpitaux. En France la consom-
III.
FORUM DE SANTÉ
PUBLIQUE
II. FORUM DU COMITÉ DES
TROUBLES MICTIONNELS
DE L
’HOMME
17
N°4 Decembre 2002
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel du Congrès, AFU 2002 -
Compte-Rendu. Essen
t
i
e
l
du
Cong
r
ès
,
AFU
2002 ..............................
Figur
e 1
Figur
e 2

18
N°4 Decembre 2002
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel du Congrès, AFU 2002 -
Compte-Rendu. Essen
t
i
e
l
du
Cong
r
ès
,
AFU
2002 ..............................
Figur
e 3
Figur
e 4
Figur
e 5
Figur
e 6

mation des médicaments est en
hausse par rapport à tous les au-
tres pays industrialisés du même
type (Figure 7). Il faut s’attendre à
ce que les normes françaises et
européennes soient plus contrai-
gnantes et que l’on soit évalué,
vérifié. Nous savons dans les
hôpitaux en tout cas, combien les
35 heures, le repos de sécurité, la
traçabilité des évaluations sont
des éléments d’inertie, de démoti-
vation actuels. Alors, quelles
recettes envisager : certaines ont
été imaginées mais on ignore cel-
les qui vont s’appliquer. Il est à
peu près certain, qu’il faudra
regrouper les centres de médecins
généralistes pour assurer des
urgences. Pour nous, il faudra
regrouper les urologues entre eux
pour avoir un niveau de compé-
tence technique et humain (l’AFU
en tout cas participe à cet élan).
P e u t - ê t re faut-il aussi déléguer
certains gestes assez reproducti-
bles comme par exemple l’hydro-
cèle vers les infirmières spéciali-
sées. Guy Vallancien, dans son
attitude volontiers provocatrice, a
même dit qu’il était anormal que
certains petits gestes chirurgicaux
soient faits par des urologues plus
aptes à faire des gestes beaucoup
plus difficiles à apprendre.
Le salaire comme la rétribution à
l’acte ne sont pas des bons systè-
mes. Ils ont tous les deux des
inconvénients. Il faut sûrement à
terme envisager quelque chose de
panaché.
La curiethérapie. Les recomman-
dations pour inclure des patients
sous curiethérapie sont en gros
celles de la prostatectomie radica-
le au-delà de soixante ans, propo-
sition faite par notre collègue
espagnol. Pour son équipe de
Barcelone, il ne faut pas traiter
des gens de moins de soixante ans
par la curiethérapie.
Un problème technique : faut il
utiliser une source liée ou source
l i b re pour éviter la migration
connue, rare mais possible. Les
résultats à long terme sont très
peu connus. Il n’y a que deux étu-
des qui donnent un début de
résultats à long terme. Finalement
la promotion fut sutout au niveau
des médias avec des arguments
qui n’étaient pas médicalement
vérifiés. Les résultats réels à long
terme sont mal ou inconnus :
Franck Bladou a une grosse expé-
rience et sur cette diapo qui lui
appartient, plus il s’avance avec
l’expérience, plus il sélectionne
les patients dans un groupe favo-
rable dès le départ au niveau de
l’inclusion (Figure 8). La morbidi-
té existe mais elle est acceptable
par rapport aux autres possibili-
tés thérapeutiques.
Le bicalutamide comme traite-
ment adjuvant : nous attendons
les résultats et il est encore trop
tôt pour conclure. Certes, on cons-
tate que les patients du bras traité
par le bicalutamide, quelque soit
le traitement associé (radiothéra-
pie, chirurgie ou abstention), pré-
sentent moins de risques de pro-
g ression mais il est impossible
d’extrapoler. Il nous faut encore
quelques années et nous sommes
très impatients de connaître ces
résultats.
Le dépistage dans les familles à
risque : plusieurs papiers furent
présentés. Ce dépistage est insuf-
fisamment pratiqué et si l’on veut
être efficace il faut passer, comme
souvent, par le médecin généra-
liste.
La corrélation entre les biopsies
IRM et la pièce de prostatectomie:
elle est mauvaise.
Faut-il faire une anesthésie par la
xylocaïne en injection avant la
biopsie de prostate ? Bernard
Lobel a conclu : si vous l’essayez
vous l’adopterez.
Lorsque les biopsies avant prosta-
tectomie sont normales sur un
lobe, peut on sans aucune arrière-
pensée garder la bandelette ? oui
peut-être. Mais 10% des patients
ont, on le sait, des tumeurs dans
le lobe qui avait été considéré
comme indemne de tumeur.
Le forum de cancérologie a été
bien structuré et passionnant.
P re m i è re notion, les biopsies.
Quel est l’état de l’art ? 10 biop-
sies, 6 doivent être médio-lobaires
et 4 latérales, échoguidées avec
une aiguille 18 gauge (Figure 9).
Chaque biopsie conditionnée à
part pour savoir quelle est la par-
tie envahie? Le malade doit être
informé avant et informé des don-
nées, cela va de soi. Mais il faut
qu’il y ait toujours une traçabilité
et probablement un compte-
rendu détaillé de l’échographie de
la biopsie.
Les rebiopsies, quand faut il les
faire ? (Figure 10) Lorsqu’il y a un
PIN de haut grade, un PSA qui
élevé ou un PSA qui continue sa
progression.
Qu’en est-il du seuil du PSA, du
rapport libre sur total ? Tout le
monde est d’accord pour dire
qu’en-dessous de 10% il faut
biopsier, rebiopsier tout le monde.
V.
FORUM DE
CANCÉROLOGIE
IV
.
CANCER DE LA PROST
A
TE
19
N°4 Decembre 2002
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel du Congrès, AFU 2002 -
Compte-Rendu. Essen
t
i
e
l
du
Cong
r
ès
,
AFU
2002 ..............................

En revanche, le seuil où il ne faut
plus biopsier n’est pas connu, il
faut le mettre très haut. Entre 25
et 10%, tout est possible. Cela n’a
pas été parfaitement validé.
Combien de répétitions de biop-
sies ? Il est probable qu’au-delà de
trois séries de biopsies, il n’y a
plus beaucoup d’intérêt à recom-
mencer. La résection prostatique
semble avoir moins d’indications
que cela a été proposé aupara-
vant.
L’équipe de Caen nous a présenté
une technique qui est abandonnée
par beaucoup et qui donne, sem-
ble-t-il, satisfaction tant au radio-
thérapeute qu’au chirurgien. Elle
associe l’irredium et la radiothé-
rapie externe.
Il y a eu un débat sur l’irradiation
p o s t - o p é r a t o i re. J’ai retenu plu-
sieurs notions (Figure 11).
Premièrement, ce n’est pas parce
qu’une marge est positive que le
patient va évoluer biologique-
ment rapidement.
Deuxièmement, il n’a pas été
prouvé que la radiothérapie sys-
tématique ou de rattrapage chan-
geait la durée de la vie.
Troisièmement, la biopsie prosta-
tique de la zone opératoire ne
change pas la décision qu’elle soit
positive ou négative. Le reste est
plus discutable. Il semble moins
toxique de faire une irradiation
adjuvante que de rattrappage. Il
semble que si l’on décide d’une
irradiation, il faut la pro p o s e r
avant un taux de PSA à un nano-
gramme et il est probablement
inutile d’irradier lorsque les vési-
cules séminales sont envahies ou
le Gleason supérieur à 7 ou le PSA
très élevé. Et bien entendu, le
patient doit être informé de tous
les items précédents.
La curiethérapie interstitielle.
Voiçi les chiffres de la morbidité
(Figure 12).
L’ablatherm: ce sont les résultats
de Lyon sur un nombre élevé avec
une technique qui a évolué. Le
c h i ff re d’impuissance n’est pas
négligeable mais, au début de
l’expérience, les patients étaient
inclus alors que le pro b l è m e
sexuel n’était pas le problème pré-
dominant.
Que faut-il faire lorsqu’on envisa-
ge l’ultrason focalisé de haute fré-
quence ? Respecter bien entendu
les indications et ne pas traiter
n’importe qui. Ce traitement peut
être répété par la même technique
ou par l’adjonction d’autres théra-
peutiques. Les effets secondaires
sont acceptables.
Discussion du groupe français de
laparoscopie : faut-il faire une
voie rétro- ou transpéritonéale ?
C’est une discussion sans fin alors
que les items actuellement sont
connus. Il faut connaître les deux
techniques et savoir adapter en
fonction des avantages et des
inconvénients. La courbe d’ap-
prentissage est terminée, en tout
cas chez les leaders, pourq u o i
continuer cette discussion ? Cela
rappelle les oppositions entre la
voie rétropéritonéale et la voie
transpéritonéale en chirurgie tra-
ditionnelle.
Deux papiers sont à retenir sur
l’évolution des cancers pro s t a-
tiques en échappement : Il ne faut
pas abandonner ces gens qui
échappent à l’androgénosuppre-
sion et une douleur chez un sujet
VII.
HORMONOTHÉRAPIE
VI.
TRAITEMENTS PHYSIQUES
CANCER DE LA PROST
A
TE
20
N°4 Decembre 2002
Essentiel du Congrès, AFU 2002 - Compte-Rendu. Essentiel du Congrès, AFU 2002 -
Compte-Rendu. Essen
t
i
e
l
du
Cong
r
ès
,
AFU
2002 ..............................
Figur
e 7
Figur
e 8
 6
6
 7
7
1
/
7
100%