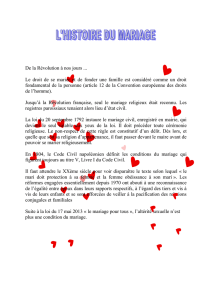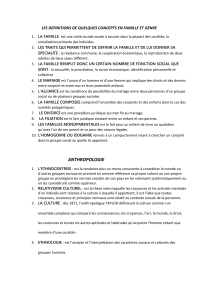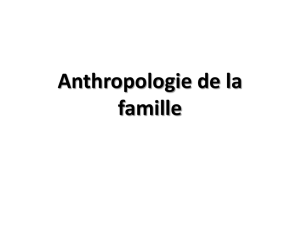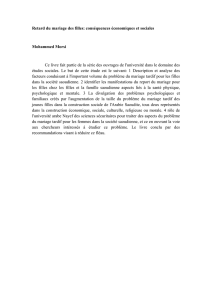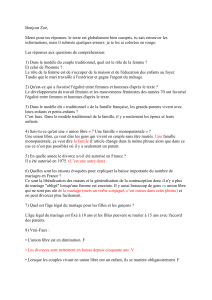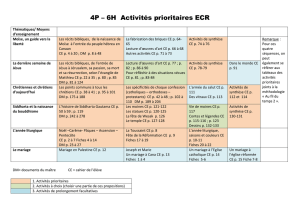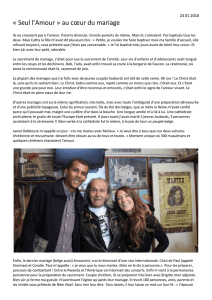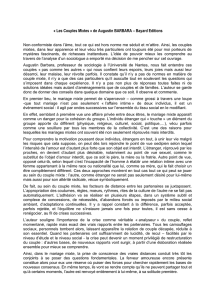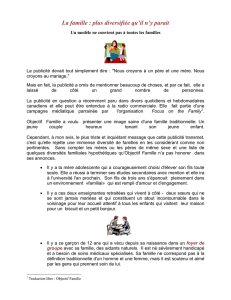Spes Christiana 2006

Spes Christiana 25–26, 2014–2015, 33–58
Mariages mixtes et rite religieux
La position adventiste et autres traditions chrétiennes
Tiziano Rimoldi
Résumé
L’article, après avoir décrit et comparé le droit interne par rapport aux
mariages interconfessionnels au sein de quatre dénominations (catholique,
orthodoxe, vaudoise, adventiste), en essayant de mettre en évidence les
aspects communs, a pour but de voir s’il y a des solutions juridiques que
l’Eglise adventiste pourrait utiliser pour reconsidérer la pratique adventiste,
face aux requêtes des membres, sauvegardant aux même temps les principes
doctrinaux.
Cet article est écrit dans l’optique que l’on appelle « droit comparé des
religions »
1
. Il est écrit du point de vue du juriste qui compare les différents
« droits internes des religions », à savoir « les droits, statuts, règlements et
disciplines élaborés par les Eglises et religions afin d’organiser les confessions
religieuses (statuts des institutions et des activités, place et rôle des ministres et
des membres). Ils relèvent à la fois du droit et de la théologie » (Messner 2003,
86).
La première partie de cet article décrit brièvement le fait que les mariages mixtes
ont toujours été un thème récurrent dans l’Eglise chrétienne. A l’origine, le
problème relevait principalement des mariages entre chrétiens (croyants) et païens
(non-croyants), mais très rapidement le problème s’est étendu aussi aux mariages
avec les hérétiques. Après les schismes du christianisme – et particulièrement
celui déclaré solennellement en 1054 entre catholicisme romain et orthodoxie
byzantine et celui qui a donné naissance à la Réforme protestante,
traditionnellement fixée à 1517 avec les 95 thèses de Martin Luther – le problème
s’est étendu aussi aux mariages entre chrétiens de différentes dénominations.
Les trois paragraphes suivants tentent de décrire les règles de droit interne qui
définissent le mariage mixte et qui en règlent l’acceptation dans trois traditions
religieuses différentes : catholique, orthodoxe et vaudoise. Nous nous limiterons
1
Il s’agit d’une branche du droit qui, en langue italienne, trouve sa veine principale dans la revue
Daimon, annuaire de droit comparé des religions, sous la direction de Silvio Ferrari (Italie), et à
Lugano (Suisse) dans la Faculté de théologie (catholique) de l’Istituto internazionale di diritto
canonico e diritto comparato delle religioni.

Tiziano Rimoldi
34
aux règles seules, sans débattre des questions théologiques sur lesquelles elles
sont basées.
Après cela, un paragraphe sera dédié à la réglementation des mariages mixtes
dans l'Eglise adventiste. En conclusion, la comparaison des règles de différentes
dénominations est faite dans le but d’identifier des éléments qui peuvent être pris
en compte pour reconsidérer les règles et la pratique adventiste en tenant compte
des requêtes des membres et pasteurs concernés.
1. Mariages mixtes dans l’église ancienne
Dès son origine, l’Eglise est confrontée à des problématiques liées aux mariages
entre « pisto,j » (croyant) et « avpisto,j » (non-croyant), basées sur la terminologie
paulinienne de la deuxième lettre aux Corinthiens : « Ne formez pas avec les non-
croyants un attelage disparate … Quelle part, pour le croyant, avec le non-
croyant ? » (2Co 6.14, 15). Ces deux versets, et d’autres encore – comme celui
relatif à la liberté de la veuve de « se marier à qui elle veut ; seulement, que ce
soit dans le Seigneur » (1Co 7.39) – ont été interprétés de manière presque
univoque dans le sens où les mariages avec les non-croyants ne sont pas en
harmonie avec la volonté divine
2
.
Si ce type d’interprétation a été constant, la façon de traiter ces mariages l’a
moins été, alternant entre sévérité majeure et mineure.
En Occident, Tertullien, par exemple, est plutôt sévère, en assimilant le mariage
avec les gentils à l’adultère et au crime
3
. Le Concile d’Elvire (305–306) interdit le
mariage des chrétiens avec les juifs, hérétiques ou païens (cf. Mahfoud 1965, 88).
En Orient, c’est lors du Concile de Laodicée (341) que va apparaître pour la
première fois un canon concernant les mariages mixtes disant que les membres de
l’Eglise devront interdire à leurs enfants d’épouser indifféremment les hérétiques
(can. X)
4
, sauf si ceux-ci promettent de se convertir (can. XXXI) (cf. Mahfoud
1965, 86; Ceccarelli-Morolli 1995, 138). L’utilisation de l’adverbe
« indifféremment » semble illustrer une situation dans laquelle le problème de la
foi devait être fortement considéré dans le choix du futur conjoint, mais il ne
s’agissait pas d’une exclusion insurmontable.
Le Concile de Chalcédoine (451) interdit aux « lectoribus » (lecteurs) et aux
« psalmistis » (psalmistes) d’épouser une femme hérétique et à leurs enfants de se
marier avec des hérétiques, juifs ou païens – sauf dans le cas où ils promettraient
de se convertir à la foi « orthodoxe » –, sous peine de censure canonique (can.
XIV) (cf. Mahfoud 1965, 86; Ceccarelli-Morolli 1995, 139, 140).
2
L’Eglise adventiste partage cette position. Cf. Rodriguez 2007.
3
Cf. Tertullien, Ad uxorem II, 3.
4
Cf. Mahfoud 1965, 86 (pour le texte grec); Ceccarelli-Morolli 1995, 138 (pour le texte latin).

Mariages mixtes et rite religieux
35
Le Concile in Trullo (691) décrète que les mariages entre chrétiens et hérétiques
sont interdits et que, là où ils ont été stipulés, ils sont considérés comme nuls et à
dissoudre, sous peine d’expulsion de la communauté des croyants (can. LXXII)
(Cf. Mahfoud 1965, 86, 87; Ceccarelli-Morolli 1995, 141, 142). En réalité, le
décret ne semble pas avoir été appliqué uniformément dans le sens de la nullité
5
,
dans le monde chrétien occidental comme oriental (cf. Mahfoud 1965, 87),
reconnaissant, au contraire, la constante validité de ces mariages, bien
qu’interdits, et donc illicites (cf. Gaudemet 1989, 49).
S’il existe une préoccupation pastorale envers les dangers liés aux mariages
mixtes, nous pouvons toutefois suggérer que l’Eglise ancienne n’avait pas
envisagé le problème d’un point de vue formel et juridique, en utilisant, au moins
relativement à la célébration des mariages, les lois et coutumes romaines (cf.
Fuchs 1984, 101).
La législation de l’Empire christianisé influence le problème de son propre point
de vue. Par exemple, les empereurs Constantin (339) et Valentinien (388)
décrètent la peine de mort pour les mariages entre chrétiens et juifs (cf. Mahfoud
1965, 86), alors que Justinien, n’interdisant pas le mariage avec les hérétiques,
impose toutefois l’éducation chrétienne des enfants, sous peine de refus des droits
de succession (cf. Gaudemet 1989, 49).
Avec le temps, parallèlement à la juridisation progressive de l’Eglise catholique,
en particulier à partir du pape Alexandre III (1159–1181) (cf. Fantappiè 1999,
123), le droit canonique formalise les empêchements pour disparitas cultus, c’est-
à-dire pour un mariage entre un baptisé dans l’Eglise catholique et un non-baptisé
(c’est-à-dire non-chrétien), et pour mixta religio, dans le cas d’un mariage entre
un baptisé dans l’Eglise catholique et un baptisé dans une autre Eglise chrétienne
(hérétique ou schismatique). Ce dernier empêchement a assumé une signification
particulière pour l’Eglise catholique à partir de la Contre-Réforme du XVIe siècle,
par rapport aux mariages avec les protestants. Les réformés, tout en refusant une
grande partie des empêchements canoniques, reproduisent en revanche un tel
empêchement dans leur propre droit ecclésial en interdisant le mariage avec les
« papistes », sous peine d’exclusion de la sainte Cène pour les époux et de
sanctions disciplinaires pour le ministre la célébrant (cf. Rimoldi 2003a, 54 ;
Rimoldi 2004, 9–11).
Il y a encore et toujours une certaine défaveur envers les mariages mixtes, mais
aujourd’hui la rigueur des normes confessionnelles s’est beaucoup adoucie et, à
partir des années 1960, ces normes on fait l’objet de modifications, soit grâce au
développement des relations œcuméniques et au dialogue interreligieux, soit à
cause de l’élaboration théologique qui s’est développée dans certains endroits
religieux, comme par exemple dans l’Eglise catholique, dans laquelle les
5
Pour une synthèse des commentaires des trois canonistes byzantins du XIIe siècle Balsamon,
Zonaras et Aristenos sur le can. LXXII, voir Coppola 1998.

Tiziano Rimoldi
36
documents produits par le Concile Vatican II ont rendu nécessaire la modification
de la législation canonique
6
.
Les paragraphes qui suivent présentent, avec quelques commentaires sur la
conception du mariage en général, la position de quatre dénominations –
catholique, orthodoxe, vaudois et adventiste – par rapport aux mariages mixtes,
c’est-à-dire entre deux chrétiens qui ne font partie de la même Eglise.
2. L’église catholique
2.1 Le mariage comme sacrement
L’Eglise catholique considère le mariage comme une union ou pacte (foedus) (cf.
Caputo 1984, 247ff.) entre deux êtres humains de sexe différent, une union stable,
et destinée à tous les hommes, pas seulement aux croyants. Selon l’Eglise
catholique, le Christ lui-même a élevé le mariage au rang de sacrement
7
et « c'est
pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne
soit, par le fait même, un sacrement » (can. 1055, § 2).
Le mariage catholique est régi par le droit divin et par le droit canonique
8
,
« restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de
ce même mariage » (can. 1059). Le caractère sacramental attribué au mariage
relève de la revendication du pouvoir de réglementation de l’Eglise soit sur le
mariage en tant qu’acte (matrimonium in fieri), soit sur le mariage en tant que
rapport (matrimonium in facto esse)
9
. Le divorce n’est pas admis, mais les
tribunaux ecclésiastiques peuvent déclarer la nullité du mariage ex tunc, c’est-à-
dire dès son commencement.
6
Pour le droit canonique précédent au Codex du 1983, cf. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei
1966 (Instructio Matrimonii sacramentum); Paul VI 1970 (Motu proprio Matrimonia mixta); Tomko
1971.
7
Catéchisme de l’Église Catholique, § 1601 (Le sacrement du mariage) : « L’alliance matrimoniale,
par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie,
ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des
enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement » ; Code de droit
canonique, can. 1055, § 1 : « L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des
conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le
Christ Seigneur à la dignité de sacrement ».
8
Nous considérerons ici seulement l’Eglise catholique latine et son droit canonique, contenu dans le
Codex Iuris Canonici de 1983. Pour le droit des Eglises catholiques orientales se référer au Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium de 1990.
9
Finocchiaro 1995, 20: « Le caractère sacramentel du mariage défini … par le Concile de Trente
emporte le pouvoir sur le lien. En effet, seule l’Eglise a le ‘divin dépôt’ des sacrements et donc seule
sa suprême autorité a le pouvoir de définir quelles sont les conditions pour leur validité, aussi bien
que l’autorité compétente, suivant le can. 838 3,4 c.i.c., a le pouvoir d’établir ce qui il faut pour une
licite célébration et leur réception (can. 841 c.i.c.) ».

Mariages mixtes et rite religieux
37
Le mariage est interdit aux religieux et à ceux qui reçoivent le sacrement de
l’ordre, sauf pour les diacres ordonnés à un âge avancé qui sont déjà mariés (cf.
Feliciani 1991, 105–108).
Le mariage contracté par deux époux baptisés, l’un catholique et l’autre lié à une
« Église ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec
l'Église catholique » (can. 1124)
10
a le caractère de sacrement (cf. Finocchiaro
1995, 15–16). Ce type de mariage est défini, selon la terminologie catholique, de
mariage mixte
11
et n’inclut pas le mariage avec les infidèles, c’est-à-dire avec les
non-baptisés (can. 1086).
Le mariage mixte, bien qu’il ait nature de sacrement et qu’il soit capable de
produire les mêmes effets sacramentels qu’un mariage contracté par deux fidèles
catholiques, est considéré comme une source de problèmes différents et ultérieurs
de ceux auxquels un ménage « normal » est soumis. C’est pour cela que le
mariage ne peut être célébré (« prohibitum est », can. 1124) sans l’expresse
permission, appelée licence, de l’autorité ecclésiastique compétente
12
. La licence
peut être accordée, généralement par l’ordinaire du lieu, seulement s’il y a une
« cause juste et raisonnable » (can. 1125) et que les conditions requises sont
remplies.
2.2 Les conditions
La première condition est que le parti catholique déclare « qu'il est prêt à écarter
les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible
pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique »
(can. 1125, 1er).
La deuxième condition est que l’époux/se non-catholique soit informé(e) de la
promesse faite par l’époux/se catholique par rapport aux enfants (can. 1125, 2e).
Normalement, la promesse du fiancé catholique doit être documentée par écrit
avec un formulaire signé devant le curé compétent, qui doit à son tour attester que
10
Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1633.
11
Sur l’évolution au travers des siècles de la norme canonique sur l’empêchement de mixta religio
et disparitas cultus, cf. Caputo 1984, 263, 265–267.
12
Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1634: « La différence de confession entre les conjoints ne
constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage, lorsqu’ils parviennent à mettre en commun
ce que chacun d’eux a reçu dans sa communauté, et à apprendre l’un de l’autre de façon dont chacun
vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-
estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n’est pas encore surmontée. Les
époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La
disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la
conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes, peuvent constituer
une source de tensions dans le mariage, principalement à propos de l’éducation des enfants. Une
tentation peut se présenter alors : l’indifférence religieuse ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%