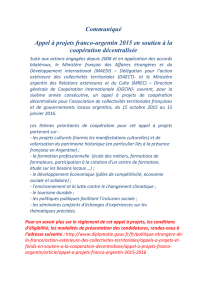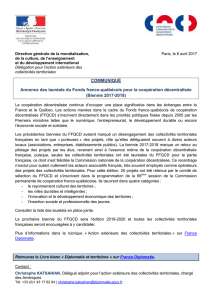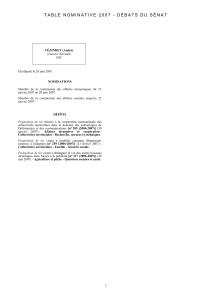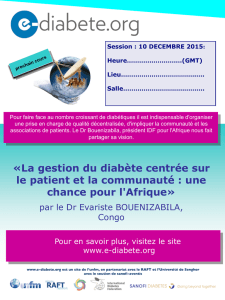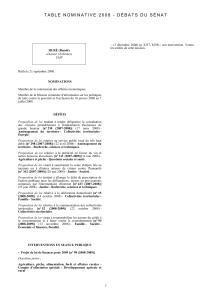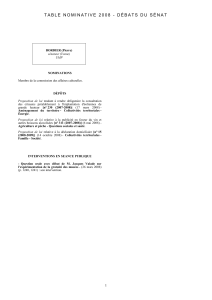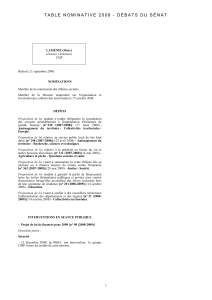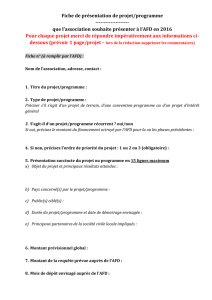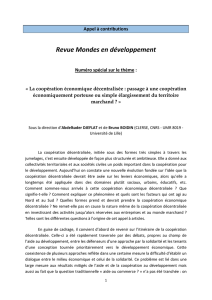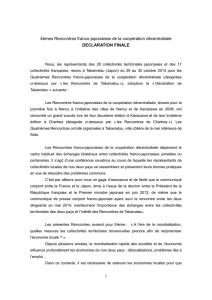La dimension économique du développement durable dans la

SÉMINAIRE
La dimension
économique
du développement
durable dans
la coopération
décentralisée :
un séminaire pour l’exemple
quelles synergies ?
SYNTHÈSE


3
Sommaire
Avant propos ................................................................................................................................................................................ 4
Intervention de M. François SCELLIER,
Président du Comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO),
Député du Val d’Oise
L’efficience et la stratégie ................................................................................................................................................. 6
Quelle valeur ajoutée : interrogations et contraintes ............................................................................ 7
Intervention de M. Bertrand GALLET,
Directeur général, Cités-Unies France
Un séminaire pour l’exemple ........................................................................................................................................ 9
- Extension des zones géographiques et des thématiques ........................................................................ 9
- Changement du cadre de coopération avec recherche de réciprocité ......................................... 10
- Rôle déterminant des collectivités pour le développement
(expertise et coordination) .......................................................................................................................................... 10
- L’impératif de transversalité ....................................................................................................................................... 12
- Enjeux opérationnels du développement économique durable ........................................................ 12
- Connaissance des acteurs et contextes économiques globaux ......................................................... 13
Langage, grammaire et vocabulaire .................................................................................................................... 14
Depuis l’échelle du chemin vicinal vers celle de l’autoroute ........................................................ 15
Intervention de M. Jean-Michel DESPAX,
Délégué pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales
Recommandations ................................................................................................................................................................ 17
Rapporteurs : M. Antoine BAILLOEUL, Président de Lianes Coopération,
M. Philippe SERIZIER, Economiste consultant,
MM. Jean Claude LEVY, Vincent AUREZ et Grégoire JOYEUX, DAECT

4
Avant propos
La dimension économique du développement
durable interroge l’action extérieure des collectivités
territoriales, par exemple sur le climat, l’eau, les dé-
chets, etc., mais elle n’est pas l’apanage des techni-
ciens des différents domaines concernés. Elle relève
d’interrogations et de choix politiques nouveaux et
elle est un levier de la gouvernance des municipalités,
des conseils généraux, des conseils régionaux.
Celle-ci est l’aptitude à mesurer l’effet interactif,
transversal, de chaque choix effectué : l’évidence de
la « transversalité », qui anime l’ensemble des actions
et des projets des collectivités locales, est aujourd’hui
prise en considération par tous les exécutifs.
Or les échanges économiques y occupent une place
cruciale. La mondialisation et de surcroit la crise
économique, aiguisent aujourd’hui d’une façon com-
plexe les interrogations des élus du monde entier,
à propos de la qualité et de l’efficience des investis-
sements locaux. Quelles sont par exemple les réali-
sations les plus aptes à promouvoir la croissance
– notamment des emplois nouveaux – sans toutefois
porter atteinte à la qualité écologique des milieux ?
La mondialisation a enfin bouleversé la relation
entre le « local » et le « global », entre « l’individuel »
au « collectif », entre le « microéconomique » et
le « macroéconomique » et enfin de façon institution-
nelle la relation entre les pouvoirs locaux et les institu-
tions provinciales, nationales et internationales.
C’est pourquoi le CNER (Conseil national des
économies régionales) et CUF (Cités Unies France),
en liaison avec l’AFD (Agence française de déve-
loppement), avec l’appui de la DAECT (Déléga-
tion pour l’action extérieure des collectivités
territoriales), ont organisé ce séminaire « pour
l’exemple », sur la base d’un choix significatif,
d’initiatives locales de coopération décentralisée,
afin d’examiner les enjeux et la valeur ajoutée de
ces initiatives et pour mieux cerner les probléma-
tiques nouvelles qui paraissent s’imposer aux élus
locaux, à leurs institutions, en regard de l’action
plus générale de l’Etat (agences ou départements
ministériels en charge de l’influence et de l’attrac-
tivité du territoire national.
Je suis heureux de vous accueillir à Cergy,
au CEEVO, avec Cités Unies France et le Conseil
national des économies régionales (CNER) et avec
de nombreuses collectivités territoriales et agences
de développement et je vous remercie d’avoir
choisi notre département pour y organiser votre
séminaire sur la dimension économique de la coo-
pération décentralisée.
Le CNER (fédération des agences de développe-
ment et des comités d’expansion économique)
fête cette année ses 60 ans. Il réunit 100 agences,
régionales, départementales et locales, soit un
réseau de 1 500 salariés, sans compter les admi-
nistrateurs bénévoles qui dirigent ces structures.
L’action internationale représente une part signifi-
cative des missions des agences et des comités,
à côté de ce que nous appelons l’endogène, c’est-
à-dire l’appui aux entreprises du territoire. Elle
se décline sous les formes suivantes :
La prospection d’entreprises, la recherche d’investis-
seurs à l’étranger ; l’appui à l’export et à l’interna-
tionalisation des PME ; le soutien au déve loppement
international des clusters des territoires : pôles de
compétitivité, grappes d’entreprises ; l’accompa-
gnement à l’international des universités, grandes
écoles, etc. ; enfin, agences et comités sont égale-
ment impliqués dans les actions de coopération
décentralisée des collectivités de leur territoire.
Le CEEVO mène des actions internationales
depuis sa création, en 1973, ce qui en fait la plus
ancienne des agences de développement écono-
mique de la région Île-de-France : D'abord, en
organisant des « missions exports » et des partici-
pations collectives d'entreprises à l'étranger, pour
leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés
et pour favoriser l'internationalisation de leurs
activités commerciales.
Depuis 20 ans, le CEEVO a ainsi développé ce type
de prestations, en complémentarité avec les opé-
rations menées par les autres membres du réseau
départemental de « l'équipe de France de l'export »,
en Europe, en Afrique, en Amérique, et en Asie.
Intervention de François SCELLIER, Président
du Comité d’expansion économique du Val d’Oise
(CEEVO), Député du Val d’Oise

5
Ensuite, en participant à la demande du Conseil
Général à des opérations de coopération décen-
tralisée, ce qui a été le cas par exemple avec la
Communauté urbaine de Douala, au Cameroun,
et avec la province d'An Giang, au Vietnam. Cela
a été le cas également, en réalisant des missions
techniques, financées par le Ministère de la coo-
pération ou par l'Union Européenne, notamment
au Portugal, en Tchéquie, ou dans les pays du
Maghreb et même au Liban. Il s'agissait, dans la
plupart des cas, d'accompagner des territoires
pour la création d'agences de développement
économique, ou pour la mise en place de nou-
veaux parcs d'activités économiques.
Enfin, le CEEVO a travaillé à l'international pour des
opérations de prospection afin d'inciter des entre-
prises à choisir le Val-d'Oise comme lieu d'implanta-
tion. Dans le cadre de la relation engagée depuis
25 ans entre le Département du Val-d'Oise et la
préfecture d'Osaka, au Japon, le CEEVO a ainsi
favorisé l'implantation dans le département de
nombreuses entreprises japonaises, lesquelles
sont aujourd'hui au nombre d'une soixantaine sur
le territoire de notre département. Depuis 1999,
le CEEVO dispose ainsi d'un bureau de représen-
tation permanente à Osaka, animé par un ancien
cadre du groupe Toyota, Monsieur Seiki Yoneda.
Ce bureau travaille également de façon impor-
tante pour favoriser des échanges universitaires,
et ce sont déjà six établissements d'enseignement
supérieur du Val-d'Oise qui disposent de conven-
tions de coopération avec Osaka.
Une démarche identique a été engagée avec
la Chine, et le CEEVO dispose depuis 2005 d'un
bureau de représentation permanente à Shanghai,
où nous soutenons également les projets des
PME-PMI dans leur approche de ce marché, tout
en favorisant la détection d'entreprises et en
appuyant les coopérations universitaires.
Nous travaillons actuellement à la préparation de
la signature d'une convention de partenariat entre
le conseil général du Val-d'Oise et l'agglomé-
ration de Wuxi, dans le delta du fleuve Yangzi,
à proximité de Shanghai.
Compte tenu de l’importance de nos actions à
l’international, les analyses, les travaux et les
conclusions de votre séminaire nous intéressent
au plus haut point. Nous sommes en effet pris
dans un jeu d’impératifs complexes, parfois
contradictoires, au milieu desquels nous devons
trouver le cap de nos actions futures. Ces impéra-
tifs, vous les connaissez tous : c’est d’abord la ra-
réfaction des ressources publiques et la nécessité,
pour les collectivités, de faire des choix drastiques
sur les actions qu’elles ont à mener ; C’est égale-
ment l’impératif d’ouverture internationale : dans
la situation économique que nous connaissons, le
pire des choix serait celui du repli sur soi, le refus
de l’ouverture au monde pour les entreprises,
pour les universités, pour les collectivités.
Enfin, nous savons tous que notre modèle écono-
mique doit être infléchi dans le sens du dévelop-
pement durable, d’une meilleure utilisation de
nos ressources, d’une réduction des nuisances
que nous faisons subir à l’environnement ; et nous
savons aussi qu’il s’agit là d’une problématique
mondiale. Le programme de votre séminaire se
situe à l’intersection de ces trois impératifs ; vos
travaux doivent contribuer à proposer des solu-
tions nouvelles. Je ne doute pas que vous y par-
veniez car, la décentralisation l’a montré, les
collectivités territoriales savent faire preuve d’ima-
gination, d’innovation, ainsi que de pragmatisme ;
elles sont à la recherche de solutions concrètes,
de formules qui marchent. Je serais personnelle-
ment très intéressé par les propositions auxquelles
vous pourriez aboutir et je souhaiterais donc en
avoir connaissance. Je vous souhaite bon courage
pour ces deux journées.
© D. Richard - AFD
© Marie-Pierre Nicollet - AFD
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%