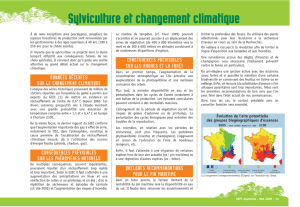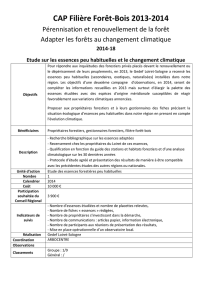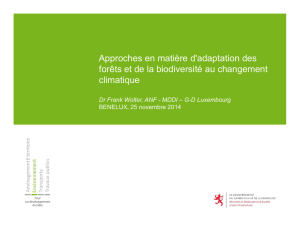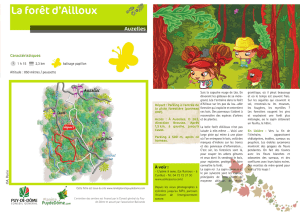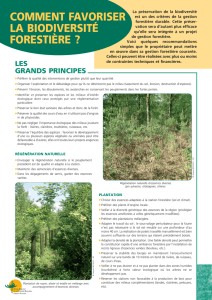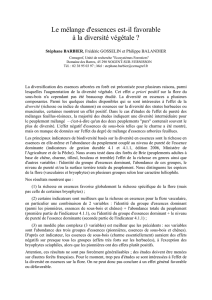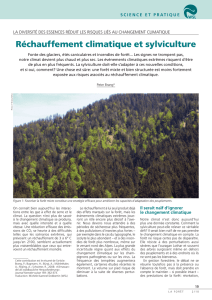Face au réchauffement climatique, faudra-t

Face au réchauffement climatique,
faudra-t-il réhabiliter certains exotiques ?
La conservation desressourcesgénétiqueslocales,desécotypeset autresexpressionsbiolo-
giquesdesparticularitésde telle région, la nécessitédeconsidérerl’arbreen tant qu’essence,
bien sûr,maiségalement en tant quesimple composanted’unécosystème particulièrement
complexe:laforêt… toutescesévidences vont-ellesêtresérieusement bousculéesparlesconsé-
quences,malheureusement trèsplausibles,du réchauffement climatique?
Il est certain queleChêne pédonculé, quireprésentequand même en France quelque 2,4 millions
d’hectares,n’apas toujours étéinstallé ou favorisésur desstationsluiconvenant:desmilliers
d’hectaressont en train de dépérir,aprèslesalertesde 1976,pour ne citerquel’une des
dernièresgrandessécheressesavant cellesde 2003 à 2005;dansla région de Vierzon, dans
celle de Montmorillon (Vienne), lesdégâts sont en cours.
Lesétudesde l’INRA (CentredeNancy), et le colloquedu GIP ECOFOR de décembre 2005àParis
en alargement débattu,annoncent unchangement drastiquedesairesde répartition desprinci-
palesessencesforestièresde notrepays :lePin maritime, réputécoriace sur dessolssecset
filtrants,commence luiaussiàdépérir,dansle Sud-Ouest ;il serafavoriséplus au Nordqu’ac-
tuellement. Le Pin sylvestre, dansle Sud-Est,souffreconsidérablement;le Sapin pectiné, le
Hêtre, l’Épicéa vont devoirentamerdesmigrationsmontagnardes vers desaltitudesplus fraîches
et plus arrosées,du moinsen principe… Bref,avec une bonne marge d’incertitude quant àla
rapiditéet l’intensitédu phénomène, le paysage forestier vachangerextrêmement vitepar
rapport aux échellesde tempsauxquellesnous étionshabitués.
Cela veut direquenossylvicultures vont devoirévoluer,réagir,presquedansl’urgence.Mais
quelsconseilsdonner(et quelsmoyens)aux propriétaires,confrontésàcettenouvelle et inquié-
tantedonne climatiqueet économique?Si l’on veut conserver,ou créer,desforêts dont l’ob-
jectif principal est bien de produiredu boisdont on connaît lesformidablesavantages
écologiques,sansdoute va-t-il falloirreconsidérerla question desexotiques,du moinsde
certainsd’entreeux. Si l’Eucalyptus n’est passouhaitable en raison de sesgravesinconvénients
sur le plan de la biodiversité, le Cèdre, parexemple, serasansdoute utile pour desmilliers
d’hectaresde terrainssecs,calcaires,où Pinset Chênesne pourront plus constituerdespeuple-
ments économiquement “soutenables”. Bien entendu,ils’agiraalors de raisonnerleslocalisa-
tions:leshabitats rareset lesespècesmenacées,quisouvent en dépendent,devront être
sauvegardés.
Bien entendu également,laprioritéabsoluedevraêtreaccordée àl’utilisation desautresessences,
naturellement présentes;mais toutesne pourront passeprêterà une sylviculture véritable.
Si le Sapin pectiné doit disparaîtredemaints espaces,silePin sylvestrenepeut plus résister,
çà et là, simême lesmagnifiqueshêtraies-sapinières,symboless’il en est de la forêt irrégulière,
abondantesen forme de vies variées,bien adaptéesaux reliefs,sont menacéesdansleurs terres
de prédilection, ne sera-t-on pasobligé, bon grémal gré, d’envisagerd’introduire, avec précau-
tion, d’autresessencesjusqu’alors en disgrâce, Sapin de Céphalonie ou autres?Ou d’installer
desessencesindigènes,maisméditerranéennes,dansle Centreou le Sud-Ouest, voirel’Ouest ?
Rev. For. Fr. LVII - 6-2005551
LIBRE EXPRESSION

Bien entendu,l’emploi élargi de cesmal-aimésdesnaturalistes,dont on peut parfaitement
comprendreet même partagerlesréticences,nedoit passefaireavec lesmêmeserreurs que
parle passé:iln’est plus question de créerou recréerde grandesmonocultures,maisde
constituerou reconstituerdesforêts mixtes,mélangées:sil’essence ou lesessencesprincipales
de production sont unou desexotiques,imposésen quelquesortepar unclimat dont nous ne
pouvonsmaîtriserlesexcèsànotreniveau,lesessences tellesquelesChênespubescents, verts,
kermès, toutesles“secondaires” non directement productivesen termesde bois,maisl’étant,
parcontre, en termesde biodiversité, d’amélioration de l’humus,de variétédespaysageset des
ambiances,devront êtresystématiquement conservées,ou,ellesaussi, introduitesdansces
nouvellesforêts :ils’agit bien de faire une sylviculturedemm ii ll ii ee uu
,
non de pp rr oo dd uu ii tt.
Ne pourrait-on espérer,ceci dit,quecertainesde nosessencesindigènes,spontanées,parles
jeux mystérieux et savants de l’évolution génétique, évoluent suffisamment rapidement pour,
d’elles-mêmes,s’adapteraux nouveaux climats ?C’est une hypothèseavancée parcertains,opti-
mistes;considérée comme peu probable, pard’autres,enraison de l’extrême rapiditédeschan-
gements en cause.
L’État asansdoutelesmoyens,et le temps,delaisserde grandessuperficiesde forêt doma-
niale évoluerspontanément,et d’en tirerlesconclusionsscientifiqueset sylvicoles,dansce qui
devient alors un“laboratoire”àciel ouvert. C’est même hautement souhaitable, et l’on connaît
l’extraordinaire valeur biologiquedesgrandesréservesintégrales,insuffisantesen nombreet
surface unitaire;maislespropriétairesprivésn’en ont pasla possibilité, quand bien même en
auraient-ilsla volonté.
Le débat,sain et normal, entrearbresexotiques,indigènes,acclimatés, vase trouver,sansnul
doute, revivifié parle contexted’unhorizon climatiquepour le moinsdéboussolant. Ànous de
ne pasperdrelenord… et de savoirécouter,convaincre, sansselancerdansdesaventuressylvi-
coleshasardeusesou mal conçues. L’écologie, le respect desmilieux associés,leprincipe de
précaution sont desatouts majeurs pour le forestier. La nécessitééconomique, sescontraintes,
doivent être tout autant expliquées.
La sylviculturededemain devraêtreàlafoisdynamiqueet douce, intégrée, n’oubliant jamais
où elle s’exerce, c’est-à-diresur l’écosystème.Maislesdéfenseurs de ce dernierdoivent aussi
intégrerl’ensemble desobjectifsfinaux de cettesylvicultureet lesobligationsdespropriétaires,
quisont de gérer unbien d’une manièreaussiefficace quepossible.Recommanderl’élimination
du sous-étage au nom de la concurrence en eau,pour certainspeuplements,dansl’avenir;envi-
sagersous-solageset labours profondsen pleine forêt,semblent releverde l’erreur écologique
majeure;maisrejeterabsolument,en tous lieux,l’emploi d’exotiques,ou d’essencesen dehors
de leur airejusqu’alors connuederépartition, danslescirconstancesquenous commençonsà
connaître, c’est-à-direpour répondreaux dépérissements en tous genresdus aux sécheresseset
aux canicules,peut releverégalement d’une erreur de principe.
Lesmenacessérieusespesant sur nosforêts et nosbois vont-ellespermettrederelier,deréunir
autour d’unmême objectif, scientifiques,gestionnaires,défenseurs de la nature, sansnaïveténi
coupsde force ?
552 Rev. For. Fr. LVII - 6-2005
A LAIN P ERSUY
Alain PERSUY*
Technicien supérieur forestier
*Auteur du
Guide de la forêt en Poitou-Charenteset Vendée
.—
La Crèche :GesteÉditions, 2003.
1
/
2
100%