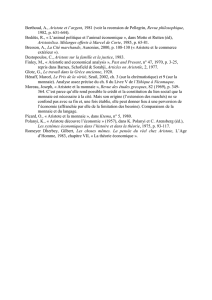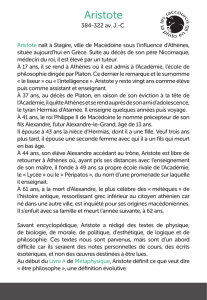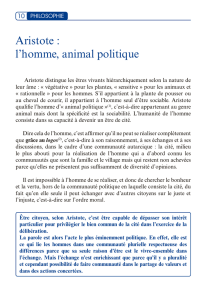Audet_Jean-Nicholas_2011_memoire - Papyrus

Université de Montréal
La recherche de l’autosuffisance chez Aristote
La rencontre entre l’éthique et la politique
par
Jean-Nicholas Audet
Département de philosophie
Faculté des Arts et des Sciences
Mémoire présenté à la Faculté des Arts et des Sciences
en vue de l’obtention du grade de maître ès art (M.A.)
en philosophie
option recherche
Août 2010
© Jean-Nicholas Audet, 2010

ii
Université de Montréal
Faculté des Arts et des Sciences
Ce mémoire intitulé :
La recherche de l’autosuffisance chez Aristote
La rencontre entre l’éthique et la politique
présenté par :
Jean-Nicholas Audet
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
M. David Piché
président-rapporteur
M . Louis-André Dorion
directeur de recherche
M. Richard Bodéüs
membre du jury

Résumé
Ce mémoire vise à mieux comprendre l'utilisation du concept d'autarcie à l'oeuvre
dans les écrits d'Aristote et, ce faisant, à nous amener à une meilleure compréhension du
lien entre l'éthique et la politique dans la pensée aristotélicienne. Pour ce faire, nous
commençons tout d'abord par distinguer deux types d'autarcie, à savoir ce que nous
appellerons dans la suite l'autarcie divine et l'autarcie humaine. L'autarcie divine doit être
comprise comme le fait de se suffire pleinement à soi-même de la manière la plus
rigoureuse qui soit et cette autarcie n'est, à proprement parler, attribuable qu'au divin.
L'autarcie humaine, quant à elle, est celle qui est à l'oeuvre dans la définition que donne
Aristote de la cité, à savoir qu'elle est un regroupement autarcique de personnes visant à
vivre et à bien vivre. Par la suite, nous montrons que la pratique de la philosophie, qui est
décrite comme une pratique autarcique en EN, X, est difficilement conciliable avec les
activités de la cité et la constitution d'une communauté politique. En effet, comme c'est le
besoin qui doit jouer le rôle de ciment de la cité, il est difficile de voir comment la
philosophie peut s'insérer dans le cadre étatique de la cité, étant donné qu'elle n'est d'aucune
utilité et qu'elle est recherchée pour elle-même. Toutefois, puisqu'Aristote ne présente
jamais la cohabitation de la philosophie avec les autres activités de la cité comme
problématique, nous tentons de voir comment il est possible de concilier la pratique de la
philosophie avec la nécessité pour l'individu de vivre en cité. C'est en examinant la notion
de loisir que nous en venons à conclure que la philosophie doit y être reléguée afin de
pouvoir être pratiquée. C'est aussi en associant la philosophie au loisir et en étudiant le rôle
que celui-ci doit jouer au sein de la cité que nous sommes en mesure de voir se dessiner le
lien entre l'éthique et la politique.
Mots-clés : Aristote, autarcie, autosuffisance, éthique, politique, loisir

Abstract
This dissertation tries to gain a better understanding of the concept of autarkeia
which is present in the writings of Aristotle. Doing this, we are also able to get a clearer
idea of the link between ethics and politics in the aristotelian thought. In order to achieve
this, we start by distinguishing two types of self-sufficiency : the divine self-sufficiency and
the human self-sufficiency. The divine self-sufficiency is to be understood as the fact of
being fully self-sufficient in the most rigorous way. Strictly speaking, it is only the divine
that can be granted of such a self-sufficiency. On the other hand, the human self-sufficiency
is the one effective in the aristotelian definition of the polis, which is the self-sufficient
grouping of persons aiming at living and good living. After that, we show that the practice
of philosophy, which is described as a self-sufficient activity in NE, X, is hardly possible as
an activity of the polis and cannot participate in bringing a polis to life. This is founded in
the fact that for Aristotle, it is the needs that keep people together, united in a polis, and
considering that, it is difficult to see how philosophy could be part of this, because it is
totally useless and searched for itself. However, we try to see how it would be possible to
conciliate the practice of philosophy with the necessity for a human to live in a polis,
because Aristotle never speaks of it as being problematic. The answer of this so-called
problem is to be found in the notion of leisure, by relegating philosophy to this part of a
human life in order for it to be practiced. It is also by associating philosophy and leisure
that we can draw the link between ethics and politics.
Keywords : Aristotle, autarkeia, self-sufficiency, ethics, politics, leisure

Table des matières
0. Introduction.........................................................................................................................1
1. Autarcie divine et autarcie humaine....................................................................................6
1,1 Autarcie divine.............................................................................................................. 7
1,2 Activité du dieu et activité du sage............................................................................... 9
1,3 La θεωρία n’est pas l'office de l’homme.....................................................................17
1,4 La vertu morale et la sagacité constituent l'office de l’homme...................................29
1,5 L’autarcie humaine...................................................................................................... 37
1,6 La cité comprise par l'analogie du tout organique.......................................................43
2. Incompatibilité entre autarcie divine et autarcie humaine................................................53
2,1 L'amitié politique........................................................................................................ 53
2,2 L'incompatibilité entre l'amitié politique et la philosophie.........................................57
2,2,1 L'inutilité de la philosophie..................................................................................57
2,2,2 L'incommensurabilité de la philosophie...............................................................60
2,2,3 L'essence de la philosophie.................................................................................. 66
2,3 L'amitié politique et la définition de la cité.................................................................69
2,4 L'ami philosophe......................................................................................................... 74
3. Philosophie, loisir et politique...........................................................................................78
3,1 Incompatibilité entre vie libre et travail utile..............................................................78
3,1,1 Le caractère avilissant des activités nécessaires..................................................79
3,1,2 Les activités nécessaires empêchent le loisir....................................................... 84
3,2 Vie totale et vie partielle..............................................................................................90
3,3 Éducation, loisir et limite du politique........................................................................98
4. Conclusion.......................................................................................................................112
Bibliographie.......................................................................................................................117
Textes et traductions .......................................................................................................117
Études.............................................................................................................................. 118
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%