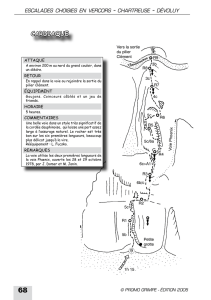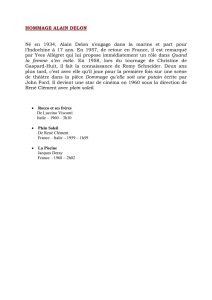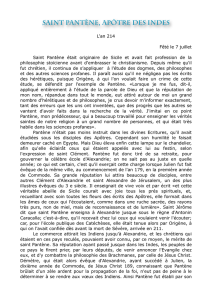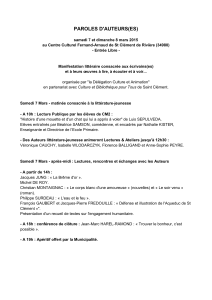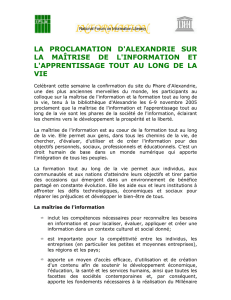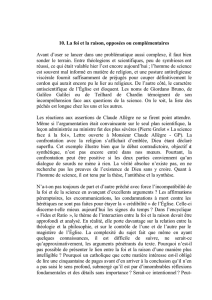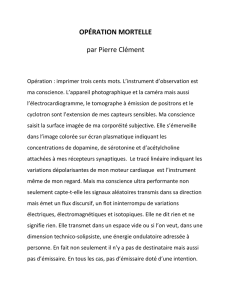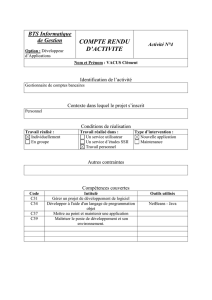clément d`alexandrie - L`Histoire antique des pays et des hommes

CLÉMENT D’ALEXANDRIE
COURS D’ÉLOQUENCE SACRÉE FAIT À LA SORBONNE PENDANT
L’ANNÉE 1864-1865
PAR MONSEIGNEUR FREPPEL, ÉVÊQUE D’ANGERS.
1873

PREMIÈRE LEÇON
Coup d’oeil général sur l’école chrétienne d’Alexandrie. - Rôle qu’elle a joué dans cet
espace de temps qui sépare les Pères apostoliques des orateurs et des théologiens du
IVe siècle.- L’école d’Alexandrie a pour mission d’établir les rapports de la science et de
la foi, de montrer l’accord de fa religion avec la vraie philosophie. - Influence du génie
des races sur les productions de la science et de l’art. - En quoi les Alexandrins diffèrent
des écrivains de l’Asie Mineure et des théologiens de l’Église d’Afrique. - Comment
Alexandrie était devenue l’un des centres principaux du mouvement scientifique et
littéraire dans le vieux monde. - Difficultés que rencontrera sur son chemin t’école
chrétienne d’Alexandrie en voulant opposer la véritable science de la obi à la fausse
gnose. - Action salutaire de l’Église de Rome au milieu du travail des esprits qui se
manifeste dans les Églises de l’Asie Mineure, dans l’Église d’Afrique et clans celle
d’Alexandrie
DEUXIÈME LEÇON
Origines de l’Église d’Alexandrie. - Mission de l’évangéliste saint Marc dans la capitale de
l’Égypte. - Races diverses qui se mélangeaient dans cette partie de l’empire. - Les
Égyptiens ; la colonie grecque ; les Juifs. - Établissement des Israélites à Alexandrie. -
Caractère particulier à la colonie juive fixée dans cette ville. - Persécution qu’elle venait
de subir à l’arrivée de saint Marc. - Elle fournit à l’évangéliste un premier noyau de
fidèles. - Les thérapeutes de Philon étaient-ils chrétiens ou Juifs ? - Commencements du
Didascalée.- Dans quel sens peut-on attribuer à saint Marc la fondation de l’école
catéchétique d’Alexandrie ? - Deux périodes bien distinctes dans l’histoire de cette
institution. - Causes qui ont imprimé à l’école primitive des catéchumènes une direction
scientifique
TROISIÈME LEÇON
Premiers maîtres de l’école d’Alexandrie. - Liens qui rattachent Athénagore à cette
institution. - Saint Pantène. - Sa vie et son enseignement. - Organisation du Didascalée à
l’époque où Clément succède à Pantène, son maître, dans la direction de l’école. -
Classification des écrits de Clément d’Alexandrie. - Œuvres perdues. - Trilogie dans
laquelle se résume l’activité théologique et littéraire de Clément. - Marche à suivre pour
l’étude de ses ouvrages. - Raisons que donne Benoît XIV pour justifier l’omission du nom
de Clément dans le martyrologe romain
QUATRIÈME LEÇON
La synthèse théologique de Clément. - Premier écrit : L’Exhortation aux Grecs. - Le chef
du Didascalée cherche d’abord à détacher les gentils des erreurs et des vices du
paganisme. - Préambule de la pièce. - Pour amener les païens à l’Évangile, Clément luise
à pleines mains dans les trésors de la littérature ancienne. - Couleur poétique du
morceau. - Après avoir pressé les Grecs d’accourir à l’école du Verbe fait chair, Clément
se tourne vers le polythéisme dont il démontre la fausseté. - Critique des religions
anciennes. - Vaste érudition de Clément dans cette partie de ses oeuvres. - Appréciation
de ses vues sur le caractère et les différentes formes du polythéisme

CINQUIÈME LEÇON
Conclusion de l’examen critique des religions anciennes. - Du polythéisme vulgaire,
Clément passe à l’enseignement des écoles philosophiques. - Trois classes de
philosophes. - Les matérialistes ; les semi-matérialistes et les spiritualistes. - Jugement
de Clément sur Platon et sur sa philosophie. - Mérite et défaut de cette appréciation. -
Comment une thèse extrême en appelle une autre. - Clément soutient que les
philosophes grecs ont pillé les livres saints. - Il prétend retrouver des emprunts
analogues chez les principaux poètes de l’antiquité païenne. - Discussion des textes sur
lesquels il appuie son sentiment. - L’école juive d’Alexandrie l’a induit en erreur sur ce
point, par la fabrication d’écrits apocryphes sous le nom des poètes grecs. - Le
monothéisme dans l’antiquité païenne
SIXIÈME LEÇON
Théorie de Clément sur les emprunts faits par la philosophie grecque aux livres de
l’Ancien Testament, - Raisons qu’il allègue pour motiver son opinion. - L’antériorité des
livres saints. - Les communications des philosophes grecs avec l’Orient. - Les emprunts
qu’ils se sont faits réciproquement. - Les ressemblances qu’on observe entre leurs écrits
et ceux des prophètes. - Examen de ces divers ordres de preuves. - Limites dans
lesquelles Clément aurait dei se renfermer pour déterminer l’influence de l’enseignement
traditionnel sur la philosophie grecque. - Tout en faisant la part trop large à l’élément
traditionnel dans la philosophie grecque Clément n’en reconnaît pas moins à la raison le
pouvoir de s’élever par elle même à certaines vérités de l’ordre naturel. - Analyse des
textes qui prouvent qu’il a tenu compte du travail de la réflexion en indiquant les sources
des connaissances religieuses et morales de l’antiquité païenne. - Comme saint Justin,
son devancier, Clément d’Alexandrie, n’est ni rationaliste ni traditionaliste
SEPTIÈME LEÇON
Rôle de la philosophie grecque par rapport au christianisme. - Répulsion excessive de
quelques esprits pour les spéculations helléniques. - Clément combat vivement cette
tendance. - Il distingue entre la sophistique et la philosophie, pour condamner l’une et
défendre l’autre. - Dans le plan de la Providence, la philosophie grecque devait servir
d’introduction au christianisme et préparer les gentils au règne universel de la vérité sur
la terre. - Développements que l’auteur donne à cette belle pensée. - Ses vues sur
l’histoire religieuse du genre humain avant le Christ. - Comment il envisage la question
du salut des païens. - Théorie singulière de Clément sur le but et les conséquences de la
descente de Jésus-Christ aux enfers - Dans quel sens on doit interpréter la maxime : en
dehors de l’Église il n’y a pas de salut
HUITIÈME LEÇON
Le traité du Pédagogue. - Après avoir détaché les païens des erreurs de leur passé,
Clément veut les initier à la vie de la foi par l’action salutaire de la discipline évangélique.
- La catéchèse ou l’instruction morale succédait, dans l’enseignement du Didascalée, à la
critique des religions et des systèmes philosophiques du monde païen.- Le Verbe,
précepteur de l’humanité. - Comment l’éducation du chrétien se fait dans l’Église, qui est
la famille spirituelle du Verbe incarné. - Belle poésie de langage dans le premier livre du
Pédagogue. - L’Église mère et vierge tout ensemble. - Elle nourrit les chrétiens du lait de
la doctrine, et développe en eux la vie surnaturelle par le moyen des sacrements - Le
premier livre du Pédagogue est l’une des productions les plus originales de l’éloquence
chrétienne

NEUVIÈME LEÇON
IIe et IIIe livre du Pédagogue. - Clément veut régler la vie des néophytes jusque dans les
moindres détails. - Comment il s’approprie les formules stoïciennes qu’il corrige et
dépouille de leur exagération. - La vie raisonnable en regard de la vie sensuelle. - Les
rapports de l’âme et du corps, au point de vue de la moralité humaine. - La question des
aliments. - Spiritualisme élevé qui éclate dans ces pages où Clément passe en revue les
différents actes de la vie commune et ordinaire. - Critique du luxe de l’époque - En quoi
consiste la véritable beauté. - Pourquoi les moralistes chrétiens tonnaient avec tant de
force contre l’abus des jouissances matérielles. - L’Église a posé de tout temps les
principes et indiqué les éléments essentiels du vrai progrès et de la vraie civilisation
DIXIÈME LEÇON
Opuscule sur le Salut des riches. - Deux extrêmes à éviter dans la question des rapports
du riche avec le pauvre. - Interprétation des paroles du Sauveur sur la difficulté du salut
des riches. - Définition de la richesse comprise et entendue dans le sens chrétien. - Du
véritable usage des biens de la terre. - La thèse de Clément n’a rien qui puisse porter
atteinte au droit de propriété. - Idéal que le christianisme tend à réaliser sur la terre,
autant que le permettent l’orgueil et les passions humaines
ONZIÈME LEÇON
Suite de l’opuscule intitulé Quel riche sera sauvé. - Doctrine de Clément sur la nécessité
des bonnes oeuvres pour le salut. - L’action divine et la coopération humaine dans
l’œuvre de la sanctification. - Sacrifices que demande l’Évangile en vue de la vie
éternelle. - Comment l’auteur interprète les textes sacrés qui formulent cette obligation.
- Les devoirs de famille et les droits de Dieu. - Une parabole de, l’Évangile expliquée par
Clément. - Origines de l’homélie et du sermon. - Développement de ces deux formes de
l’éloquence sacrée dans les trois premiers siècles de l’Église
DOUZIÈME LEÇON
Prière qui termine le traité du Pédagogue. - Doctrine de Clément sur la consubstantialité
du Verbe. - L’Hymne au Christ Sauveur. - Origines de la poésie chrétienne. - La première
forme de la poésie chrétienne a dû être la forme lyrique, l’hymne ou le chant sacré. - Le
lyrisme chrétien dans saint Paul. - La poésie religieuse, auxiliaire de l’éloquence sacrée. -
Rythme particulier à l’Hymne au Christ. - Beautés poétiques de cette pièce. - Épître
dédicatoire au Verbe. - Caractère et mérite de cette deuxième composition. - Clément
d’Alexandrie envisagé comme poète
TREIZIÈME LEÇON
Les Stromates, complément de l’Exhortation aux Grecs et du Pédagogue. - Idée et plan
de l’ouvrage. - Comment l’auteur justifie la forme qu’il a cru devoir lui donner. - Les
Stromates comparées aux Pensées de Pascal. Puissante originalité de cette esquisse de
philosophie chrétienne. - Analyse des sept livres dont se composent les Stromates. -
Style de l’ouvrage. - Terminologie singulière qu’emploie l’auteur en divers endroits

QUATORZIÈME LEÇON
La question des rapports de la foi avec la science, point capital des Stromates. -
Définition de la foi. - Analyse de l’acte de foi.- Principe de la foi. - La foi, résultat d’une
illumination et d’une impulsion divines. - La foi, acte de l’intelligence q ni adhère à la
vérité, et de Li volonté qui détermine cette adhésion. - Motif suprême de la foi, la
véracité divine. - L’Église, canal par lequel la révélation nous arrive pure et intacte -
Objet de la foi : les vérités divinement révélées. - Le propre de ces vérités, c’est de
s’appuyer sur l’autorité divine et non sur des preuves intrinsèques. - Comment les vérités
de l’ordre naturel peuvent être comprises dans l’objet de la foi. - Sources de la foi :
l’Écriture sainte et la Tradition. - Doctrine de Clément sur l’inspiration des livres saints. -
Pour interpréter l’Écriture dans son véritable sens, il faut consulter la tradition vivante et
orale de l’Église. - L’Église catholique et les sectes. - Résumé de cet enseignement
QUINZIÈME LEÇON
La question de la science, parallèle à celle de la foi. - Maxime fonda mentale de Clément
: il n’y a pas plus de foi sans science qu’il n’y a de science sans foi. - La foi peut devenir
savante, mais à condition que la science restera fidèle - Les sciences humaines dans
leurs rapports avec la théologie. - Rôle et importance de la philosophie. - L’enseignement
de la philosophie dans l’école d’Alexandrie. - Fragment des Hypotyposes. - Ce traité de
logique est une imitation des couvres analogues d’Aristote - La psychologie et la
métaphysique dans l’école d’Alexandrie. - L’éclectisme de Clément. - Dans quel sens et
pour quelle fin l’auteur des Stromates emploie la méthode éclectique
SEIZIÈME LEÇON
Les sciences humaines sont autant de degrés d’ascension vers Dieu. - Rôle des autres
sciences par rapport à la philosophie, et rôle de la philosophie relativement a la
théologie. - Les sciences naturelles viennent aboutir à la philosophie comme à leur centre
commun - La philosophie trouve à son tour dans la théologie son faite et son
couronnement. - Subordination de la philosophie à la théologie. - La certitude des vérités
de la foi est plus haute que la certitude résultant des démonstrations rationnelles. -
L’objet de la révélation est plus élevé que celui des connaissances purement humaines.
Cette subordination des sciences humaines à la théologie n’empêche pas chacune d’elles
d’avoir sa sphère propre, ses lois, sa méthode, ses attributions. - Vraie et fausse liberté
de la science. - Les sciences groupées autour de la foi aux trois époques les plus
remarquables de l’histoire des peuples chrétiens
DIX-SEPTIÈME LEÇON
Théorie de Clément sur la science des Écritures et sur les différentes méthodes
d’interprétation qu’on peut leur appliquer. - Son érudition biblique. - Valeur de son
témoignage pour l’authenticité de l’Ancien et du Nouveau Testament. - Dans quel sens et
pour quelle fin il cite parfois clos écrits apocryphes. - Clément use d’une assez grande
liberté dans la reproduction du texte sacré. - Prédilection trop marquée pour le sens
allégorique. - Idées de Clément concernant le symbolisme. - Influence de Philon et de
l’école juive d’Alexandrie sur Clément pour l’interprétation allégorique des livres saints. -
Le Décalogue expliqué dans le sens mystique. - Abus de cette méthode
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
1
/
233
100%