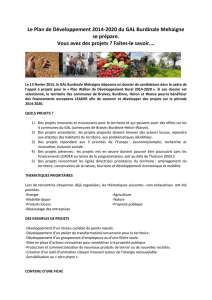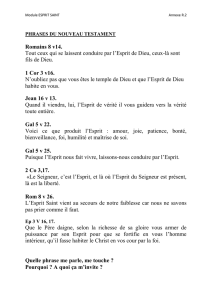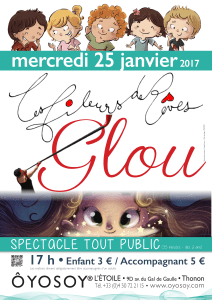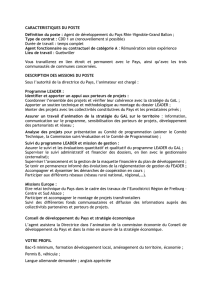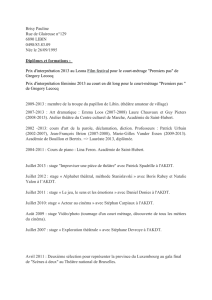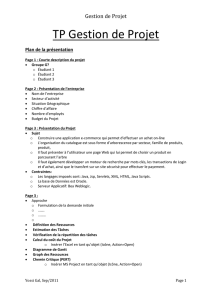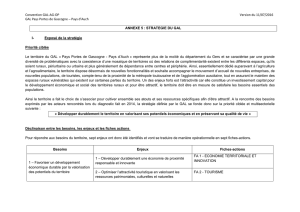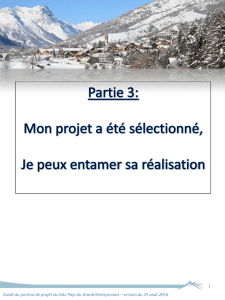3. Le diagnostic évolutif - racines



Etude paysagère « Racines et ressources » - diagnostic évaluatif
Décembre2010
-
3
-
T
ABLE DES MATIERES
1.
INTRODUCTION ............................................................................................................. 4
2.
EVOLUTION GENERALE DU TERRITOIRE JUSQU’AU 18
EME
SIECLE ...................... 5
2.1.
E
VOLUTION GENERALE
............................................................................................... 5
2.2.
E
VOLUTION HISTORIQUE DE CHAQUE COMMUNE ACTUELLE JUSQU
’
AU
18
EME
SIECLE
... 7
2.2.1
Tellin .................................................................................................................... 7
2.2.2
Saint-Hubert........................................................................................................ 7
2.2.3
Libin..................................................................................................................... 8
2.2.4
Bertrix.................................................................................................................. 8
2.2.5
Herbeumont ....................................................................................................... 8
3.
EVOLUTION DU 18
EME
SIECLE A NOS JOURS ............................................................ 9
3.1.
C
ADRE GENERAL
........................................................................................................ 9
3.2.
E
VOLUTION DE LA
F
AMENNE
.................................................................................... 11
3.2.1
18
ème
siècle .......................................................................................................11
3.2.2
19
ème
siècle .......................................................................................................11
3.2.3
Du 20
ème
siècle à nos jours .............................................................................12
3.3.
E
VOLUTION DE L
’A
RDENNE
...................................................................................... 14
3.3.1
18
ème
siècle .......................................................................................................14
3.3.2
19
ème
siècle .......................................................................................................14
3.3.3
Du 20
ème
siècle à nos jours .............................................................................15
4.
EVOLUTION DE L’AGRICULTURE A LA FIN DU 20
EME
SIECLE ET AU DEBUT DU
21
EME
SIECLE ....................................................................................................................................... 18
5.
EVOLUTION DU BATI A LA FIN DU 20
EME
SIECLE SUR LE TERRITOIRE DU GAL 23
5.1.
S
UPERFICIE URBANISEE
............................................................................................. 23
5.2.
T
YPE DE LOGEMENT
................................................................................................. 24
5.3.
T
AILLE DES TERRAINS
À
BATIR
................................................................................... 25
5.4.
I
MPLANTATION DES BATIMENTS ET DEVELOPPEMENT DES VILLAGES
.......................... 26
6.
IMPLANTATION DES GRANDES INFRASTRUCTURES............................................28
6.1.
S
CHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L
’
ESPACE RÉGIONALE
(SDER) ............................. 29
6.2.
L
E RÉSEAU ROUTIER
.................................................................................................. 30
6.3.
L
E RÉSEAU FERROVIAIRE
........................................................................................... 31
6.4.
L
ES PYLÔNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LE TRANSPORT D
’
ÉNERGIE
...................... 33
6.5.
L
ES BASES MILITAIRES ET AÉRODROMES ET LES EOLIENNES
....................................... 34
7.
EVOLUTION DES FONDS DE VALLEES ....................................................................35
8.
EVOLUTIONS PREVISIBLES ........................................................................................36
8.1.
A
PPROCHE GENERALE
.............................................................................................. 36
8.2.
A
PPROCHE DETAILLEE PAR COMMUNE
...................................................................... 36
8.2.1
Commune de Tellin......................................................................................... 37
8.2.2
Commune de Saint-Hubert ............................................................................38
8.2.3
Commune de Libin..........................................................................................40
8.2.4
Commune de Bertrix.......................................................................................42
8.2.5
Commune de Herbeumont ............................................................................45
9.
CONCLUSION............................................................................................................... 47
10.
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................ 48

Diagnostic évolutif
Décembre 2010
4
1.
INTRODUCTION
Une première analyse du territoire du GAL « Racines et ressources » et de ses
paysages a permis de mettre en évidence les grandes entités paysagères et les éléments qui
les composent.
Une analyse de l'évolution des paysages est indispensable, à ce stade, pour
comprendre les mécanismes de l'évolution du territoire et pour déterminer les paysages
patrimoniaux, ou paysages témoins, c'est-à-dire, ceux qui expriment l'évolution des lieux.
Cette analyse se base sur des documents écrits et cartographiques (cartes de
Ferraris, de l'Institut Cartographique Militaire ou de l'Institut Géographique National). Grâce
à ces cartes, pour chaque territoire paysager identifié, il est possible de retracer l'évolution
du paysage et de déterminer les facteurs de cette évolution.
L'influence de quatre facteurs sur l'évolution des territoires paysagers depuis les
années '80 est ensuite réalisée (agriculture, bâti, infrastructures de transport et autres). Elle
permet de vérifier l'impact sur le paysage de l'évolution de l'agriculture, de l'habitat, des
grandes infrastructures et du changement dans les modes de gestion de certains milieux.

Diagnostic évolutif
Décembre 2010
5
2.
EVOLUTION GENERALE DU TERRITOIRE JUSQU’AU
18
EME
SIECLE
2.1. E
VOLUTION GENERALE
L’occupation de la région par l’homme est très ancienne, puisqu’elle date du
Néolithique (5.000 à 2.500 avant JC). Les premières installations remontent à la préhistoire
comme en témoignent divers objets, haches polies, grattoirs, pointes de flèche, retrouvés
entre autres à Smuid (Libin), Awenne (Saint-Hubert), et Resteigne (Tellin).
De nouvelles installations ont lieu à l’époque des Celtes, au premier siècle avant
Jésus-Christ. Aux confins des terres d’Ochamps (Libin), les celtes ont laissé plusieurs
centaines de tertres d’orpaillages de chaque côté du thalweg de la Large Fontaine. A Martilly
(Herbeumont), une ancienne fortification subsiste sur une hauteur, près du lieu-dit le Chaslet.
Les Trévires s’installeront ensuite. Ils auraient introduit la technique des jachères. Tant
que les techniques agricoles ne sont pas suffisamment maîtrisées, l’habitat (ou du moins sa
localisation) ne se pétrifie pas : dès que les sols s’appauvrissent, l’homme se déplace pour
défricher et cultiver d’autres terres.
La période gallo-romaine est marquée par les premiers grands déboisements et le
développement de centres agricoles. L’installation des villas bouleverse l’économie rurale.
L’agriculture est la composante principale de l’économie, essentiellement l’élevage des
moutons. Parmi les vestiges hérités de cette époque, citons une villa romaine à Villance
(Libin), de nombreux vestiges à Hatrival (Saint-Hubert), une villa à Vesqueville (Saint-
Hubert), oppidum du Trinchi à Herbeumont.
A l’époque des Francs débutent les défrichements massifs à dessein agricole. Les
surfaces défrichées sont transformées en pâtures-sarts et en landes-sarts tandis que les
vallées sont aménagées en prairies semi-naturelles.
L’influence humaine sur le paysage se marque surtout au voisinage des localités
existantes. En effet, les terres cultivées et pâturées se situent de préférence à proximité des
villages tandis que la forêt occupe les terres difficilement exploitables par l’agriculture ou
trop éloignées des lieux habités.
En forêt, la zone des contreforts sera soumise très longtemps au régime des taillis, au
soutrage, au pâturage et à l’essartage périodique. Au 14
ème
siècle, ces pratiques seront
réduites et on instaurera une politique de droits de chasse, de pacage,…
L’époque du Moyen-âge (500 à 1500 environ) est marquée par la poursuite des
déboisements, des défrichements et également par la naissance d’activités commerciales.
Cette époque, parfois troublée, est marquée par une ouverture sur les territoires voisins, par
le développement d’activités de commerce et d’échanges. La population s’accroît mais tant
l’Ardenne que la Famenne restent des régions peu peuplées, en raison de leur caractère
boisé.
Lorsque la sidérurgie s’implante vers le 17
ème
siècle, la première exploitation
intensive du bois débute.
A partir du 17
ème
siècle, les grands massifs du plateau ardennais sont activement
charbonnés. On retrouve en forêt de nombreuses aires de fauldes et des vestiges de forges.
Les forêts deviennent de plus en plus claires suite à ces différentes pratiques (essartage,
soutrage, affouage). Les landes à genêts sont abondantes de par les régimes culturaux
imposés (friches, écobuages, assolement, abandon des sols stériles…). Vers la fin de ce
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%