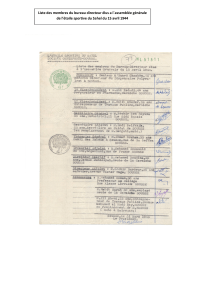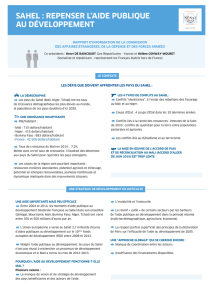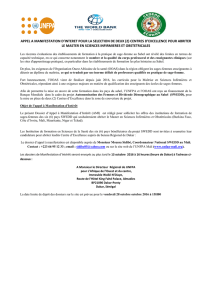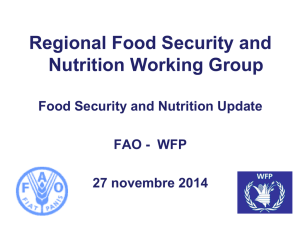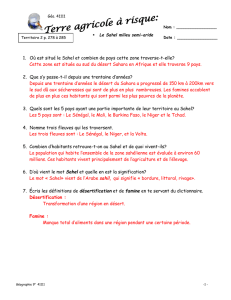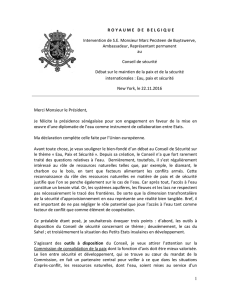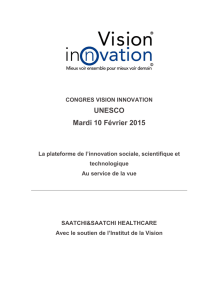Mali et Sahel : Mali et Sahel : dossier

dossier
3
/ janvier/février 2017 / n°467
Je ne peux commencer l’introduction de
ce dossier de rentrée 2017 de la revue
des anciens élèves de l’Ena consacré au
Mali et au Sahel sans tout d’abord évoquer
avec émotion et tristesse le terrible attentat
terroriste suicide commis à Gao (une des
plus anciennes villes du Mali et la capitale
politique de l’Empire Songhaï au Xe siècle)
le 18 janvier dernier, quelques jours après
le Sommet Afrique France de Bamako.
Cette attaque n’a suscité qu’une faible
couverture médiatique internationale :
elle a pourtant causé la mort d’au moins
77 personnes et 115 blessés. L’intensité
et la violence de cet attentat ne peuvent
que nous rappeler les horreurs commises
ces deux dernières années à Paris, Berlin,
Ouagadougou, Nice, Tunis, Beyrouth,
Bamako ou encore le 31 décembre 2016
à Istanbul. L’objectif poursuivi par les
commanditaires de cet acte barbare1,
au nom de leur conception idéologique
dévoyée de l’Islam2, est de faire dérailler
le processus de paix engagé au Mali depuis
juin 2015 et d’essayer d’entraîner une
fois encore ce pays et toute la région
dans une spirale de déstabilisation. La
devise immédiatement apparue sur les
réseaux sociaux sahéliens par solidarité
pour les victimes et leurs familles, Gao
gaabandi ! (Gao résiste, Gao soit fort) ou
encore Mali gaabandi ! s’apparente à une
splendide leçon de force et de résilience
que nous adresse le peuple malien. Si
besoin en était, cet attentat confirme
aussi l’impérieuse solidarité qui doit tous
nous unir Européens et Sahéliens, au-
delà de toutes nos différences politiques,
culturelles, ethniques ou religieuses,
dans cette lutte impitoyable contre
ce fléau commun qu’est le terrorisme
sectaro-islamiste.
Le Sahel, qui est incontestablement une
des régions les plus pauvres et défavorisées
de notre planète, mais aussi les plus riches
culturellement (ce que ne manque pas
d’ailleurs de relever dans son article sur
« Le patrimoine culturel mondial du Sahel :
une richesse fragile » la directrice générale
de l’Unesco, Irina Bokova), traverse
une mutation économique, sociale et
environnementale sans précédent.
La dernière décennie a été marquée
par la résurgence, la multiplication et
l’intensification de crises politiques et
de gouvernance, aux causes externes
(les conséquences de l’effondrement
du régime libyen en 2011 ne doivent
pas à cet égard être sous-estimées) et
internes (confiscation du pouvoir par les
élites centrales, corruption, délitement
institutionnel), qui ont profondément
détérioré la situation sécuritaire de
la région. Ces crises, s’ajoutant aux
crises agro-climatiques, économiques
et nutritionnelles récurrentes depuis les
années 1970, menacent non seulement
la stabilité des régimes politiques en place
mais remettent aussi en question les
équilibres sociétaux des pays concernées.
Elles risquent de générer à leur tour de
nouvelles crises intercommunautaires.
Elles contribuent à des mouvements
forcés de populations et l’intensification
de flux de migrations de moins en moins
contrôlables (32 millions de migrants
africains représentent déjà 13,4 % des
migrants mondiaux). De la classique
« trappe de pauvreté » traditionnellement
mise en avant par les économistes, on
Par Jean-Marc Châtaigner
Jean Monnet 1990
passe à « la trappe de conflictualité »
évoquée dans leur article par Sylviane
Guillaumont Jeanneney, Camille Laville
et Jaime de Melo (« Le Sahel est dans
une situation de pièges de pauvreté et de
conflit : un appel à l’action internationale »)
et dans laquelle se trouverait saisi
aujourd’hui le Sahel.
Avant qu’il ne puisse peut être (re)devenir
« le pays de cocagne » rêvé par René
Billaz dans son dernier livre paru en
décembre 20163, les défis auxquels le
Sahel se retrouve confronté sont en effet
de plusieurs ordres.
Le premier facteur de vulnérabilité (et
de mon point de vue le principal) est
celui de la croissance démographique.
Dans son ouvrage Africanistan largement
consacré aux enjeux sahéliens, Serge
Michailof résume lucidement la situation :
« Il ne faut pas se le cacher, le continent
est un véritable baril de poudre. La
poudre s’appelle démographie. Et le
détonateur se nomme emploi ». Les taux
de natalité actuels laissent entrevoir une
augmentation de la population du Sahel
de 135 millions de personnes en 2015
à 330 millions en 2050. En rapportant
ces chiffres à l’échelle mondiale, l’espace
sahélien accueillait presque 2 % de la
population mondiale en 2014 et selon
les projections constituera entre 3,5 et
1 - L’attentat a été revendiqué par l’organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi).
2 - Je rappellerai à cet égard simplement les paroles fortes et claires prononcées
par Mohamed VI, Roi du Maroc et Commandeur des croyants, lors de son discours
à la Nation du 20 août 2016 : « Les terroristes qui agissent au nom de l’Islam
ne sont pas des musulmans et n’ont de lien avec l’Islam que les alibis dont ils
se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. Ce sont des individus
égarés condamnés à l’enfer pour toujours. »
3 - René Billaz, « Faire du Sahel un pays de cocagne : le défi agro-écologique »,
L’Harmattan, Paris, 2016.
Mali et Sahel :
Nous sommes tous Sahéliens
Mali et Sahel :
Nous sommes tous Sahéliens
dossier

Mali et Sahel :
Nous sommes tous Sahéliens
dossier
4 / janvier/février 2017 / n°467
4 % en 2050. Le Niger qui comptait 3,4
millions d’habitants à l’indépendance
en 1960 atteint pratiquement en 2015
20 millions d’habitants. La projection
actuelle est de 72 millions d’habitants
pour 2050. La capitale du Niger, Niamey,
avait en 1960 la taille d’une sous-
préfecture française (30 000 habitants).
En 2015, sa population est passée à
774 245 habitants et dans la prochaine
décennie, elle entrera évidemment dans la
catégorie des villes millionnaires. Le Mali
qui comptait 5,3 millions d’habitants à
l’indépendance en 1960 atteint en 2015
17,6 millions d’habitants. La projection
pour 2050 est de 46 millions.
Cette question démographique est
une véritable épée de Damoclès pour
l’avenir du Sahel – le démographe Michel
Garenne n’hésite pas d’ailleurs à parler
« d’une bombe démographique »4 –,
insuffisamment, voire pas du tout,
prise en compte par les politiques de
développement. Elle empêche les pays
sahéliens de tirer les bénéfices éventuels
d’une croissance forte et durable. Les
investissements induits par l’ampleur de
cette vague démographique, en particulier
dans les secteurs sociaux (éducation et
santé), dépassent largement les capacités
existantes et les ressources internes et
même externes disponibles. A contrario,
les pays asiatiques, y compris les pays les
moins avancés (comme le Bangladesh),
ont montré tous les dividendes pouvant
être tirés de transitions démographiques
réussies, qui sont elles-mêmes le résultat
de politiques volontaristes de contrôle des
naissances. Dans mon avant-propos au
remarquable – et visionnaire – ouvrage
collectif sur la démographie africaine
coordonné par Benoit Ferry et publié il y a
10 ans en 20075, je lançais déjà un appel
à l’élaboration d’un véritable programme
d’action sur le sujet pour le Sahel. Un tel
programme devrait étroitement associer
pays partenaires et bailleurs de fonds
et favoriser une approche beaucoup
plus intégrée des questions de santé et
d’éducation dans toutes les politiques
sectorielles, avec une prise en compte
réelle des spécificités locales (langues
vernaculaires, culture, religion, rapports
de genre).
Le second défi rencontré par le Sahel pour
construire durablement son développement
est celui de la gestion de son indispensable
rattrapage économique. En 2014, le
Pib de l’ensemble des pays de la zone
sahélienne, en comprenant le Nigeria,
représente 0,91 % du Pib mondial. Mais
sans tenir compte du Nigeria, ces pays
n’atteignent pas 0,18 % du Pib mondial.
Le Pib du Niger (20 millions de personnes)
s’élève en 2015 à 7,1 milliards de dollars,
soit plus de 10 fois moins que la richesse
personnelle de l’homme le plus riche du
monde, Bill Gates. L’extrême pauvreté
touche environ entre 40 et 50 % de la
population. Les vulnérabilités économiques
et environnementales du Sahel (avec la
raréfaction des ressources naturelles et la
dégradation de la productivité agricole)
limitent les perspectives d’une croissance
économique qui reste extrêmement volatile
selon les années et inégalitaire dans sa
distribution. Largement rurale, l’économie
sahélienne subit de plein fouet les aléas
climatiques, les variations des prix des
matières premières et l’insécurité liée à la
multiplication et la propagation des crises
politiques et institutionnelles.
Facteur de complexité supplémentaire pour
les prochaines années, le Sahel fait partie
des régions dans le monde qui seront le
plus directement affectées par la menace
globale du changement climatique (avec
des épisodes climatiques, sécheresses ou
inondations, nécessairement plus intenses
et perturbateurs). Comme le souligne
également Serge Michailof, « les deux
degrés d’augmentation de la température
déjà considérés inévitables au niveau
mondial à échéance de la fin du siècle,
vont se traduire au Sahel par deux degrés
de hausse effective d’ici 20 ans et de trois
à cinq degrés d’ici 2050.6 ».
La marginalisation économique du Sahel
dans l’économie mondiale s’accompagne
d’une insertion faible et tout aussi
préoccupante dans les réseaux globaux
de production de connaissances. Selon
les statistiques de la Banque mondiale, on
compte en effet 29 chercheurs par million
d’habitants au Mali ou 39 par million
d’habitants au Nigeria (qui est pourtant
le premier pays publiant d’Afrique avec
l’Afrique du Sud) contre près de 4 000
aux États-Unis.
Le troisième et dernier défi, sans doute
le plus immédiat pour les pays du Sahel
et la communauté internationale, est
celui du rétablissement de la paix et
de la sécurité régionale. En dépit de
l’intervention militaire française au Mali
en janvier 2013, du relais pris dans ce
pays par le déploiement de la Minusma
(Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali), de la poursuite de l’engagement de
l’armée française dans tout le Sahel contre
les groupes armés djihadistes salafistes à
travers le déploiement depuis le 1er août
2014 de l’opération Barkhane, du début
de coopération militaire entre le Nigeria
et ses pays voisins pour faire face aux
sinistres agissements de Boko Haram7,
la situation sécuritaire du Sahel demeure
extrêmement fragile et dépendante de
l’assistance extérieure. D’une manière
générale, les grands trafics (armes, drogue,
personnes) et les problèmes politiques
et d’extrémisme religieux constituent les
ferments principales de ces violences.
Mais il existe une insécurité quotidienne,
qui est tout autant, sinon plus perçue par
les populations sahéliennes, à travers
la progression de crimes liés aux divers
trafics incluant le vol de bétail, les
violences domestiques, les vols à main
armée ou les kidnappings. Les divers
groupes mafieux ont une grande influence
sur les jeunes sans perspective d’emplois
qui représentent pourtant une proportion
considérable de la population totale de la
zone sahélienne.
Tout l’enjeu est ici de passer d’une
approche réactive de courte vue à une
approche préventive et de coopération
de long terme, avec des questions à
résoudre qui ne sont pas simples. Quelles
activités et quels moyens pour soutenir
le développement tout en tarissant les
sources d’insécurité ? Quel est le niveau
de sécurité minimal à garantir pour activer
les ressorts du développement ? Quel rôle
chaque acteur doit-il jouer ? Quel est le
coût de l’inaction ?
La structuration de ce numéro permet
d’aborder tous ces sujets de façon
originale, avec des éclairages que nous
espérons variés et de nature, je l’espère,
à susciter la curiosité et l’intérêt de nos
lecteurs.
Dans leurs deux remarquables articles
d’ouverture et de clôture de ce numéro,
François Gaulme (« Le Sahel, quésaco ? »)
et Bertrand Fessart de Foucault (« Frontière

dossier
5
/ janvier/février 2017 / n°467
ou trait d’union ») nous rappellent tout
d’abord et chacun avec leurs mots les
difficultés de définir, cerner, restreindre
cet espace sahélien dans lequel l’homme
trouve ses origines et sa généalogie (ce
qu’a notamment confirmé la découverte
en 1995 par Michel Brunet au Tchad de
la mâchoire d’australopithèque d’Abel,
premier pré-humain de 3,5 millions
d’années connu à l’ouest de la Rift
Valley). Ils nous parlent aussi des rapports
particuliers que la France a toujours
entretenus avec le Sahel entre fascination
et recherche d’un supplément d’âme…
Un premier cœur du dossier est consacré
à l’évolution de la situation au Mali depuis
2012. Jacques Gautier, vice-président de
la Commission aux Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées
du Sénat revient sur le bilan de l’inter-
vention militaire française qu’il qualifie
« d’exemplaire », tout en relevant ses
forces et ses faiblesses et en préconisant
pour gagner la paix « une approche globale
coordonnée ». Hervé Ladsous, secrétaire
général adjoint pour les Opérations de
maintien de la paix de l’Onu, reprend
quant à lui l’historique de l’intervention
de la Minusma en soulignant toutes les
difficultés rencontrées par l’opération,
son souci constant d’adaptation et les
risques d’enlisement du processus de
paix. Dans son papier au titre allusif
« Le Mali est-il un nouvel Afghanistan ? »,
Lola Cecchinel, directrice d’ATR Mali,
dresse le parallèle de la situation entre
ces deux pays et marque toutes les limites
militaires, mais aussi politiques d’une
intervention extérieure. Ses observations
sur « le fantasme de la démocratie et
des élections » et « l’illusion de l’aide
publique au développement » ne peuvent
que susciter la réflexion et le débat, à
l’instar des interpellations encore plus
crues qu’avaient posé le chroniqueur
du Monde Afrique, Laurent Bigot8. À
travers une perspective historique, Charles
Grémont, chercheur de l’IRD, dresse un
tableau des « Origines et perspectives
des conflits menés par des Touaregs
au Mali ». Il relève notamment que la
« question touarègue » est beaucoup plus
complexe que celle parfois décrite : « une
fois encore les mouvements rebelles sont
loin d’emporter l’adhésion de l’ensemble
des populations touarègues (et maures),
mais la répression et le discrédit s’abattent
sur cet ensemble », nuance-t-il. Enfin,
l’ancien ministre des Affaires étrangères
du Mali et président du Parti d’opposition
pour la renaissance nationale, Tiébilé
Dramé pose avec franchise les questions
de gouvernance et de corruption qui se
posent à son pays. Sa conclusion est sans
appel : « Quatre ans après Serval, pour
éviter une rechute, il est urgent que les
Maliens et leurs amis comprennent que
la solution aux crises maliennes ne réside
ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Moscou, ni
à New York, mais au Mali ».
Plusieurs articles reviennent ensuite de
façon plus transversale sur différents
aspects des dangers et menaces,
mais aussi des opportunités, qui se
présentent aujourd’hui au Sahel. L’ancien
ambassadeur au Mali, Congo et Sénégal,
Nicolas Normand nous explique les facteurs
structurels d’apparition du terrorisme
islamiste au Sahel en mettant en évidence
les premières origines américaine et
saoudienne et l’existence d’un « incubateur
afghan ». Reprenant les thèses d’une
récente publication de la Ferdi9, Sylviane
Guillaumont Jeanneney, Camille Laville
et Jaime de Melo développent pour leur
part un vigoureux plaidoyer en faveur
d’une action internationale renforcée pour
ce bien public qu’est la paix au Sahel,
en mettant l’accent sur l’enseignement
primaire et l’agriculture. Serge Michailof
s’interroge sur les vertus que pourrait
avoir un plan Marshall pour le Sahel et
les écueils qu’il conviendrait d’éviter pour
sa mise en œuvre. Il insiste notamment
sur l’idée qu’« un plan Marshall pour
le Sahel ne consiste pas à y déverser
des ressources massives dans la plus
grande incohérence ». Gwénola Rageau se
penche sur le dynamisme de la jeunesse
sahélienne dont elle marque la profonde
hétérogénéité et les difficultés d’accès
au marché de l’emploi. Elle relève la
nécessité présente au Sahel, ce qui n’est
pas sans rappeler la situation de nos pays
occidentaux, de « réinventer des relations
intergénérationnelles » afin d’éviter que
toute une jeunesse ne bascule dans la
contestation et la violence. À rebours
de nombreuses idées reçues, Gilles
Holder nous présente les ferments d’un
réformisme islamique francophone au
Sahel, le français y jouant le rôle « langue
de travail » : « la stratégie francophone et
la promotion de la culture de l’excellence
sont requises pour la conquête de la
bureaucratie d’État ». Le directeur
d’Investisseurs et Partenaires et ancien
directeur général de l’Agence française
de Développement (AFD), Jean-Michel
Severino, s’écarte lui-aussi des clichés
habituels sur le monde sahélien pour nous
faire part de la révolution technologique
en cours au Sahel et l’émergence dans
cet environnement particulièrement
déshérité d’un entrepreneuriat qualifié
et dynamique. Dans une démonstration
particulièrement convaincante, que j’ai
déjà mentionnée, Irina Bokova insiste
sur l’idée que « l’histoire du Sahel, zone
frontière, témoigne (…) d’un dynamisme
et d’une diversité culturelle exceptionnelle,
qui on irrigué toute l’Afrique ».
Trois articles viennent enfin compléter
ce dossier suivant des perspectives
géographiques différentes. Marc-Antoine
Pérouse de Montclos, directeur de
recherches à l’IRD, s’interroge sur la
nature et l’avenir de « Boko Haram : entre
fragmentation et internationalisation ? ».
Reprenant des travaux initiés par la revue
Passages et popularisés en 2015 par la
publication d’un Atlas du Lac Tchad10,
Roland Pourtier revient sur les enjeux
du « Lac Tchad entre crise écologique et
menaces géopolitiques ». Je présente enfin
les enjeux structurels de co-construction
d’une plateforme commune de partage
de connaissances entre l’Europe, la
Méditerranée et le Sahel. C’est en effet
une des conclusions qui s’imposent à la
lecture et l’analyse de tous les articles
de ce dossier. Nous ne pourrons faire
face aux défis qui attendent le Sahel,
sans davantage mobiliser nos savoirs et
nos connaissances dans une démarche
résolument équitable et partenariale. ■
4 - Le Monde, 17 janvier 2017.
5 - Benoît Ferry (direction), « L’Afrique face à ses défis démographiques : un
avenir incertain »), AFD – CEPED – Karthala, Paris, 2007.
6 -http://www.iris-france.org/71383-le-sahel-victime-du-rechauffement-
climatique-cette-region-a-besoin-dun-plan-marshall/
7 - Le nombre de morts violentes au Nigeria a presque triplé entre 2012 et 2014,
passant de 7908 victimes en 2012 à 22544. Boko Haram reste la première
cause de morts violentes au Nigeria (http://www.nigeriawatch.org/media/html/
NGA-Watch-Report15Final.pdf.)
8 - Laurent Bigot, « Un sommet Afrique-France ? Pourquoi pas, mais, de grâce,
pas au Mali ! », Le Monde Afrique, 11 janvier 2017
9 - Fondation pour les études et recherches sur le développement international
(Ferdi), « Allier sécurité et développement – Plaidoyer pour le Sahel »,
Clermont-Ferrand, 2016.
10- Géraud Magrin, Jacques Lemoalle, Roland Pourtier (dir. Scient.), « Atlas
du lac Tchad », Passages (diffusion IRD), 2015.
1
/
3
100%