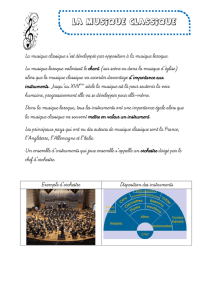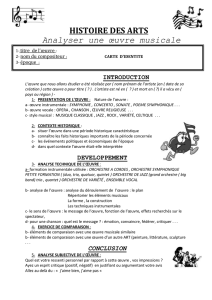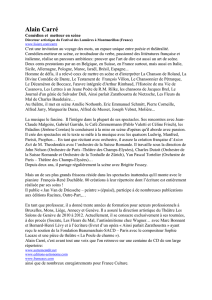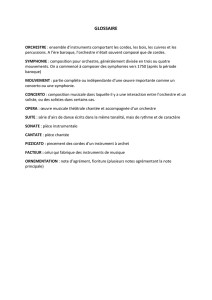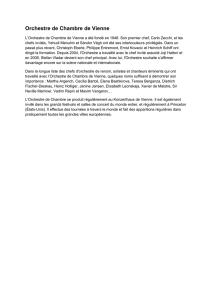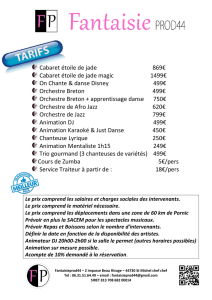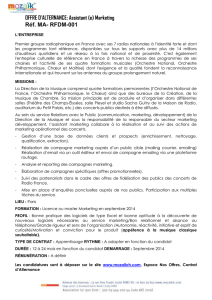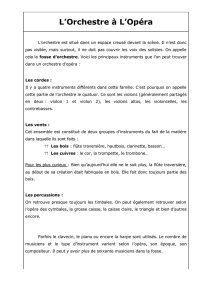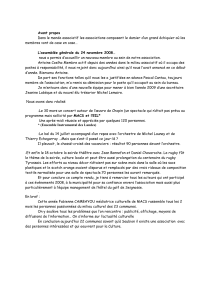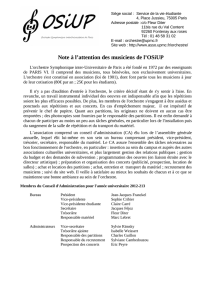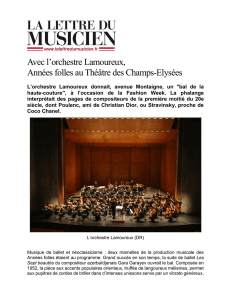Revue de presse Orchestre Titanic

REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE

FLORILÈGE DE PRESSE
TT On aime beaucoup. Les cinq comédiens sont au top. (...) Un théâtre
burlesque et drôle, qui résonne comme une métaphore de l’Europe
d’aujourd’hui, mais où l’on sait encore rire.
Sylviane Bernard-Gresh - Télérama Sortir
Les interprètes ont vraiment l’étoffe de leurs personnages, et l’illusion
théâtrale fonctionne tendrement, sûrement, elle nous émeut (...) et nous
fait craquer.
Évelyne Trân - LeMonde.fr
Remarquable. (...) Philippe Lanton aura su honorer le texte et son sous-
texte tout en respectant le burlesque de la proposition et sa radicale
poésie. Une pièce avec de l’esprit, beaucoup d’esprit.
David Rofé-Sarfati - Toute la Culture
On vit au rythme des espoirs frustrés d’une bande de laissés pour compte
dotés d’un sens de l’humour digne de Charlot ou des Marx Brothers.
Jack Dion - Marianne.fr
La force espiègle et l’élan moqueur de ces gentils plaisantins agit
magnifiquement sur la scène pour les spectateurs ravis. (...) La comédie
de Philippe Lanton bat son train (...) et le public se divertit en méditant
sur l’accueil des migrants du monde.
Véronique Hotte - Hottello
Philippe Planton réalise une mise en scène psychologique, (...) intimiste
dans l’exploration personnelle des consciences et burlesque dans la
façon d’être des comédiens. (...) Un bel exercice de philosophie.
Philippe Delhumeau - La Grande Parade
Venez vous émerveiller du jeu des ces merveilleux farceurs (...), vous en
sortirez la tête nettoyée d’une couche de fumée noire, dernier vestige
d’une loco du passé dépassé.
Camille Arman - Fréquence Paris Plurielle

Quatre SDF attendent avec leur valise, sur le quai
d’une gare désaffectée, un hypothétique train qui ne
s’arrête jamais. Il y a là un ancien chef d’orchestre
et sa copine, un ancien cheminot, un ex-montreur
d’ours. Quatre laissés-pour-compte, comme tant
de gens aujourd’hui. Ils sont fortement alcoolisés,
et rêvent. Arrive un magicien, qui semble donner de
la réalité à leurs illusions. La scène est parsemée
de détritus, de deux tentes.
Dans ce théâtre très caractéristique de l’Europe
de l’Est, on ne sait jamais si l’on est dans la réalité
ou dans le monde imaginaire des personnages. Ils
ont quelque chose de Vladimir et Estragon d’
En
attendant Godot
. On pense aussi aux frères Marx. Les
cinq comédiens sont au top. Le dramaturge bulgare
Hristo Boytchev conçoit un théâtre burlesque
et drôle, qui résonne comme une métaphore de
l’Europe d’aujourd’hui, mais où l’on sait encore rire.
Sylviane Bernard-Gresh
10 Janvier 2017
TT
On aime beaucoup

Sur la route burlesque d’Orchestre Titanic, de Hristo Boytchev, mis en scène par
Philippe Lanton.
Il faut être prêt à croire qu’un autre avenir est possible. Qu’une vie nouvelle peut
encore se dessiner. Ils sont quatre. Sur la ligne de départ. Un ex-chef d’orchestre. à
ce qu’il dit. Sa petite amie. Ou une fille de rencontre. Un ex-montreur d’ourse. Veuf
inconsolé de son animale. Un ex-cheminot. Qui fut employé ici même. C’est-à-dire
dans cette gare où les trains ne font plus que passer. Faute de mieux, de nid douillet,
ou de niche plus intime, ils campent là. Dans le bâtiment laissé à lui-même. En
imaginant qu’un train, un jour, va quand même faire halte. À l’approche de chaque
convoi, ils se tiennent prêts, répètent leur rôle, valise à bout de bras, bien alignés.
Prêts à grimper dans les voitures. Pour s’enfuir. Ou bien pour jouer aux bandits, en
détroussant les voyageurs.
Il y a du Beckett dans l’air
D’autant plus que tout se complique encore quand survient Hari. Sorte de double de
Godot, nous dit Philippe Lanton, le metteur en scène. Mais un Godot bien présent.
Il y a du Beckett dans l’air. Hari (Olivier Cruveiller) est encore plus insaisissable que
ses compagnons de hasard. Il est magicien. Mais pas seulement. Et le voilà aussi, un
temps, chef de la petite bande. Pour autant, Louko (Bernard Bloch), Meto (Philippe
Dormoy), Doko (Christian Pageault) et Lubka (Evelyne Pellier) ne sont pas tombés
de la dernière averse. C’est à qui sera le plus retors. Et s’il y a de la vodka, c’est
encore mieux. C’est même indispensable.
Comme l’orchestre du Titanic qui joua pendant que le navire sombrait, cette «
comédie philosophique et burlesque », écrite en 2002 par le Bulgare Hristo Boytchev,
s’accroche aux murs d’une Europe qui tangue. En 2007, la Bulgarie a rejoint
la Communauté européenne. Boytchev évoquait déjà les évolutions sociales et
économiques, les migrations, le mirage de « l’éden économique ». Tout en brouillant
les pistes. « Hier, il est passé cinq trains dans un sens, qui transportaient du sable,
et cinq autres dans le sens inverse, qui eux aussi transportaient du sable. Quel est
le sens, je demande, de transporter du sable à droite et à gauche ? Si on y réfléchit,
il n’y a aucun sens, mais si on n’y réfléchit pas, il y en a un peut-être un », dit par
exemple Louko. Comme un résumé.
Gérald Rossi
18 janvier 2017

Les voilà au banc de la société, quatre paumés, nous dit-on, garés dans une gare désaffectée, qui n’ont
pour seule distraction que les passages d’un train qui ne s’arrête jamais. La pause pourrait paraître
insignifiante, après tout les arbres aussi regardent les trains qui passent mais il s’agit d’humains tout de
même, d’êtres toujours allumés d’espoir, de désirs, de rêves… Cette énergie-là qui la leur enlèverait ?
Quoi, vous nous n’auriez plus le droit de dire que vous existez parce que vous ne faites plus partie de la
société, que vous avez largué les amarres ou que vous avez été éjectés ?
La considération est douloureuse pour l’auteur Bulgare d’
Orchestre Titanic
, H. Boytchev, qui sonde le
phénomène du flux migratoire, à travers l’histoire de quatre individus, dans la misère, assaillis par la
grande illusion, celle d’un autre monde plus bienveillant qui s’appellerait l’Europe.
Il s’agit d’une réponse métaphorique, philosophique à une angoisse existentielle tétanisante, celle de
s’éprouver de l’autre côté du mur, celui des réprouvés, des bannis, des pauvres, des abandonnés.
L’impression est désastreuse, c’est une claque ! Imaginez-vous dans la peau de ces quatre auto-stoppeurs
avec leurs valises sur le bord de l’autoroute, dans le froid, qui attendent en vain qu’un automobiliste
s’arrête ! Combien de temps devront-ils attendre ? Et vous qui êtes passé devant eux sans vous arrêter
et repassez sur le chemin, pourrez-vous constater avec soulagement qu’ils ont disparu ?
Magique le temps ! Tout passe même une vision terrifiante. Les quatre énergumènes qui plongent dans
la grande illusion ont tout de même un avantage sur ceux qui se plaignent de ne jamais s’arrêter, celle
de faire la pause, d’ouvrir un autre clignotant temporel, celui du rêve.
Les quatre zigotos, un ancien cheminot, un chef sans orchestre, sa copine, et un ex-montreur d’ours,
n’ont pas d’autre choix que d’imaginer que le train va stationner, parce qu’il ne cesse de donner des
signes de vie en déversant des déchets, des bouteilles vides. Un jour, c’est un homme qui passe par la
fenêtre du train. Il est inconnu et focalise bien des fantasmes, tel un être imaginaire, un magicien, une
sorte de gourou fantasque qui va distraire les quatre personnages en devenant le support de leurs rêves.
La vie serait-elle une illusion ? Nombre de philosophes se sont penchés sur la question. Illusion fatale,
nous dit l’auteur. Mais le chant du cygne de Doko, le montreur d’ours, qui se retrouve tout seul, est
empreint d’une telle humanité qu’il est possible de croire qu’il n’a pas rêvé, qu’il était bien là avec les
autres, que leur rêve était collectif.
La mise en scène dépouillée de Philippe Lanton laisse libre cours à l’imagination du public, c’est aux
personnages d’instruire l’illusion puisque chacun porte déjà son histoire sur le visage. Le corps est mis
en avant, sa chair, vulnérable, comique, ubuesque. Ce ne sont pas que des quilles ou que des bouteilles
vides mais des gens qui ont vécu, qui ont aimé, joui, souffert et qui résistent malgré tout.
Les interprètes ont vraiment l’étoffe de leurs personnages, et l’illusion théâtrale fonctionne tendrement,
sûrement, elle nous émeut parce qu’elle nous gratifie aussi d’un sentiment d’enfance, de merveilleux ;
comme dans la petite marchande d’allumettes d’Andersen, elle nous fait craquer.
Évelyne Trân
08 janvier 2017
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%