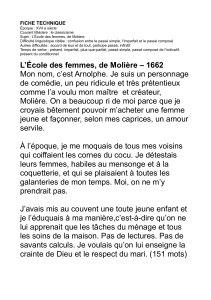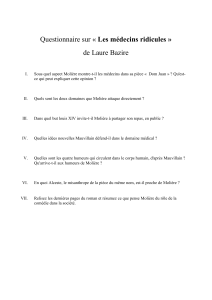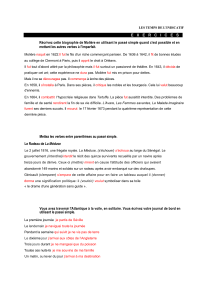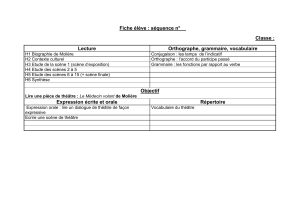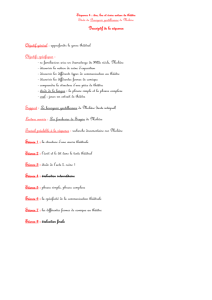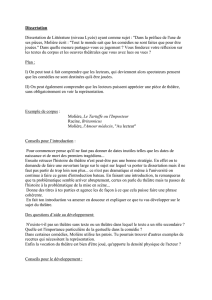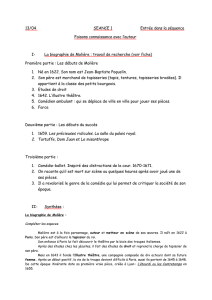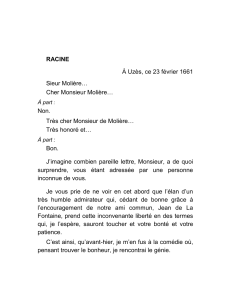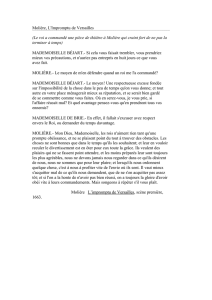la gastronomie dans des pièces choisies de molière et dans leurs

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3062
ROMANICA WRATISLAVIENSIA LV
Wrocław 2008
JADWIGA ŻYSZKOWSKA
Université de Wrocław
LA GASTRONOMIE
DANS DES PIÈCES CHOISIES DE MOLIÈRE
ET DANS LEURS TRADUCTIONS
PAR TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI
Tadeusz Boy-Żeleński a été pendant décennies et souvent est toujours consi-
déré comme un traducteur de génie; Jan Błoński l’a même appelé le « Shakespeare
de la traduction ». Sans doute, le travail effectué par Boy étonne aussi bien par sa
quantité que par sa qualité qui impose le respect, dans la mesure où ses traductions
sont souvent considérées comme un modèle de référence.
Malgré l’incontestable talent de Żeleński, on aperçoit des erreurs et des la-
cunes dans ses traductions. Wacław Borowy, d’ailleurs très favorable à l’égard de
l’œuvre de Boy, mentionne que parfois le traducteur omet une partie du texte, par-
fois il manque de connaissance de la réalité française ou il choisit mal ses mots1.
Boy « aimait » certains auteurs plus que d’autres, et il les traduisait mieux (par
ex. Molière). Ses traductions des œuvres de Proust, de Pascal et sa traduction de
Phèdre de Racine ont été critiquées le plus souvent. Il est donc possible d’imagi-
ner des traductions mieux faites2. Plus récemment, Andrzej Siemek, sans pourtant
essayer de « détrôner » Żeleński, a attiré l’attention sur des omissions importantes
dans sa traduction des Liaisons dangereuses de Laclos et sur des changements
stylistiques dans Jacques le Fataliste de Diderot, ce qui a donné un texte polonais
assez éloigné de l’intention de l’auteur français3. Dariusz Bralewski, dans son
analyse des expressions fi gées utilisées par Boy dans ses traductions des pièces de
Molière et de Racine, met en évidence les écarts que le traducteur a commis par
1 W. Borowy, « Boy jako tłumacz », [dans:] Studia i rozprawy, t. II, Wrocław 1952, pp. 88–90.
2 J. Błoński, « Szekspir przekładu », [dans:] Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XIV: Antologia
literatury francuskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958, p. 11.
3 A. Siemek, « Dumając nad Boyem: przekład jako wizja obowiązkowa », Literatura na
Świecie 12, 1999, pp. 237–244.
imprimatur_R_LV.indd 87imprimatur_R_LV.indd 87 2008-10-13 15:27:502008-10-13 15:27:50
Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS

88 JADWIGA ŻYSZKOWSKA
rapport aux usages en vigueur4. Les expressions fi gées dans les traductions des
œuvres de Molière ont fait aussi l’objet d’une analyse de Tomasz Stróżyński qui
estime que Boy semble parfois avoir succombé à sa « fantaisie linguistique » et
« avoir dépassé les bornes de la liberté de traducteur »5.
Les expressions fi gées ne sont qu’une partie du lexique impressionnant qu’uti-
lisait Żeleński et qui comporte une multitude de synonymes, proverbes, diminu-
tifs, augmentatifs, des termes techniques qui n’ont pas encore fait l’objet d’une
analyse. La richesse du vocabulaire utilisé par Boy est étonnante. J’en cite la liste
thématique d’après Borowy: théologie, philosophie, droit, économie, médecine,
pharmacie, escrime, tactique et stratégie, navigation, chasse, agriculture, équita-
tion, noms d’oiseaux et de poissons, boucherie, cuisine, dialectique et jeux6.
Les commentaires critiques concernant les expressions fi gées dans les tra-
ductions de Żeleński invitent à regarder de plus près aussi comment il a traité les
termes techniques. Les cadres de cet article nous permettront d’analyser juste une
partie de cette riche terminologie, celle qui se rapporte à la cuisine. Comme la
gastronomie « constitue l’une des expressions les plus spécifi ques d’une ethnie
et, aux Temps modernes, d’une nation »7, le vocabulaire de la cuisine représente
un problème pour le traducteur. Les diffi cultés surgissent surtout avec l’apparition
dans l’œuvre originale de mots renvoyant à des réalités différentes de celles que
connaît le lecteur de la traduction. Les traductologues considèrent que ces diffé-
rences peuvent être cause d’intraduisibilité des œuvres littéraires (Vinay, Darbel-
net, Mounin, Wojtasiewicz).
La traduction de toutes les pièces de Molière (qui apparaît en 1912) a été le
premier grand accomplissement de Boy-traducteur8. Dans ses comédies, Molière
utilise le vocabulaire de la gastronomie pour montrer l’avarice ou la fausse mo-
destie et ridiculiser des personnages. Les noms des repas, des plats et des produits
alimentaires ne se sont donc pas trouvés dans ses textes par hasard: ils y remplis-
sent un rôle et pour cela ils méritent d’être présents aussi dans le texte traduit.
Notre but est de soumettre à l’analyse la traduction des termes gastronomiques
dans L’Avare, Tartuffe et Le Bourgeois gentilhomme. Nous avons choisi ces trois
pièces parce que le vocabulaire de la cuisine y est bien visible. Nous allons es-
sayer de montrer dans quelle mesure Boy a réussi à rendre dans ses traductions le
lexique de la cuisine. L’analyse sera précédée par une caractéristique du banquet
dans la comédie, notamment dans les pièces choisies, et se composera de trois
4 D. Bralewski, « Połknąć wronę, czyli o frazeologii boyowskich przekładów Moliera i Raci-
ne’a », Folia Litteraria 23, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1988, p. 146.
5 T. Stróżyński, « O frazeologizmach w Boyowskich przekładach Moliera », [dans:]
E. Skibińska, M. Cieński (dir.), Język – stereotyp – przekład, Dolnośląskie Wydawnictwo Eduka-
cyjne, Wrocław 2002, p. 228.
6 W. Borowy, op. cit., pp. 87–88.
7 P. Ory, « La Gastronomie », [dans:] P. Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire, t. 3: Les France,
Gallimard, Paris 1997, p. 3743.
8 T. Stróżyński, op. cit., p. 221.
imprimatur_R_LV.indd 88imprimatur_R_LV.indd 88 2008-10-13 15:27:502008-10-13 15:27:50
Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS

La gastronomie dans les pièces de Molière 89
parties: la première concernera les noms de produits alimentaires, la deuxième, les
noms de plats, et la dernière, les noms de repas.
L’ALIMENTATION DANS LA COMÉDIE
Avant de procéder à l’analyse de la traduction des expressions culinaires dans
les oeuvres de Molière, nous voudrions dire quelques mots sur la présence de l’ali-
mentation dans les comédies, notamment dans les trois pièces choisies.
Le festin (ou le banquet) au théâtre est porteur de nombreux signes, sens et
fonctions. On peut observer sa présence déjà dans la tradition antique, bien que,
à cause de la règle de bienséance, il y soit seulement relaté. Traditionnellement,
dans la comédie, l’annonce ou l’apparition du banquet a lieu à la fi n et signale le
début de la vie heureuse des héros (souvent il s’agit d’un banquet de noces). Dès
les XVIIIe et XIXe siècles, grâce au courant du réalisme et à l’infl uence du drame
sentimental, on peut voir sur scène des images de la vie quotidienne, entre autres
des scènes de table9. Et, comme le remarque Justyna Łukaszewicz, dans le théâtre
comique, le banquet peut prendre diverses formes, d’une tasse de café à un grand
festin. La situation peut y être créée avec quelques objets seulement, comme une
table, des chaises, une tasse. Le banquet sert aussi comme prétexte pour la rencon-
tre des personnages et souvent est un élément important de leur caractéristique10.
L’Avare est la comédie de Molière où l’alimentation est la plus présente, sur-
tout pour mettre en évidence l’avarice du personnage principal. Dans le IIIe acte,
Harpagon commence à distribuer aux domestiques les tâches liées au souper qu’il
veut donner le lendemain. Le lecteur peut soupçonner que ce souper constituera
le dénouement heureux de la pièce. Le cuisinier essaie de persuader son maître
que pour bien manger il faut payer, mais le menu qu’il lui propose est tout de suite
rejeté, comme étant trop cher. Dans le V
e acte les événements se succèdent rapide-
ment et la pièce fi nit sans montrer le banquet. On peut deviner qu’il aura lieu, mais
on ne le verra pas au théâtre.
On peut aussi parler du banquet dans le cas du Bourgeois gentilhomme, où
il est l’une des actions entreprises par M. Jourdain pour séduire la marquise Do-
rimène. Le festin est montré sur scène et a lieu dans le IIIe acte, non à la fi n. Non
seulement il ne clôt pas la pièce, mais même l’ouvre en quelque sorte: on pourrait
considérer les deux premiers actes comme une introduction.
Dans Tartuffe, on ne mange pas sur scène et l’alimentation y prend le moins
de place parmi les pièces analysées. La servante mentionne seulement le souper
9
D. Ratajczakowa, « Jedzenie na scenie, czyli o gatunkowych determinantach charakteru
i znaczeń biesiad dramatyczno-teatralnych », [dans:] P. Kowalski (dir.), Oczywisty urok biesiadowa-
nia, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, pp. 120–127.
10 J. Łukaszewicz, « Biesiada w komediach Goldoniego », [dans:] P. Kowalski (dir.), op. cit.,
p. 129.
imprimatur_R_LV.indd 89imprimatur_R_LV.indd 89 2008-10-13 15:27:502008-10-13 15:27:50
Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS

90 JADWIGA ŻYSZKOWSKA
de la veille et la description de ce qu’il a mangé aide à montrer la fausseté de
Tartuffe.
Aucune des trois pièces analysées ne répond aux critères théoriques men-
tionnés ci-dessus concernant la place du banquet au théâtre. Molière soit n’a pas
montré le repas sur scène (en se soumettant aux règles du théâtre antique), soit il
l’a placé au milieu de la pièce, non à la fi n. Le rôle de la nourriture dans les trois
pièces est surtout de caractériser les personnages et de produire un effet comique.
LA TRADUCTION DES NOMS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
La plupart des substantifs qui servent à désigner des noms de denrées ali-
mentaires ne posent pas de problème. Cette remarque est surtout valable pour les
produits dont l’usage est le plus courant aussi bien en France qu’en Pologne: le sel
(A, III, 1, p. 85) traduit par sól (Sk, III, 5, p. 78), le lait (A, II, 5, p. 71) par mleko
(Sk, II, 6, p. 64) et le fromage (A, II, 5, p. 71) par ser (Sk, II, 6, p. 64).
Toutefois, certains de ces termes peuvent susciter des réfl exions. Comme l’ex-
pression les citrons doux (A, III, 7, p. 104) qui signifi e « fruits à peau fi ne, plus ou
moins ronds, jaunes à maturité, à pulpe non acide [...]. Le fruit se mange à pleine
dent grâce à son absence d’acidité, également confi t sucré ou salé »11. Le traduc-
teur a utilisé le mot daktyl (Sk, III, 12, p. 89), peut-être parce que les citrons doux
n’étaient probablement pas encore connus en Pologne. L’usage de ces deux fruits
est assez proche, ce qui peut justifi er la traduction. Le mot confi tures (A, III, 7,
p. 104), qui désigne non seulement les confi tures elles-mêmes, mais aussi les
fruits confi ts et pâtes de fruits12, est traduit par konfi tury (Sk, III, 12, p. 89), ce qui
ne rend pas exactement la signifi cation de ce substantif. Il en est presque de même
avec l’expression les oranges de Chine (A, III, 7, p. 104). Ces fruits de luxe sont
des oranges douces qui d’ailleurs ne viennent pas de Chine13. Pourtant, Boy les a
traduits par chińskie pomarańcze (Sk, III, 12, p. 89), expression qui n’apparaît pas
dans les dictionnaires polonais du début du XXe siècle.
Un autre cas qui peut nous surprendre est le procédé utilisé pour la traduction
du mot pommes.
(1) Frosine: Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de la bou-
che. C’est une fi lle accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et
à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni or-
ges mondés perpétuels, ni les autres délicatesses qu’il faudroit pour une autre femme.
(A, II, 5, pp. 71–72)
11 www.plantesdusud.com
12 G. Couton, « Notes », [dans:] Molière, Amphitryon, George Dandin, L’Avare, Gallimard,
Paris 1971, p. 306.
13 Ibidem, p. 306.
imprimatur_R_LV.indd 90imprimatur_R_LV.indd 90 2008-10-13 15:27:502008-10-13 15:27:50
Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS

La gastronomie dans les pièces de Molière 91
Le lecteur averti pourrait être surpris en constatant que Żeleński a métamor-
phosé les pommes en ziemniaki (Sk, II, 6, p. 64). D’après le contexte, on peut
comprendre que le mot pommes sert à désigner un aliment très simple et bon
marché, ce qui n’est pas le cas de la pomme de terre en France au XVIIe siècle: la
propagation de ce légume ne devient massive qu’à l’extrême fi n de l’Ancien Ré-
gime14. Dans la cuisine polonaise de cette époque, les pommes de terre n’étaient
pas populaires non plus. Dans les maisons des aristocrates ou des riches bour-
geois, on mangeait surtout de la viande, et la base de l’alimentation du peuple était
le navet, que l’on peut considérer comme le prédécesseur de la pomme de terre
d’aujourd’hui15. De plus, l’utilisation du terme pomme comme ellipse de pomme
de terre est un phénomène qui n’est apparu qu’au XXe siècle16, ce qui suggère que
le traducteur a commis un anachronisme.
En ce qui concerne les boissons, dans la maison d’Harpagon, leur choix n’est
pas très grand et on parle seulement de l’eau (A, I, 4, p. 45) qui dans la traduction
devient toujours woda (Sk, I, 5, p. 41), et du vin (A, III, 1, p. 88) traduit par wino
(Sk, III, 5, p. 78).
LA TRADUCTION DES NOMS DE PLATS
Les plats sont un des éléments les plus spécifi ques de chaque peuple, et pour
cela, leurs noms sont diffi ciles à traduire. Dans les pièces analysées, certains ter-
mes ne posent aucun problème. C’est le cas du mot rôt (A, III, 1, p. 85) qui signi-
fi ait jadis le rôti17. L’équivalent utilisé par Żeleński, pieczyste (Sk, III, 5, p. 75),
est tout à fait correct.
Le passage suivant est par contre un nouvel exemple des diffi cultés que la
gastronomie peut poser au traducteur:
(2) Dorante: […] un pain de rive, à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement
sous la dent; d’un vin à sève veloutée, armé d’un vert qui n’est point trop commandant;
d’ un carré de mouton gourmandé de persil; d’une longe de veau de rivière, longue comme
cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d’amande; de perdrix rele-
vées d’un fumet surprenant; et pour son opéra, d’une soupe à bouillon perlé, soutenue d’un
jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux, et couronnée d’oignons blancs, mariés avec
la chicorée. (BG, IV, 1, pp. 376–377)
14 J. Carpentier et F. Lebrun (dir.), Histoire de France, Éditions du Seuil, Paris 1992, p. 220.
15 M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1994, pp. 120–124.
16 A. Rey (dir.), Le Grand Robert de la langue française, t. V, 2e éd., Dictionnaires Le Robert,
Paris 2001, pp. 930–932.
17 Ibidem, t. VI, p. 23.
imprimatur_R_LV.indd 91imprimatur_R_LV.indd 91 2008-10-13 15:27:502008-10-13 15:27:50
Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%