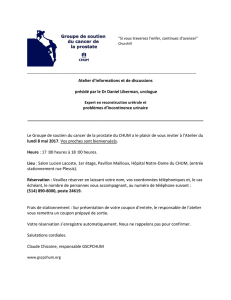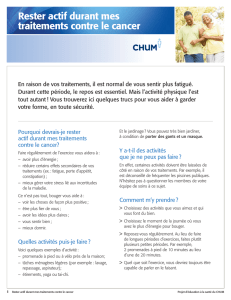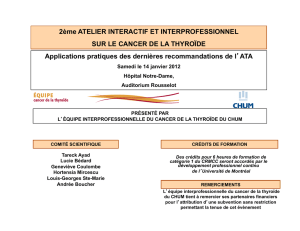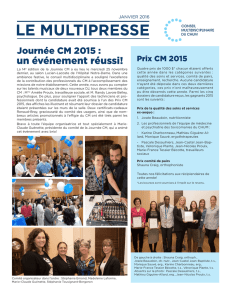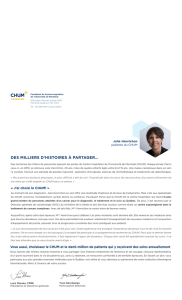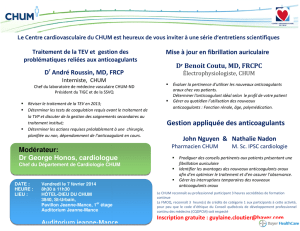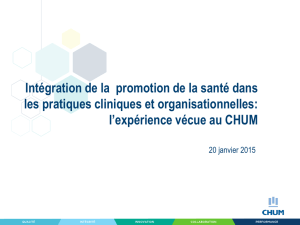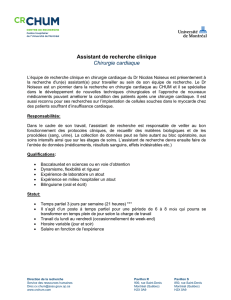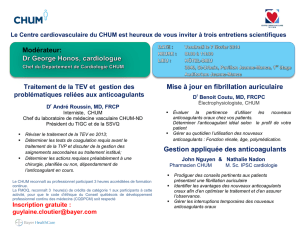2012 Volume 3 Numéro 1 : Des nouvelles du

Centre hoSpitalier de l’UniverSité de Montréal volUMe 3
·
nUMéro 1
·
2012
Amélioration continue : six exemples
La malnutrition à l’hôpital, on s’en occupe
Littératie : un enjeu
DOSSIER
CANCER,
AXE STRATÉGIQUE
L’énucléée
MARATHONIENNE
Quelle profusion d'énergie chez
cette patiente, Isabelle Auger qui,
atteinte d'un cancer, a perdu un
oeil et a entrepris de s’entraîner
pour un marathon, après son
opération.
Son histoire en page 22.

chumagazine est publié par la
Direction des communications du CHUM
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1T8
ÉDITRICE
Ève Blais
RÉDACTRICE EN CHEF
Camille Larose
COLLABORATION
Sandra Aubé, Clara Baron, Lise Boisvert, Lyne Bourbonnais,
Manon Bélanger, Éloi Courchesne, Julie Desbiens,
Geneviève Frenette, Amélie Giguère, Sylvie Lafrenière,
Valérie Lahaie, Nathalie Léveillé, Pauline Maisani,
Natalie Pinoteau, Sylvie Vallée
CONCEPTION GRAPHIQUE
André Dubois
CONSEILLER GRAPHIQUE
André Bachand
PHOTOGRAPHES
Stéphane Lord (page couverture), Stéphane Gosselin,
Dominique Lalonde, Luc Lauzière
RÉVISION
Annie Kobril, Johanne Piché
IMPRESSION
Imprimerie Moderne
chumagazine est publié six fois l’an, tous les deux mois.
Les textes et photos doivent parvenir à la rédaction six
semaines avant la parution du numéro bimestriel.
Sauf pour les infirmières, le masculin est utilisé dans les
textes afin de faciliter la lecture et désigne aussi bien les
hommes que les femmes.
Les articles du chumagazine peuvent être reproduits
sans autorisation, avec mention de la source. Les photos
ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
DISPONIBLE SUR L’INTRANET DU CHUM
Accueil/dc/publications/chumagazine/volume3numéro1
DISPONIBLE SUR LE WEB
chumagazine.qc.ca
ISSN 1923-1822 chumagazine (imprimé)
ISSN 1923-1830 chumagazine (en ligne)
POUR JOINDRE LA RÉDACTION, COMMENTAIRES
ET SUGGESTIONS
514 890-8000, poste 23679
INTERNET
chumontreal.com
ActuAlitéS
Yvan Gendron, nouveau directeur général associé ..................................................... 4
Enseigner à s’auto-injecter ...................................................................................................... 5
Un numéro unique pour prendre rendez-vous ............................................................... 28
Délégation expérience patient ................................................................................................. 29
Clinique de procréation assistée ........................................................................................... 30
RubRiqueS
Édito ....................................................................................................................................................... 3
Interventions ainées ..................................................................................................................... 9
RUIS ........................................................................................................................................................ 9
Commissaires ................................................................................................................................... 12
La page de la Fondation ............................................................................................................. 13
La page de la recherche .............................................................................................................. 14
Agrément ............................................................................................................................................. 23
Nouveau CHUM ................................................................................................................................ 24
Planification stratégique ............................................................................................................ 26
C.A. ......................................................................................................................................................... 27
Brèves
................................................................................................................................................... 28
Félicitations ....................................................................................................................................... 30
À LA UNE
L’ENJEU
de la littératie en santé
Pages 10 et 11
AMÉLIORATION CONTINUE :
6 exemples
Pages 6 et 7
MALNUTRITION, on s’en occupe
Page 8
DOSSIER
CANCER : AXE STRATÉGIQUE
Pages 16 à 22
Formé de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc, au cœur de Montréal, le CHUM
est le plus grand centre hospitalier universitaire francophone en Amérique du Nord. À ce titre, il occupe
une place prépondérante dans l’application d’approches de soins novatrices, dans la recherche de nouvelles
connaissances, de même que dans la transmission du savoir auprès des professionnels et des futurs
professionnels de la santé.
En plus d’accueillir la clientèle adulte de son territoire désigné, le CHUM reçoit des patients de partout au Québec
dans les spécialités où il possède une expertise reconnue, notamment en oncologie, maladies cardiovasculaires
et métaboliques, neurosciences, médecine des toxicomanies, hépatologie (spécialité des maladies du foie),
transplantation d’organes, plastie de reconstruction y compris les soins aux grands brûlés et, plus récemment,
en gestion de la douleur chronique.
Structuré en grandes unités cliniques regroupant plusieurs spécialités, le CHUM place le patient au cœur de
son action et vise à ce que chaque geste de chaque intervenant tienne compte de ce grand principe. Une réalité
qui sera de plus en plus tangible grâce à la construction du nouveau CHUM, au 1000, rue Saint-Denis, et de
son centre de recherche avoisinant, où médecins, chercheurs et autres professionnels de la santé travailleront
côte à côte sous un même toit.
le pAtient eSt Au cœuR De notRe Action
(et en page couverture de chumagazine).
Hôtel-Dieu Du cHuM
3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2W 1T8
HôpitAl notRe-DAMe Du cHuM
1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1
HôpitAl SAint-luc Du cHuM
1058, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3J4
un Seul nuMéRo De télépHone
514 890-8000
inteRnet
chumontreal.com

ÉDITORIAL
| CHUMAGAZINE | 3
Christian Paire , directeur général
Le CHUM
SE RENOUVELLE
Avec la construction du nouveau CHUM bien en selle, notre plan
stratégique fraîchement adopté et l’arrivée au CHUM de gens d’une
grande expérience, dont un nouveau directeur général associé,
notre centre hospitalier semble être entré dans une ère de renouveau.
Le CHUM bouge, change, se transforme…pour le mieux. Et nous
sommes les acteurs principaux de ce changement.
En déposant notre plan stratégique l’automne dernier, nous avons
opté pour un changement organisationnel majeur, au cœur duquel
se trouve notre positionnement clinique. Cancer, neurosciences,
cardio-métabolique, transplantation, musculo-squelettique
fonctionnel : cinq axes stratégiques cliniques, auxquels il faut
ajouter quatre axes transversaux : imagerie, technologies avancées,
génétique et bio-marqueurs ainsi que immunologie infectiologie.
Ces axes ont été déterminés selon plusieurs critères, et parmi eux,
un besoin important de soins auprès de la population, de même que
l’expertise unique dont nous disposons dans ces domaines.
Vous trouverez dans les pages qui suivent un premier dossier sur
l’un de nos axes stratégiques : celui du cancer. Rappelons que le CHUM
est le centre hospitalier québécois qui reçoit le plus grand nombre de
personnes atteintes de cancer pour diagnostic, traitements et suivi.
En tant que centre universitaire, le CHUM dispose d’une expertise
unique touchant certaines pathologies cancéreuses rares ou qui sont
particulièrement complexes. Nos chercheurs se consacrent à la mise
au point de traitements plus ciblés en cancérologie ; les étudiants en
apprentissage de leur profession chez nous sont formés par les meilleurs ;
nos 17 équipes interdisciplinaires, dont 14 ont reçu une reconnaissance
ministérielle, offrent les meilleurs soins à nos patients. Notre dossier
présente des exemples d’excellence dans l’axe du cancer. Il aurait pu
traiter de dizaines d’autres sujets tout aussi représentatifs de l’excellence
dont font preuve nos équipes en cancer, dont je suis personnellement
extrêmement fier.
Ainsi, notre plan stratégique est générateur de changement, tout
comme la venue de nouvelles personnes au sein de notre centre
hospitalier. M. Yvan Gendron, nouveau directeur général associé, est
entré en poste au début du mois de janvier. Notre conseil d’administration
a par ailleurs été renouvelé, ouvrant la porte à plusieurs nouveaux venus,
dont M. Alain Cousineau, élu au poste de président le 7 février dernier.
M. Cousineau a occupé, au cours d’une carrière remarquable, des
postes de haute direction, tant dans le milieu universitaire que dans
celui des affaires. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Je tiens finalement à souligner que si l’arrivée de gestionnaires
expérimentés ouvre de nouveaux horizons, l’expérience et l’expertise
de nos équipes, en place depuis 1, 5, 10, 15, 20, 30 ans et plus même,
est d’une valeur inestimable. Chaque membre du CHUM, avec son
bagage personnel et professionnel, est une composante essentielle de
notre identité. Votre expérience et vos connaissances contribuent à la
pérennité des soins de qualité, offerts jour après jour à nos patients.

4 | CHUMAGAZINE |
Nouveau directeur général associé
Yvan Gendron :
PRÊT À RELEVER LE DÉFI
ACTUALITÉS
Depuis le 9 janvier, le CHUM a un nouveau directeur général associé
(dg associé) : M. Yvan Gendron. Gestionnaire d’expérience du milieu de
la santé, dans lequel il fait carrière depuis plus de 28 ans, M. Gendron a
été attiré par le dynamisme du CHUM et les défis à relever afin de réaliser
avec succès notre transition vers nos nouvelles installations. Portrait du
nouveau dg associé du CHUM.
LE MILIEU DE LA SANTÉ, IL CONNAÎT
Détenteur d’une maîtrise en administration publique de l’École nationale
d’administration publique (ENAP), Yvan Gendron a commencé sa carrière
dans le milieu de la santé, où il a d’abord été préposé aux bénéficiaires à
l’Hôtel-Dieu avant d’y devenir, quelques années plus tard, chef du Service
de médecine nucléaire (1985 et 1988). Il connaît ainsi les rouages du système
hospitalier pour avoir côtoyé de près les patients, ainsi que les membres du
personnel. Au fil des ans, il a fait sa marque en tant que cadre supérieur et
consultant dans le milieu de la santé, tant au privé qu’au public. Il était jusqu’à
tout récemment président-directeur général (pdg) de l’Agence de la santé et
des services sociaux de la Montérégie. Il avait auparavant occupé les fonctions
de directeur général de l’Hôpital Charles LeMoyne et de directeur général
du CSSS Haut-Richelieu-Rouville, entre autres.
POURQUOI LE CHUM ?
Parce que le CHUM, le présent comme le nouveau, est un projet unique :
« pour la fierté, dit-il, d’être partie prenante de l’équipe qui nous conduira
dans nos nouvelles installations, pour le siècle à venir ». M. Gendron se
définit comme un visionnaire, aimant travailler dans la collégialité et
l’interdisciplinarité tout en apprenant constamment. La transformation
vers le nouveau CHUM est une occasion privilégiée de mettre ses intérêts
et compétences à profit, dans un milieu universitaire des plus stimulants,
alliant enseignement et recherche.
SON TRAVAIL DE DGA
Le directeur général associé relève directement du directeur général ; il est
responsable de la gestion des activités d’exploitation quotidiennes de l’hôpital.
Il chapeaute, en outre, toutes les fonctions administratives de l’organisation.
L’une des priorités de sa fonction : faire évoluer l’équipe de direction vers une
gestion plus imputable, autonome, moderne et décentralisée.
SA VISION, SA MISSION
À titre de dg associé, Yvan Gendron contribuera à la mobilisation de
l’ensemble de la communauté du CHUM, en route vers le nouveau CHUM.
Agent mobilisateur, il souhaite que chaque membre du personnel soit
accompagné de façon optimale dans le processus de transformation
des pratiques, la conduite de cette dernière étant l’un de ses principaux
mandats. Le projet de construction fait aussi partie des responsabilités de
M. Gendron , de même que la mise en application de recommandations
du directeur exécutif pour la réalisation du nouvel hôpital et de son centre
de recherche. À l'ouverture du nouvel hôpital, il devra s'assurer de la mise
en fonction d'un système d’information à la mesure des enjeux cliniques,
logistiques et de gestion d’un CHU de pointe et de renommée internationale.
Un défi de taille.

| CHUMAGAZINE | 5
ACTUALITÉS
Allergie et immunologie
De l’enseignement qui
CHANGE LA VIE
Plusieurs traitements et médicaments soignent et guérissent. Mais il
existe des maladies, dites orphelines, pour lesquelles il n’existe pas de
traitement curatif et s’il en existe, les effets secondaires sont pénibles
et nombreux. Ces maladies affectent peu de gens et la recherche
d’un médicament est plus limitée. Nous traitons dans cet article d’une
de ces raretés, l’angio-œdème héréditaire, qui est l’objet depuis plus
d’un an maintenant d’un enseignement particulier permettant aux
patients affectés de se traiter à domicile : une grande amélioration à
leur qualité de vie.
L’ANGIO-ŒDÈME HÉRÉDITAIRE
L’angio-œdème héréditaire est causé par une protéine manquante du
système immunitaire (le C1INH), en réalité héréditaire chez 75 % des
patients, spontané chez les 25 % qui restent, et se transmettant une fois
sur deux dans tous les cas. Quelque deux cents personnes atteintes de
cette maladie sont répertoriées, il est probable que d’autres ignorent
l’avoir. Ces personnes enflent spontanément et anormalement au
moindre traumatisme. Ce peut être relativement banal s’il s’agit d’un
genou, d’une épaule ou d’une lèvre, mais c’est très dangereux lorsque la
langue ou la gorge sont atteintes, jusqu’à causer la mort dans les pires cas.
Le Dr Benoît Laramée, allergologue suivant une vingtaine de tels patients,
dont une famille de Joliette depuis près de vingt ans, a récemment révisé
avec les urgentistes du CHUM les caractéristiques de la maladie afin de
bien la distinguer des autres formes d’allergie avec enflures qui nécessitent
un traitement, par exemple aux antihistaminiques, auxquels ne réagissent
pas les patients ayant une crise d’angio-œdème héréditaire.
Cette maladie a été découverte dans les années 1800, nous explique le
Dr Laramée, mais des chercheurs ont découvert qu’une enzyme du sang
déficiente était en cause, enzyme qui pouvait être extraite du sang de
donneurs et injectée pour remplacer celle déficiente des patients. Ce produit
sanguin existe depuis 30 ans. Il était disponible au Canada depuis une dizaine
d’années sur demande spéciale et est maintenant disponible partout. C’est
un produit cher (700
$
la fiole), administré par intraveineuse. On le donne à
l’urgence quand le patient est en crise, mais comme on connaît les facteurs
prédisposants, on le donne aussi en prévention. Ces facteurs sont le stress, les
infections, l’œstrogène lié à la période menstruelle (ces femmes ne peuvent
pas prendre de contraceptifs oraux qui contiennent trop d’œstrogènes, mais la
grossesse peut réduire beaucoup les crises) et tous les traumatismes : coup de
poing, chute, extraction de dent, etc. Certains patients doivent être injectés
jusqu’à deux ou trois fois par semaine, mais ce peut être toutes les deux
semaines ou tous les mois. La maladie se présente parfois dès l’enfance, le
plus souvent à l’adolescence. Cette épée de Damoclès rend leur vie leur vie
difficile, car ils sont souvent contraints de venir à l'hôpital pour recevoir une
injection intraveineuse qui demande chaque fois quelques heures de présence.
demande chaque fois quelques heures de présence. demande quelques heures.
APPRENDRE À S'AUTO-INJECTER
Depuis un peu plus d’un an, un enseignement est dispensé au CHUM
permettant aux patients de s’auto-administrer le produit. Cette liberté acquise
a profondément amélioré leur qualité de vie. En diminuant considérablement
la fréquence et la durée de leurs visites à l’hôpital, ces patients retrouvent
une vie beaucoup plus normale, ce qu’ils apprécient grandement.Cet
enseignement est donné par l’infirmière Suzanne Moreau qui travaille de
pair avec les allergologues regroupés à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM
qui suivent de tels patients, comme le Dr Laramée déjà cité, mais aussi les
Drs Martin Blaquière et Normand Dubé.
L’enseignement est individuel, dure de cinq à six semaines, à raison
de deux heures par rencontre, et dès le premier cours, le patient s’injecte
le produit. Il doit apprendre à remplir les demandes de produits à la
Banque de sang, comment manipuler les flacons, et très important, s’assurer
de la plus complète stérilité de la seringue et de l’environnement. Certains
rares patients ne peuvent recevoir l’enseignement, faute de la maturité
nécessaire et d’être suffisamment responsable, notamment concernant
l’asepsie. C'est néanmoins l'une parmi les nombreuses belles histoires du
CHUM, alliant la fine pointe technologique médicale et la compétence
empathique infirmière, pour le plus grand bénéfice de quelques patients.
Les patients affectés d’autres maladies rares, par exemple d’hypogamma-
globulinémie, une déficience immunitaire causant des infections à répétition,
bénéficient aussi d’un enseignement semblable, par l’apprentissage de
l’injection sous-cutanée.
L'infirmière Suzanne Moreau avec Mylène Verge, une patiente apprenant à s'auto-injecter un produit
sanguin par voie intraveineuse.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%