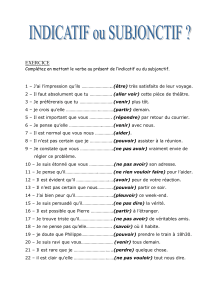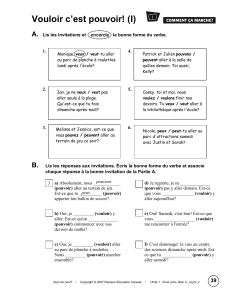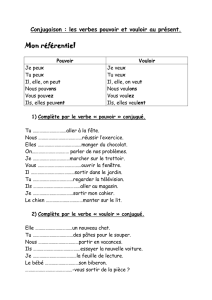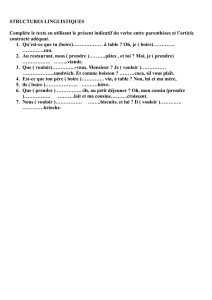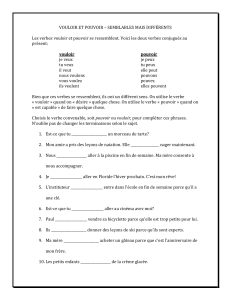Si Bondié lé

Si Bondié lé…
Philippe CHANSON
Théologien protestant (ancien aumônier de Cayenne)
(extrait de l’ouvrage « KOURAJ DI KRE LO NOU KREOL », 1996)
UNE FAMEUSE EXPRESSION
L’étranger qui a, comme moi, le privilège et l’opportunité de visiter et d’habiter ce beau
pays de Guyane, ne peut pas manquer d’être frappé par une expression culturelle créole
caractéristique qui revient si fréquemment à nos oreilles et que nous retrouvons également aux
Antilles françaises et jusqu’en Haïti. Une expression typique de trois mots aussi privilégiés
que conséquents, trois mots bien connus du patrimoine biblique, trois mots devenus formules
traditionnelles, trois mots qui rythment les conversations et clôturent pratiquement toute
salutation : « Si Bondié lé »
12
.
Depuis que j’entends prononcer et re-prononcer cette fameuse expression, à la fois je m’en
émerveille et m’interroge. Ces trois mots si souvent redits reflètent-ils un véritable contenu ?
Leur véritable finalité ? Leur « spiritualité » ? Ou bien l’expression glissant dans l’habitude, le
réflexe, s’est-elle réduite en formule langagière, rituelle, de pure convention ? Ou encore, plus
subtilement, gonflée d’imaginaire, ne se serait-elle pas muée, pour certains, en formule
superstitieuse, religieuse, carrément magique ? Enfin une telle expression, c’est clair, a tout
pour être porteuse de résignation et de fatalisme. Et je soupçonne fort__nous y
reviendrons__qu’elle peut être grosse d’abus et d’hypocrisie
3
.
La question, on le voit, est de taille. J’avoue que j’ai longuement hésité à m’y risquer, n’en
maîtrisant pas tous les tenants et aboutissants. Mesurant l’épaisseur inévitable des
incompréhensions aussi. Et je précise d’emblée que je ne vise pas à aller à l’encontre de cet
élément culturel coutumier. Loin de moi l’idée de renier et de m’opposer à l’emploi de ces
trois petits mots si riches de sens et de promesses. Par contre, c’est au courage de la
revendication de leur emploi que j’appelle et exhorte. Car la Parole nous y invite. C’est d’elle
que nous pourrons être dérangés peut-être, bousculés sans doute, entraînés à penser une
remise en question, certainement.
1
Des recherches personnelles sur l’expression « si Bondié lé » avaient déjà été menées pendant quelques mois
avant de risquer cette prédication. Après ce culte dominical, les réactions furent si vives qu’elles suscitèrent et
aboutirent à une enquête sur la question de l’emploi de cette formule auprès de la population de Cayenne
(enquête réalisée par la radio chrétienne locale RVLD et menée par un de ses animateurs Corneille Jacobs). Le
moins que l’on puisse en dire, c’est que les résultats confirmèrent tous les sens pressentis. On m’invita d’ailleurs
à commenter les réponses de la population interrogée lors d’une émission radiophonique consacrée au sujet.

« Si Bondié lé », en effet, est une expression aussi bien culturelle que biblique
4
. Difficile
pourtant de faire la part des choses et de déterminer avec exactitude si c’est la culture créole
qui a intégré la parole biblique ou si c’est la culture biblique qui s’est imposée à la parole
créole
5
. Même si l’on sait maintenant de source sûre que Christophe Colomb, malheureux
père du colonialisme caribéen, importa aussi avec lui la fameuse formule
6
. La symbiose est
totale. Le christianisme au cours des siècles et des avatars de son histoire mouvementée a
étroitement mêlé les fruits de la tradition biblique à ceux des traditions culturelles. Et les deux
traditions, d’essence orale, ont mêlé leurs mémoires. Elles ont été soigneusement transmises
et donc conservées.
LA TRADITION BIBLIQUE
2
Selon l’exégèse François VOUGA (aux pp. 123-124 de son commentaire sur L’épître de Saint-Jacques,
Genève, Labor et Fides, 1984), originellement, l’expression appartient autant à la piété grecque qu’à celle du
judéo-christianisme. Outre les textes du Nouveau Testament, on la rencontre en effet fréquemment chez Platon,
Epictète, et dans la communauté de Qumrân. Elle prend évidemment, dans tous ces textes, des sens différents.
Ainsi, au niveau des emplois de tradition grecque, dans le Phédon de Platon, il est question, comme chez Saint-
Jacques, de la seigneurerie de Dieu sur la vie et sur la mort : « Peut-on…soutenir que l’âme qui va dans un lieu
qui est comme elle, noble, pur, invisible, chez Celui qui est vraiment l’Invisible, auprès d’un dieu sage et bon,
lieu où tout à l’heure, s’il plaît à Dieu, mon âme doit se rendre aussi… » (80d). Dans l’Alcibiade, il est question
en revanche de la liberté humaine : « …sais-tu qu’elle est le moyen de te libérer de ton état présent ? – Oui, je le
sais – Quel est ce moyen ? – Je me libérerai si tu le veux, Socrate. – Ce n’est pas là ce qu’il faut dire, Alcibiade.
– Mais que dois-je dire ? – Si Dieu le veut… » (135d). Dans le Théétète, c’est des capacités personelles qu’il
s’agit « …garde-toi de dire jamais que tu n’en es pas capable ; car, si Dieu le veut et t’en donne le courage, tu
en seras capable » (151d). La perspective stoïcienne d’Epictète est évidemment autre : « Il faut disposer au
mieux de ce qui dépend de nous, et user des autres choses comme elles sont. – Comment sont-elles ? – A la
volonté de Dieu » (I, 1, 17). Il appartient ici au sage de ne s’attacher qu’à ce qui dépend de lui et de ne pas
dépasser la mesure de ce que permettent les dieux.
3. A relire la note qui précède, j’hésite à dire que l’expression biblique est plus ancienne que la tradition créole.
A première vue, je réfléchis fortement vers le oui, d’autant que c’est en référence avouée à la tradition biblique
que le créole prononce la formule. Mais pour en être tout à fait sûr, il nous faudrait savoir si les différentes
religiosités ancestrales africaines, d’où sont historiquement issus les esclaves caraïbéens, ne connaissaient pas un
tel équivalent.
4. Après recherche, j’ai découvert que l’expression avait en tout cas passé dans le créole via le christianisme
colonial des « découvreurs » de l’Amérique, à la fin du XVe siècle. Au vrai, dès mon arrivée en Guyane,
étonné par ce que j’estimais être un emploi abusif de la formule, j’avais naïvement pensé que « si Bondié
lé » provenait uniquement d’une certaine spiritualité évangélique importée par les missionnaires d’après-
guerre. Mais je remarquais bien vite que l’expression était aussi prononcée par les catholiques et par toute la
population locale de quelque bord religieux qu’elle soit. Ces constatations m’interrogèrent pendant
longtemps sur les origines de l’emploi du terme aux Antilles-Guyane jusqu’à la lecture du Journal de bord
de Christophe Colomb réédité à l’occasion des fastes__contestés__de la « découverte » de l’Amérique. La
réponse tomba alors toute seule. Les écrits journaliers de Colomb sont parsemés de « si Dieu veut ».
L’expression remonte donc de beaucoup plus loin et traversa l’océan déjà par ce biais. Cf. Christophe
Colomb, in La découverte de l’Amérique, tome 1 : Journal de bord. 1492-1493, trad. Par Soledad
Estorachj et Michel Lequenne, Paris, édit. La Découverte, 1993 : expression par exemple employée p. 45
(Mercredi 19 septembre : « le temps est bon, s’il plaît à Dieu, tout se verra en retour »), p. 161 (jeudi 11
octobre : « et, s’il plaît à Notre Seigneur, au moment de mon départ, j’en emmènerai [Colomb parle des
Indiens !] d’ici six à vos Altesses pour qu’ils apprennent notre langue »), p. 76 (vendredi 19 octobre : « Ce
que je veux, c’est voir et découvrir le plus que je pourrai pour revenir auprès de Vos Altesses en avril, si
Dieu le veut »). On note qu’à chaque fois l’expression est employée dans le contexte d’un déplacement.
Mais les cahiers de Colomb sont encore truffés de « grâce à Dieu » et de références à la « bonne volonté de
Dieu » (qu’il juge omniprésente) absolument pour tout ce qu’il entreprend, pour tout ce qu’il cherche (l’or
désespérément !) et pour tout ce qui lui arrive. Je ne cite même pas Colomb de manière sarcastique.
Simplement, l’aventurier vivait de la spiritualité de son époque, dans l’optique de l’Imago Mundi et de
l’Imago Dei répandues par le christianisme étatique extrêmement puissant de son temps.. Ce qui reste
étonnant, c’est la manière avec laquelle toutes ces formules sur Dieu ont été privilégiées par les esclaves et
leurs descendants (c’est frappant par exemple à travers la figure émouvante de « m’man Tine » du
magnifique roman de Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres

Sur le point qui nous concerne, prenons la tradition biblique tout d’abord. L’expression « si
Bondié lé » y est transmise six fois dans le Nouveau Testament : quatre fois par Paul dans le
cadre de ses projets de visites aux églises ; une fois dans l’Epitre aux Hébreux à propos d’un
projet d’enseignement ; et, texte plus probant, une fois dans l’Epitre de Jacques dans la suite
de versets bien connus où l’auteur replace les projets de l’homme dans la perspective du
temps qui s’écoule et de la mort qui pointe chaque destin. C’est cette dernière exhortation de
Jacques, la plus convaincante pour notre propos, que nous retiendrons et entendrons :
Jak 4. 13 – 17
13. Aprézan zot ki ka di : « Jod-la, - ou dimen – nou ké alé tel koté, nou ké rété oun lannen,
nou ké fè trafik, nou ké gangnen soumaké »,
14. Zot ki pa menm savé sa ki ké rivé dimen ! A ki sa ki zot lavi ? Zot kou oun lafimen ki ka
Paret pou oun ti moman épi ki ka disparet.
15. Miyò zot di : « Si Bondié lé », nou ké viv, nou ké fè si, nou ké fè sa ».
16. Mé zot ka vanté zot kò ; zot plen lògey. I pa bon pou vanté so kò kon sa.
17. Moun ki konnet fè sa ki bien é ki pa ka fè li, ka mété so kò annan péché.
LA TRADITION CREOLE
Voici donc pour la tradition biblique. Regardons maintenant du côté de la tradition créole.
Nous le ferons en écoutant les extraits d’un conte fameux récolté et retransmis par Marie-
Thérèse Lung-Fou, conte circulant aux Antilles-Guyane et mettant en jeu notre « si Bondié
lé ».
POUKI CHIEN PA KA PALE ANKO
An tan-tala, Bondié té ka désann asé souvan asou latè. I té ka vini wè Lasenn-Viej ki té ka
rété asou latè, é, i té ka profité di pasaj-li pou fè an ti tounen, gadé ki manniè lé-choz té ka
pasé. Yo té ka pran’y pou nenpot ki Béké pas i té ka abiyé kon yo : lenj blan bien anpézé, bien
ripasé, kas-li oubien pannama’y rilévé pa dèyè. I té ka jis pran baton bwa-makak li osi. Sé pa
mwen kay aprann zot ki sé an baton ki té ka palé : kan i té bizwen sav an bagay, i té ka mété’y
bò zorey-li é i té ka pozé ‘y lakèsion é baton-a té ka réponn li…Sa té vayan…Sé pa pies vié
Neg ki sé pé ni sa.
Anfen bref, Bondié té ka pwonmnen bod lanmè é chien’y té toujou épi’y pas sé té pou’y an
ami fidel. Mwen oubliyé di zot ki an tan-tala, chien té ka palé, mé sé manniè rapòtè’y ki fè si
jòdi i ped lapawol. An jou, Bondié té ka pwonmnen bod lanmè (…). I wè an nonm ki té ka
éséyé koupé an gwo piébwa, sé té an pié fwomajé. I dwet té ni bon laj pas fok té pasé an fisel
ki té ni omwens dis met alantou’y pou fè latouwonni’y. Kantapou branch-li, yo té ka rivé jis
anlè simitiè-a di an koté, é anlè lanmè pa lot koté-a. Anfen, piébwa-a li-menm té telman wo
akwèdi i té lé touché siel.
Bondié rété doubout an moman pou admiré’y…Wi, sé li ki té fè tou sa, é vwala i té an
admirasion douvan an si bel kréyasion…I gadé nonm-la ki té lé koupé’y la é i pansé : fout
nonm-tala kourajé pou ozé atatjé kò’y a an si gwo piébwa ki, pou siw, té ni san-tan pasé…A,
non boug-tala sé pa an kapon non pli, pas fwomajé sé piébwa zonbi, sé adan yo tout ka vini fè
saba-yo lannuit.
Bondié di : nonm-tala, sé an brav é, tou kontan, i pasé douvan’y, é i di’y kon sa :
__Bonjou, monfi, sé an bel piébwa ou ka koupé la-a…Sé sa yo pé aplé an kolos…Ki tan ou
kay pé rivé a bout li ?

__Dimen, réponn nonm-la an manniè sek.
Tjek tan apré sa, Bondié siflé chien’y, é yo pati pou alé fè an ti p^wonmnad…Siel-la té bel,
lanmè-a té klè. Alos, yo pwan chimen bod lanmè é yo rivé bò nonm-la ki, épi rach épi koutla,
té toujou ka éséyé koupé piébwa-a…Elas, i pòkò té antamé’y bien fon. I abo té ka frapé’y tout
fos-li, wap !, wap !, sé pa té gran choz i té ka rivé tiré asou’y…
Bondié, an pasan, di boug-la kon sa :
__Kouraj, mon-anmi, kouraj ! ! ! Ki tan ou konté fini ?
__Misié chè, biento, mwen ka espéré ki sé zonbi-a pa kay jennen mwen.
Bondié gadé nonm-la ; (…) poutan, an partan, i soukwé tet-li konsidiré té ni an bagay ki té
ka jennen’y…Bref, i di’y ovwè, i kontinié chimen’y é kan i rivé tibren pli lwen, chien-an tann
li ka di an dan’y :
__I ka di zonbi…Ki zafè di zonbi…
E non, konpè, sé pa zonbi ki kay fè’w ayen, mé lògey-ou pas tout tan ou pa kay di : s’il plâit
à Dieu, ou pa kay fini koupé piébwa-a.
Twa jou apré sa, Bondié lévé bonnè, é, a lafréchè, i pwan menm chimen-a pou alé fè an ti
pwonmnad, chien’y dèyè ka suiv li. I wè nonm-la ka souflé, ka swé déjà à lè-tala kon an
kannari chateny…E Bondié, kon lézot jou, arété :
__Bonjou ami ! Ba mwen nouvel travay-la.
__A misié, i kay pé fini biento s’il plaît à Dieu…
Bondié rété estébékwé, i di ovwè é i pati…Chien té douvan, ka kouri, ka soté. Bondié, kan i
rivé tibren pli lwen, di’y kon sa :
__Chien, vini isi. Sé wou, hen, ki palé é i ba’y an sel kout baton bwa-makak anlè tet ki dépi
jou-tala, chien ped lapawol é an sel bagay i pé di sé wa ! wa !
Nous voilà donc mis en face de nos deux traditions, biblique et culturelle, et surtout de deux
manières à la fois subtilement proches et éloignées d’employer la même expression : « Si
Bondié lé ». C’est ici un constat de surface qu’il nous faut maintenant approfondir avec, en
visée, cette interrogation : avec quel degré de réalité utilisons-nous, à tort ou à raison, cette
fameuse formule ? Ou, pour le dire plus trivialement : à quelle sauce l’employons-nous ?
Je suggère, pour tenter d’y voir plus clair, que nous partions tout simplement des trois
termes de la formule qui sont autant de questions et d’enjeux : celui du « si », celui du
« Bondié » et celui du « lé ». Et je postule__comme c’est le cas graphiquement et
grammaticalement__que c’est la question du « Bondié » qui est au centre et à partir de
laquelle tout s’articule. Qu’est-ce qui se passe quand je dis : « Bondié » ? Cela pose tout le
problème de ma perception de Dieu, de l’image que je m’en fais, et de ce que cela implique
finalement pour moi. La question du « lé » pose ensuite celle du vouloir de Dieu. Qu’est-ce
que ce vouloir diven ? Ce « bon plaisir » de Dieu ? Qu’est-ce que Bondié peut bien vouloir
pour moi et moi pour lui ? Puis il reste le premier terme, ce petit « si » gros de sens. C’est lui
qui peut faire basculer l’intention de la formule par ce qu’il peut sous-tendre d’indécision,
d’imprévisible, de conditionnel. C’est ce « si » qui décape la formule de son absolu : « Bondié
lé ! ». Quoi qu’il reste à déterminer s’il s’agit d’un « si » attaché entièrement au vouloir de
Dieu ou dépendant de mon propre vouloir. En d’autres termes, quel est mon « si » à moi ?
LA QUESTION DU BONDIE
Je veux donc d’abord m’interroger sur la question du « Bondié ». Non pas en une grande
envolée métaphysique. Ce n’est pas le lieu. Mais tout bonnement de manière pragmatique,
pratique. Oui, qu’est-ce qui se passe en moi quand je dis « Bondié » ? Qu’est-ce qui affleure à
ma pensée ? Quelle imagerie danse dans ma tête ou devant mes yeux ? Certes, ici, on ne peut
qu’effleurer. Car c’est une question qui traverse l’existence et qui, particulièrement aux

Amériques et aux Caraïbes, a à voir avec l’histoire coloniale. C’est bien pourquoi il nous faut
savoir quand même à quel Dieu nous avons affaire. Je propose que sur ce point nous nous
restreignions à cette alternative propre à mettre en lumière soit nos imaginaires religieux
enfermants soit notre espérance confiante et libératrice : crois-je au Dieu populaire présenté
dans le conte créole ou au Dieu de l’Evangile présenté par Jacques ?
Malgré l’adjonction typiquement créole du « Bon » à « Dieu », croyons-nous en effet, à ce
« Bondié » du conte qui, si on décrypte la symbolique satyrique et les règles de ce genre
littéraire, ressemble fort à l’ancien maître des habitations coloniales régissant sa main-
d’œuvre esclavagiste ? Ce Bondié terrible qui a tous les droits sur nous, qui exige une
obéissance aveugle, qui détient et défie notre liberté, le Bondié du bâton, qui frappe, qui
fomente nos peurs, le Bondié qui tient en réserve nos « Misère » et « Tracas », le Bondié
moraliste du savoir et du pouvoir blancs qui transpirent tant dans la culture, l’éducation et les
expressions créoles. Croyons-nous donc à ce Bondié-là ou croyons-nous au Dieu de
l’Evangile ? Le Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, le Seigneur de la joie et e la
liberté, le Christ de l’amour sans égal, le Dieu de la grâce qui ne comptabilise pas nos œuvres
bonnes pour les déduire sur les mauvaises au jour du malheur, l’Esprit miséricordieux qui
bannit la crainte, arme notre espérance et fortifie notre foi ? Oui, sous la coupe de quel Dieu
avons-nous été mis__ou nous nous sommes mis__par force colonisation et christianisation
parjures, mission, éducation, imagination ? Ou pour le dire encore autrement, dans quelle
image avons-nous enfermé ce Dieu dont on ne peut se faire une image ? Tout ceci ne peut
qu’entraîner à la réflexion et à un choix.
LA QUESTION DU « LE »
Regardons maintenant la question du « lé ». Grammaticalement, c’est clair. Dieu est le sujet
de ce « vouloir » dont il s’agit de comprendre le contenu significativement proposé dans cette
demande de la prière du Notre Père : « A sa to lé, ki divet fet » (« Que ta volonté soit
faite »)…Il est cependant immédiatement précisé : « …asou latè kou annan siel-a » (« …sur
la terre comme au ciel »).
Si ce vouloir concerne donc Dieu (« kou annan siel-a »), il renvoie cependant aux hommes
que nous sommes (« asou latè »). Mais qu’est-ce que Dieu peut finalement bien vouloir ? Sur
ce point, nous pouvons affirmer que toute l’histoire biblique nous oriente vers le fait que Dieu
ne veut pas tant quelque chose pour lui-même, pour son propre intérêt, que quelque chose
pour l’homme, pour l’intérêt de l’homme. La volonté bonne de Dieu a donc comme
fondement, comme substrat__nous pourrions même dire comme essence__le Bien de
l’homme, ce rappel de la création originaire : « Bondié wè ki sa té bon toubonnman » (« Dieu
vit que cela était bon »). Le Dieu bon veut donc la vie, la liberté, la paix, le bonheur et la
justice comme horizon ultime de l’homme et de l’humanité. En un mot, comme l’entendent
les expressions hébraïques qui traduisent cette volonté divine, ce que Dieu veut, c’est le salut
de l’homme. Telle est sa volonté immuable et inébranlable : aider à tendre au bien et libérer
pour sauver. Et même si ce bon plaisir de Dieu à sauver dut aller jusqu’au drame extrême du
sacrifice du Fils incarné. Que l’on se rappelle l’angoissante prise de conscience du Christ
avant sa mort dans le jardin de Gethsémané : « Pa sa mo lé, mé sa to lé ! » (« Non pas ce que
je veux, mais ce que tu veux !).
Ce n’est alors qu’à partir de cette volonté inaliénable de Dieu, incarnée par Jésus, que l’on
pourrait parler de la volonté permissive de Dieu qui est cette liberté que Dieu laisse à
l’homme d’accepter ou de se soustraire à sa volonté. C’est là une volonté par laquelle, en
quelque sorte, Dieu s’est lié par le statut de créature libre et responsable qu’il a conféré à
l’homme selon sa volonté.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%