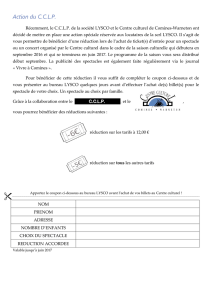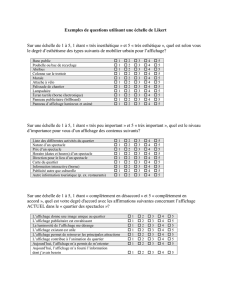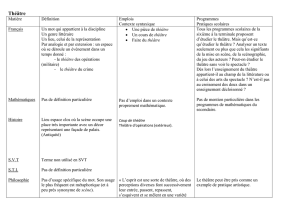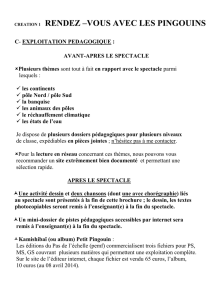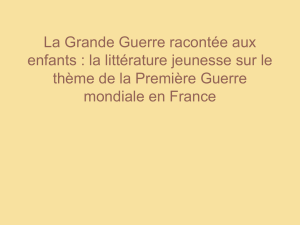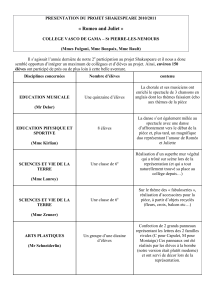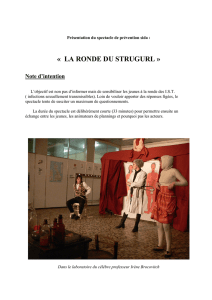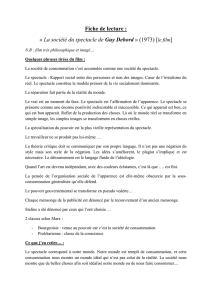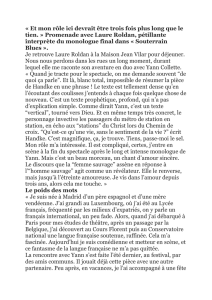Théâtre Océan Nord

Océan Nord
Théâtre
Journal n° 45
Notre tâche ( ou bien
tout le reste sera
pure statistique et
affaire d'ordinateur )
est de travailler à la
différence.
Heiner Müller
P204134 / Bimestriel / novembre-décembre 2010
BELGIQUE -BELGIE
P.P.
Bruxelles X
1/2799
02 216 75 55 info@oceannord.org 63-65 rue Vandeweyer 1030 BRUXELLES www.oceannord.org
L’équipe
direction artistique
Isabelle Pousseur
images et divers
Michel Boermans
administration
Patrice Bonnafoux
communication, relations publiques
Julie Fauchet
coordination Julie Robert
organisation Journées-Rencontres,
relations avec le public scolaire
et associatif
Emmanuelle Lê Thanh
régie générale Nicolas Sanchez
stagiaire régie Aurore Bolssens
intendance Mina Milienos
interview Alain Cofino Gomez
traduction néerlandais
Sari Middernacht

L’équipe
direction artistique
Isabelle Pousseur
images et divers
Michel Boermans
administration
Patrice Bonnafoux
communication, relations publiques
Julie Fauchet
coordination Julie Robert
organisation Journées-Rencontres,
relations avec le public scolaire
et associatif
Emmanuelle Lê Thanh
régie générale Nicolas Sanchez
stagiaire régie Aurore Bolssens
intendance Mina Milienos
interview Alain Cofino Gomez
traduction néerlandais
Sari Middernacht
Le journal du Théâtre Océan Nord est imprimé par Vervinckt. Editeur responsable, photo couverture, graphisme : Michel Boermans.
novembre-décembre 2010 / page 4
Tarifs plein : 10 €
réduit : 7,50 €
(seniors, chômeurs, étudiants)
hyper-réduit : 5 €
(professionnels, groupes)
art 27 : 1, 25 €
Théâtre partenaire du réseau chèques Accès
Culture de la Sabam
Paiement uniquement en liquide
réservation 02 216 75 55 info@oceannord.org
Le Théâtre Océan Nord est subventionné par le Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre. Il reçoit en outre le soutien de la Commission Communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF) : Service Cohésion sociale, du Centre pour l'égalité des Chances et la lutte contre le Racisme-Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés.
Faim
de spectacle ?
Le bar du Théâtre vous accueille
45 minutes avant les spectacles
et bien sûr après ceux-ci.
Vous y trouverez
boissons chaudes et froides
et petite restauration
selon l'humeur du jour...
2010/2011 au Théâtre Océan Nord
Gare du Nord
rue de Brabant
Océan Nord
place
Liedts
rue Gallait
rue des Palais
rue
Vandeweyer
ch. de Haecht
maison
communale
rue Royale St Marie
St Servais
arrêt St Servais : tram 92
arrêt pl. Liedts : 25 / 33/55/94
rue d’Aerschot
Qu'est-ce que cee bizarrerie qu'on appelle l'âme?
Bergman nous propose d'entrer dans le champs de
bataille de l'intimité d'une femme, incarnée sur la
scène du théâtre schaerbeekois par deux visages
complémentaires. (...) Victoria, c'est la femme en
morceaux. Est-ce une comédienne ou une malade
mentale? Pourquoi pas les deux, suggère Bergman
chez qui tout est possible.
N.Crousse - 7/12/2010 - LE SOIR
MB
30/11 > 11/12
Aaire d’âme (reprise)
Ingmar Bergman / Myriam Saduis
Carmen, une passion mythique, un amour qui
embrase tout et… une narratrice qui manipule
objets et marionnees. Carmen est gurée par une
petite poupée folklorique espagnole, Don José par
une gurine militaire articulée. Un univers plastique
kitsch, amboyant : robe amenca, castagnees et
taureaux aux yeux rouges.
Carmen
La Compagnie Karyatides
21 > 23/12
01 > 12/02
Les poissons rouges
Martin Crimp & Peter Handke
Virginie Strub
Connaissez-vous la blague du poisson rouge? Les
biologistes ont découvert que le poisson rouge a
une mémoire d’environ deux secondes. Or donc :
Un poisson rouge tourne dans son bocal en faisant
des bulles, quand soudain, il tombe sur un caillou.
« Qu’est-ce donc ? Un caillou ! Que faire ? Le
contourner ! Hop ! » Deux secondes plus tard, le
poisson rouge a refait le tour du bocal et une série de
bulles, et il retombe sur le même caillou. « Qu’est-ce
donc ? Un caillou !... » Connaissez-vous la tragédie
humaine ? Les anthropologues ont découvert que
l’homme avait une mémoire collective d’environ
cinquante ans. Or donc : ….
Simon Tanner, dans Les enfants Tanner, ne faisait
que raser les murs et passer par des trous. Il ne voulait
prendre sa forme dénitive que le plus tard possible.
Jacob, dans L'Institut Benjamenta, pousse la
logique plus loin : n’ayant, en dénitive, aucun but
pour lui-même, il en arrive à ne plus désirer se régler
que sur les intérêts d’autrui et à s'annuler totalement
au prot du service. Jacob, dont le rêve serait d’être
un zéro tout rond, et l’Institut Benjamenta, dont
la vocation est de fabriquer des zéros à la chaîne,
nissent par s’accorder parfaitement l’un à l’autre.
22/03 > 02/04
L'Institut Benjamenta
Robert Walser / Nicolas Luçon
Ajuste tes pensées petite sœur met en scène la
rencontre d’Alma et Myriam, deux nouvelles
pensionnaires dans un hôpital psychiatrique et de
leurs deux inrmières. Tout aurait pu se passer selon
les lois de la médecine si Alma n’avait pas refusé sa
médication. Un accident thérapeutique qui prend la
tournure d’un étrange road trip où se mêlent ction
et réalité.
24/05 > 04/06
Ajuste tes pensées
petite sœur
Les Deux Frida asbl
Sarah Brahy & Aline Mahaux
Le PASS à l'acte
Une aventure pour les élèves de 5ème et 6ème
secondaires, à la découvrerte des multiples formes
du théâtre contemporain. Un parcours qui permet
également de découvrir diérents lieux culturels.
Le PASS à l’acte réunit quatre théâtres
bruxellois : le Rideau de Bruxelles, Les Tanneurs,
le KVS et le éâtre Océan Nord.
Outre 4.48 Psychose, les partenaires de ce PASS
pourront découvrir Hamelin de Juan Mayorga,
mis en scène par Christophe Sermet (Rideau de
Bruxelles), Bezee stad / Ville occupée de Jeroen
Perceval, mis en scène par Ruud Gielens, d’après le
texte de Paul Van Ostaijen (KVS) et I would prefer
not to, mis en scène par Selma Alaoui, d’après les
œuvres de Guyotat, Melville et Witkiewicz (Les
Tanneurs). Diérents ateliers, à la fois réexifs et
pratiques seront proposés aux élèves.
Prix du PASS : 35 € par élève.
Renseignements : Emmanuelle LÊ THANH
02 242 96 89
Ingmar Bergman : images inédites
4/12 JOURNÉE-RENCONTRE
ANIM'ACTION
Un programme de la Commission communautaire
française qui vise à développer des projets culturels
dans les écoles francophones de la Région
bruxelloise.
Le premier projet Anim'action que proposera
Océan Nord s’élaborera avec le Lycée Emile Max
et les artistes de L’Institut Benjamenta. Il sera
présenté lors de la Journée-Rencontre organisée
en marge de la mise en scène de Nicolas Luçon.
Le second réunira le Rideau de Bruxelles,
l'Institut Notre-Dame des Champs et l'Institut
Saint-Luc. Il portera sur l’auteur Robert Walser et
sera alimenté par L’Institut Benjamenta et RW
(premier et deuxième dialogue) mis en scène par
Pascal Crochet au Rideau, présentations au éâtre
Océan Nord les 7 et 8 mai.
5/02 JOURNÉE-RENCONTRE
26/03 JOURNÉE-RENCONTRE
28/05 JOURNÉE-RENCONTRE
S.Lozet
Prix de la critique 2009 : Meilleure découverte.
A.Blanquart
Laufenauer
Loin des interprétations morbides trop souvent
aachées à l’univers de Sarah Kane, Isabelle Pousseur
nous propose une lecture lumineuse de cee pièce qui
parle, certes, de dépression et de suicide, mais aussi et
surtout d’amour et de liérature.
J-M Wynants - 20/03/ 2008 – LE SOIR
MB
21/09 > 9/10
4.48 Psychose (reprise)
Sarah Kane / Isabelle Pousseur
Prix de la critique 2008 : Meilleur spectacle,
Meilleure interprétation, Meilleure scénographie.
PENSER
CONVERSATION
LE THEATRE
OUVERTE
Deux Conversations Ouvertes sont
prévues en deuxième partie de
saison en présence de Michel Dupuis
(philosophe à l’UCL et à l’ULg,
vice-président du comité consultatif
de bioéthique) et de Paul Camus
(meeur en scène et comédien) sur la
question d'un théâtre juste, dénitions
et conséquences.
NOUVEAU !
Chaque mercredi (représentation à 19h30)
RENCONTRE APRES LE SPECTACLE
entre équipe artistique et public.
ANIMATIONS
En amont des spectacles, le éâtre Océan
Nord propose des ANIMATIONS. Elles sont
destinées aux associations et écoles et permeent
de préparer le public à une représentation. Notre
animatrice se rend dans votre institution.
N.Luçon
MB

novembre-décembre 2010 / page 2
Le rendez-vous avec Virginie est xé chez elle. C’est
visiblement un endroit de bouillonnement dramatur-
gique. Sur un mur une esque occupe l’espace ; c’est le
spectacle dessiné en une suite de tableaux graphiques.
D’emblée on devine un mouvement fait de glissements
parfois dramatiques parfois amusés.
Alain Cono Gomez – Où en es-tu de ton ap-
proche du spectacle à venir ?
Virginie Strub – Je suis en n de travail prépara-
toire… quelques jours avant le travail de plateau
et la mise en route, donc, de la création.
A.C.G – Quelle est la matière à partir de laquelle
tu bâtis Les poissons rouges ?
V.S – Deux textes sont à la base du spectacle. Une
trilogie de Martin Crimp (Ciel bleu ciel, Face au
mur et Tout va mieux) et Prédiction de Peter Hand-
ke. Pour résumer l’idée de cee réunion de textes,
je dirais que l’un, le Crimp, me sert de couplet tan-
dis que l’autre, le Handke, serait plutôt le refrain.
Il y a donc deux niveaux spéciques de narra-
tion. Mais à ces deux éléments viennent s’ajouter
d’autres couches dramaturgiques. Il ne s’agit pas
de texte à proprement parler, ni de « parler » au
sens strict… une partie sans le son, en somme, qui
vient s’ajouter à la structure. Je suis donc occupée
à mere en place une articulation à plusieurs ni-
veaux, assez complexe pour au nal donner à voir
et surtout à ressentir quelque chose d’assez simple.
A.C.G – D’où sans doute ce travail graphique
accroché à ton mur qui ressemble à la BD du
spectacle ?
V.S – C’est un peu le synopsis visuel de ce qui
va se tramer sur la scène. Il y a un jeu de couches
successives et d’évolution parallèle de récits divers
dont il est dicile de se rendre compte autrement
que par cee mise à distance dessinée. On y voit
esquissés une voiture et des personnages en l de
fer qui s’agitent…
A.C.G – Comment en es-tu arrivée à cee accu-
mulation de textes et de récits parallèles ?
V.S – Dans un premier temps, je voulais prolon-
ger le travail de fond et de forme amorcé au tra-
vers de mon premier spectacle, Les amantes. Sur
le fond je voulais continuer mon observation de la
nature humaine et de son mécanisme profond. Ce
qui m’intéresse, ce sont les fonctionnements plus
que les résultantes. Mais je voulais élargir cee ré-
exion. Dans mon premier spectacle il s’agissait
d’observer un groupe sociétal réduit, la famille et
le couple, ainsi que ses rapports au pouvoir. Ici, il
sera question de la notion de société qui appelle
à l’idée du groupe de façon plus étendue et plus
générale. Le propos est de continuer l’explora-
tion la dynamique humaine dans le groupe. Et en
ce qui concerne la forme, je voulais pousser plus
loin mon travail sur l’oralité. C'est-à-dire que pour
moi le son peut faire sens à lui seul ; parfois il fait
même plus sens que le fond. Ce qui m’intéresse
encore ici c’est de montrer le comment et pas le
pourquoi. De jouer des questions du langage, du
discours, de l’oralité et du son qui fait sens. S’il de-
vait y avoir une étape suivante à mon parcours, un
troisième spectacle, il se pourrait qu’il soit muet,
qu’il s’agisse d’un spectacle totalement sans le
son. J’ai envie de gommer tout commentaire. Bon,
cela donne une idée sur ce qui a pu m’amener à
réunir toutes ces sources textuelles dans un seul
spectacle. Je veux dire que lorsque j’ai rencontré
chacun des textes, je me suis dit que c’était exacte-
ment le bon support pour aller plus loin dans ma
recherche de meeur en scène. Et c’est justement
le terreau de mes réexions qui a rendu possible
la rencontre de ces deux textes, leur imbrication
dans un même spectacle. Je suis certaine qu’ils
parlent de la même chose, qu’ils se complètent
même en quelque sorte. Les trois textes de Crimp,
sont un peu comme trois cadavres exquis qui met-
tent en scène des personnages dont on ne sait rien
et dont tout l’intérêt réside non pas dans ce qu’il
raconte, mais dans le comment il raconte. À l’inté-
rieur de chacune de leurs prises de parole, les per-
sonnages de cee trilogie relatent une succession
de prises de pouvoir des uns sur les autres. On as-
siste ainsi à trois déclinaisons où le langage est le
cheminement de pensée lui-même, et non plus sa
traduction. Les protagonistes ne dialoguent pas,
ils construisent ensemble un cheminement de
pensée, un puzzle, une sorte d'équation ; ils n'ont
donc pas chacun un langage propre, mais ils uti-
lisent et déplacent des pièces de puzzle, des don-
nées d'équation, les mêmes pour tous, an de créer
collectivement un trajet qui les mènera «quelque
part». C'est comme si on voyait en direct des neu-
rones travailler. Et si un neurone meurt, un autre
reprend sa fonction telle quelle. Je rebondis sur
cee image de l'équation qui se retrouve à l'échel-
le de tout le spectacle : si on schématise ce qu'est
la vie en groupe, à petite échelle ou à l'échelle de
l'humanité, on peut dire que le jeu est de choisir
et de dénir une équation qui comporte toujours
les mêmes variables indispensables … Qui sont
les nôtres ? Qui sont les autres ? Quel est le juste ?
Quel est le faux ? Quelle est notre perception de la
réalité, et quelles sont les «vérités» qu'on en tire ?
… plus toutes les pulsions et passions humaines,
la peur, l'instinct de domination, le désir, le besoin
de croire en quelque chose, etc. On peut faire des
tas d'équations diérentes avec ça, mais les varia-
bles fondamentales sont toujours les mêmes. Et
bien, quelle que soit l'équation qu'on en tire, on va
aboutir, plus ou moins vite, avec une violence plus
ou moins exprimée, à la même chose. C'est ce que
je fais dans le spectacle : trois équations complète-
ment diérentes, comme les trois textes de Crimp,
et qui pourtant aboutissent à la même chose.
A.C.G – Mais il y également du Peter Handke ?
V.S – Oui ! Il s’agit d’une partie de son célèbre
texte, Outrage au public. Cela prend la forme d’une
longue liste assez répétitive construite autour
d’une même phrase dont seuls varient le sujet et
le complément. Il y a un côté hypnotique à cee
construction poétique et formelle. Au-delà du fait
que ce texte raconte notre invariabilité et notre in-
terchangeabilité face à la mort, c’est également un
support formidable pour donner à sentir le pou-
voir du langage. Je l’ai donc utilisé comme liant
dramaturgique et musical entre les trois variations
sur le thème de l’impasse de la condition humaine
et du groupe que sont à mes yeux les textes de
Crimp.
A.C.G – Je pressens, dans ce que tu dis là, com-
me le développement d’une démonstration ?
V.S – La clé de voûte de tout le contenu du specta-
cle, et de toute ma recherche en tant que meeur
en scène, c’est la question du langage, de l'oralité.
C'est lui qui nous diérencie des animaux, et c'est
derrière lui qu'on se dissimule pour croire et faire
croire que nous ne sommes pas des animaux. Alors
que nous le sommes ; nous avons juste un outil en
plus pour «noyer le poisson». Dans mon travail,
je cherche, dans la forme, à voir jusqu'où je peux
pousser ce langage, et surtout qu'est-ce qui le dé-
nit et le fait fonctionner. Dans le contenu, je cher-
che à montrer ce qu'il est, sa place, son pouvoir,
je cherche à le magnier autant qu' à le dénon-
cer. C'est ce qui m'a plu chez Peter Handke, car
c'est exactement ce qu'il fait, Martin Crimp aussi
d'ailleurs. Ils jouent tous deux de ce que j'appelle
«la part manquante» comme révélateur. Cee
«part manquante», c'est tant de ne pas consom-
mer l'imaginaire du spectateur que d'ôter une des
composantes habituelles du langage ; c'est enle-
ver un bout, pour que tout apparaisse. Mais je ne
donne pas à consommer dans un spectacle… Je
ne consomme rien sur le plateau, j'expose, de fa-
çon très pure et symbolique, des pièces de puzzle
qui peuvent se voir et se combiner à des niveaux
et sous des angles diérents. Dans ce sens, j’ex-
pose plus que je ne démontre…
A.C.G – Mais ce qui est exposé touche égale-
ment de manière précise à l’actualité, en tout
cas à ce que l’Europe semble vivre présente-
ment, non ?
V.S – J’ai la sensation qu’aujourd’hui, en 2010,
on trouve les mêmes réponses aux mêmes pro-
blèmes. Il y a par exemple des systèmes de pensée
qui se développent aujourd’hui que je trouve as-
sez monstrueux et erayants. Ils ressemblent à s'y
méprendre à ce qui se pensait au début des années
trente. Cela se fait comme s’il s’agissait de pen-
sées qui viennent de naître, qui surgissent, alors
que l’Histoire dément cee prétendue originalité.
Cela me donne d’étranges impressions de déjà vu.
C’est bien entendu une vue de l’esprit puisque je
n’ai pas connu les années trente. Mais je trouve
cela intrigant et je me suis beaucoup interrogée
là-dessus. Je dévore des livres entiers d’anthropo-
logie pour constater que l’être humain fait et refait
les mêmes choses et qu’il ne peut pas s’en rendre
vraiment compte parce que les événements aux-
quels il pourrait se référer se sont déroulés un peu
trop tôt. À une époque que sa mémoire ne peut
pas aeindre. Cela pose une question fondamen-
tale sur la mémoire du groupe et sur le côté cy-
clique de notre comportement d’espèce. Je veux
parler de cela, de ces cycles, de ces structures de
comportement. Je veux parler de nous comme
d’un poisson rouge qui a une mémoire trop cour-
te pour s’erayer de sa propre condition et de sa
condamnation à reproduire son Histoire, de la fa-
culté qu’a notre espèce de tourner en rond dans
son bocal et de s’émerveiller de la perpétuelle re-
découverte de petits cailloux au fond de l’eau.
01 > 12 /02 / 2011
à 20 h30, mercredis 19 h30
relâche dimanche et lundi
Les poissons rouges Deux maîtres dans l’art de
questionner et critiquer le monde
avec nesse, humour et cruauté.
Martin Crimp (1956), auteur
britannique de nombreuses pièces, écrits
pour la radio et adaptations théâtrales.
Récompensé par plusieurs prix (John
Whiting Award for Drama 1993), il est
avec Sarah Kane l’un des rares dramaturges
du théâtre contemporain anglais qui ait su
anchir les ontières avec succès.
Peter Handke (1942) auteur
autrichien de multiples romans, scénarios,
pièces de théâtre, essais. Primé par de
nombreux grands prix liéraires autrichiens
et allemands, il réussit en 1966 une entrée
provocante avec sa pièce Outrage au public.
En 2006, il déclenche la polémique avec ses
écrits en faveur de la Serbie.
Road trip absurde qui voit des personnages dans
et autour d’une voiture tenter des variations
sur le thème du « groupe », de son essence et
de sa survie. Ce spectacle, espèce de Mon oncle
d’Amérique déjanté, nous demande, à nous
public, d’endosser le rôle de joyeux anthropologue
un peu voyeur. A la fois cynique, drôle et
erayant, c’est notre espèce, notre groupe d’êtres
qui est ausculté avec la science du théâtre comme
outil. La mise en abîme de notre animalité et
de nos cycles courts de mémoire collective est le
fond de recherche spectaculaire de cet étonnant
et viviant objet scénique.
Entretien avec Virginie Strub
Mise en scène Virginie Strub
assistée de Meryl Moens
Avec Jessica Gazon, Mathilde Lefèvre,
Viviane iébaud, Cyril Briant ,
Pedro Cabanas, Christophe Lambert,
Achille Ridol
Costumes et scénographie Anne Sollie
assistée de Ledicia Garcia
Création lumière, régie Nicolas Sanchez
Construction décor, régie plateau Christophe
Wullus assisté de Patrick Léonard
Son Iannis Héaulme
Traduc teurs Elisabeth Abgel-Perez
et Jean Sigrid
Avec l’aide du Ministère de la
Communauté française, Service du éâtre.
Un accueil en résidence du éâtre Océan Nord.
L’Arche est éditeur et agent théâtral des textes
représentés.
Création d’après Ciel bleu ciel, Face au mur et Tout va mieux de Martin Crimp
et Prédiction de Peter Handke
Mise en scène : Virginie Strub Kirsh Compagnie

novembre-décembre 2010 / page 3
Les « à-côtés »
Journée-Rencontre
Autour de Les poissons rouges
samedi 5 février entrée libre
Touchant à deux questions essentielles qui
traversent le spectacle, la construction identitaire
et le pouvoir du langage, cee Journée-Rencontre
vous proposera diérents moments, réexifs
et festifs ! Au programme : intervention d’un
anthropologue, échange avec l’équipe artistique
et concert d’improvisations-variations par Les
lles de Hirohito (Jean-Bastien Tinant et Daniel
Bajoit) autour des textes qui ont nourri la pièce.
De goudvissen
Creatie – Naar Whole Blue Sky, Face To e Wall
en Fewer van de Brit Martin Crimp en
Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke
van de Oostenrijker Peter Handke.
Regie Virginie Strub –
Een project van Kirsh Compagnie
De goudvissen i s g een t o neel b ewerk in g maar een
op het eerste zicht onmogelijke ontmoeting
tussen twee personaliteiten en twee toneeltalen.
Allebei zijn het meesters in de kunst van het
in vraag stellen en kritisch bekijken van de
wereld. Beiden manipuleren met een nesse,
ironie, humor en wreedheid de wapens van
de sensualiteit en de schoonheid van de taal.
De goudvissen, een kleine antropologische reis
onder vrienden.
NL
L’atelier pour acteurs professionnels HUBERT SELBY mené par Isabelle Pousseur
Le caniche arrosé s’en ira
la queue entre les jambes
comme un caniche arrosé.
Le pauvre diable se sentira
comme un pauvre diable.
La vache se tiendra devant
la clôture neuve comme
une vache devant une
clôture neuve.
Le coq régnera sur le
fumier comme un coq sur
le fumier.
Peter Handke Prédiction
Exposition
Les jours s’en vont, je demeure...
L’asbl Entr’âges restaure une dynamique de
l’échange entre les générations. Lors de l’année
scolaire 2009-2010, elle a chapeauté un projet
théâtral réunissant des personnes âgées et des
élèves de 4ème secondaire en Arts d’expression.
Un photographe a xé ces moments.
Qu’est-ce qui reste constant de moi, quel que soit
mon âge, avec le temps qui passe ?
Les spectateurs seront invités à mere par écrit
leur grain de sel dans cee réexion.
Ve r n i s s a g e, a t e l i e r d ’écriture : mercredi 2 février.
Expo visible durant la durée des représentations
du spectacle Les poissons rouges.
Partenaires Institut Notre Dame des Champs, Résidence
Augustin, Résidence Beeckman et Entr’âges.
Photographe Ian Dykmans .
Animateur atelier d’écriture Christian Merveille.
Depuis 10 ans, le éâtre Océan Nord n’avait plus
organisé d’ateliers pour acteurs professionnels. Dési-
reuse de relancer cee expérience j’ai proposé, cee
saison, un atelier réparti sur deux mois autour de
l’œuvre de Hubert Selby Jr Last exit to Brooklyn et
plus particulièrement son dernier chapitre intitulé
Coda. Cent septante personnes se sont portées can-
didates à cet atelier et pour des raisons d’organisa-
tion évidentes j’ai limité mon choix à septante d’en-
tre elles. Trente cinq ont travaillé durant tout le mois
de juin dernier, les trente cinq autres durant le mois
d’août. Le choix de cee œuvre d’Hubert Selby était
aventureux et risqué. Bien sûr j’éprouvais une sorte
d’intuition par rapport aux possibilités de théâtra-
lisation de ce texte, intuition basée principalement
sur l’existence d’une langue musicale, très orale et
sur la présence d’une structure polyphonique, dans
une unité de temps et d’espace : la vie d’un immeu-
ble d’un quartier pauvre de Brooklyn sur une durée
se situant très précisément entre le samedi matin
et le dimanche matin. Entre les deux, une journée
et une nuit, des disputes, des enfants qui braillent,
qu’on envoie à la rue où ils apprennent la guerre,
du sexe, fantasmé ou réel, des fêtes, de l’alcool, de
la drogue, de la solitude, de la méchanceté, de la
boue, beaucoup de violence et à travers cela, de
temps à autre des bouées d’humanité, des rayons
de chaleur dus au printemps qui arrive et s’installe,
sur les arbres et dans la douceur de l’air, malgré la
misère, la pauvreté, la violence.
Mais en choisissant ce texte je ne pouvais pas imagi-
ner à quel point il se révélerait un formidable trem-
plin, à quel point le passage de ce roman à la scène
allait mobiliser ces acteurs, les porter, les stimuler. Je
n’imaginais pas que nous tracerions autant de pistes
diverses, diérentes, chacune apportant un éclairage
singulier sur l’un ou l’autre aspect du roman, sur son
contenu aussi bien que sur sa forme.
Parmi les groupes qui se sont formés, il y a ceux qui
ont creusé la notion de communauté dans ce qu’elle
peut à la fois révéler d’hostilité et de solidarité, ceux
qui ont interrogé le couple, dans son animalité et sa
puissance conictuelle, ceux qui ont voulu rendre
compte du regard des enfants, ceux qui ont cherché
à exploiter la musique du texte, ceux qui ont cherché
les glissements, ceux qui ont mis en évidence la po-
lyphonie en faisant vivre en même temps plusieurs
familles dans un même espace, ceux qui ont imaginé
une sorte de parade fellinienne qui tournerait mal à
Coney Island, ceux qui ont construit (plus ou moins)
et ceux qui ont préféré rester en improvisation.
Il y a eu de la réalité, du quotidien, de l’onirisme, de
l’excès, de la performance, des petits bouts de lms,
de la danse, de la musique…
Il y a eu l’amour pour ces personnages de déchus,
inspiré de l’amour que Selby lui-même leur portait,
l’amour pour Mary, Vinnie, Mike, Irene, Abra-
ham, Nancy, Lucy, Ada… et pour tous les enfants
qui font déborder les baignoires ou enamment les
boîtes aux leres de la Résidence. Il y a eu de l’hu-
mour aussi, un humour qui soulageait, qui libérait,
rendant possible peut-être tout simplement le fait
que nous osions nous emparer de leur vie, de leur
détresse, de cee misère, et, dans le même temps,
de leur constante aspiration au bonheur. Pendant
deux mois je me suis sentie en état d’inspiration, et
de cela je ne peux qu’être immensément reconnais-
sante à tous ceux qui ont partagé cee aventure avec
moi. J’espérais leur apporter quelque chose mais ne
soupçonnais pas à quel point j’allais être stimulée et
nourrie par leurs propositions.
Elles vivent encore en moi, avec leur richesse, leur
générosité, leur audace.
Et je n’en ai pas ni avec Selby. Pas avant un bon
moment. C’est une certitude.
Isabelle Pousseur
Avec Guillaume Alexandre, Jean-Marc Ame,
Mathieu Besnard, Delphine Bibet, Marie Bos,
Sarah Brahy, Luc Brumagne, Raphaëlle Bruneau,
Pierange Buondelmonte, Pedro Cabanas, Del-
phine Cheverry, Muriel Clairembourg, Coraline
Clément, Zoé Coulée, Christian Crahay, Pau-
line d’Ollone, Jeanne Dandoy, Anne-Sophie de
Bueger, Angelo Dello Spedale, Marie Denys, Sibel
Dincer, Jasmina Douieb, Simon Duprez, François
Ebouele, Dimitri Fornasari, Estelle Franco, Joëlle
Franco, Hélène Gailly, Simon Gautiez, Stella Giu-
liani, Anne Grandhenry, Geneviève Gühl, Vin-
cent Hennebicq, Julie Istasse, Francesco Italiano,
Sophie Jaskulski, Yvain Juillard, Caroline Kem-
peneers, Christophe Lambert, Gaëtan Lejeune,
Anabel Lopez, Seloua M’Hamdi, Aline Mahaux,
David Manet, Emilie Maréchal, Quentin Marteau,
Marie-Pierre Meinzel, Catherine Mestoussis,
Guylène Olivares, Conchita Paz, Nicolas Philip-
pe, Stéphane Pirard, Julie Rahir, Lola Riccaboni,
Nathalie Rjewsky, Marie-Rose Roland, Anne
Romain, Anna Romano, Mélanie Rullier, Cathe-
rine Salée, Michèle Schor, Sarah Sire, Emmanuel
Texeraud, Alexandre Tissot, Marcha Van Boven,
Benoît Verhaert, Pierre Verplancken, Laurence
Warin, Catherine Wilkin.
Assistanat Guillemee Laurent et Coline Struy.
1
/
4
100%