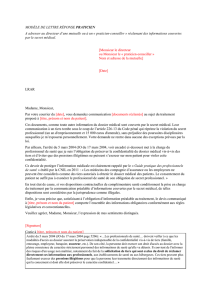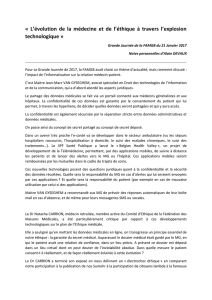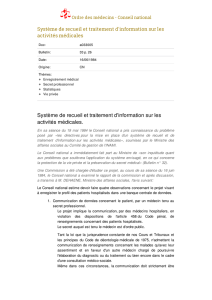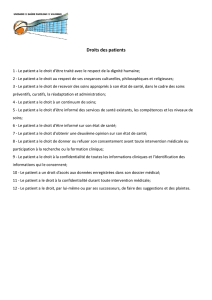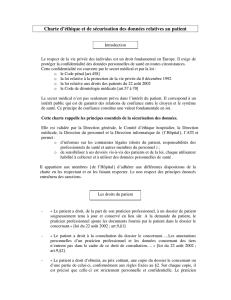problèmes posés par les évolutions récentes Le point de

17
http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011
RÉFLEXION
Confidentialité et DIM :
problèmes posés par les
évolutions récentes
MISE EN PLACE DES DÉPARTEMENTS
D’INFORMATION MÉDICALE
Le PMSI a eu pour effet de rapprocher les systèmes
d’information administratifs et médicaux qui, souvent,
évoluaient de manière indépendante et étaient gérés
pour les uns par les services informatiques de l’établis-
sement, et pour les autres par des
praticiens intéressés à l’informa-
tique. Ce rapprochement a néces-
sité que soient mises en place un
certain nombre de structures et de
règles afin de préserver les notions
de confidentialité et de secret
médical et d’éviter une trop grande
disponibilité du dossier médical en
dehors de ceux qui avaient le
patient en charge.
C’est dans ce contexte qu’ont été
mis en place les départements
d’information médicale (DIM),
d’abord par circulaire en 1989 qui
définissait « une structure de l’infor-
mation médicale » ayant pour vocation d’aider les
services médicaux à faire le PMSI, de s’assurer auprès
des médecins responsables de la qualité des données
et de leur exhaustivité et « de veiller à la confidentialité
des données concernant le malade, conformément aux
recommandations de la CNIL ».
En vue de la généralisation du PMSI
en 1996, l’existence d’un « médecin respon-
sable de l’information médicale » a été
inscrite de manière légale et réglementaire
dans le code de santé publique (CSP), à
travers les articles L6113-7 et R6113-1 à 11 :
Article L6113-7 : « Les établissements de santé, publics
ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. Dans le
respect du secret médical et des droits des malades,
ils mettent en œuvre des systèmes d'information qui
tiennent compte, notamment, des pathologies et des
modes de prise en charge en vue d'améliorer la connais-
sance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de
favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé
publics et privés transmettent les données médicales
nominatives nécessaires à l'analyse
de l'activité et à la facturation de
celle-ci au médecin responsable de
l'information médicale pour
l'établissement dans des conditions
déterminées par voie réglementaire
après consultation du conseil
national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de
l'information médicale est un
médecin désigné par le directeur
d'un établissement public de
santé ou l'organe délibérant d'un
établissement de santé privé
s'il existe, après avis de la
commission médicale ou de la
conférence médicale. Pour ce qui concerne les établis -
sements publics de santé, les conditions de cette
désignation et les modes d'organisation de la fonction
d'information médicale sont fixés par décret.»
Article R6113-1 à 11 : «…Le praticien responsable
d'une structure médicale ou médico-technique ou le
praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui
le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des
informations qu'il transmet pour traitement au médecin
responsable de l'information médicale dans l'établis -
sement.
Ce médecin conseille les praticiens pour la production
des informations. Il veille à la qualité des données qu'il
confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers
médicaux et les fichiers administratifs.…
Les médecins chargés de la collecte des données
La diffusion généralisée
de l’outil informatique
dans la pratique médicale
et ses liaisons obligées avec
les outils administratifs ont
maintenant rendu perméable
la frontière entre données
médicales et données
administratives.
“
“
Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) a été généralisé à
l’ensemble des établissements de santé pour permettre de disposer d’une mesure
standardisée de leur activité au niveau national. Son système de recueil pose le
problème du respect des règles de confidentialité et du secret médical que chaque médecin
et chaque établissement de santé doivent à leurs patients.
PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page17

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011
18
RÉFLEXION
médicales nominatives ou du traitement des fichiers
comportant de telles données sont soumis à l'obli-
gation de secret dont la méconnaissance est punie
conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Il en est de même des personnels placés ou détachés
auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploi-
tation de données nominatives sous leur autorité,
ainsi que des personnels intervenant sur le matériel
et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement
des données.
Après avis selon le cas de la
commission médicale d'établis -
sement ou de la conférence
médicale, le représentant de
l'établissement prend toutes
dispositions utiles, en liaison
avec le président de ces instan-
ces et le médecin responsable
de l'information médicale, afin
de préserver la confidentialité
des données médicales
nominatives. Ces dispositions
concernent notamment l'étendue,
les modalités d'attribution et de contrôle des autorisa-
tions d'accès ainsi que l'enregistrement des accès… »
Lors de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A),
qui a pour but le financement des établissements de
santé, il a été décidé d’utiliser le PMSI et son système
de recueil déjà existant pour valoriser l’activité des
hôpitaux. Ce lien direct entre ressources hospitalières et
activité médicale a rendu stratégique le contrôle du
recueil d’activité et accru le poids des directions admi-
nistratives sur les médecins responsables de l’informa-
tion médicale, posant ainsi un certain nombre de
problèmes.
LES PROBLÈMES POSÉS SUR LA
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
La gestion quasi exclusive de l’information médicale
par des médecins avant la T2A, et surtout avant le PMSI,
avait rendu peu utile une réflexion unifiée sur secret
médical, secret professionnel et confidentialité.
La diffusion généralisée de l’outil informatique dans la
pratique médicale et ses liaisons obligées avec les outils
administratifs ont maintenant rendu perméable la
frontière entre données médicales et données adminis-
tratives : les factures émises comportent les notions
d’actes en nature ou de médicaments pour les consul-
tations externes, et même (pour l’hospitalisation privée)
le groupe homogène de séjour, dont le libellé ne prête
pas à confusion sur les affections traitées. Il est prévu
que ce soit le cas à partir de 2012 pour les établis -
sements publics.
De fait, un nombre croissant de personnes a accès à des
données nominatives médicales dans le cadre d’une uti-
lisation financière ou économique, sans avoir forcément
conscience du caractère sensible de telles données.
Cette banalisation de l’accès aux données médicales
rend de plus en plus difficile une sensibilisation au
secret médical, d’autant que le traitement de ces
données, en raison de sa complexité et de la nature
financière de son utilisation, est
de plus en plus délégué aux
équipes administratives qui en
ont un usage croissant. Le suivi
de l’activité des plateaux
techniques par pôle, par UF et
parfois par praticien est de plus
en plus réalisé directement par
les services de contrôle de
gestion, avec un accès direct aux
tables individuelles nominatives,
sans aucun contrôle. La réalisa-
tion d’infocentre ou d’entrepôts
de données dans les hôpitaux
s’accompagne rarement d’une gestion fine des
habilitations, par méconnaissance des règles, paresse
intellectuelle, pour éviter des complications organisation-
nelles ou pour des problèmes de coûts de dévelop pement.
Dans les rares cas où le problème de l’accès est posé,
on se trouve face à des divergences d’interprétation
sur la notion de secret médical et secret professionnel.
Pour une partie non négligeable d’administratifs, toute
personne soumise au secret professionnel et travailllant
dans l’établissement doit pouvoir avoir accès aux
données médicales nominatives des patients dans la
mesure où elle agit dans le cadre de ses missions. Il est
vrai que la loi du 4 mars 2002 qui redéfinit le secret
des informations auquel le patient a droit peut être inter-
prétée de manière différente.
La loi du 4 mars 2002 stipule que
« toute personne
prise en charge par un professionnel, un établis -
sement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au
respect de sa vie privée et au secret des informa-
tions le concernant. Excepté dans les cas de
dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l’ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance
du professionnel de santé, de tout membre du
personnel en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s’impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu’à TOUS les profes-
sionnels intervenant dans le système de santé. »
La sujétion administrative
ruine la nécessaire
indépendance que le médecin
responsable de l’information
médicale devrait avoir pour être
garant de la confidentialité des
informations médicales
“
“
PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page18

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011
19
RÉFLEXION
Beaucoup interprètent le fait que, ce secret s’imposant
à « tous les professionnels intervenant dans le système
de santé », tous les professionnels de santé ont donc
droit à un accès à toutes les informations médicales. Bien
que cette interprétation ait été jugée abusive par le
conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), elle
continue à avoir cours dans les établissements, le CNOM
n’étant pas reconnu comme ayant une valeur contrai-
gnante par l’administration.
D’autre part, le même article L1110-4 du CSP précise que
« lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement
de santé, les informations la
concernant sont réputées
confiées par le malade à l’en-
semble de l’équipe ». Là encore,
la notion d’équipe est interprétée
de façon éminemment variable
selon les établissements. Certains
d’entre eux ont, d’ores et déjà,
ouvert l’ensemble des informations
du dossier patient informatisé à
l’ensemble des soignants de
l’hôpital, sans aucun contrôle de
ces accès, ce qui, outre les
éventuels manquements au secret
professionnel que cela peut
entraîner, a déjà eu la conséquence qu’une partie
importante du personnel refuse de se faire soigner dans
son établissement quand il en a le choix.
LES PROBLÈMES POSÉS SUR LA
POSITION DU MÉDECIN RESPONSABLE
DE L’INFORMATION MÉDICALE
La fonction de médecin responsable de l’information
médicale (MRIM) a été créée afin que la dérogation
légale qu’est le PMSI au secret médical puisse être sous
la responsabilité d’un médecin et que celui-ci puisse
garantir la confidentialité des données transmises.
La mise en place de la T2A a infléchi cette fonction
principale du MRIM vers celle de production des
informations nécessaires à la facturation des séjours. Le
centre de gravité de leur activité s’est donc déplacé du
médical vers l’administratif, ce qui s’est traduit dans un
certain nombre d’établissements par l’intégration du
MRIM à un pôle administratif (31 % des DIM de CHU
sont rattachés directement à la direction générale de
l’établissement, à la CME, ou aux deux).
Cette sujétion administrative ruine la nécessaire indépen-
dance que le MRIM devrait avoir pour être garant de la
confidentialité des informations médicales, notamment
quand elle est une gêne à l’évaluation de l’activité
médicale et de sa valorisation.
Pour ceux qui dépendent encore d’un pôle médical ou
médico-technique, le renforcement des pouvoirs
exclusifs du directeur sur la carrière d’un praticien hospi-
talier à travers la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
(HPST) rend plus difficile encore l’exercice indépendant
d’un contrôle de la confidentialité. Si, dans la plupart des
cas, une négociation intelligente est possible, des conflits
peuvent néanmoins survenir et malheureusement conduire
aujourd’hui à des actions autoritaires allant jusqu’à la
mise en recherche d’affectation du praticien gênant.
Ce risque est d’autant sensible pour le MRIM qu’un e
partie des recettes des établis-
sements est liée aux données
médicales qu’il gère dans le cadre
de la T2A. Des dysfonction -
nements dans le recueil ou le
traitement de ces informations
peuvent conduire à des pertes
financières conséquentes et la
demande d’audit de la chaîne de
l’information médicale par
l’administration devient de plus
en plus fréquente en cas de
problèmes financiers de l’établis-
sement.
Enfin, le rôle du MRIM dans la
préservation de la confidentialité
est interprété selon les établissements : si certains
l’assurent pour des informations médicales, y compris
les dossiers papier ou la communication à des tiers,
d’autres voient attributions limitées aux strictes
données du PMSI (fichiers résumés de séjour), sans
droit de regard sur le reste de l’information médicale.
LES PROBLÈMES POSÉS SUR LE
RECOURS À DES SOCIÉTÉS EXTERNES
Si des contrôles qualité sont pratiqués régulièrement
dans le cadre des procédures normales d’un MRIM, il
devient de plus en plus fréquent que des audits
externes soient réclamés par les établissements. Ils sont
même gérés de manière institutionnelle par des
structures officielles comme l’Agence nationale d’appui
à la performance des établissements de santé (ANAP)
qui assure auprès de centaines d’hôpitaux des
missions d’amélioration de la performance, aboutissant
à la signature de contrats tripartite ANAP-ARS-hôpital.
Dans ce cadre, il est proposé à l’établissement des
audits externes de la chaîne de codage PMSI, réalisés
par des sociétés externes privées avec lesquelles l’ANAP
a passé marché. Ces audits consistent, à partir du fichier
de RSS que récupère la société, à tirer au sort des
dossiers que le personnel de ces sociétés, pas forcément
médecin, va recoder à partir du dossier patient.
La difficulté
pour le médecin responsable
de l’information médicale
est de faire part
de ses préventions sur
la rupture de laconfidentialité
sans être soupçonné de vouloir
faire obstacle à l’évaluation
de ses pratiques.
“
“
PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page19

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011
20
La difficulté pour le MRIM est de faire part de ses pré-
ventions sur la rupture de la confidentialité sans être
soupçonné de vouloir faire obstacle à l’évaluation de ses
pratiques.
Quand de tels audits ont été pratiqués, les mêmes
sociétés proposent souvent, dans la lancée, des contrats
« d’optimisation » du codage. Ceux-ci consistent à
essayer de maximiser la valorisation des séjours en
recherchant dans les dossiers patients certains
éléments qui pourraient manquer. Les promesses de
gain (parfois plusieurs millions d’euros) sont difficiles à
refuser pour des établissements en difficulté financière.
Il est ardu dans ces conditions de faire valoir les
exigences de confidentialité face à ces recettes
potentielles, tant vis-à-vis de l’administration que des
cliniciens confrontés à des manques de moyens. Il est
d’autant plus malaisé au MRIM de faire valoir ces
problèmes de confidentialité que ce manque de
recettes lui est implicitement reproché, comme
pouvant venir d’une insuffisance professionnelle que
vient pallier la société externe.
Il arrive donc, à l’issue de ces procédures, que le MRIM
apparaisse plus comme un obstacle à une bonne valo-
risation de l’activité, tant par le défaut de recettes qui est
mis en évidence par les sociétés externes, que par ses
préventions sur leur activité pour récupérer ces recettes
et « optimiser » le codage. Il apparaît désormais plus
avantageux à certains établissements de supprimer les
postes de MRIM ainsi que les services auxquels il est
rattaché, et de confier à ces sociétés externes le soin de
gérer l’intégralité de l’information médicale, de la
valoriser et de la contrôler.
Les personnes qui interviennent ne sont donc plus du
personnel médical hospitalier, mais des contractants,
directement payés par l’administration et n’ayant plus
aucune indépendance. Le corps médical n’a plus aucune
implication dans ce processus puisqu’il dépend exclu-
sivement de marchés passés entre l’administration et ces
sociétés. L’externalisation de ces tâches, pourtant de
nature médicale, permet aux directions de s’affranchir de
tout contrôle médical, ce qui crée un fâcheux précédent
qui pourrait s’appliquer à d’autres types d’activités.
On notera que l’effet d’aubaine créé par ce type de
prestations de services a suscité de très nombreuses
vocations : certains MRIM ont créé leur société et
développent cette activité à titre privé en plus de leurs
fonctions hospitalières. D’autres personnes, encore
moins scrupuleuses, s’engagent à une « optimisation »
éclair (plusieurs milliers de dossiers en quelques
semaines), utilisant des personnes n’ayant aucune
compétence dans le domaine de la santé, mais
rapidement formées. Elles proposent une rémunération
au pourcentage de dossiers « optimisés », de l’ordre
parfois de 10 % ou 12 %, sur les gains annoncés. Il arrive
que certaines fassent valoir des fausses autorisations.
On notera que l’implication de MRIM dans de telles
sociétés explique le peu de réactions officielles des
collèges les représentant, malgré les demandes répétées
de certains membres.
Dr Jérôme FAUCONNIER
Pôle de Santé Publique
Département d'Information Médicale, CHU Grenoble
RÉFLEXION
L’intervention de personnes externes, ne participant
pas aux soins, pose nécessairement le problème de
la mise à leur disposition de données médicales
nominatives. Cette question se pose tant pour
le MRIM que pour le praticien ayant en charge
le patient, chacun étant soumis pour ce qui le
concerne au secret médical.
En conclusion
L’importance stratégique de l’information
médicale dans le financement des établis -
sements conduit de plus en plus de directions
à vouloir la contrôler, jusqu’à réaliser de
véritables « hold-up » de cette fonction de
nature médicale, au mépris de toutes les règles
de confidentialité.
Une certaine indifférence, voire une compli-
cité du corps médical, peut-être ignorant de
ce qui est en jeu, facilite cette usurpation. La
récente loi HPST devrait pourtant accentuer
ce type de démarche et éventuellement
l’étendre à d’autres champs de l’activité médi-
cale, afin de s’affranchir de la relative indé-
pendance qu’ont les médecins hospitaliers
dans leur pratique face à leur administration.
Il convient donc d’examiner avec attention
cette évolution, tant pour les problèmes de
confidentialité et de rupture du secret médical
qu’elle pose, que pour le modèle de relation au
corps médical qu’elle annonce.
PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page20

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011
21
RÉFLEXION
Le SNPHAR-E a été alerté par plusieurs médecins responsables de l’information médicale hospitalière, très inquiets quant au respect des règles
de confidentialité et du secret médical que chaque médecin et chaque établissement de santé doivent à leurs patients.
Alors que la réglementation est très stricte (Art L.6113-7), imposant le respect du secret médical et des droits des patients pour l’analyse de
l’activité hospitalière, avec même un risque pénal si ce secret n’est pas respecté, de plus en plus d’établissements, étranglés budgétairement,
externalisent à des sociétés privées le codage des pathologies et actes réalisés. Des données médicales nominatives du dossier médical sont
extraites par du personnel non médical n’ayant rien à voir avec le patient, ce qui est contraire aux recommandations de l’Ordre.
Mais en 2011, que valent les principes éthiques et déontologiques de respect de la confidentialité face à certaines directions pilotant des
établissements en grande difficulté financière et dont le financement repose entièrement sur cette saisie d’informations ?
Les médecins de l’informatique médicale, soumis à forte sujétion administrative, qui ont essayé dans certaines structures de faire valoir ces règles
ont subi culpabilisation et chantage, allant jusqu’à des menaces de mise en recherche d’affectation ou pressions diverses. Certains
établissements ont même supprimé totalement l’information médicale interne pour l’externaliser dans sa totalité. Comme si les données
médicales pouvaient être traitées comme le ménage ou la restauration ! C’est d’ailleurs sûrement un nouveau marché, puisqu’apparaissent
des sociétés spécialisées dans le codage externalisé, avec primes au rendement pour des employés qui n’ont rien à voir avec la santé et ses
principes…
Pourtant, la CNIL et le conseil de l’ordre, consultés, convergent formellement pour exiger que soit garantie la confidentialité des données
éventuellement transmises qui, en aucun cas, ne devraient contenir les identifiants des patients, ce qui signifie qu’en l’état actuel, les données
type RSS ou RSA ne doivent pas être transmises aux auditeurs externes.
Il est nécessaire que chaque médecin hospitalier clinicien, garant des données concernant ses patients, sache que celles-ci sont
peut-être livrées à des sociétés privées sans garantie sur la confidentialité. C’est désormais une responsabilité partagée entre médecin
de l’informatique et médecins cliniciens.
Le SNPHAR-E sera d’une vigilance extrême pour défendre les collègues menacés dans le respect de leur indépendance professionnelle alors qu’ils
sont le dernier rempart de la confidentialité et du secret médical.
Le SNPHAR-E a pris ce dossier en main désormais au niveau national et va le porter fortement.
Le point de vue du SNPHAR-E
MAI 2011
19 mai Commission SMART (CFAR)
20 mai Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)
JUIN 2011
15 juin Réunion du comité de coordinnation sur le livre du SNPHAR-E à paraître (Paris)
16 juin Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)
17 juin Rencontres interprofessionnelles du conseil d'administration du SNPHAR-E.
Invités : les internes, CCA, jeunes PH. Hôpital Pompidou (Paris)
20 juin Rencontres avec les représentants du PS : présentation de la plateforme du
SNPHAR-E
21 juin Bureau et directoire du CFAR (Paris)
22 juin Table ronde du groupe Socialistes Radicaux Citoyens à l'Assemblée Nationale :
Les risques psychosociaux au travail
30 juin Réunion de la Commission Statutaire Nationale (CNG Paris)
JUILLET 2011
6 juillet AG INPH ( Paris)
8 juillet Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E : rencontre président SFAR et
président du CFAR (Paris)
SEPTEMBRE 2011
8 septembre Bureau du CFAR (Paris)
9 septembre Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)
21 - 25 septembre Congrès national de la SFAR
RETROUVEZ-NOUS TOUS LES JOURS, 24/24 SUR FACEBOOK ET TWITTER
AGENDA DU CA
PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page21
1
/
5
100%