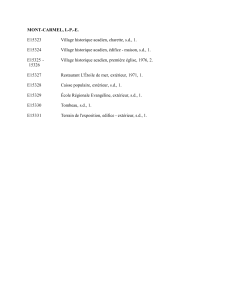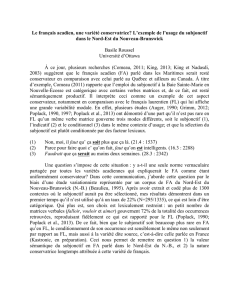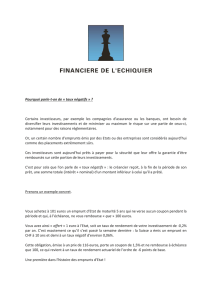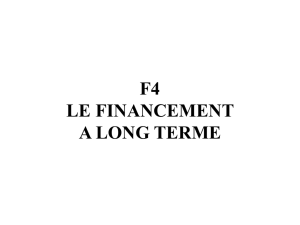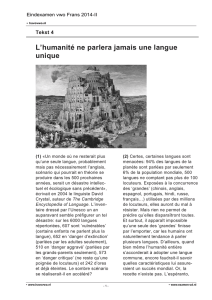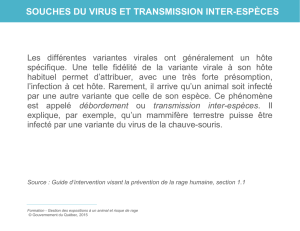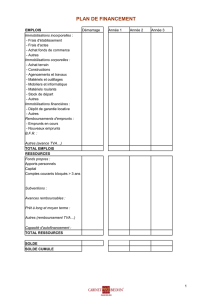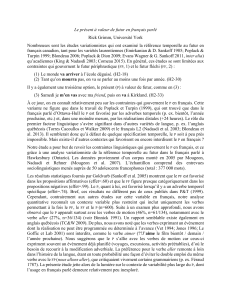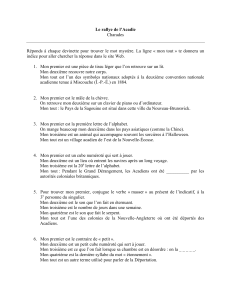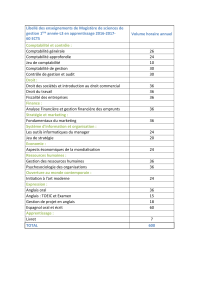Étude sociolinguistique du français acadien du nord

!"#$%&'()*(+*,-#*'"*.#%&$#&/01,21*'&1)1$*%,&$#&,(0$3%'"&$#&&
4(#5%1#360#,'7*)8&
&
&
&
&
9:+*''1&;<*1''(,3=:-%0&
&
&
&
&
&
><?'%&'(#@*'%&A&+1&
B1)#+":&$%'&:"#$%'&'#C:0*%#0%'&%"&C('"$()"(01+%'&
$1,'&+%&)1$0%&$%'&%D*-%,)%'&$#&C0(-01@@%&$%&
E()"(01"&%,&+*,-#*'"*.#%F&
&
&
&
&
&
E:C10"%@%,"&$%&+*,-#*'"*.#%&
B1)#+":&$%'&10"'&
G,*5%0'*":&$HI""171&
&
&
&
&
&
&
J&9:+*''1&;<*1''(,3=:-%0K&I""171K&;1,1$1K&LMNO&

&
**&
RÉSUMÉ&
;%""%&:"#$%&C(0"%&'#0&+%&/01,21*'&1)1$*%,&$#&,(0$3%'"&$#&4(#5%1#360#,'7*)8&
%,&1$(C"1,"&+H1CC0()<%&$%&+1&'()*(+*,-#*'"*.#%&510*1"*(,,*'"%&P=1Q(5K&NRSSK&NRSRK&
NRONK&NRTLK&NRTUVF&=H:"#$%&%'"&Q1':%&'#0&NS&%,"0%5#%'&'()*(+*,-#*'"*.#%'&0%)#%*++*%'&
%,&LMNW&A&;101.#%"&%"&A&X"3X*@(,K&$%#D&@#,*)*C1+*":'&$1,'&+1&Y:,*,'#+%&1)1$*%,,%F&
=%&)(0C#'&%'"&%,"0%&1#"0%'&'"01"*/*:&'%+(,&+%&0:'%1#&'()*1+K&+%&'%D%K&+HZ-%&$%'&+()#"%#0'&
1/*,&$H%DC+(0%0&+%&)(,$*"*(,,%@%,"&'()*1+&%"&+*,-#*'"*.#%&$%'&510*1Q+%'&)*Q+:%'&C10&
+H:"#$%&%"&$%&0%C:0%0&$%'&)<1,-%@%,"'&C("%,"*%+'&%,&)(#0'&C10&+%&Q*1*'&$%'&1,1+['%'&
%//%)"#:%'&%,&"%@C'&1CC10%,"F&&
=%'&(Q\%)"*/'&C0*,)*C1#D&$%&+1&0%)<%0)<%&'(,"&$%&$:)(#50*0&+%&/(,)"*(,,%@%,"&
$%&+1&-01@@1*0%&'(#'3\1)%,"%&$#&/01,21*'&1)1$*%,&%,&@%,1,"&#,%&:"#$%&%@C*0*.#%&%"&
.#1,"*"1"*5%&'#0&+1&510*1Q*+*":&'()*(+*,-#*'"*.#%&$%&$%#D&510*1Q+%'&
@(0C<('[,"1D*.#%'&]&P*V&+H%DC0%''*(,&$#&/#"#0&%"&P**V&+H1))(0$&'#\%"35%0Q%&$%&+1&
"0(*'*?@%&C%0'(,,%&$#&C+#0*%+F&&Y(#0&)%&.#*&%'"&$#&/#"#0K&+%&4(#5%1#360#,'7*)8&%'"&+1&
'%#+%&C0(5*,)%&A&,%&C1'&15(*0&:":&:"#$*:%&$H#,&C(*,"&$%&5#%&'()*(+*,-#*'"*.#%F&=%'&
0:'#+"1"'&5*%,,%,"&1+(0'&)(@C+:"%0&+%&C(0"01*"&$0%'':&'#0&+%&/#"#0&$%&.#1"0%&0:-*(,'&
$%&)<1)#,%&$%'&C0(5*,)%'&1"+1,"*.#%'&P^*,-&%"&41$1'$*K&LMMW_&;(@%1#K&LMNNV&%"&
@(,"0%,"&)(@@%,"&+%&/#"#0&%,&/01,21*'&1)1$*%,&$#&4(#5%1#360#,'7*)8&'%&)(@C(0"%&
C10&01CC(0"&A&)%+#*&$%'&C0(5*,)%'&5(*'*,%'&)(,'*$:0:%'&)(@@%&)(,'%051"0*)%'F&X#0&+%&
C+1,&$%&+H1))(0$&'#\%"35%0Q%&$%&+1&"0(*'*?@%&C%0'(,,%&$#&C+#0*%+K&+%'&0:'#+"1"'&$%&
)%""%&:"#$%&'(,"&)(@C10:'&A&)%++%'&@%,:%'&15%)&$%'&$(,,:%'&$1"1,"&$H*+&[&1&%,5*0(,&
L`&1,'&P6%1#+*%#K&NRR`V&$H#,%&0:-*(,&5(*'*,%&C(#0&%,"0%&1#"0%'&5:0*/*%0&'*&+%'&"1#D&
'(,"&'%@Q+1Q+%'&(#&A&+1&Q1*''%&%"&5(*0&'*&$H1#"0%'&/1)"%#0'&.#%&+%&0:'%1#&'()*1+&\(#%&#,&
0a+%&$1,'&+%&@1*,"*%,&$%&+1&/+%D*(,F&G,&"0(*'*?@%&$(@1*,%&1&1#''*&:":&:"#$*:&]&+%'&
%@C0#,"'&A&+H1,-+1*'F&=H1,1+['%&.#1,"*"1"*5%&$%'&%@C0#,"'&$1,'&#,&)(,"%D"%&
/01,)(C<(,%&@1\(0*"1*0%&C%0@%"&$H%D1@*,%0&)%&.#*&%'"&%@C0#,":K&+1&/0:.#%,)%&%"&
)(@@%,"&+%'&%@C0#,"'&'(,"&*,":-0:'&$1,'&+1&+1,-#%&$%'&+()#"%#0'F&;%""%&:"#$%&
C%0@%"&1#''*&$%&5:0*/*%0&'*&+1&)0([1,)%&C(C#+1*0%&.#%&+%&/01,21*'&)1,1$*%,&'%01*"&
"0#//:&$H1,-+*)*'@%'&%'"&/(,$:%&(#&,(,F&&
&
&

&
***&
REMERCIEMENTS&
>(#"&$H1Q(0$K&\%&0%@%0)*%&5*5%@%,"&@(,&$*0%)"%#0&$%&"<?'%K&C0(/%''%#0&
X"%C<%,&=%5%[&.#*K&$?'&@1&C0%@*?0%&1,,:%&1#&$()"(01"K&'H%'"&@(,"0:&'*&1))#%*++1,"&%"&
<#@1*,F&X"%C<%,K&'*&\%&,H1*&C1'&1Q1,$(,,:&)%""%&1,,:%3+AK&)H%'"&%,"0%&1#"0%'&-0Z)%&A&
"(*b&9%0)*&$H15(*0&1))%C":&$%&@%&'#C%05*'%0&%"&$H15(*0&:":&,(,&'%#+%@%,"&#,&
C:$1-(-#%&<(0'&C1*0K&#,&%D)%++%,"&'#C%05*'%#0&)(@C0:<%,'*/&%"&%,)(#01-%1,"K&@1*'&
:-1+%@%,"&#,%&C%0'(,,%&*,"?-0%&%"&1#"<%,"*.#%&15%)&.#*&\H1*&%#&+%&C0*5*+?-%&$%&
)<%@*,%0F&
9%0)*&Q%1#)(#C&1#D&:51+#1"%#0'&$%&@1&"<?'%&]&+%'&C0(/%''%#0'&=(#*'%&
6%1#+*%#K&;10@%,&=%6+1,)K&!0*)&91"<*%#&%"&c,$0:'&Y1Q+(&X1+1,(51F&d("0%&0:"0(1)"*(,&
0*)<%&%"&)(,'"0#)"*5%&@H1&C%0@*'&$H1@:+*(0%0&+1&.#1+*":&$%&@1&0%)<%0)<%F&&
G,&-01,$&@%0)*&A&"(#'&+%'&C10"*)*C1,"'&.#*&(,"&-:,:0%#'%@%,"&$(,,:&$%&+%#0&
"%@C'&%"&1))%C":&$%&@%&+1*''%0&%,0%-*'"0%0&"(#"%'&)%'&<%#0%'&$H%,"0%"*%,'F&&
G,&@%0)*&Q*%,&'C:)*1+&A&@1&C0%@*?0%&C0(/%''%#0%&$%&+*,-#*'"*.#%K&=(#*'%&
6%1#+*%#K&-0Z)%&A&.#*&\H1*&,(,&'%#+%@%,"&$:5%+(CC:&#,&*,":0e"&C(#0&+1&')*%,)%&$#&
+1,-1-%&$?'&+%&)(#0'&$H*,"0($#)"*(,K&A&X<*CC1-1,&%,&LMMOK&@1*'&.#*&@H1&1#''*&
%,)(#01-:%&A&C(#0'#*50%&@%'&:"#$%'&1C0?'&@(,&Q1))1+1#0:1"&%,&:$#)1"*(,F&&
f%&"*%,'&1#''*&A&0%@%0)*%0&"(#"%&+1&Q%++%&:.#*C%&$#&E:C10"%@%,"&$%&/01,21*'&$%&
+HG,*5%0'*":&$%&>(0(,"(K&"(#"&'C:)*1+%@%,"&@1&'#C%05*'%#0%&$%&@:@(*0%K&
C0(/%''%#0%&c,,%3910*%&60(#''%1#K&%"&1#''*&@%'&1@*%'K&c++*'(,K&g*-*K&g+%,$1K&
9%1-1,K&9*718(&%"&X1,$0*,%K&15%)&+%'.#%++%'&\H1*&C1'':&#,%&"0?'&1-0:1Q+%&1,,:%&+(0'&
$%&+1&@1h"0*'%F&d(#'&15%i&'*&Q*%,&'#K&15%)&"(#"%&5("0%&)(,5*5*1+*":&%"&5("0%&)<1+%#0K&
@H1*$%0&A&@1*,"%,*0&+%&,*5%1#&$%&@("*51"*(,&,:)%''1*0%&.#*&@H1&C%0@*'&$%&
C(#0'#*50%&@%'&:"#$%'&1#&$()"(01"F&
9%0)*&A&@%'&)(++?-#%'&$%&+HG,*5%0'*":&$HI""171&]&c+%D1,$01K&c++*'(,K&c,,*%K&
61'*+%K&601,$(,K&E10[+K&j7%+*,1K&B%0%'<"%<K&g*"1K&k:+?,%K&f(%K&f(,1"<1,K&^*@K&=1#01K&
910*%3;+1#$%K&910"*,%K&9(++[K&9['"*.#%K&41<%$K&41"<K&4*)":K&Y<*+K&X1+5*(K&X(C<*1&%"&
d%'%+1F&9%0)*&C(#0&,('&:)<1,-%'&'"*@#+1,"'&%"&@%0)*&C(#0&5("0%&-%,"*++%''%&%"&5("0%&
%,"01*$%F&

&
*5&
9%0)*&A&C0(/%''%#0%&B01,)%&910"*,%1#&%"&A&"(#"%&+1&Q%++%&:.#*C%&$#&
=1Q(01"(*0%&=%'&C(+[C<(,*%'&$#&/01,21*'&15%)&.#*&\H1*&Q%1#)(#C&1*@:&"0151*++%0F&
9%0)*&Q%1#)(#C&C(#0&5("0%&1CC#*F&
9%0)*&A&"(#"%'&@%'&1@*%'&%"&)(#'*,%'&15%)&.#*&\H1*&%#&"1,"&$%&C+1*'*0&$#01,"&
@%'&C1#'%'&$%&$()"(01"K&&)%++%'&.#*&@H(,"&:C1#+:%&"(#"%'&)%'&1,,:%'K&.#*&,H(,"&\1@1*'&
)%'':&$%&@H%,)(#01-%0&C(#0&.#%&\%&C%0':5?0%&%"&'#0"(#"K&.#*&(,"&"(#\(#0'&)0#&%,&
@(*&]&c,,1Q%++%K&c,,*%K&c,*)8K&61,1/'<%<K&E17,K&j@*+*%&;FK&j@*+*%&EFK&j@@1,#%++%K&
g%,&6FK&g%,&>FK&l'1Q%++%K&f1,%+K&f%1,,*%K&f#+*%&cF&9FK&f#+*%&;FK&910*%K&910*%3c,$0:%K&
910*%3j5%K&910*%3k:+?,%K&91[#@*K&9%+K&9:+*''1K&41,)[K&I(+$(#iK&X1Q*,%K&X(C<*%K&
X"%C<&kFK&X"%C<&>F3EFK&d1+:0*%K&d1,%''1K&d:0(&cFK&d:0(&9F&%"&m#8*8(F&
G,&@%0)*&'C:)*1+&A&@%'&)(C*,%'&$%&^>^&]&910\(+1*,%K&910"[,%K&41,)[K&n*"1F&=%&
"%@C'&C1'':&15%)&5(#'&+(0'&$%&)%'&$%#D&$%0,*?0%'&1,,:%'&$%&0:$1)"*(,&%"&$%&0:5*'*(,&
$%&@1&"<?'%&@H1&:":&501*@%,"&C0:)*%#DF&
f1$%&%"&G[%,K&\%&5(#'&0%@%0)*%&"(#"%'&$%#DK&'*,)?0%@%,"&%"&)<1+%#0%#'%@%,"K&
C(#0&+H1CC#*&%D)%C"*(,,%+&.#%&5(#'&@H15%i&(//%0"&\#'.#H1#&'C0*,"&/*,1+F&
9%0)*&A&"(#"%&@1&/1@*++%&]&@%'&C10%,"'&=*%""%&%"&910*(K&@%'&/0?0%'&><*%00[&%"&
f%1,3n:@*K&@%'&Q%1#D3C10%,"'&X(+1,-%&%"&n:-*,1+$K&@%'&Q%1#D3/0?0%'&E%,*'&%"&
n:\%1,F&f%&'1*'&A&.#%+&C(*,"&5(#'&15%i&)(,"*,#%++%@%,"&:":&/*%0'&$%&@(*&%"&21&@H1&
"(#\(#0'&/1*"&#,&:,(0@%&Q*%,F&G,&@%0)*&'C:)*1+&A&@(,&C1001*,&%"&A&@1&"1,"%&=*'%F&
9%0)*&A&@%'&-01,$'3C10%,"'&;<*1''(,&]&c,$0:1&%"&B%0,1,$F&d(#'&15%i&:":&#,%&
'(#0)%&$H*,'C*01"*(,&C(#0&@(*K&%"&)%&$?'&@(,&%,/1,)%F&d(#'&15%i&"(#\(#0'&51+(0*':&
+H:$#)1"*(,&%"&+H1).#*'*"*(,&$%&)(,,1*''1,)%'F&;(@@%&\%&'#*'&)<([:%&.#%&5(#'&@H1[%i&
*,)#+.#:&)%'&51+%#0'&.#*&@H(,"K&'1,'&1#)#,&$(#"%K&1@%,:%&A&@%&'#0C1''%0F&
G,&@%0)*&"(#"&$(#D&C(#0&@1&C%"*"%&/:+*,%&c-1"<%&.#*&1&:":&A&@%'&)a":'&"(#"&+%&
+(,-&$%&@(,&$()"(01"F&X(,&'(#"*%,&@(01+&%"&'1&)(@C1-,*%&0:)(,/(0"1,"%&'#0&+%'.#%+'&
\%&C(#51*'&"(#\(#0'&)(@C"%0K&@e@%&+(0'&$%&,(@Q0%#'%'&,#*"'&Q+1,)<%'K&@%&'(,"&
*,%'"*@1Q+%'F&
B*,1+%@%,"K&@*++%&@%0)*'&$#&C+#'&C0(/(,$&$%&@(,&)o#0&A&@(,&@10*K&n*)<10$F&
f%&0%''%,'&#,%&-01"*"#$%&*,/*,*%&%,5%0'&"(*F&X1,'&"(*K&\%&,H[&'%01*'&C1'&C105%,#%F&9%0)*&
$%&@H15(*0&'(#"%,#%&'1,'&0%+Z)<%F&f%&"H%,&'%01*&:"%0,%++%@%,"&0%)(,,1*''1,"%F&9%0)*&
C(#0&"(#"%&"1&Q(,":K&"1&':0:,*":K&"1&\(*%&$%&5*50%K&"(,&1@(#0F&9%0)*&$He"0%&"(*F&

&
5&
TABLE&DES&MATIÈRES&
=lX>j&EjX&>c6=jcGp.............................................................................................................. ix&
=lX>j&EjX&BlgGnjX................................................................................................................... x&
&
;<1C*"0%&N&]&l4>nIEG;>lI4 ................................................................................................... 1&
NFN&;(,"%D"%&'()*(3<*'"(0*.#%&$#&/01,21*'&1)1$*%, ............................................................. 1&
NFL&IQ\%)"*/'&$%&+1&"<?'% ............................................................................................................ 3&
NFW&X"0#)"#0%&$%&+1&"<?'%........................................................................................................... 9&
&
;<1C*"0%&L&]&njdGj&Ej&=c&=l>>!nc>Gnj..........................................................................10&
LFN&>01*"&)(,'%051"%#0&$#&/01,21*'&1)1$*%,........................................................................10&
LFL&Y(#0.#(*&)*Q+%0&+%&/01,21*'&C10+:&1#&,(0$3%'"&$#&4(#5%1#360#,'7*)8q................14&
LFW&jDC0%''*(,&$#&/#"#0 ..........................................................................................................15&
LFU&c))(0$&'#\%"35%0Q%&A&+1&"0(*'*?@%&C%0'(,,%&$#&C+#0*%+.............................................. 22&
LF`&j@C0#,"'&A&+H1,-+1*' .........................................................................................................27&
&
;<1C*"0%&W&]&9!>kIEI=Iglj................................................................................................32&
WFN&>0151*+&$%&"%001*,&%"&,1"#0%&$%'&$(,,:%'.....................................................................32&
WFNFN&60%/&<*'"(0*.#%&$%'&0:-*(,'&A&+H:"#$% .........................................................................34&
WFNFL&l@C(0"1,)%&+*,-#*'"*.#%&$#&)<(*D&$%&+1&0:-*(, ........................................................35&
WFL&;(@C('*"*(,&$#&)(0C#' ....................................................................................................37&
WFLFN&j,"0%5#%&'()*(+*,-#*'"*.#% ..........................................................................................40&
WFLFL&Y0("()(+%&$%&"01,')0*C"*(, ...........................................................................................44&
WFW&;1$0%&"<:(0*.#%&]&"<:(0*%&510*1"*(,,*'"%......................................................................44&
WFWFN&d10*1Q*+*":&*,<:0%,"%&$#&$*')(#0'&%"&<:":0(-:,:*":&'"0#)"#0:%............................45&
WFWFL&Y0*,)*C%&$H*@C#"1Q*+*": .................................................................................................45&
WFWFW&c'[@:"0*%&$%&/(0@%'&%"&$%&/(,)"*(,'&%"&,%#"01+*'1"*(,&$1,'&+%&$*')(#0' ...........45&
WFWFU&E:+*@*"1"*(,&$#&)(,"%D"%&$%&+1&510*1Q+% ....................................................................47&
WFWF`&g0(#C%'&$%&/1)"%#0'&%"&/(0@#+1"*(,&$%'&<[C("<?'%' ..............................................48&
WFWFS&c,1+['%&$*'"0*Q#"*(,,%++% .............................................................................................49&
WFWFO&c,1+['%&@#+"*510*:%.......................................................................................................49&
&
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
1
/
175
100%