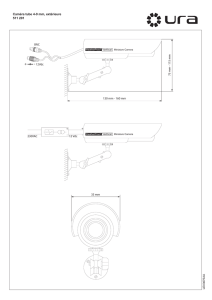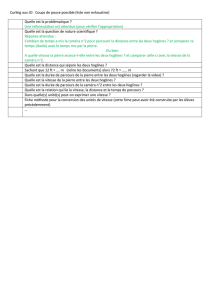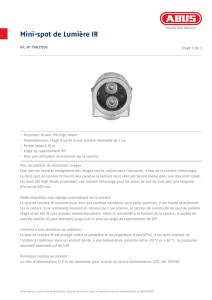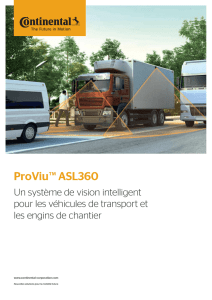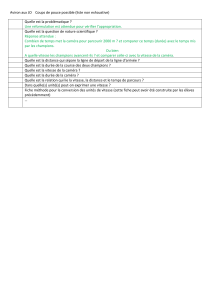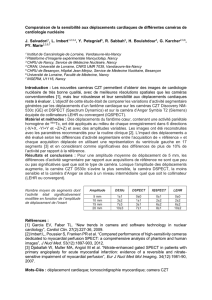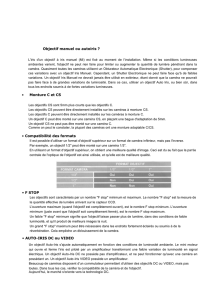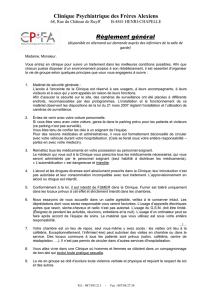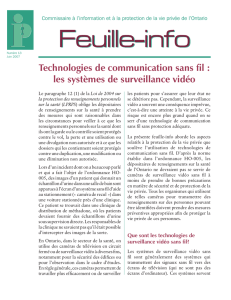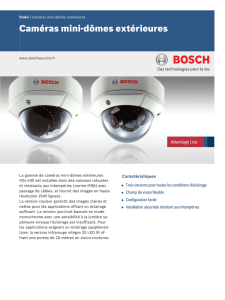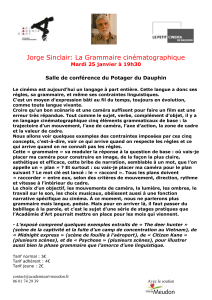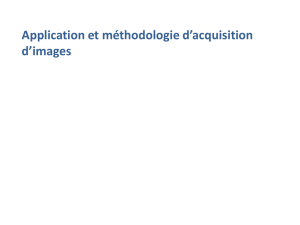i2S Vision Mag no10

L
a nouvelle caméra intelligente SONY
XCI-SX1 a été conçue pour fournir aux
OEM, aux intégrateurs et aux fabricants
d’outils de vision, un composant robuste,
réunissant le capteur, l’intelligence et
l’interface dans un module "tout-en-un"
facile à installer et à intégrer.
La caméra intègre un système d’exploitation
Linux. Elle dispose d’un processeur AMD
performant, d’une mémoire Compact Flash et
de dispositifs d’E/S tels que Ethernet, port
série USB et sortie moniteur.
Le boîtier mécanique de la nouvelle caméra
intelligente conserve la forme habituelle des
caméras analogiques et numériques Sony, ce
qui facilite son intégration.
«L’arrivée de la caméra Sony XCI-SX1 et de
la série complète de produits à venir, créent
de nouvelles opportunités pour nos clients
désireux de livrer des solutions répondants
aux besoins de leurs clients finaux» signale
Ken LaMarca, directeur général des produits
d’imagerie chez Sony Electronics' Broadcast
& Business Solutions.
«L’utilisation
de notre
hardware
permet aux
fabricants
de systèmes
de focaliser
leurs compétences sur leurs cœurs de
métier, améliorant ainsi les performances
des bibliothèques de vision et des outils de
programmation utilisés dans la création des
solutions clé en main».
LaMarca ajoute que le modèle équipé du
capteur SXGA (1280 x 960) N&B et du
système d’exploitation Linux n’est que le
premier modèle d’une longue série de
caméras intelligentes SONY. Diverses
configurations seront proposées pour
améliorer les processus de fabrication, créant
ainsi de la valeur ajoutée pour l’OEM et pour
ses clients…
(Suite page 8)
My wonderful cameras!
S’il existe un élément dans la
chaîne d’acquisition et de
traitement d’images, pour lequel
l’offre est devenue pléthorique
c’est bien la caméra. Depuis plus
de 30 ans et l’avènement du
capteur à semi-conducteur, les
technologies CCD, CMOS, CID …
n’ont cessé de progresser pour la
plus grande satisfaction des clients,
en termes de résolution, de
vitesse, de qualité d’images et de
coût. Plus ou moins intelligente, la
caméra s’est dotée depuis
quelques années d’interfaces
standardisées de transmission
numérique - type Camera Link,
IEEE1394, ou Giga Ethernet - qui
garantissent les hauts débits
d’images en s’affranchissant en
partie, des solutions d’acquisition
propriétaires. Le capteur reste plus
que jamais au centre des
préoccupations des clients et la
multiplicité des applications
nécessite une grande diversité des
solutions. Coté tendance, les
caméras CMOS reviennent en force
grâce à une qualité d’image
nettement améliorée et à une
restitution excellente des scènes
très fortement contrastées. Leurs
fréquences images, supérieures
dans bien des cas à celles des
caméras CCD sont un atout
supplémentaire.
Comme à chaque fois, l’actualité
caméra est riche en nouveautés
avec entre autres : plus de
résolution avec la nouvelle caméra
Dalsa 11 mégapixels, plus de
vitesse avec la caméra intelligente
Matrox à 100 images par seconde
et grande première Sony avec la
disponibilité de sa nouvelle caméra
intelligente. Pour découvrir tous
ces produits, je vous donne
rendez-vous fin septembre à notre
prochain salon Opto/Automation,
avec d’autres surprises.
Bonnes vacances à tous,
Philippe Vieilleville
Directeur
Commercial
- 1 -
Juin 2005, numéro 10
www.i2s-vision.fr
i2S VISION
i2S VISION
i2S VISION
Mag
Mag
Mag
Dans ce numéro
Editorial 1
Application : Expériences en micro-
pesanteur à bord de l’airbus A300-0G 2,3
Produits SONY
La caméra intélligente XCI-SX1,
la fonction Daisy Chain de la caméra
IEEE1394B XCD-V50
1,8
Produits PHOTON FOCUS
Blizzard - nouvelle caméra CMOS
10 bits, 60 images/s, USB2 & CL
3
Produits DALSA
Caméras Pantera TF 6 & 11 mégapixels,
nouvelle gamme linéaire très haute
définition Piranha3 - 8 & 12K pixels ...
4,5
Produits MATROX
Nouvelle Morphis PC104+, Helios XD,
Odyssey XD et Xpro+...
6,7
Les salons 2005, les guides de sélec-
tion, contactez-nous... 8
C’est l’aventure
scientifique vécue
avec passion par les
élèves de seconde
(option MPI) du Lycée
Montesquieu de
Bordeaux.
Répondant avec succès aux appels à projets
du CNES dans le cadre de son programme
culturel spatial, nos scientifiques ‘en herbe’
ont conçu et fabriqué des bancs
d’expérimentations destinés à être
embarqués sur l’Airbus A300-0G, un des
rares avions au monde à créer les conditions
très proches de l’apesanteur, par la
technique du vol parabolique. Les caméras
d’i2S étaient présentes le jour j, pour filmer
les expériences imaginées par nos élèves.
La suite en pages 2 & 3.
Expériences en micropesanteur
à bord de l’Airbus A300-ZéroG.
NOUVEAU
Prochain salon : Opto & Automation, 27 - 28 - 29 Septembre à Paris
Nous vous donnons rendez-vous, les 27, 28 et 29 septembre
sur les salons Opto et Automation, à Paris Exposition - Porte
de Versailles. Notez notre no de stand J54 et surtout
n’hésitez pas à contacter Amélie Roy au 05 57 26 68 96 ou
a.roy@i2s.fr afin d’obtenir une ou plusieurs invitations gratuites.
A bientôt !
XCI-SX1 : la nouvelle caméra intelligente
de SONY est disponible !

VOL PARABOLIQUE ET MICROPESANTEUR
Si le vide est facile à obtenir sur Terre, l’impesanteur – plus
exactement la micropesanteur2 – est un état difficile à
reproduire. Difficile, mais pas impossible.
Le vol parabolique, effectué à bord d’un avion spécialement
aménagé, permet d’obtenir une chute libre à trajectoire
parabolique.
Le principe du vol parabolique
Lors de la 1
ère phase de vol, l’avion évolue à l’horizontale. Le
pilote prépare sa parabole en augmentant progressivement sa
vitesse jusqu’à environ 810 km/h, vitesse maximale autorisée
pour ce type d’appareil. Puis il cabre progressivement l’appareil
pour atteindre un angle de 47°. Il s’instaure, pendant cette
manœuvre, une forte pesanteur : les passagers pèsent 1,8 fois
leur poids sur Terre.
Alors que l’avion est en pleine ascension, le pilote réduit
significativement le régime des moteurs. L’appareil tel un
projectile décrit alors une parabole. Ses passagers et sa
cargaison sont alors en chute libre dans des conditions proches
de l’impesanteur.
20 s plus tard, le retour à la pesanteur est rapide. Lorsque
l’avion atteint une inclinaison de 45° vers le bas, le mécanicien
augmente cette fois le régime des moteurs pour redonner de la
vitesse à l’appareil et permettre au pilote de le redresser
progressivement. Les passagers pèsent une nouvelle fois 1,8 fois
leur poids pendant 20 s, en descente cette fois, avant un retour
à l’horizontale et l’attente d’une nouvelle parabole 2 min plus
tard.
Ces manœuvres sont répétées 31 fois lors de chaque vol.
Un champ d’investigation étendu
L’intérêt des vols paraboliques s’étend à de nombreux domaines
tant en sciences physiques qu’en sciences de la vie. La
mécanique des fluides, la biologie, la physiologie humaine, la
combustion et la physique fondamentale comptent parmi les
disciplines les plus étudiées.
Les limites des vols paraboliques
Les conditions d’accès à l’impesanteur lors de vols paraboliques
sont, par rapport aux vols spatiaux, limitées en qualité et en
durée. L’impesanteur recréée lors de ces vols est ainsi de 0,05g,
alors qu’elle est de 10-6g dans une capsule spatiale automatique.
Cette valeur reste cependant suffisante pour l’étude de
nombreux phénomènes.
i2S VISION Mag no10 www.i2s-vision.fr
- 2 -
D
epuis plusieurs années, les
établissements scolaires sont
invités à concevoir et réaliser des
expériences qui sont mises en œuvre
dans des conditions proches de
l’impesanteur1, lors d'une campagne de
vols à bord de l’airbus A300-0G.
Différence entre poids et masse, étude
des oscillations d'une masse, étude du
comportement d'une émulsion… sont
autant de projets développés par des
groupes de jeunes passionnés pour
comprendre le phénomène et les effets de
l'impesanteur.
L’objectif de cette initiative est également
de les sensibiliser à la science et à
l’organisation d’un projet spatial.
Dès la rentrée scolaire de septembre, le
CNES lance un appel à projets permettant
de sélectionner trois groupes d'une
quinzaine d'élèves de collège ou de lycée.
Les expériences sont alors mises en
œuvre au cours d’une campagne de vols
paraboliques du printemps suivant.
Parmi les trois groupes retenus en 2004
par le CNES, figure un groupe de 18
élèves de seconde du Lycée Montesquieu
de Bordeaux - suivant l’option MPI
(Mesures, Physique et Informatique) -
sélectionné pour une série d’expériences
(cf. image 1) sur la chute des corps, les
mouvements sur un plan incliné, les
mouvements de pendule et le
comportement de liquides non miscibles.
Le projet
L’idée du projet est de marcher dans les
traces de scientifiques illustres tels que
Galilée, Newton et bien d’autres, mais en
explorant un nouveau champ
d’investigation, la micropesanteur.
Il semble que Galilée ait beaucoup
expérimenté pour découvrir les lois de la
chute des corps. Il opérait de façon
méthodique en faisant varier de
nombreux paramètres pour recueillir des
données multiples qui étaient ensuite
rassemblées. L’expérience et la mesure
jouent un double rôle, celui de la
découverte et celui de la confirmation
d’une théorie. L’étude des mouvements
sur plan incliné ou des mouvements de
pendule lui permettaient de vérifier les
lois établies avec la chute libre.
Dans un autre domaine, Marie Curie
imagina une expérience avec des liquides
non miscibles qui utilisait les théories
précédemment établies.
«On a compensé le poids de l’huile par la
poussée d’Archimède. En d’autres termes,
on a supprimé la Terre.
Ce qui
montre
que la
forme
d’équilibre
d’un
liquide
abandonné
à lui-même est une sphère. Et c’est ainsi
que la terre est ronde…»
Avec cette idée de supprimer "l’effet de la
terre", le projet présenté par notre équipe
de jeunes scientifiques consiste à
effectuer une série d’expériences qui
permettront de vérifier des lois déjà
connues mais dans des conditions que
nos célèbres physiciens, cités
précédemment, n’ont pu étudier : la
micropesanteur.
Encadré par leur professeur de physique
Eric Couture, notre groupe d’élèves
(Suite page 3)
Expériences en micropesanteur à bord de l’airbus A300-Zéro G.
Un système d’enregistrement filme plusieurs expériences réalisées en micropesanteur
pendant un vol parabolique.
(1) au terme apesanteur, utilisé dans le langage courant, on préfère aujourd’hui celui d’impesanteur
(2) appelée aussi microgravité
Image 1 : Les bancs d’expérimentation à bord de
l’A300-0G
Image 2 : Eric découvre les premières sensations
de la micropesanteur !

i2S VISION Mag no10
www.i2s-vision.fr
- 3 -
Expériences en micropesanteur : les résultats.
L
a société suisse Photon Focus lance la BLIZZARD, une
nouvelle caméra CMOS très compacte en format
Camera Link ou USB2.0. Cette caméra appartient à la
nouvelle génération de caméras CMOS Photon Focus, qui se
caractérise par une grande qualité d’image. Celle-ci est
obtenue par la réduction drastique des pixels défectueux de
la matrice, tout en maintenant les fonctions essentielles :
Global Shutter, LinLog et fenêtrage. La série Blizzard utilise
le même design que la série MV-D1024, exploitant toutes les
sorties du capteur et sa vitesse maximale, pour délivrer
jusqu’à 60 images par seconde.
BLIZZARD : nouvelle
caméra CMOS 10 bits
USB2.0 / Camera Link
de Photon Focus
Spécifications BLIZZARD-60
Capteur CMOS 2/3’’ monochrome
Résolution 750 x 400
Taille pixel 10,6 µm x 10,6 µm
Numérisation 10 bits
Fréquence image 60 images / s
Flux max 20MHz
Dynamique > 120 dB avec LinLog™
Sensibilité 1,2 DN/(nJ/cm²) à 630 nm / 8 bits / gain = 1
Format de sortie Base Camera Link ou USB2.0
Monture CS/C
Dimensions version CL 24 mm (P) x 55 mm (H) x 55 mm (L)
Dimensions version USB2.0 35 mm (P) x 55 mm (H) x 55 mm (L)
Poids 140 g (CL) – 180 g (USB2.0)
Alimentation 12 VDC
Consommation 1 W (CL) - 2,5 W (USB2.0)
T° de fonctionnement 0 à 60 °C
NOUVEAU
imagine, conçoit et réalise quatre
expériences robustes, pouvant résister à
des accélérations de 8g.
Sur l’image 3, on distingue au premier
plan sur la gauche l’expérience relative
aux liquides non miscibles. Elle sera filmée
à l’aide d’un caméscope standard. En
arrière de la valise de réglage des
caméras, se situe le deuxième bloc
d’expérimentations relatives à la chute
d’une bille, aux mouvements d’une bille
sur plan incliné et aux mouvements d’un
pendule.
Ce bloc incorpore un système d’acquisition
et d’enregistrement d’images pour une
exploitation et une analyse ultérieure des
résultats.
Le système d’enregistrement d’images
Le système préparé par l’équipe de
support technique i2S (cf. image 4) est
basé sur un système d’acquisition Matrox
4 Sight équipé de deux caméras Sony XC-
HR50. Pendant la phase d’impesanteur,
Eric, notre ‘zeronaute’ expérimentateur -
seul habilité à participer au vol - choisit la
caméra appropriée à l’expérience en cours
et déclenche la séquence
d’enregistrement.
Au rythme de la caméra, les images sont
compressées et enregistrées en temps réel
sur le disque dur du système.
Une réussite totale
Le jour J - mercredi 9 mars 2005 - les
expériences ont parfaitement fonctionné et
de nombreuses vidéos ont été réalisées.
Les images 5, 6 et 7 illustrent, les
déplacements de billes ou du pendule
observés par les deux caméras XC-HR50.
Les points de trajectoire ont été
matérialisés sous forme d’incrustation
graphique.
Sources documentaires et images fournies par la classe
de 2nd du Lycée Montesquieu.
Plus d’information sur le site www.lmpi.tk.
(Suite de la page 2)
Image 6 : Trajectoire d’une bille en chute libre.
La bille est lancée avec une vitesse initiale horizontale par
un système propulseur (absent sur l’image).
Image 7 : Etude du mouvement d’un pendule.
Le balancier peut être mis en mouvement soit par un
système mécanique soit manuellement.
Image 3 : Installation des expériences à bord de
l’A300-0G et derniers réglages avant le vol.
Image 4 : Le système d’enregistrement d’images
et son boîtier de commutation vidéo et de
démarrage de séquences.
Le départ approche pour Eric. Ses élèves
attendent beaucoup de lui. Il sera leur
zéronaute d’un jour.
Image 5 : Etude du mouvement d’une bille
guidée par un rail incliné.
La bille est propulsée par un système de ressort gâchette.

i2S VISION Mag no10 www.i2s-vision.fr
- 4 -
N
ouvelles caméras Pantera TF 6M8 et 11M4
DALSA propose deux nouvelles caméras matricielles
multi-mégapixels, la Pantera TF 6M8 et la Pantera TF 11M4.
Architecturées autour de capteurs DALSA TrueFrame™, ces
caméras combinent très haute résolution et rapidité (jusqu'à 8
images par seconde). Leurs très grandes dynamiques, leur
conférent des performances idéales dans les domaines de
l'inspection électronique et du contrôle des écrans plats, du test
non-destructif par rayons X, de l'imagerie biomédicale et
scientifique, de la reconnaissance aérienne, de la microscopie et
des applications d'archivage.
Avec 6 et 11 mégapixels ces nouvelles caméras proposent de
très grandes résolutions pour une meilleure détection des
détails. Dotées d'un flux de données pouvant atteindre
2 x 36 MHz, les deux caméras permettent la conception de
systèmes d'inspection nécessitant peu de caméras, diminuant
ainsi le coût global de l'installation, tout en améliorant
l'efficacité et la productivité.
Technologie CCD TrueFrame™
Les capteurs CCD TrueFrame utilisés dans les caméras 6M8 et
11M4 sont produits par DALSA, grâce à un procédé de
fabrication innovant qui garantit un faible niveau de bruit. Les
deux caméras fournissent ainsi une sortie vidéo numérique 12
bits pour un plus grand contraste et une image sans défaut.
«Au travers du développement et de la fabrication des capteurs,
DALSA possède une compétence unique dans l’optimisation
simultanée des technologies du capteur et de la caméra, pour
répondre aux besoins des applications d’imagerie les plus
performantes» précise David Cochrane, Directeur Produit et
Marketing de la division "Vision for Machines" de DALSA.
Le dispositif de faible courant d’obscurité développé par DALSA
permet la production de caméras 12 bits non refroidies, moins
coûteuses que les technologies concurrentes qui présentent
l’inconvénient d’une complexité accrue due au système
additionnel de refroidissement.
David Cochrane poursuit : «Cette caméra couvre des marchés
diversifiés qui requièrent des technologies innovantes et fiables.
Avec la caméra Pantera TF 11M4 nous sommes convaincus que
nous proposons au client exactement ce qu’il demande, avec
plus de performance et de qualité d’image».
Contrôle du shutter
Les caméras 6M8 et 11M4 sont équipées de capteurs full frame
(sans mémoire), ce qui signifie que le capteur continue à
intégrer les charges (autrement dit continue à exposer) pendant
la lecture de l’image. Ceci produit un phénomène de traînée
verticale (smear).
Il existe deux solutions pour supprimer ce phénomène. La
première solution consiste à utiliser un shutter mécanique
(fabriquants : UNIBLITZ, SUTTER) tandis que la deuxième
préconise l’utilisation d’un éclairage pulsé.
Dans les deux cas de figure, l’utilisation du mini connecteur
USB, situé sur la partie supérieure de la caméra permettra la
synchronisation du dispositif externe.
Ce connecteur fournit une sortie TTL à l’état haut pendant la
phase d’exposition de la caméra. De plus il fournit également un
signal de synchro (SYNC).
La gamme PANTERA de DALSA s’enrichit de deux nouvelles caméras 2D
très hautes résolutions !
La gamme PANTERA est une nouvelle génération
de caméras numériques hautes résolutions,
interface Camera Link, équipées de capteurs
monochromes ou couleurs offrant des
résolutions de 1 à 11 mégapixels. Les caméras
PANTERA délivrent des images de grande qualité
à des vitesses pouvant atteindre 60 images/s.
Spécifications PANTERA TF 6M8/11M4
Capteur CCD Full Frame, Progressive
Couleur ou Monochrome
Résolution 11M4 : 4008 x 2672
6M8 : 3072 x 2048
Taille pixel 11M4 : 9 µm x 9 µm
6M8 : 12 µm x 12 µm
Numérisation 12 bits
Fréquence image 11M4 : 4,3 images / s
6M8 : 8 images / s
Flux max 2 x 36 MHz
Gain 1X – 4X
Sensibilité 20DN/(nJ/cm²) à 530 nm
Format de sortie 2 x 8/10/12 bits Base Camera Link
Monture M72x0,75 ou F
Dimensions hors tout -
M72x0.75 57 mm (P) x 94 mm (H) x 94 mm (L)
Dimensions hors tout - F 85,1 mm (P) x 94 mm (H) x 94 mm (L)
Poids 680 g
Alimentation 12 à 24 V
Consommation <15 W
T° de fonctionnement 0 à 40 °C
Les points forts des caméras PANTERA
TF 6M8 et 11M4
• Résolutions jusqu’à 11 Mégapixels
• Image couleur ou monochrome haute
définition
• Pixels carrés de grande taille : jusqu’à
12 µm x 12 µm
• Facteur de remplissage à 100%
• Cadence image jusqu’à 8 i/s
• Fonction de binning
NOUVEAU

i2S VISION Mag no10
www.i2s-vision.fr
- 5 -
D
alsa annonce la sortie de la gamme de
caméras linéaires Piranha3. Conçue autour
d’un capteur innovant, la gamme Piranha3 franchit
un nouveau cap dans la technologie linéaire,
proposant les plus grandes résolutions et les plus
grandes vitesses.
Résolutions de 8 et 12k pixels
Avec des images 1D de 8k et 12 k pixels délivrées à
des cadences pouvant atteindre 33kHz et 23kHz
respectivement, les caméras P3 répondent aux
exigences de production, rencontrées dans l’inspection des
nouvelles générations d’écrans plats et de la fabrication
électronique en général. Ces caméras innovantes démontrent les
capacités de Dalsa à anticiper les besoins des clients et à
développer de nouvelles technologies.
La sortie 320 MHz de la PIRANHA3 permet l’inspection de plus de
produits en moins de temps. La caméra 12k pixels surpasse la
résolution de toute autre caméra linéaire, fournit plus de détails,
et permet la diminution du nombre de caméras dans les
systèmes multi-caméras. Résultat : une économie réelle sur la
partie imagerie. D'autres économies sont également induites sur
l’optique grâce à la très grande précision d'alignement du
capteur, à l’excellente sensibilité de la caméra et une taille
optimale de pixel. L’interface Camera Link assure une intégration
facile des caméras Piranha3 dans les systèmes existants.
NOUVEAU
Les points forts des PIRANHA3
• Résolutions lignes jusqu’à 12288 pixels
• Pixels carrés
• Fréquence ligne jusqu’à 33,7KHz
• Facteur de remplissage à 100%
• Anti-éblouissement à 100%
• Très grande dynamique : 12 bits
• Correction d’uniformité
• Interface Camera Link
Spécifications P3-80-8K40 P3-80-12K40
Résolution 8192 pixels 12288 pixels
Taille pixel 7 µm x 7 µm 5 µm x 5 µm
Dimension capteur 57,34 mm 61,44 mm
Facteur de remplissage 100 %
Anti-éblouissement 100 %
Flux max 8 x 40MHz
Fréquence ligne 33.7 kHz 23.5 kHz
Sensibilité 44.4DN/(nJ/cm²) 22.2DN/(nJ/cm²)
Gain +/- 10 dB
Format de sortie 8/10 bits Camera Link®
Medium ou Full
Monture M72x0.75
Dimensions hors
monture 42 mm (P) x 150 mm (H) x 80 mm (L)
Poids 630 g
Alimentation 12 à 15 V
Consommation < 15 W
T° de fonctionnement 0 à 50 °C
Piranha3 8 & 12 k pixels : nouvelle génération
de caméras linéaires numériques très hautes
résolutions de DALSA.
D
ALSA a présenté sa nouvelle série de caméras Piranha HS (High Sensitivity) basée sur
sa dernière génération de capteurs en technologie TDI (Time Delay and Integration).
Disposant d’une sensibilité 100 fois supérieure à celles des caméras linéaires classiques, la
série Piranha HS répond en termes de vitesse et de sensibilité aux applications fournissant
peu de lumière : inspection d’écrans plats, tri postal, fabrication électronique, inspection des
semiconducteurs et contrôle en continu. Au travers d’une solution accessible et répondant à la
demande du marché, la série Piranha HS propose aux clients une nouvelle avancée en vitesse
et sensibilité.
La série Piranha HS fournit des fréquences lignes jusqu’à 68kHz permettant la réduction des
temps de cycle et ainsi une augmentation de la productivité. Le niveau élevé de sensibilité de
la nouvelle gamme autorise une inspection de grande qualité avec moins de lumière, même à
grandes vitesses. La diminution de la puissance de l’éclairage se traduit par des économies
substantielles pour le client. La gamme Piranha HS propose deux nouvelles versions de
caméras - résolutions de 4k et 8k pixels - avec balayage bidirectionnel, 96 étages
d’intégration sélectionnables et une interface Camera Link.
«Aujourd’hui les clients font tourner leurs systèmes si vite que la mise en place d’un éclairage
à bas coût devient un vrai défi. Avec le TDI, le problème est résolu, parce que l’exposition
multiple produit une incroyable sensibilité. Les caméras Piranha HS sont spécialement conçues
pour améliorer les performances des applications très gourmandes en lumière» commente
David Cochrane, Directeur Produit et Marketing de la division "Vision for Machines" de DALSA.
DALSA PIRANHA HS : nouvelle génération de caméras TDI linéaires très sensibles
NOUVEAU
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%