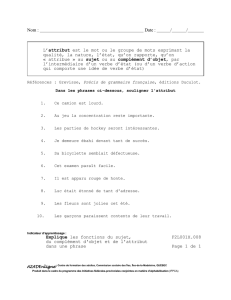Untitled - GWDSpace
publicité

GRAMMAIRE ARABE.
Se vend À Paris
,
père et fils, Libraires de la Bibliothèque
impériale rue Serpente n.° 7.
a tiré
quelques exemplaires sur papier vélin.
Chez De Bure
,
On
On trouve ,
,
les mêmes
che%
les
Libraires,
Ouvrages
suivans du
même Auteur:
Mémoires
de la
diverses
sur
antiquités,
de la Perse
et
,
sur
fes médailles des rois
des Sassanides ; suivis de l'Histoire de cette dynastie, traduite
du persan de Mirkhond. Paru, de V Imprimerie (lu Louvre {Imprimerie royale],
dynastie
*793> * 'v°l- W~4-9
Franc de port.
ou
Extraits de divers écrivains Arabes,
,
On vient de
tant en
q vol.
in-/}..0
LI
avec
,
qui
fig.
,
en
.
,
prose
.
42.
,
Mémoires de l'Académie
XLVH, XLVIII
tome
.
mettre en vente
tomes
Le
$ fr.
à
Franc de port par la poste.
et
1
l'usage des élèves de l'École spéciale des langues Orientales
Paris, de l'Imprimerie impériale 1806 3 vol. in-8." brochés.
366*.
qu'envers,
Histoire
pl#nche$, hwché.
19.
Chrestomatbie Arabe,
vivantes.
de ç
***
XLIX
et
,
royale
h la même adresse,'"
des
L. Paris, de
inscriptions et belles-lettres,
l'Imprimerie impériale i8op
,
renfermera les tables
,
8q fr.
feuilles
et
terminera entièrement
cette
collection
le
paraîtra plus promptement possible.
Ces quatre volumes ont été imprimés
cédera.
à
beaucoup plus petit
nombre que les
pré
»
GRAMMAIRE ARABE
A
DES
ÉLÈVES
L'USAGE
DE
L'ÉCOLE SPÉCIALE
DES
LANGUES ORIENTALES
VIVANTES;
AVEC FIGURES.
Par A. I, SILVESTRE DE SACY.
SECONDE
A
DE
PARTIE.
PARIS,
L'IMPRIMERIE
IMPÉRIALE.
M. DCCC. X.
Haec
qui puer neglexerit, vel adolescentior vir factus in scriptoribus
legendis versatissimus, ubique locorum hœret, saepè pedem ofFendit
ad minimos scrupulos, et in parvis graviter labitur. Si desideramus nucleum,
cortex
frangendus est, et cum aliquâ amaritudine perrumpendus. Studium
linguarum in universum in ipsis primordiis triste est et ingratum ; sed
priinis diffîcultatibus labore improbo et ardore nobili perruptis posteà ubi
sanctissima antiquitatis monumenta versare licet cumulatissimè beamur.
,
,
Arabicis
,
,
,
,
,
,
L. C. Vttlchenatrii Observ. acad.
adorig.
Crac. éd. ah. p. 27.
h
TABLE
Des
conterais dans la II.e Partie.
Chapitres
TROISIÈME.
LIVRE
De la
Syntaxe.
Chap. I." Division de la syntaxe
taxe et la construction
en
deux
la syn
parties,
Page
Chap. II. De la syntaxe proprement dite
Chap. III. Des
règles de dépendance
en
2.
général
Chap. IV. De la syntaxe des verbes , par rapport
des temps et des modes
15.
nominatif
l'emploi
a.
16.
Chap. V. De la syntaxe des noms, par rapporta
des cas
S. I." Du
S. II. Du
i.
l'emploi
35.
36.
«
génitif
39.
S. III. De l'accusatif
Circonstances de temps
48.
59.
60.
Circonstances de lieu
Circonstances de manière
62.
,
Circonstances de manière relatives à l'action
66.
Circonstances de
67.
Circonstances
exprimé,
adjectift
avec
le
comparaison
servant
soit par
soit par
à restreindre
un
un
à déterminer l'attribut
verbe concret, soit par
nom ou un
sujet est indiquée par
entendu
ou
un
simple
adjectif dont la relation
le verte
être, exprimé
.
eu sous-
ibid.
chapitres.
table des
y;
Circonstances de
Page
motif, d'intention
68,
l'usage des cas pour exprimer le compellatif
la complainte.
7&
Chap. VI. De
et
*
Chap. VII.
Syntaxe du sujet
et
de l'attribut
Chap. VIII. Des
Chap.
80.
.
complémens en général
IX. Des complémens objectifs tant immédiats que
médiats des verbes, et des changemens qu'ils éprouvent
quand les verbes passent à la voix objective
X. Syntaxe des complémens des noms
XI. Syntaxe particulière des noms d'action.
XII. Syntaxe particulière des adjectifs verbaux par
rapport aux règles de dépendance
.
.
.
»
.......
Chap.
Chap.
Chap.
.
.
,
.
.
92,
97»
107,
128.
,
142.
S. I.cr
§. II.
§.
Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms d'agent.. 143.
Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms de patient. 153.
III. Syntaxe des adjectifs verbaux simplement qualificatifs. 156*
Chap. XIII.
et
Syntaxe des complémens objectifs des verbes,
autres complémens, dans le cas d'inversion
163*
Chap. XIV.
Syntaxe
des
propositions complémentaires.
176.
Syntaxe des verbes admiratifs et exclamatifs
XVI. Concordance du verbe avec le sujet.
1835.
XVII. Règles de dépendance et de concordance qu'on
doit observer lorsqu'un même nom sert de sujet à plu*
sieurs verbes ou de sujet a un verbe et de complé
au
ment a un autre
enfin d'attribut a plusieurs pro^
Chap, XV.
Chap.
Chap.
171.
.
.
.
»
,
,
positions
...
.
*
<
..............
Chap. XVIII. Concordance du
Chap,. XIX. Concordance des
tratifs
et
des pronoms
sujet
et
les
.
.
.
,,
.
..
.
de l'attribut.
adjectifs,
avec
,.
.
.
.
,
.
.....
198V
204.
des articles démons
noms
Çhap> XX* Çom.Qrd,am des appojitifs .;..*,*,.«
207..
*
«
*
.
224.
TABLE DES
Chap. XXI. Concordance des
vjj
CHAPITRES.
liés par des
mots
particules
Page
conjonctives
Chap. XXÏI.
Syntaxe particulière des verbes qui
complément un sujet et un attribut.
Chap. XXIII.
Syntaxe particulière
Chap. XXIV.
servent
à
Chap. XXV.
§. I."
$. II.
Numératifs cardinaux
Numératifs ordinaux
des
...
.
termes
Chap. XXX.
240.
25
r.
ibid.
.
273.
déterminatif. 276.
Syntaxe particulière de l'adjectif conjonctif
278.
conjonctifs et interrogatifs
Syntaxe
Syntaxe
des pronoms
des
297.
propositions qui fontfonction de
circonstanciels d'état.
Syntaxe
303.
des particules indéclinables
306.
Syntaxe des prépositions
Syntaxe des expressions adverbiales elliptiques appelées
=
noms
238.
noms
Chap. XXIX.
de verbes
,
servent au
Syntaxe
»...
,
S. III. Observations sur la conjonction c_>
S- IV. Syntaxe des particules d'exception et
§• V.
.
numératifs
particulière de l'article
Syntaxe
Chap. XXVIII.
§. I.cr
S, II.
..
.
Chap. XXVII.
et
235.
des verbes abstraits
des
r.
pour
Syntaxe particulière des adjectifs verbaux qui
exprimer le comparatif et le superlatif. y.
Syntaxe particulière
Chap. XXVI.
ont
23
même usage
de la particule
309..
ibid,,
qui
autres mots
315
,
suppositive
ibid.
et
négative Vy
Chap. XXXI. De la construction proprement dite.
,
.
.
.
322.
324.
S. I.er Construction du sujet, du verbe et ds l'attribut
325^.
§. II. Construction du verbe et de ses complémens objectifs
médiats et immédiats
3 3 y..
S. III. Construction du nom et de ses complémens
339*
§. IV. Construction
des termes circonstanciels.
34°*
Virj
CHAPITRES.
DES
TABLE
S. V. Construction des prépositions relativement à leurs ante'
Page
cédens et a leurs conséquens
Chap. XXXII. De
l'ellipse
Du pléonasme
Des licences poétiques
Chap. XXXIII.
Chap. XXXIV.
37 *•
Chap. I." De la
proposition
parties
propositions
tant
Chap. IV. De
l'inchoatif.
Chap. V. De
l'énonciatif
37?-
général
des diverses
nature
Chap. III. Des
en
des
système
Arabes.
grammairiens
Chap. II. De la
359-
considérée suivant le
Syntaxe
34&-
QUATRIÈME.
LIVRE
De la
344*
*
380.
propositions
essentielles
des
qu'accessoires
382.
»...
383.
.
385.
Chap. VI. Du verbe
386.
Chap. VII. De
ibid.
l'agent
Chap. VIII. Du
Chap. IX. Du
Chap. X. Du
Chap. XI. Du
patient
terme
circonstanciel d'état
389.
spécificatif.
complément mis au génitif
terme
Chap. XII. De la chose
Chap. XIII. Des
Chap. XIV.
388.
-.
390.
391.
exceptée
392.
appositifs
Observations
sur
ibid.,
les
chapitres précédens.
Chap. XV. De la construction
Chap. XVI. De la concordance.
.
.
.
k
.
*
395.
396.
402.
Chap. XVII. Des
règles de la dépendance
l'influence du verbe.
nom
d'agent
CHAP, XVIII. De
CHAP. XIX.
Du
CHAP. XX. Du
nom
Chap. XXI. De
de
nom
en
général. Page
404.
ibid.
4°8.
41
patient.
assimilé
l'adjectif
Chap. XXII. Du
I*
CHAPITRES.
DES
TABLE
au
verbe
'•
4*3-
4*6.
d'action
Chap. XXIII. Du rapport d'annexion
.
4-8,
«-
420.
parfait
421.
Chap. XXV. Des particules qui exigent le génitif
Chap. XXVI. Des particules qui ont deux régimes, l'un au
ibid.
nominatif, l'autre h l'accusatif.
423«
Chap. XXVII. Des particules négatives U et Vnon.
le
l'ac
nom à
Chap. XXVIII. Des particules qui mettent
424«
cusatif
le
mettent
au
verbe
mode
Chap. XXIX. Des particules qui
429subjonctif
mettent
le verbe au cas
Chap. XXX. Des particules qui
Chap. XXIV. Du
nom
.
.....
.
nommé
djezm
Chap. XXXI. Des
ou
.
mode conditionnel
qui
noms
mettent
430.
le verbe
au
mode
conditionnel
Chap,
XXXIÏ. Des
432.
noms
Chap. XXXIII. Des
d'une
noms
signifcation
qui équivalent
vague
aux
verbes
Chap. XXXIV. Des verbes abstraits
d'approximation
XXXVI. Des verbes de louange et de
XXXVII. Des verbes appelés verbes
XXXVIII. Des régissans logiques
Chap.
Chap.
ibid.
434.
ibid.
Chap. XXXV. Des verbes
Chap.
.
436.
blâme
437.
de
439.
cœur
442.
DES
TABLE
X
CHAPITRES.
Chap. XXXIX. De la syntaxe de la
ou admirative des verbes
mots
exclamatîve
.Page 443.
quelques usages
appelés abrogatifs
Chap. XL. Observations
Chap. XLI. Des
forme
sur
des pronoms
Chap. XLII. Des adverbes de temps et de lieu,
suivies de leur complément
.
.
447et
des
pré-
générales
maticale
Additions
et
sur
l'analyse gram
i
•
•
•
•
449-
corrections pour la seconde Partie de la
4j7«
Grammaire Arabe
Fin
.
44**-
positions
Chap. XLIII. Observations
444-
dp la Table des Chapitres
de la II.e Partie.
GRAMMAIRE
GRAMMAIRE
ARABE.
■-»
TROISIÈME.
LIVRE
LA
DE
SYNTAXE.
CHAPITRE
Division de
la
Syntaxe
et
La
en
deux
I.er
parties,
la
Syntaxe
la Construction.
partie de la grammaire, que nous venons
de parcourir, a pour objet de faire connoître les diverses formes
suivant les
ou inflexions dont un même mot est susceptible
I.
seconde
,
différentes modifications de genre , de nombre , de temps , &c.
qui- sont accidentelles à l'idée principale que le mot exprime.
Mais il
usage
ne
est
suffit pas de connoître
assujetti
,
dont la connoissanee
discours. De
'
viennent ,
plus
doivent
ces
différentes formes
dans toutes les
est
les
,
//.' PARTIE.
revêtus des
être
disposés
leur
règles
composition du
formes qui leur con-
langues
indispensable pour
mots
encore
:
\ certaines
,
dans
la
un
certain ordre ,
A
2
que l'on
sens
ou
ne
JBE
LA
fe
plus
pourroit
SYNTAXE'.
souvent
intervertir
du moins à la clarté du discours. Ces ,deux
d'une
réunies
forment
nuire
au
parties
de
sans
que l'on ap
l'enseignement
langue
pellera syntaxe. Mais, en prenant ce mot dans une acception
plus restreinte on appelle syntaxe la réunion des règles qui
déterminent i'usage que l'on doit faire des diverses formes dont
ïes mots sont susceptibles pour lier ïe discours et indiquer les
rapports des différentes parties qui le composent ; et l'on com
prend sous le nom de construction ïes règles qui ont pour objet
l'ordre que l'on doit établir dans la disposition respective des
différentes parties. Dans certaines langues la construction n'est,
presque assujettie a aucune autre règle qu'a celles de l'harmonie ;
dans d'autres il est impossible de la réduire à un système uni
forme et rigoureux. Celle de la langue arabe tient un milieu
entre ces deux extrémités. Mais il est à
propos de parler d'abord'
de la syntaxe proprement dite (a).
,
,
ce
,
,
,
,
,
CHAPITRE
De la
IL
Syntaxe proprement
dite.
Avant d'entrer dans
l'exposition des règles dont se com
langue arabe il est bon de rappeler ici
quelques principes généraux qui sont propres à jeter beaucoup
2.
pose la syntaxe de la
de
,
jour sur cette matière.
3. Nous avons dit ailleurs (n.°2i7,
r." p.)
que toute p-oposition n'étant autre chose que i'énonciation d'un jugement de
notre esprit , et Rêvant en être ie tableau fidèle
il est nécessaire
,
qu'elle exprime
un
sujet,
(a) Voyei,s\xr la syntaxe et
tale, a.e édit. p. 231 et suiv.
un
attribut,
sur son
objet
,
et
mes
l'existence intellectuelle
Principes de grammaire géni
I3E
de
sujet
ce
avec
LA
relation à
tuelle, parce que
SYNTAXE.-
3
attribut. Je dis^ existence intellec
cet
esprit peut concevoir et conçoit effec
sur lesquels il forme un jugement sans affir
notre
tivement des êtres
,
leur existence réelle.
mer
parties dont l'ensemble forme une proposi
tion le sujet qui est la première est toujours un nom ou un
pronom ou l'infinitif d'un verbe dans les langues où ce mode
existe; car l'infinitif est un mode impersonnel qui participe
beaucoup de la nature du nom (a). Ces mots sont les seuls qui
puissent exprimer ïes êtres soit réels soit intellectuels ; et c'est
pour cela qu'ils peuvent seuls faire la fonction de sujet. La
seconde des trois parties d'une proposition l'attribut peut tou
jours être rendue par un nom un pronom ou un adjectif; et
la troisième qui est l'expression de l'existence intellectuelle du
sujet avec relation à l'attribut est exprimée par le verbe subs
tantif ou abstrait le seul qui ne contienne rien d'étranger à la
4-
De
ces
trois
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
nature
du verbe proprement dit
,
c'est-à-dire
,
aucun
attribut
déterminé
(n.° 219, i.T" p. ).
J. .Quoiqu'il ne puisse pas
y avoir de
proposition qui ne
contienne un sujet, un attribut, et l'expression de l'existence
intellectuelle du sujet avec relation à l'attribut
cependant if
n'est pas nécessaire dans toutes ïes langues que chacune de ces
trois parties d'une proposition soit exprimée par un mot par
ticulier. Tantôt le sujet étant un pronom n'est exprimé que
par l'inflexion que l'on donne au verbe et qui distingue la per
sonne
qui parle de celle à qui l'on adresse la parole et de celle
de laquelle on parle : ainsi l'on dit en latin rex sum rex es rèx
est; tandis qu'en françois on exprime le sujet par un mot séparé,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
(a) Voye£,
sur
2.c édit. p. 195
et
la
nature
de^ l'infinitif,
mes
Principes
de
,
grammaire générale;
suiv.
A2
4
disant,
en
JE
l'attribut seuls
suis roi ,
sont
SYNTAXE.
LA
DE
roi , IL
TU es
exprimés
,
et
l'attribut ,
telle de l'attribut,
ou
sujet
de
et
,
sa
sujet
qui
est
et
le
relation à
parce qu'il y a dans la forme acciden
dans la manière dont l'attribut est coor
supprimé
est
roi. Tantôt le
le verbe abstrait
de l'existence intellectuelle du
signe
est
,
donné par rapport au sujet, un signe suffisant de cette exis
tence et de cette relation : ainsi l'on peut dire en latin : tu dives,
ille pauper;
libre,
tu ES
il
l'existence
et
but;
et
c'est-là la fonction de
abstrait ,
et
de verbes
aucun
ingenuus, ille servus [tu es riche, il EST pauvre;
EST
esclave]. Tantôt un seul mot exprime l'attribut
intellectuelle du sujet avec sa relation a cet attri
tu
de
auxquels
on
tous
peut , par
raison
,
que le verbe
donner le
nom
ou
verbes
par
un
je
suis
mangeant, je suis allant, je
,
cette
autres
attributifs (n.° 22^, //' p,) : aussi n'est-il
qui ne puisse être rendu par le verbe abstrait
attribut; je mange, je vais je lis sont équivaïens à
concrets
ces
et
même
les verbes
,
,
lisant. Le verbe être lui-
suis
lorsqu'il sert à affirmer l'existence réelle
,
devient concret,
et peut être rendu
par le verbe abstrait et par un attribut : ainsi
Dieu est, signifie Dieu est étant ou existant. Lorsque le verbe être
signifie
l'existence réelle
il peut être rendu
franco» par il
suis
seroit
ridicule en
lisant,
parler
y
je
qui
est
usitée
en
Dans
cette
françois
anglois.
langue on dit : / am
lam
Iwas
vais
lis
going
reading,
je
going [je
j'aliois]. Souvent
un seul mot
indique les trois parties de la proposition comme
en latin,
lego dico; ce qui est la même chose que si l'on disoit,
a.
Cette manière de
,
en
,
,
,
,
,
,
,
ego
sum
legens
,
ego sum dicens.
l'attribut peuvent être
6.
sujet
simples ou composés
ou
:
ils
sont
incomplexes
complexes
simples ou composés à rai
son du nombre d'idées
qu'ils présentent à I esprit ; incomplexes
ou
suivant
complexes
que les idées sont exprimées par un seul
mot ou par
l'assemblage de plusieurs Pinots.
Le
et
,
,
,
DE
J. Le sujet
terminé par
par un seul
dans
,
il offre à
idée
que
5
l'esprit
cette
un
idée soit
être dé
exprimée
par la réunion de plusieurs mots ; comme
Le roi est brave. Le roi d'Angleterre n'a pas le
mot ou
phrases :
ces
simple quand
unique, soit
est
une
SYNTAXE.
LA
pouvoir législatif.
Les hommes les
plus
savans sont
habitent les déserts
modestes. Les Arabes
aussi les
plus
Dans
hospitaliers.
qui
phrases, le sujet est simple : car, quoiqu'il soit
exprimé par plusieurs mots la réunion de ces mots ne présente
à l'esprit qu'une idée totale ; et l'on ne pourroit supprimer
chacune de
sont
ces
,
de
aucun
8.
Le
dénaturer cette idée.
ces mots sans
sujet
composé quand il comprend plusieurs sujets
des idées différentes, comme dans cette phrase:
est
,
déterminés par
Les Arabes , les Persans
et
les Turcs
sont
mahométans.
simple quand il n'exprime qu'une seule ma
nière d'être du sujet comme dans ces exemples : L'homme est
mortel. L'homme est le plus bel ouvrage du Créateur. Les sultans
Asiatiques gouvernent leurs sujets avec une autorité despotique. Dans
l'attribut est simple quoiqu'exces deux derniers exemples
primé par plusieurs mots, parce que tous ces mots concourent à
O.
L'attribut
est
,
,
,
,
former l'idée totale d'une seule manière d'être.
10.
L'attribut' est
nières d'être du
sujet,
comme
dans
il
exprime plusieurs ma
cette phrase : Les Arabes sont
composé, quand
généreux hospitaliers et vindicatifs (a).
I I
Le sujet est incomplexe, quand il n'est exprimé
,
.
un
a
nom,
créé
un
toutes
ou un
pronom
choses , Mentir
12. Il est
(a) Voyrr,,
et
de l'attribut
et
suiv.
infinitif,
est
un
complexe quand
sur
,
la manière de
composés,
mes
comme, Nous
que par
lisons, Dieu
crime.
le
nom
,
le pronom
ou
l'infinitif
distinguer le sujet et l'attribut simples du sujet
Principes de grammaire générale z.c édit. p.
,
zi
6
DE
SYNTAXE.
LA
accompagné dé quelque addition qui sert à le restreihdre à
l'expliquer où à le déterminer comme dans ces phrases : Moi
qui suis vieux je touche a ma fin. Un discours éloquent plaît a tout le
monde. Aimer son semblable est un devoir indispensable. La loi de~
est
,
,
,
Mahomet
.
L'attribut
13.
seul
est
dans l'Alcoran.
incomplexe, quand
comme
,
II
complexe quand
est
,
d'autres
ces
Une
1^.
simples
sont
1
et
6.
qui
mots
phrases
arabe. Je suiÊ
l'un
exprimé
et
le
mot
principalement
énoncer la manière d'être que l'on attribue
dans
est
par un
attribut ,
dans
comme
pagné
il
soit que ce mot soit en même temps verbe
je lis ; soit que l'attribut soit séparé du verbe
dans je suis aveugle.
mot
I/f.
est contenue
:
Je lis
l'autre,
elle
est
sont
sujet
modifient la
en
tous
les
,
destiné à
est accom
signification comme
jours quelques pages d'un livre
aveugle pour les choses que
,
je
ignorer.
simple quand sujet et l'attribut
composée, quand le sujet ou l'attribut, ou
proposition
;
au
,
est
veux
le
,
composés.
Une proposition
de même
incomplexe quand le sujet
incomplexes ;
complexe quand le sujet
ou l'attribut, ou. l'un et l'autre, sont
complexes.
Toutes les fois que le sujet ou l'attribut sont
17.
complexes,
on
peut y distinguer le sujet et l'attribut logique du sujet et
de l'attribut grammatical. Le sujet
logique se compose de la
réunion de tous les mots nécessaires pour
exprimer la totalité
des idées partielles qui concourent à former l'idée totale du
sujet. Le sujet grammatical au contraire ne consiste que dans
le mot qui exprime l'idée
principale qui sert, en quelque sorte,
et
l'attribut
est
elle
sont
,
de base à toutes les autres,
et
,
est
,
,
que
toutes
les idées accessoires
ne
font que développer, étendre, restreindre ou modifier. Si
je dis,
La religion que Mahomet a fondée, et dont la
et
les
armes
ont
force
assuré le triomphe, est plus
conforme à la raison que l'idolâtrie
DE
de la Grèce
Mahomet
et
LA
de Rome, le
SYNTAXE.
7
sujet logique
dont la
les
est
la
religion
que
assuré le
force
fondée,
sujet grammatical est la religion.
II est facile d'appliquer cet exemple à la distinction de l'attri
but logique et de l'attribut grammatical.
18. Toutes les règles de la syntaxe ont pour objet la con
cordance ou la dépendance. En effet, lorsque plusieurs mots se
réunissent pour l'expression d'une idée totale qui forme le sujet
ou l'attribut d'une
proposition ces mots ont entre eux une
triomphe ;
et
a
et
armes ont
mais le
,
relation d'identité
détermination,
,
le Dieu éternel
comme
comme
car, les
noms
genres,
cette
étant
ou
un
rapport de
le roi de Suède,
La relation d'identité
19.
,
par la concordance ;
de divers nombres et de divers
indiquée
est
susceptibles
variété de nombres
et de
genres pouvant aussi
les
,
pronoms , les adjectifs et les
variations n'ayant d'autre destination que d'in
avoir lieu dans les articles
verbes
,
et ces
diquer les rapports de ces diverses espèces de
noms, les règles de la concordance enseignent à
convenable pour fixer ces rapports.
mots
en
avec
faire
les
l'usage
Les rapports de détermination sont indiqués par la dé
pendance ; car ce sont ïes règles de dépendance qui apprennent
20.
à
employer
guer les
mots
des
tives,
lues ,
convenablement les
mots
cas et
les modes
employés relativement et
employés absolument et
les
des
,
pour distin
propositions rela
propositions abso
pour établir dans les rapports la distinction convenable
les deux termes dont ils se composent.
et
entre
Tout rapport a nécessairement deux termes : de ces
deux termes, le premier,
que l'on nomme antécédent, a besoin
du second , appelé
conséquent, pour compléter l'expression de
2 I
l'idée
port
.
; et
,
à raison de cela
se nomme
aussi
,
le terme
conséquent
de
tout
complément.
A4
rap
8
Tantôt le
22.
sert
conséquent
tantôt il y a
d'exposant, c'est-à-dire
l'antécédent
SYNTAXE.
LA
DE
est
entre
;
,
qui
le
complément
ïes deux
immédiat de
termes un mot
détermine ïa
du
nature
qui
rapport.
d'exposant ; alors
le
du
devient
le terme conséquent
complément gramma
rapport
et l'exposant avec son complément forme
tical de l'exposant
le complément total de l'antécédent.
23. On peut envisager les complémens par rapport à leur
signification ou par rapport à la forme de leur expression.
24. Par rapport à leur signification ils peuvent être réduits
à trois espèces : complémens objectifs, modificatifs et circonstanciels.
1 .° Le
complément objectif est celui qui exprime le second
Ainsi dans
ces mots
,
une statue
de
bois, de
sert
,
,
,
'
,
terme
du
rapport dont l'antécédent
est
un
mot
relatif de
sa
même n'en
qui n'exprimeroit qu'un
incomplet,
l'on
si
aucun,
exprimeroit
supprimoit le complément : tel est le
toute
préposition ; tel est aussi le complément
complément (de
de tout verbe actif relatif. Sur quoi il est bon d'observer qu'il y a
un
grand nombre de verbes relatifs dont le sens ne peut être
complété que par l'addition de deux termes différens,et qui ont,
par conséquent deux complémens objectifs ; comme donner
sens
nature,
ou
,
,
quelque chose a quelqu'un recevoir quelque chose de quelqu'un. De ces
deux complémens celui qu'il est le plus indispensable
d'expri
mer
être
nommé
celui
^st
moins
peut
primitif;
qu'il
indispen
sable d'exprimer doit être nommé secondaire. Dans ïes
exemples
donnés, le complément objectif primitif est quelque chose ; le
complément objectif secondaire est a quelqu'un, de quelqu'un. II
faut encore regarder comme complément objectif celui des noms
appellatifs des adjectifs ou des adverbes qui renferment né
cessairement l'idée d'une relation. Ainsi dans ces
exemples le
de
Platon, conformément a la loi, égal a Dieu, les mots
disciple
de Platon, a la loi, à Dieu, sont les
complémens objectifs de*
,
,
,
,
,
,
,
DE
SYNTAXE.
LA
p
mots le disciple, conformément , égal, parce que les idées de dis
ciple, de conformité , d'égalité , supposent nécessairement celles
comparaison entre deux objets.
2.0 Les complémens modificatifs sont ceux qui expriment une
manière d'être particulière qu'on ajoute à l'idée principale du
mot complété
pour la restreindre l'étendre ou la modifier ;
un homme
comme vivre honnêtement parler en étourdi
sage, ta
loi la plus parfaite, un cheval de bois.
3 .° Les complémens circonstanciels sont ceux qui expriment
de maître , de
,
,
,
,
les circonstances de temps
de motif , &c.
Les
pris
2
de lieu
,
complémens objectifs
la dénomination
sous
Les
et
,«de
moyen
,
d'instrument
modificatifs peuvent être
commune
de
,
com
déterminatifs.
à la forme de leur expres
complémens par rapport
incomplexes ou complexes: ils sont incomplexes,
quand ils sont exprimés par un seul mot comme vivre sagement,
l'homme juste, je l'ai vu hier; complexes, quand ils sont exprimés
par plusieurs mots comme l'intérêt de toutes les puissances de
l'Europe je l'ai vu deux jours avant sa mort, vivre très-sagement.
On voit par ce dernier exemple que le même complément
peut être complexe dans une langue et incomplexe dans une
autre ; car, au lieu du
complément complexe très-sagement, on
diroit en latin sapientissimè, On peut encore observer qu'un
complément complexe est toujours formé de plusieurs complé
mens
incomplexes.
20. On peut distinguer, dans les complémens complexes, le
complément logique du complément grammatical. Le complément
<j
sion,
.
,
sont
,
,
,
,
,
,
,
logique comprend la
l'idée totale
réunion de
tous
ïes
nécessaires pour
l'antécédent : le com
mots
exprimer
qui sert à compléter
n'est
plément grammatical
que le mot qui exprime la première et
la principale des idées partielles
qui concourant à former cette
DE
IO
idée totale.
la valeur
ne
le çérfoit
en
cette
rien
proposition, J'ai vu Turenne dont
a celle des plus célèbres
généraux de
,
complément logique du verbe voir
valeur &c. ; mais le complément grammatical
l'antiquité,
la
Ainsi, dans
SYNTAXE.
LA
le
Tout
27.
ce
absolus des
mots
que
nous venons
mots
relatifs.
de dire ,
est
Turenne dont
est
Turenne.
mène à
distinguer les
Je n'entends pas ici par
mots re
qui le sont de leur nature ou qui sont susceptibles de
le devenir logiquement: dans ce sens le mot père, par exemple,
est toujours, relatif; car l'idée de
père suppose celle de fils. Mais
j'appelle absolus grammaticalement, les mots qui sont employés
dans une proposition sans être en relation d'identité ou en rap
port de détermination avec aucun autre ; et relatifs grammati
calement ceux, au contraire qui sont employés avec l'une de ces
latifs ,
ceux
,
,
,
,
deux sortes de relation à d'autres
mots.
La relation du
sujet
à
l'attribut n'est ni relation d'identité , ni rapport de détermination ;
elle ne rend donc pas les mots qui expriment le sujet , relatifs
grammaticalement à ceux qui expriment l'attribut. Dans cette
phrase le père est âgé, les mots père et âgé sont employés d'une
,
manière absolue.
28. Ce que
sition
ou
,
s'applique
absolues
tion ,
nous
cet
ou
disons des
aussi
qui composent une propo
propositions elles-mêmes. Elles sont
aux
faut pas entendre ici par rela
existe entre toutes les propositions
relatives ; mais il
enchaînement
qui
discours
mots
ne
qui lie les différentes parties d'un
syllogisme. Cette relation est logique et non grammaticale.
Une proposition est grammaticalement absolue
quand elle
forme à elle seule un sens complet ; elle est
grammaticalement
relative quand elle ne forme un sens complet que par sa réunion
avec. une ou plusieurs autres
propositions.
Une
absolue
proposition
peut être impérative prohibi
2p.
tive interrogatife affirmative
négative /concessive, optative,
qui composent
un
,
ou
,
,
,
,
,
,
,
LA
DE
admirative ;
et ces
I I
SYNTAXE.
différens caractères
sont
indiqués
ou
par des
qui n'ont d'autres fonctions que de déterminer la nature
des propositions, comme an, en latin, pour les propositions interrogatives utinam pour les propositions optatives ; ou par les
différens modes du verbe ou par l'ordre dans lequel on dispose
les diverses parties constitutives de la proposition.
abstraction faite du
QO. Dans les propositions relatives
comme supcaractère de chaque proposition en particulier
positive, conditionnelle subjonctive &c. on peut toujours
mots
,
,
,
,
,
,
considérer l'une des deux
le
conséquent
nommé
I
3
jonction
.
du
,
comme
rapport ,
et ce
l'antécédent
second
et
terme
l'autre
comme
peut aussi être
complément.
La
nature
du rapport
est
déterminée , soit par
une con
soit par un mot conjonctif qui en est l'exposant ; ou
bien elle est seulement indiquée par la forme des propositions ,
,
les modes des verbes, &c.
3 2.
La division que
nous
avons
faite des
complémens en
peut aussi s'appliquer
sont objectives, quand
,
objectifs modificatifs et circonstanciels
propositions complémentaires. Elles
elles sont nécessaires pour indiquer le ^second terme d'un rap
port dont l'antécédent se trouve faire partie de la proposition à
compléter ; exemple : Le roi voulut que le coupable avouât sa faute.
La proposition complémentaire que le coupable avouât sa faute
est le
complément objectif du verbe voulut. Si elles servent seule
ou un
ment à modifier la proposition qui sert d'antécédent
des termes de cette proposition elles sont modificatives ; telles
sont les propositions complémentaires
qui étoit instruit de sa
conduite pourvu que cela vous fasse plaisir dans ces phrases: Le
roi, qui* étoit instruit de sa conduite, lui fit diverses questions.
J'irai volontiers promener, pourvu que cela vous fasse plaisir. La
première modifie seulement le sujet le ni ; la seconde modifie
,
,
aux
,
,
,
,
,
,
SYNTAXE.
LA
DE
12
j'irai volontiers promener. Enfin les pro
positions complémentaires sont circonstancielles quand elles
ajoutent seulement l'idée d'une circonstance à la proposition qui
sert d'antécédent, comme, Je partis de Constantinople lorsque
la
proposition
entière
,
,
mon
fils fut
revenu.
propositions complémentaires sont aussi complexes
ou
inçompléxes : complexes quand elles sont elles-mêmes for
mées de plusieurs propositions qui ont entre elles les rapports
d'antécédent et de conséquent ; incomplexes quand elles ne sont
point le résultat de plusieurs propositions réunies. Dans celles
qui sont complexes on peut distinguer la proposition complé
mentaire logique de la proposition complémentaire gramma
Les
33.
,
,
,
ticale.
34.
et, s'il
•
II y
est
a
plusieurs
permis
de
manières de déterminer
se
servir de
ce
,
de
restreindre,
terme, d'individualiser les
appellatifs.
adjectifs les propositions con
jonctives les complémens déterminatifs sont employés pour
produire cet effet. Mais, outre cela, il est un autre moyen d'un
usage très-fréquent et auquel on a recours aussi-bien avec ïes
noms
propres qu'avec .les pronoms et les noms appellatifs : ce
moyen consiste à réunir plusieurs noms qui tous donnent l'idée
de la même personne ou de la même chose, mais envisagée
sous divers
points de vue. Alexandre nom propre commun à
hommes
est suffisamment déterminé lorsque j'y joins
plusieurs
ï epithète le
grand, pour que l'on sache avec certitude quel est
parmi les hommes qui ont portç le nom dJ Alexandre celui dont je
veux parler : mais
je puis encore ne pas m'en tenir la ; et Alexandreïe-Grand pouvant être envisagé comme fils de Philippe comme
roi de Macédoine comme vainqueur de Darius comme meur
trier de Clitus je puis joindre à son nom l'expression de tous
ces points de vue, ou de quelques-uns d'entre eux, et dire:
Les articles
noms
,
les
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
DE
LA
SYNTAXE.
13
Alexandre-le-Grand, roi de Macédoine, fils de Philippe, vainqueur de
Darius
Ces
expressions que je nomme appositifs (a),
quelques règles de syntaxe.
3 5 Outre les propositions dont se compose tout discours
il en est encore une autre partie constitutive et indispensable et
que l'on doit toujours supposer, quoique souvent elle ne soit pas
exprimée; c'est celle qui sert à appeler l'attention de ceux à qui
s'adresse le discours comme quand on dit, monsieur, madame,
seigneur vous tous qui m'écoute^; je la nomme compellatif Elle
peut être simple ou composée incomplexe ou complexe. En
&c.
,
,
donnent lieu à
.
,
,
,
,
,
voici
une
de
ce
dernier genre
Fortune
Les
,
:
dont la main
forfaits
les
Du faux éclat
couronne
inouïs
plus
qui t'environne
,
Serons-nous toujours éblouis!
En voici
une
qui
est en
même temps
complexe
Faux sages, faux savans indociles esprits
Un moment, fiers mortels, suspendez vos
composée :
,
,
36.
et
mépris.
Tous les
principes que nous venons de poser sont com
langues. Nous allons maintenant passer à l'ex-*
position des règles particulières à, la syntaxe de la langue arabe.
37» La classification la plus naturelle des règles de la syn
taxe seroit de
parcourir successivement les différentes parties
intégrantes d'une proposition, soit simple, soit composée, soit
principale soit incidente soit directe soit subordonnée et
d'indiquer, sur chacune de leurs parties, telles que le sujet, l'at
tribut, et la relation du sujet av^: l'attribut les formes acciden
telles ou inflexions qu'il convient
d'employer. Par exemple,
muns
,
à toutes les
,
,
,
,
,
(a) Voyei mes Principes de grammaire générale
,
a.« édit. p. A70
et
suiv.
l4
diroit
on
qu'en
doit être mis
tion
avec
nombre ,
au
arabe
,
dans
nominatif,
règles
les
comme
les inflexions
vue
espèces
le
,
avec le sujet en
genre et en
l'attribut doit être mis à l'accusatif. Une autre ma
de la syntaxe consiste à
cessivement les différentes
,
proposition directe le sujet
verbe abstrait qui indique la rela
une
l'attribut doit s'accorder
et
nière de classer les
discours
SYNTAXE.
LA
DE
de
mots
verbes , &c.
noms
ou
sortes
,
mots
qui
,
entrent
et
formes accidentelles de
telles que les
,
de
les verbes , &c.
cas
des
noms
parcourir
,
dans le
à passer
ces
suc
en re
différentes
les modes des
circonstances chacune de
dans
indiquant
quelles
employée. En suivant cette méthode on
dira par exemple que le nominatif s'emploie pour indiquer le
sujet d'une proposition directe ; que le verbe abstrait lorsqu'il
ces
en
formes doit être
,
,
,
,
le
doit s'atcorder
lui
nombre ;
genre
l'accusatif
l'attribut
, quand il est
que
s^mploie pour indiquer
avec le
le
verbe
La
abstrait.
sujet par
joint
première méthode
est
après
sujet,
avec
en
et en
et
seroit
une
véritable
synthèse; la
seconde
approche plus
de l'ana
lyse. C'est celle-ci que nous suivrons principalement , parce que,
dans l'enseignement des langues , nous commençons par
expli
quer,
c'est-à-dire, par analyser
des
phrases déjà composée*,
et
n'est que par la voie d'imitation que nous
que
passons à la
syîithèse. Nous ne renonçons pas -cependant absolument à em
ce
ployer aussi la première méthode sur-tout pour ce qui concerne
les règles de concordance.
Je m'occuperai d'abord des règles de dépendance
applicables
aux verbes et aux noms, et
je commencerai par les verbes, pouf
me conformer à l'ordre
adopté dans la partie étymologique de
cette
grammaire. Je passerai eitsutfe aux Tègles de concordance;
Après cela j'entrerai dans quelques détails sur la syntaxe de
diverses espèces de mots qui exigent des observations
particu
lières ; et ces observations seront relatives tant à la
dépendance
,
,
DE
la concordance. Enfin
1*5
SYNTAXE.
LA
je parlerai de l'ellipse et du pléo
nasme
figures grammaticales auxquelles il est nécessaire de faire
bien attention pour réussir dans l'analyse du discours.
qu'à
,
,
CHAPITRE
Des
Les
38.
ïes
verbes,
général.
en
noms
dépendance
n'ont pour
,
du discours. Cette influence détermine les modes des
parties
verbes
de
dépendance
objet' que les
les pronoms, les adjectifs et les articles ; car
les seuls qui éprouvent l'influence des diverses
règles
sont
ces mots
de
Règles
III.
les
et
,
cas
des pronoms que l'on doit
circonstance.
des
noms ou
em
ployer dans chaque
3 O. Les adjectifs ne sont à proprement parler assujettis aux
règles de dépendance qu'à cause qu'ils jouent fréquemment le
rôle des noms, par l'ellipse que l'on fait du nom auquel ils se
,
,
,
rapportent
abstraction faite de
:
les considérer
comme
cette
considération
assujettis uniquement
aux
,
on
devroit
de
règles
con
cordance.
40. Les articles démonstratifs
dépendance
natif J I
par les
4
1
,
par la même raison ;
emploi
de
règles
dépendance
Toutes les fois qu'il y
,
ou son
son
,
sont
et
assujettis
aux
règles
de
quant à l'article détermi
omission
sont
déterminés tantôt
tantôt par celles de concordance.
dépendance entre deux parties
agir sur l'autre la régir
ou h
gouverner, comme l'on s'exprime ordinairement. Les gram
mairiens Arabes appellent cette influence d'une partie du dis
cours sur une autre
Jj£ action ; ils nomment le mot qui exerce
cette influence, et
qui en régit un autre, J*U agissant, et celui
qui éprouve cette même influence et qui est régi, JpU, c'est•
du discours
,
l'une des deux
,
a
est
censée
,
\6
DE
SYNTAXE.
LA
lequel on. agit. Nous emploierons communément les
idées.
mots antécédent et complément, pour exprimer ces deux
rieu
un
plus d'éten
42. Les grammairiens Arabes donnent
due à cette action qu'on ne le fait ordinairement parmi nous.
Petrus
Si, par exemple, ils avoient à analyser cette phrase,
à-dire ,
sur
occidit Paulum
,
ils diroient que le verbe
OCCIDIT
gouverne
son
Paulum à l'ac
sujet Petrus au nominatif, et son complément
assez juste
cusatif; et cette manière de s'exprimer me paroît
le principal rôle dans
puisque c'est, en effet, le verbe. q»i joue
ïe discours (a). S'ils avôient à analyser cette phrase Scimusquia.
,
,
cùm venerit
quia
(Deus)
similes ei erimus, ils diroient que
,
virtuellement à
similes ei erimus
sont
le
de scimus ;
complément
analysassent ensuite chacun des
traction faite de la dépendance
sont
ce
Syntaxe
des Verbes
Temps
et
erimus, similes
jis
CHAPITRE
De la
parce qu'ils
qui n'empêcheroit pas qu'ils
mots
où
l'accusatif,
ces mots
sont
et
ei, abs
du mot scimusi
IV.
par rapport à
des Modes.
,
l'emploi
des
indiqué, dans la première partie de la
Grammaire (n.V 307 et 353), l'usage que les Arabes font des
le
temps de leurs verbes pour exprimer le passé le présent et
ou
de
d'antériorité
différens
les
et
futur
postériorité.
degrés
bien
de
soit
moindre
nombre
leurs
le
temps
que celui
Quoique
des temps que les verbes admettent dans la plupart des langues
43-
Nous
avons
,
,
(a)
sur
On peut voir
de ce principe dans ce que j'ai dit ailleurs
sujet doit être mis en latin, suivant que le verbe
&X infinitif ou au participe caractères qui distinguent
l'application
les différens cas* où le
,
un mode personnel ,ow
propositions directes complémentaires et
grammaire générale i.e édit. p. 309 et suiv.
est
à
,
les
,
,
adverbiales.
Voyez
mes
Principes de
,
européennes
,
LA
DE
SYNTAXE.
IJ
européennes puisqu'ils n'ont que deux temps simples le pré
au
térit et le présent ; cependant
moyen de l'auxiliaire £)B
de
et
certaines particules ils parviennent à indiquer toute sorte
d'époques.
44* On pourroit penser que ce n'est pas à la syntaxe à régler
l'emploi des divers temps du verbe; car, ces différentes formes
étant destinées à exprimer l'époque présente, passée ou future
,
,
,
,
d'un événement, il semble que leur usage ne doive être déter
miné que par celle de ces époques à laquelle appartient l'événe
parle, et que l'on doive nécessairement employer le
présent s'il s'agit d'une action présente le prétérit s'il s'agit d'une
action passée enfin le futur si l'action dont il s'agit est future.
Cependant il n'en est pas ainsi et il arrive souvent que pour
exprimer un événement, on emploie un temps qui de sa na
ture ne convient pas à l'époque que l'on veut indiquer; ce
qui tient à certaines règles de dépendance. Je dis, par exemple,
en françois, si tu viens ici dans deux ans, tu trouveras ce jardin
ruiné ; il n'est pas douteux que l'action exprimée par ces mots tu
viens, ne soit future ; et cependant je dis si tu viens, en employant
le temps présent, et non si tu viendras, en employant le futur,
ment
dont
on
,
,
,
comme
moins
feroit
on
latin
en
tion conditionnelle si,
,
verbe
qui
et
italien. II n'en résulte néart--
parce que la conjonc
le verbe de la proposition corrélative
obscurité dans le
aucune
tu trouveras
et en
,
est au
langage
futur,
,
déterminent suffisamment le
peut mettre l'un et l'autre verbe
pareil
des deux propositions corrélatives au prétérit, parce que le seul
emploi de la conjonction conditionnelle qÎ si détermine ces
sens.
En
verbes
arabe,
au sens
Ujî^ÀQUc^f
au
cas
en
futur
ta»
,
on
(n.° 316,
//'
p.).
ôo^-j é£^~ *** lj££>
On dira donc
cxU- <jf
ïes deux verbes étant
prétérit.
11.' PARTIE.
:
.B
l8
DE
SYNTAXE.
LA
exemple pris de la langue franeoise : J7 tu m'aimois, tu serois digne de ma tendresse. Tu m'aimois
est proprement le temps passé que l'on appelle imparfait ou
présent antérieur; il exprime une chose passée par rapport à
l'époque où l'on parle, mais considérée en même temps comme
présente par rapport à une époque passée de laquelle on parle.
Mais ici il sert à exprimer une supposition rapportée à un temps
Donnons
encore un autre
présent ou futur : c'est que sa valeur est déterminée par la con^
jonction suppositive si (a) et par le verbe de la proposition
corrélative tu serois, qui appartient au mode suppositif, et qui
exprime également le présent et le futur, mais ne peut pas expri
mer le passé. En arabe, on mettra encore les deux verbes de
l'une et de l'autre proposition corrélative au prétérit parce que
le seul usage de la conjonction suppositive
^J détermine ces deux
verbes au sens suppositif (n.° 312, i.re p.). En conséquence
,
,
on
dira
:
<3îjlt
liLiw %-j^S
Dans les deux
les verbes
^^L]
Il
que l'on vient de
cas
voir, c'est
parce que
dans la
dépendance des conjonctions £jî et 1J,
l'on
doit
se servir du
prétérit. Cet emploi des temps est
que
donc déterminé par les règles de dépendance.
Mais comme, en traitant des verbes, nous avons dû néces
sairement anticiper sur cette partie de la syntaxe
pour déter
miner la valeur des temps des verbes arabes, nous
n'y revien*
sont
•
drons pas ici.
Nous
nous en avons
dit ailleurs
passerons, à
syntaxe
partie
(a)
,
et
l'usage
dont
nous
contenterons de
(n.os
des modes
,
et
307
nous nous sommes
Sur la distinction des
t."
z.e édit. p.
184
part. p. #7
et
suiv.
,
//' p.
,
,
que
proprement à la
réservé de traiter dans cette
).
propositions conditionnelles
n.0885;
)
ce
et nous
qui appartient
de la Grammaire ( n.° 351, i.re
p.
ci-devant,
35 3
renvoyer à
et mes
Principes
et
de
suppositives vqyei
grammaire générale
,
,
DE
4^
J'ai dit ailleurs
SYNTAXE.
LA
ip
p.) que je distinguois six
modes dans les verbes arabes Vindicatif, le subjonctif, le condi
tionnel ['énergique, l'impératif, et Vimpératif énergique ; et j'ai, en
même temps observé que j'avois déterminé ïes dénominations
de ces modes par l'usage auquel chacun d'eux est employé le plus
•
272, /."
(n.°
,
,
,
ordinairement.
46.
le seul temps dans
lequel on distingue les
quatre premiers
particulières ( n.° 3 o 5
i.rep. ) Ainsi nous avons à considérer ici l'usage des quatre modes
de l'aoriste indicatif, subjonctif, conditionnel et énergique.
47'- L'aoriste indicatifdoit être employé toutes les fois qu'il ne
survient point quelqu'une des circonstances qui exigent l'emploi
L'aoriste
est
modes par des formes
,
.
,
de l'un des trois
48.
ser
autres
et que nous allons exposer.
,
destiné principalement à caractéri
modes
Le mode,
subjonctif
propositions qui expriment les
les
,
mouvemens
de la volonté ,
toujours l'idée d'un temps futur, et un degré plus ou
moins grand d'incertitude ; et c'est-là ce qui distingue essentiel
renferme
lement
propositions de celles qui sont simplement complé
conjonctives (a). Cette observation sur la nature
du subjonctif peut faire sentir que ce mode n'appartient qu'im
proprement au prétérit ou au présent ; et l'on ne doit pas être
surpris après cela qu'en arabe l'aoriste soit le seul temps qui
ait le mode subjonctif.
L'aoriste subjonctif s'emploie : r.° après la conjonction qJ
que, afin que. Exemples:
ces
mentaires
ou
,
,
[j.^i.
*LJn *ûJ> £ iS^y^r
Je désire que
mangie^ che^
vous
J^»^~>'
moi,
01
cette
tyg^»*'
nuitfr
du
pain.
»
(a) Vqye^,
de
nos
p. 179
sur
la
nature
des modes,
facultés intellectuelles,
et
suiv, ;
et sur
le
et
leur rapport
de
avec
les différens usages
générale z.c édit.
Principes
grammaire
subjonctif en particulier, le même ouvrage
£ 2.
mes
,
,
p.
189.
DE LA
20
// leur
promit
à
tous
SYNTAXE.
deux
qu'il
ne
les
attaquerait
doit être
conjonction ^r
afin que ne, pour que
voici des exemples tirés
II faut observer que la
certaines occasions, par
(n.° 880, i.rep.\>
£?«/#
^wi rrvîfltf
la
pas
permission de
à combattre pour la
iVW
avons
prennent point
En
pas.
traduite, dans
de peur que
de l'Alcoran :
ne,
c
w
Z)/Vk
ne
point employer leurs
cause
mis des
de Dieu
voiles
dernier jour,
« *zz/
sur
ne te
biens
et
demanderont
leurs personnes
(a).
leurs cœurs, afin
qu'ils
ne
le
com
(b),
C'w/ Jrfta/z seul qui
me
l'a fait oublier, de peur
queyV
ne
m'en
(c).
ressouvinsse
faut pas croire néanmoins que
qÎ puisse signifier in
différemment pour que ou pour que ne. La négation n'est pas
proprement comprise dans la conjonction £)f ; mais elle se trouve
implicitement renfermée dans quelqu'un des mots de la pro
position principale à laquelle se joint la proposition conjonctive.
Dans le premier exemple le mot (jituj signifie demander
congé ;
c'est le latin deprecari: dans le second, *l%»f des voiles, et dans
le troisième, Uoî faire oublier, renferment implicitement l'idée
JI
ne
,
'
.
(a)(b)
(c)
Alcoran
,
Aie.
sur.
Aie.
sur.
sur.
18,
p,
v.
;8.
iS\ v.' 6;.
v.
<f£,
DE
LA
2 1
SYNTAXE.
îSobstacle, Sempêchement. Dans
c'est la
préposition
^s. (n.° 834, /." p.) qui
parce que quel
des
en renferme la valeur
mots
qu'un
précédens
(a).
La conjonction ,£)f étant suivie des adverbes négatifs Vet ^J ;
tous ces cas
,
est sous- entendue
,
,
contractée
ou
avec ces
mêmes adverbes
influence,
en un
seul
mot
VI
-
^J f
,
elle Faoriste
subjonctif.
exige après
conjonction ^t cependant n'exige après elle le mode
subjonctif que lorsque cette conjonction avec le verbe qui la
suit équivaut à l'infinitif du nom d'action ; que le verbe ex
prime un temps futur par rapport au verbe de la proposition pré
cédente ce qui est un caractère essentiel du subjonctif; et enfin
qu'il y a entre la proposition principale et la proposition conjonc
tive une dépendance de subordination. Quand la proposition
conjonctive est simplement complémentaire et ne renferme
point les conditions précédentes l'aoriste se met à l'indicatif,
comme dans cet exemple :
-y.5 yf i.cf je sais qu'il dort. Après
les verbes ^i> ù>^*. penser s'imaginer, et autres qui indiquent
une
opinion douteuse ou incertaine, on peut employer l'indicatif
ou le subjonctif.
2.0 L'aoriste subjonctif s'emploie après la particule conjonc
conserve son
La
et
,
,.
,
,
,
,
,
-
,
tive j pour que,
afin de,
fa) Cèst ainsi qu'on
ou
(jt
s.re
p.
-
).
ft-fi
•
&c.
Exemple : éijjjf 'j?'o-L* je suis.
dit indifféremment
£jf
\lc }Lij
bien loin de cela que-,
bienloinque, quand cette expression est suivie d\in verbe (n.° 864»
Comme
cette
construction peut embarrasser lej commençans, il est à
expliquant ce texte de l'Alcoran , s. 17, v. $zr
propos de nous y arrêter. Beïdhawi
Lijjt \yi\3ui
ï
n'approcher, pas
,
de la fornication
,
dit
,
qLXjVI t\ +jjJL>
*._£(JLj (j\ •jLÂJ9 oL«ô>A-lv par Pintention et en faisant tous les préludes
de ce crime, bien loin de le commettre effectivement. On peut voir un autre
exemple
de cette construction à l'endroit cité ,pnmiére partie, page j8^.~
,
DE LA
2X
venu
pour
posées
ne
,
rendre visite. Il
te
de celle-ci
:
SYNTAXE.
de même dés
en est
l$3 afin que,$ÇJ*
de peur que (a).
3 .° II s'emploie pareillement
de, ayant la valeur
et
particules
<!À^.£=J afin que
com
v
après préposition J pour afin
conjonctive. Exemples :
// chercha
la
chose pour le manger.
quelque
*
«°
»
-
j
,
Dieu n'étoit pas pour laisser périr votre foi ; c'est-à-dire, in
tention de Dieu n'étoit gas d'anéantir votre foi.
J n'étant point une conjonction mais une préposition (n.° 8 27,
p.J, quand cette particule a un verbe pour complément, le
mode subjonctif indique qu'il y a
ellipse de la conjonction ^î.
,
i.re
II
de cettevtournure
latine, volo facias.
employer
subjonctif après la pré
position LSiL^ (n.° 830 J."p.) indiquant le but d'une action,
et
pouvant être rendue par afin que ou jusqu'à te que. Exemples :
en est comme
4.° On doit
aussi
le mode
,
,
'
£
•■■■
—
Jï/* /* wif à charge par mon poids fais-le
que je m'envole de dessus toi,
,
moi
connoître, afin
J^Vf j jX^i j^ JL.VÎ j^ jJXlî ^_2 ^
Z'*Ȕ* n'abandonne pas P
espérance jusqu'à ce qu'elle arrive
l'instant du trépas.
,
J^
est une
:
il faut donc
appliquer k sa cons
subjonctif, ce que nous venons
dire de la préposition J
Si
(b). J&. n'indique pas le but d'une
truction
de
préposition
h
avec un
(a) Vqyei
la i.TC
(b) Djewhari
dit
verbe
au
mode
partie^ n.° 884
J^j, mot
:
«
,
^. 397, et
note
de la forme
(a)..
jJLà
.
.
C'est
une
partrcufc
DE
SYNTAXE.
LA
23
,
particule n'a pas d'influence sur le verbe , que l'on
tinet alors à l'indicatif, parce que la conjonction £>f > en ce cas,
action
cette
n'a
point elle-même cette influence.
5 .° Le subjonctif est exigé après la particule c3 toutes les
fois qu'elle peut être rendue pas pour que, afin que, de sorte que,
>
de peur
—
^..Exemples
"
:
'
'
,
1
!
1
1
1
m
■
I
préposition, et remplace jf indiquant le terme, le but.
conjonction synonyme de
Quelquefois aussi elle est placée
au commencement d'une
proposition conjonctive pour la lier avec la précédente comme dans cette phrase : Le sang de ceux qui avôient été tués, ne cessa de
couler par flots dans les eaux du Tigre jusqu'à telpoinh ( /L&.) que Us eaux du
fleuve devinrent d'une couleur mêlée. Si alors le verbe qui suit J^Â est à
la fonction de
qui fait
»
C'est aussi
»
»
une
«
.
,
»
,
»
»
,
l'aoriste,
»
»
»
le
met au
subjonctif, parce qu'il
y
a
sous-entendu. Vous dites
q|
suis allé à
dans l'Alcoran
«comme
»
le
Coufa, afin que j'entrasse A_a.il <j*-â. dans cette ville. J^a.
JLà»iî signifie jui.il £)t J,\ ; mais si vous voulez dire que vous entre^dans
la ville en ce moment, vous mettrez le verbe à l'indicatif. C'est ainsi qu'on lit
•»je
»
on
situation
texte
:
Jj^JyJ f
indiquant
JL^ f
de
,
le but
comme
Djewhari
IjJj^jj
Jj-JÛj <>_i.
«JiLàJt
s'il y avoft
;
les
autres
kJLâ
0
à
•
JJLj
P
Les
,
uns
*isent
comme
Jj—*j-J \
Uj&Â
indiquant
<jj—Â
.
"
>
la
Voici
:
jjCUIJ *l^Çj¥ f j J,\
i}AJ3Tl# JjjUuj
'
ïJJjZ^ VjLa^
#îà£î ôjÂ
fc)j-£lï
Oj-*-
c£j c^-*-* L?-»
oJ?-> à$J j^ï *lp-4.
*«lé
(Jj^Jj
ôlr qIî LâJLo.Sî q( Jf J-*2 L4JUÔÎ c>-^
*-tr-^f Jî ^j-?
^*-*-V JjT*,i *i^' £
v{j-»>"N îjj-jî-rf <>-* W>bi ^-Hj
6<^_> Jj^J' ci-* js»-^ **•— *A*<9» £*3 o-^b
o-^j
*
*^
'*L*^ s^-*2-^
B4
2^
SYNTAXE.
LA
DE
-.-
f
recevrai
avec
'
Visite-moi
,
et
je
te
que je puisse t' honorer
en
j'entre
-
honneur; c'est-à-dire
,
m
W*
te recevant.
Pardonne -moi,
dans le
•
Seigneur,
paradis.
j'entrerai c'est-à-dire, afin
et
que
,
<2UUfel> <£<>_£. lli *#
Ne
risse,
me
ou
châtie pas
de
je périmai; c'est-à-dire, m sorte- que je pé
périsse.
peur que je
,
et
ne
...*Jj«a.j Ojt^rLH t^*^'! *j tV*-' ^ r*~0 O^t^' ^<H
iVV chasse pas ceux
soir, dans la vue de lui
du nombre des
chassois,
tu
puisse
-Lh2--*
*
^sjLÎÏ.11 Jj-* (JjXjCJ j^i^JaLxJ
qui invoquent leur Seigneur, te matin et le
plaire
.
.
.
,
les chasseras,
et tu
et tu seras
si
prévaricateurs ; c'est-à-dire, parce que,
tu
les
serois &c.
Zéid est-il
que je
'
che^
lui!
aller le
Pour que la
et
j'irai
le trouver;
c'est-à-dire,,
en
sorte
trouver.
soit
susceptible du sens de pour
que, afin que, en sorte que, de peur que,set qu'elle exige, en con>séquence, après elle, le mode subjonctif (n,° 880, 1." p.) il
faut qu?elle exprime une conséquence un effet de l'idée conte
nue dans la
proposition précédente et que cette proposition
ou
un commandement
renferme,
jï>~ÀJ où une prière *\£oJi
ou une
ou
une
prohibition J&J
déprécathn ^1/f j iUÎ4?',
ou une
interrogation J^kxl^i , ou un souhait I&Jf ou une
,
conjonction £
,
y
,
,
,
,
,
DE
espérance J+jiJiï
sentation
^'j^\
ou
y
exhortation
ou une
,
,
enfin
SYNTAXE.
LA
,
une
2$
lj#râ^&J
négation
repré
ou une
,
d'une chose future
J^J
.
que, dans tous ces cas, le
subjonctif après <J , renferme l'idée d'une
Si l'on y fait attention,
on verra
verbe que l'on met au
chose futijre dont l'existence
la volonté
et ce
;
conditions
sont-là
,
est
subordonnée à
comme
nous
l'avons
qui requièrent proprement l'usage
action de
une
déjà dit, les
du mode sub
jonctif.
quand elle est employée dans la même
signification que la particule ci des exemples précédens exige
après elle le mode subjonctif (n.° 883, i.re p.). Exemple: \\
6\° La
conjonction J
,
,
JtJjU. -4.C.À-*
^jj^uJ \
lji\»li '^ùS\
croyez-vous que
Dieu sache auparavant qui
courageusement
,
en
vous
Jk*î vZJtl «JL^t L_Li.(>_»" q! iO^ua.
entrerez dans le paradis
d'entre
vous
Dans l'avant-dernier
mot
sorte
leur
Mil
qui
qu'/7 connaisse par-là ceux qui
sont ceux
ont
sans
que
combattu
sont constans
(dans
croyance)!
1JL«-^ la con
jonction j signifie Ja même chose que <£**. et c'est ce qu'in
dique l'aoriste subjonctif.
La conjonction J exige encore l'aoriste subjonctif, lorsque
outre l'une des dix conditions dont nous avons
parlé au sujet
de la conjonction ci elle indique simultanéité entre ce qui la
précède et ce qui la suit : mais c'est qu'alors même elle peut
encore être considérée comme
équivalente à la particule js£
,
,
,
,
.
Exemple : ^jjJJl CSy&j éllsuJ! J^=»u J*
du
en
jonction
comme
Dans
cause
et
que
tu
mangeras
que tu boiras du lait! c'est-à-dire, en sorte que tu
même temps du tait : car , si dans cette phrase la con
poisson,
boives
est-ce
j
et
étoit
JU=>U
simplement copulative
il faudroit ç.tj
-
*
.
tous ces cas
d'effet
,
entre
,
la
conjonction <J indique un rapport
les deux propositions qu'elle lie ; et
de
la
z6
DE
conjonction ^,
LA
dont l'usage
SYNTAXE.
est
plus
rare
indique un rapport dç
,
simultanéité.
jl,
7.0 La conjonction
qui signifie proprement
ou,
ou
bien,
doit quelquefois être traduite par pour que , jusqu'à ce que, à moins
ne ; et alors elle met le verbe qui la suit au mode subjonc
que.
tif (n.°
.
.
884, '"?•)• Exemples: liLï
jî JilCÏÎ "^^jSÎ certes, jj
fasse musulman; iÀJ^*jJ*
JLâ. JS U y j \ certes, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu me donnes
il y a une ellipse
ce
que tu me dois. JDans ces propositions,
ou de
que l'on pourroit suppléer ainsi, il faut que £)l ^àÂà^
quelque manière équivalente.
La particule jî exige aussi l'aoriste subjonctif, lorsqu'elle est
répétée et qu'elle sjgnifie 'soit que. C'est ainsi qu'on lit dans
l'Alcoran : a_jo^JLj \\ 'b^JJJc ôy^-J y *is» _>-**' o~* &-* (J^cr
smt que Dieu leur
pardonne soit qu'il les punisse cela ne te regarde
tuerai
à moins
l'infidèle,
qu'il
ne
se
m
,
,
y
,
nullement.
Dans
ïe
subjonctjf
rentes
les
tous
,
il y
manières
,
où ïes
cas
a une
conjonctions ci j et jl exigent
ellipse que l'on peut suppléer de diffé
-
suivant les circonstances
:
mais
de
,
quelque
toujours la
qu'on supplée
ellipse,
conjonction qÎ ; et c'est parce que la proposition est réellement
dépendante d'Une autre et subjonctive que l'on emploie le
manière
cette
on
y trouvera
,
mode
'
subjonctif.
emploie toujours l'aoriste^ subjonctif après l'adverbe
négatif ^J. Exemple :'ôSjoJLi 11 11! Vf JJjJ\ IlL? y le feu
ne nous tojichera
qu-'un certain nombre de jours.
n'est
O-J
qu'une contraction de qÎ V [non quodj qui suppose
l'ellipse du verbe ojJC feritj en sorte que cet adverbe négatif
équfrautà £>l op^j. V il n'arrivera pas que (n.° 8 50 //' p.) ; et
c'est à cause que cet adverbe renferme la conjonction £>(, qu'il
veut après lui le subjonctif.
^
8.° On
,
,
,
DE
LA
27
SYNTAXE.
emploie aussi l'adverbe JÎ dans le sens déprécatif (a).
9.0 Après l'adverbe fit ou ô'ij qui répond aux mots françois
eh bien fort bien le verbe se met aussi à l'aoriste : mais il faut
dans la signification de
pour cela 1 .° que l'aoriste soit employé
On
,
,
,
,
futur,
et non
premier
mot
immédiate à
présent; 2.0 que cet adverbe soit le
de la phrase; 3.0 que cette phrase soit la réponse
une
phrase précédente et en indique une con
dans celle de
,
l'adverbe sans
que l'aoriste suive immédiatement
d'aucun mot , à moins que ce ne soit une né
séquence ; &.°
l'interposition
gation un serment
,
,
ou un nom
vocatif.
Exemple : qu'une perj'irai te voir demain; celle-
Càjjj\ uî
ci peut lui répondre éUjJ=»f ^ïî fort bien, je
honneur, ou bien lsUJJ ^i. f *JI I j ô i\ fort bien
sonne
dise à
ttui
une autre
*
*
te
,
ferai dû bien; ou
d'affront.
encore
cillât H ô>f
eh bien,
recevrai
par Dieu
je
ne te
,
avec
je
te
ferai pas
requises pour que l'ad
verbe (jïf exige l'usage de l'aoriste subjonctif, et sur la termi
naison de cet adverbe je suis très-porté à croire que c'est encore
la conjonction q( qui introduit dans ce cas l'aoriste subjonctif
et
que £)M est pour £)f if ; mais alors il faut supposer l'ellipse
En réfléchissant
sur
les circonstances
,
,
y^JCJ en sorte que la phrase complète seroit £)li"'M
éUj^=.f yf qj-Cj \ùlsa si la chose est ainsi alors il arrivera que
du
mot
,
,
(a)
L'auteur du Kamous reconnoît que ^J est une contraction de
V\
rejette l'opinion des grammairiens qui prétendent que cet adverbe
^f
mais il
ajoute de l'énergie
à la
négation.
Voici
ses
propres
expressions <_jj-a*
:
£)f V l$JU>î J^aîJLlUf
Vj JUîxlôu Sj-jJ
*Leà-U ir-ij -M^Ul ci-* *0^^' X3 j^-M Djewhari semble
o*Jj3
o~»j£
même avis que Firouzabadi
nier une chose future.
....
; car
il dit seulement que
cette
[J
ù^Sj
être du
particule
sert
à
28
SYNTAXE.
LA
DE
la
je t'honorerai fa). On voit que dans toutes ces circonstances
proposition qui commence par le mot Û>J, renferme les idées
de futur et de dépendance qui caractérisent l'usage du subjonctif.
4<). II résulte de tout ce qui vient d'être dit de^ l'usage
de l'aoriste subjonctif* que c'est la seule conjonction £)t expri
mée ou sous-entendue qui détermine l'emploi de ce mode. La
,
,
arabe fait donc usage de deux moyens réunis pour
tériser les propositions subjonctives , de la conjonction y f
langue
mode
Au lieu de
(a)
auteur
subjonctif,
de deux manières
.° Comme
.-on
^if
comme vous
Les conditions
f
7.» if
observe que
chose arrive
mode
de même
subjonctif;
dit aussi
,î\i
à
^J
équivaut
,
on
emploie
du
et
la conjonction
suivant l'auteur du Kamous. Cet
<~-.\ L«~j
jL*i\ qLé=> (jf
influe
l'aoriste,
si h
Paver, dit.
£jif
requises
pour que
prouvent évidemment
,
ce me
sur
semble que
ce
,
le mette
et
mot est
au
employé
:
if
adverbe de temps conjonctif,
passées, et de la conjonction
contraction de
ploie qu'en parlant
renfermant alors
latin
qu'en
carac
des choses
une
ellipse,
qui
.
q[
ainsi que
je
l'ai dit
ne
s'em
et comme
;
;
>f qui n'est originairement qu'un nom ainsi que
p.). On écrit^if au lieu de [if qui cependant
est aussi admis ; et il est si vrai que
Jjif n'est, en ce cas que la représenta
tion de l'accusatif tif que Djewbari observe que, quand ce mot se trouve à la
fin d'une phrase, en sorte que la voix se repose dessus, on doit prononcer
|if sans faire sentir le q, comme, en pareil cas, on prononce, sans faire sentie
le tanwin
fôujj au lieu de f juj
2.0 Comme accusatif de
je
l'ai dit ailleurs
(n.° 857,
,
,
i.re
,
,
,
,
,
observation pour deux raisons : la première c'est
qu'elle
j'ai cru,pouvoir avancer, qu'il n'y a, à proprement parler que
la seule conjonction
£jf exprimée ou sous-entendue, qui exige après elle le
mode subjonctif; la seconde est que cet exemple fait voir ce
que j'ai eu plus
d'une fois occasion de remarquer que les préceptes de la
grammaire Arabe, qui.»
au
premier coup-d'ceil semblent n'être que l'effet du caprice ou d'une aveugte
J'insiste
confirme
sur cette
ce
,
,
que
,
,
,
,
routine, sont fondés sur des raisons que Ton découvre
et leurs exceptions, à'ime analyse réfléchie.
en
soumettant
les
règle*
DE
le même mode. L'un de
ut et
2$
SYNTAXE.
LA
ces
signes suffisant
grammaticale on ne doit
deux
fonction
à la
,
remplir cette
surpris que l'usage autorise souvent l'ombsion de l'un
des deux je veux dire de la conjonction,
ÇO. La conjonction <jf et tous les mots qui semblent la rem
placer comme j-* l? J ci &c. sont nommés par les
rigueur
pour
,
,
pas être
,
-
-
-
,
,
grammairiens
Arabes
cj^fyit
,
c'est-à-dire
,
mots
qui
(o\x mode) nommé nasb o*li (a).
dique proprement la ûnalefatha ou a; dans les noms
verbe
mettent
Ce
au cas
il
le
in
mot
désigne
(a) Le mode subjonctif de l'aoriste a été nommé par Erpénius et par Ie$
grammairiens qui l'ont suivi, futur antithétique. Comme j'ai conservé sur, mes
tableaux cette dénomination ainsi que les autres qui ont été introduites par
Erpénius je crois à propos d'en rendre raison ici. Ce grammairien, voulant
éviter les expressions barbares dont s'étoient servis jusqu'à lui ceux qui avôient
donné des grammaires arabes en latin, a substitué aux mots mod^areum rafeatum
nasbatum giesmatum &c. qu'ils employoient des dénominations plus
intelligibles. If a appelé simplement fiitur ce que l'on appeloit futurum rafèatum; ensuite ayant égard uniquement à la forme extérieure des autres inflexions
de ce temps
il a appelé futur antithétique ce que l'on nommoit avant lui
nasbatum.
Cette nouvelle dénomination est fondée sur ce que, dans
filturum
cette forme
on substitue un
fatha au dhamma pour dernière, voyelle dans
toutes les personnes du futur ou de l'aoriste qui n'ajoutent rien
après les lettres
radicales; et, en effet, le mot cu/lfiiotç qui est grec, signifie, entre autres
choses l'action de mettre une chose à la place d'une autre.
Du mot grec eumiMm qui veut dire retranchement, il a appelé futur
apocope,
la forme que je nomme mode conditionnel ; et il a adopté cette dénomination
parce que l'aoriste à ce mode, perd sa dernière voyelle.
Enfin il a nommé futur paragogique du mot grec Tntçttyuyii l'action
d'alonger,
le mode énergique qui se forme par addition d'un (j avec ou sans teschdid à la,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
fin des personnes de l'aoriste.
Pour moi, ayant observé que ces diverses formes de l'aoriste
exprimoient
réellement des modes différens , j'ai cru devoir leur donner des dénominations
de leur usage le plus ordinaire. Ces dénominations , en
rappelant à l'esprit
leur destination, soulagent la mémoire.
à
ce
sujet, mes Principes de
Voye^,
prises
grammaire générait
,
a.' «dit, p,
a
«5
,
et note
(a).
LA
DE
$0
l'accusatif,
SYNTAXE.
dans les verbes le
et
subjonctif (n.os
305
,
716
et
718, //>).
Le
£)H
mot
nommé par les Arabes
est
de
particule
réponse
I
L'aoriste
du
_J
'■■■
.
circonstances;
1
tions
mode conditionnel
s'emploie
dans
,
plusieurs
:
On doit
,°
^fj-â-j oÎJâ. ^JjS.
de rétribution.
et
en
faire usage
toutes
les fois que deux
proposi
rapport conditionnel, soit que ce rapport soit
énoncé par la conjonction £jf si soit qu'il soit exprimé par quelsont
dans
un
,
qu'un
des
[£> quiconque, L'a
mots
que , U.Js'
que,
et
composés -L*
ses
que , LÀ*
quelque chose que ce soit
,jjÎ U^jf et LSJo. ^« quelque lieu que ce soit que,
^we, tif
Û\A etLM lorsque, ^ et U<jj~ï quand, en quelque temps que: ce
soit que, tjJLs et wLL^*/£ quelque manière que de même que,
ls,\ et ^.] quiconque. Toutes ces expressions établissent entre deux
propositions un rapport conditionnel, et il est facile de leur subs
tituer effectivement la conjonction q] si (n.° 343 //' p.). En
effet, il est -indifférent de dire quiconque m'aime je l'aimerai,
et, en quelque lieu que je le rencontre, je le servirai ; ou de dire,
tout ce
-
les
toutes
fois
-
,
,
,
homme m'aime, je l'aimerai ,
si
un
je
le servirai.
II
à
,
en est encore
l'impératif,
condition.
et
Que
de
Dans
sitions
peut
souvent
indéfini,
on
disoit,
si
vous
en un
endroit,
propositions
que l'autre dépende de celle-là
l'on dise, faites du bien, on yous
comme
d'une
en saura
faites
est
gré;
du bien,
on
gré.
toutes ces
sont à
si je le rencontre
si l'une des deux
même,
c'est la même chose que si l'on
vous en saura
et
circonstances
Faoriste
,
employer
les
met
ce
qui
dans
,
si les verbes des deux propo
n'est pas toujours ,
parce
le prétérit comme
ce. cas
tous deux à
qu'on
temps
l'aoriste. conditionnel. Je. ne
DE
SYNTAXE.
LA
3
I
donne pas ici d'exemples de l'application de cette règle T parce
que j'en ai donné plusieurs en traitant du sens exprimé par l'ao
riste conditionnel
Cette
sage
:
(n.w 342, 343
et
quelquefois
règle
LkL>
Jot j\ yÉ^> h {$*
'J~f {jij L$U-«
juC^f
1."
345,
violée
semble
p.).'
comme
,
Vf
(JJI4.
%àU
dans
ce
L~U- J^ ô*
^jjkjô (^LaJjIj l>-;S^ j-*j Mais la raison en est que
mots (jjlï vXi la conjonction
change la nature de
les
pas
dans
•
l'ex
o
pression
l'influence du rapport conditionnel
empêche
et
,
le verbe
sur
tjfU, ; et que dans ces autres mots qJ<àôS iîLjV^U
la même conjonction remplace l'influence de ce rapport, le verbe
ûy^ôu ne pouvant plus éprouver cette influence, parce qu'il
est dans un autre
rapport immédiat de dépendance avec son
sujet <2ljVjf On peut supposer qu'il y a ellipse du second
terme du rapport conditionnel dont l'antécédent est*_J^.
J_,p ^f
et traduire ainsi : Ceux
auront fait du mal
qui
(en recevront) mais
ils ne recevront que l'exacte rétribution de ce qu'ils auront fait ;
pour
ceux
qui auront fait du bien, soit hommes, soit femmes et qui
seront vrais croyans ceux-là entreront dans le
paradis (a).
Si, dans la première proposition, on emploie le présent anté
rieur c'est-à-dire le prétérit du verbe qL? suivi d'un aoriste
cet aoriste se met au mode indicatif.
Exemples :
,
t
.
,
,
,
,
,
'
*
-
J
Celui
,
J
'
qui
i>
•
-
-
aura
,
•••
*
-
i
•'r1
,:
voulu cultiver le.
,.-
\j\
champ
-
»
-
-»
de la vie
-»-i^...
future,
nous
augmenterons le profit de sa culture; et celui qui aura voulu cul
tiver le champ de ce monde, nous lui accorderons les biens de cette
vie.
(a) Vojyri A\cor. sur. 40
proportions en traitant de
,
,
v.
41. Je reviendrai
la syntaxe des
sur
particules.
l'analyse de
ces sortes
de
DE
32
LA
SYNTAXE.
dJ »LLiJ f
Jlltf ^o c_>Lkj eLâJClJ ôV ôi
J7 une petite somme d'argent te suffit, nous te la rassemblerons à
JLd j
l'instant ( a).
Si l'on
emploie dans la proposition conditionnelle le prétérit
antérieur, c'est-à-dire, le verbe (jL^> suivi d'un prétérit, le verbe
yUr doit se mettre à l'aoriste. J'en ai donné un exemple ailleurs
(n.° 344, //».
Si le premier verbe seulement est à l'aoriste, on le met aussi
au mode conditionnel.
Exemple : UJjbi Ô^ix-j UJlL». par-tout
où vous ire^ nous irons aussi. Si le second seulement est à l'ao
riste et le premier au prétérit, on peut employer l'aoriste indi
,
catif
ou
l'aoriste conditionnel , à volonté. Ainsi l'on peut dire
également ç_À_^f ^kxZ, L et IjJL\ ce que vous fere^, je le ferai.
Voyez un autre exemple de ceci (n.° 316, //' p.). Si l'on emploie
l'indicatif, cela s'appelle *UjJ ou jjJ
L'adverbe conjonctif fi] lorsque, s'emploie aussi
quelquefois.
en
dans
le
même
sens
et
il
alors
a la même
si,
poésie
que ÛJ
influence. Exemple : y^lsjvi iJ^Llà. elLaJ' fit
quand il te survien
dra une faim violente supporte-la.
.
,
,
La
conjonction suppositive jJ si, étant suivie de l'aoriste,
n'exige point le mode conditionnel; au contraire, il faut eh ce
employer le mode indicatif.
propositions corrélatives qui se trouvent unies par
la conjonction
Q si, ou par quelqu'un des mots qui en renferment
la valeur conditionnelle, celle qui
exprime la condition se nomme
et
condition
celle
;
Ly:
qui exprime une affirmation hypothétique,
LjiJf Àj^ rétribution ou compensation de la condition, ou simple
cas
Des deux
ment
ëfjLiÊ compensation.
(a) Voyez
Consessus Haririi quartus,
quintus
et
sextus, p. 150.
Les
DE
lies
£yi
L
SYNTAXE.
LA
Uui
33
la même
qui
appelés par les grammai£jj
noms
tronqués ou imparfaits, parce
qu'il ne leur suffit pas d'une proposition pour former un sens
et qu'ils veulent nécessairement être suivis de deux propositions.
2.0 On doit toujours employer l'aoriste au mode condition
nel après l'adverbe négatif li Exemple : JJl* ^J. jù&s 'J CJLi
juLj.fl Igkjj-i Cà[ i mais comme elle ne put rien faire qui y res
semblât l'abeille la frappa.
Quand il y a plusieurs aoristes dépendans l'un de l'autre celui
qui suit immédiatement la particule 1J est seul au mode condi
tionnel. Exemple : J^lS <_>>*j ôi=.j' Il Une savoit pas nager.
3.0 Après l'adverbe négatif Cl ne pas encore (n.° 8 5 2 //' p. )
négation qui a presque la même signification que If il faut aussi
employer le mode conditionnel. J'en ai donné un exemple
ailleurs (n.° 346 r." p* ) ; on peut y joindre ceux-ci :
mots
-
-
exercent
et autres
influence que la conjonction
riens Arabes fciyuCM *LwV I
,
sont
,
.
,
,
,
,
,
,
»
A>
(Il
«ncore
a
envoyé
son
fyi-Jô
prophète )
atteint le rang des
Ll *a£o
,^jjà.fj
à d'autres d'entre
eux
qui
n'ont point
premiers.
CJ>î(>i. USjiXj Ll JJ
.Afais ils n'ont pas
encore
éprouvé
mes
châtimens.
préposition J, lo^B'elIe donne
signification impéiarive, on doitemproyer le mode
4.° Après
la
de l'aoriste.
à l'aoriste la
conditionnel
Exemple
je ^ilXJ que l'homme qui est dans
Nous
avons déjà observé
ailleurs
l'aumône.
fasse
n.°
8
27, i.Tt p. ) que cette préposition peut perdre sa voyelle
(
lorsqu'elle est précédée des conjonctions J ou <J (a).
l'aisance
:
«*X>
,
(a) Je dois f ire observer ici que dans l'exemple que j'ai donné (n.° 345,
i.r*p.), «-w>i c5i^=»? Ijt <^*j Us arrêtez-vous ( ma deux amis J, pleurons a»
II.' PARTIE.
G
34
DE
SYNTAXE.
LA
s'emploie toujours après l'ad
verbe négatif ^, quand
signification prohibitive ou déprécative. Ex. "Je. élfL ^H ne dépense pas ton argent pour moi : ^àj
est pour ^Jù".
5 .° Le même mode de l'aoriste
il
o
52.
prétérit
mots
la
qui
i.° que la conjonction ô] si,
renferment ïa valeur, donnent même
attention,
en
du
signification
3 10 et 318, //' p.) ;
ferment en elles-mêmes le
(n.os
connoissent les
optative
,
la
J
Si l'on fait
ïes
tous
a
présent indéfini
2.0 que les
sens
ou
du temps futur
négations-
du temps
passé
et
au
l
et
Ltren-
comme
,
le
re-
grammairiens Arabes ; 3 .° que toute proposition
prohibitive ou déprécative porte par elle-
concessive
,
,
même l'idée d'un temps futur
,
indépendamment
de la forme du
verbe que l'on emploie ; on ne sera pas éloigné de penser que,
dans tous les cas où l'on fait usage de l'aoriste au mode con
ditionnel
,
la détermination du temps
que dans la forme même des
conjonctifs,
les
est
moins dans le verbe
propositions
,
ou-
dans les
les adverbes
mots
prépositions
qui y
joints.
surpris en conséquence que l'aoriste condi
tionnel semble signifier tantôt le futur, tantôt le passé, tantôt,
d'une manière indéfinie toutes les époques du
temps.
5 3 Tous les mots soit noms soit adverbes ou prépositions
qui exigent l'usage du mode conditionnel de l'aoriste sont nom
més par les
jgl^it parce qu'ils requièrent
après eux la forme nommée*jLi. ( n.os 305 et 7 1 6 /." p.)
$4' L'usage des deux formet de l'aoriste énergique n'est
assujetti à aucune régie fixe : on les emploie pour donner plus
On
ne sera
ou
pas
,
sont-
,
,
.
,
,
,
,
grammairienjMkabes
,
,
souvenir d'une amante, le verbe
çfo
est au
mode conditionnel
,
non
impératif, et que le J de commandement
tendu mais parce que cette phrase renferme l'équivalent d'une
Taraalyse grammaticale étant, si vous vous arrête^, nous pleurerons.
qu'il
a
,
la valeur d'un
à
cause
est sous-en
condition ;
LA SYNTAXE.
DE
de force à
avec ou
l'expression,
iYtfW
ou
,
en
soit
tu tournois ton
voyions que
du ciel ; mais ,
affirmant
interrogeant,
quand l'aoriste a la signification
prohibitive (n.° 347* r/' p4). Exemples s
sans serment
impérative
soit
35
soit
en
certes , nous te
visage
ferons
vers
différentes parties
côté qui te sera
tourner vers un
agréable.
Vf
Qfkuj* rufl
yfcfaf
Dieu
enfans,
bien de mourir
sans
certes,
en
vous
ce
verre^
jour-là,
lesquelles vous aure^
JJ.
gique-,
II
en est
de
( ce jardin
ma
une
part
vous
JO. Nous
néral
718,
,
et en
//' p.
garde^-vouS
;
cependant
vous
direction.
,
vous
vécu.
de même des deux formes de
leur usage n'est
Syntaxe
la terre )
Ifc^ ^
le verre^ d'une vue claire :
demandera compte des délices dans
l'enfer ; oui
on
sur
assujetti
à
aucune
CHAPITRE
De la
*Ju» 0'
choisi pour vous cette religion ;
avoir embrassé l'islamisme.
recevrez assurément de
,
/i-^f
a
Descende^ ensemble
Certes
$& {Jï&Jl /»^nf
(jj'pi'
l'impératif
règle certaine.
V,
des Noms par rapport à
avorts
parlé
éner
l'emploi
suffisamment ailleurs des
des Cas.
cas en
gé
particulier de ceux de la langue arabe ( n.oî 713). Leur destination, ainsi que nous l'avons dit, est
^'indiquer
îa fonction que les
font dans
chaque proposition ,
//,' PARTIE,
mots
et
susceptibles
d'être déclinés
les rapports da*s lesquels ils
.Cz
36
les
sont avec
ici
cas
LA
DE
en
autres
parties
SYNTAXE.
du discours. Nous allons examiner
détail les circonstances dans
de la
langue arabe
doit être
lesquelles
employé.
chacun des trois
§. I.cr Du Nominatif,
57. L'usage propre du nominatif est de caractériser le sujet
comme je
des propositions ; et l'on pourroit à raison de cela
i.re
l'ai dit ailleurs, le nommer cas subjectif (n.° 717,
p.).
ou neutre,
soit
de
soit
tout
Le
actif,
passif
verbe,
sujet
58.
à ïa voix subjective comme à la voix objective se met au no
minatif ; ce qui a également lieu soit que le nom précède ou
suive le verbe auquel il sert de sujet. Ex. : QjX^i' U- JJo Jiff
ou bien Ulf .JsLî Dieu sait ce
que vous faites.
5p. Le sujet du verbe ^l *-> faisant fonction de verbe
abstrait, et celui des autres verbes de la même nature (n.° 221
se met aussi au nominatif, soit que le verbe abstrait
//' p )
soit exprimé ou sous-entendu : car il est très-ordinaire, en arabe,
de ne point exprimer le verbe abstrait mais seulement le sujet
et l'attribut lorsque l'on parle d'une chose présente ou que Tort
énonce une vérité indépendante de toute circonstance de temps.
L'attribut se met pareillement au nominatif, quand le verbe
abstrait est sous-entendu soit que l'on place cet attribut avant
ou
après le sujet. Exemples :
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
Dieu
Dieu
g*
Ce
qui
défendu,
est
,
le
U
U0f^4_l=>t
(est) très-grand.
(est), tr es-savant.
(jUoVf J,\ s,ji 00.1
plus agréable
aux
hommes, ( c'est)
ce
qui leur est
DE
•
•
Combattre
en ce
•-Y?
mois,
-
->-•?-»• -V?-
(c'est)
ta voie de Dieu être incrédule
,
vénérable,
et en
faire
mal plus
une
en
sortir ceux
bien
encore
SYNTAXE.
LA
plus grave
grand que la
aux
V\
$J
-•
faute grave ;
mais détourner de
lui" et à la sainteté de la
qui
la visitent,
ri
J'',*\J*
(c'est),
yeux de Dieu. La séduction
mosquée
faute
une
(est)
un
mort.
60. Quoique les prépositions gouvernent le génitif, cepen
on trouve
quelquefois le nominatif après la préposition Cà
cornme (n.°826, il' p. )..
6 1 o£« et o* signifiant depuis et étant employés pour dési
gner une époque passée ou un intervalle de temps, sont survis
dant
.
,
du nominatif. Ainsi l'on dit
:
LL**kf
*^j- 0^ «£jÏJ
Li
je
ne
Fat
pas vu depuis vendredi. Les mots à* et ô-îS sont considérés
alors comme des noms , et l'on suppose une ellipse ; en sorte
je ne l'ai pas vu ; le commencement de l'époque
depuis laquelle j'ai cessé de le voir, est le vendredi. On peut aussi
considérer o>» et oo£ comme des prépositions et les construire
avec le
génitif : alors ils sont synonymes de ô*-de, s'il s'agît d'une
époque passée; et de J dans, s'il s'agît d'une époque présente.
62. Il arrive très-souvent que le complément objectif d'un.
verbe, qui devrbit être à Faecusatif, celui d'une préposition,
qui devroit être au génitif, ou le complément déterminatif d*ùn
nom
qui devroit aussi être au génitif, ainsi que nous le dirons
bas
sont
déplacés du lieu qui leur appartient dans la
plus
et mis au commencement de la
proposition
phrase : on les met
alors au nominatif, et ils sont remplacés, dans le lieu qu'ils
que le
sens est :
,
,
,
,
ijevroient occuper naturellement
sonnel. Ainsi l'on dit
,
par
un
pronom affixe per
1
Ci
25/Vtf,
/«
tf
appartient tout
Dieu ,
son
SYNTAXE.
LA
DE
38
qui
ce
apôtre
est
dans le ciel
milieu de
est au
«-■"""
Moïse ,
Dans
remplacent
et
le
ces
sens est
à Dieu.
exemples
ces
,
,
nous
expressions
Tout
L'apôtre
ce
,
est
qui
de Dieu
terre.
vous,.
l'avons choisi.
-
12 *J
-
"*J^3 *^
«Jll Jyj
dans le ciel
est au
la
j
«JjT
U*J
et* sur
et sur
milieu de
vous..
"'
-
la
*ko*^*°'
cSî'jr*
(S>3*
^*^^J.i
terre
appartient
Nous,
avons
choisi
Moïse.
s'exprimer ajoute de l'énergie au dis
et lui donne une sorte d'emphase
qu'on pourroit faire
en françois, en disant : Ûest à Dieu qu'appartient tout ce
Mais
cours
.
,
sentir
cette
manière de
,
qui est dans le ciel et sur la terre.
qui est au milieu de vous. Moïse est
celui que nous ayons choisi (a)%
dans le dernier exemple , est nomi
Remarquez que J^J»
natif, quoiqu'il ne diffère
,
du nombre de
ceux
qui
en
ont
rien, de l'accusatif, ce nom étant
les trois cas*sembïables (n.° 73 1 ,
'■»
Cette construction
suivant
aura
fait
qui
<^^
^y*
de mal , elle serait , certes, bien
intervalle
entre
cela
et
elle
;
péchés
dont elle s'est rendue
eût
ô? ô*k^ ^
elle
grand
coupable.
un
lieu dans
a
contente
c'est-à-dire,
( au jour du jugement ) qu'il y
les
celle
est encore
fô^aj fo^>f *^j ^6-^0^
:
C'est t'apôtre de Dieu même
Fexempl e
ce
s'il y avoitun
(l'ame)
intervalle
qu'elle
grand
voudrait bien
entre
elle
fa) Vqye7_, sur l'usage de cette construction énergique dans la langue
ia-aïque, Sal. Glassii Philologia sacra, de l'édition donnée par Dathius
p. 68 et 6p. Glassius appelle cette construction nominatif absolu.
,
et
hét..
h
LA
DE
SYNTAXE.
jp
*
la chose que.
équivaut ^oJf *<[$àjf
63. II résulte de là qu'une même proposition semble avoir
deux sujets grammaticaux, parce qu'il y a deux noms, indépendans l'un de l'autre, au nominatif: Deus apostolus ejus inter vos~
Mais il n'y a réellement qu'un sujet ; et le mot mis au nominatif
d'une manière absolue qui semble ne pas appartenir à la pro
position, et être, si je puis m'exprimer ainsi comme un horsd'œuvre et qui se place toujours à la tête de la proposition et
avant le sujet est le véritable complément représenté par le pro
nom
personnel qui fait la fonction de complément grammaticaL
Ainsi, dans cette proposition 'j^S^tJ^ «JJf Dieu, son apôtre est
au milieu de vous
[Deus apostolus ejus inter vos), dont le sens est,
de
est au milieu de vous [apostolus Dei est.inter
Dieu
l'apôtre
le vrai sujet grammatical est tlr-3 l'apôtre; le sujet lo
vos ]
gique est *ÎJf jJjLj l'apôtfe de Dieu; et *JtîT Dieu, mis au nomi
natif absolu est réellement le complément logique de JJjh»*>
l'apôtre.
64. Le nominatif s'emploie souvent pour exprimer le vocatif.
Je me contente d'indiquer ici cet usage parce que je traiterai
séparément de la manière d'exprimer en arabe le compellatif.
65 II survient fréquemment au commencement de la pro
position devant le sujet ou devant le mot qui devroit être mis
au nominatif absolu
certaines conjonctions ou autres particules
indéclinables qui exigent que l'on substitue l'accusatif au nomi
natif, comme on le verra dans peu.
Observez que ti
ce
à
que ,
,
,
,
,
,
,
•
,
,
,
.
,
,
,
,
S. IL DU GÉNITIF.
66.
Le génitif s'emploie pour caractériser les noms qui servent
de complémens à d'autres noms ou à des prépositions. Ce ca
ractère autoriseroit à
mentaire
(
n.° 7 1 7,
désigner
i.re p. )
ce cas sous
le
nom
de>cas
C4
complé
4o
La
signification vague
terminée
restreinte
,
q» and
on
Paul
les deux
i
que l'on
on veut
dit,
des
iiUj
pierre
alors
en
annexion
W-iJ
conséquent
ou
Pour désigner
le
,
celui
et
autre nom ;
un
,
rapport
; et dans ce
73J, i.re
modifier la
ou
qui opère
cette
complément *JJt c>^-if
dé
est souvent
comme
le livre de* Dieu, le
(n.°
déterminer\ restreindre
o
appellatifs
noms
modifiée par
ou
table de
noms sont
nomme
l'antécédent,
le
une
SYNTAXE.
LA
DE
fis-
de
rapport,
p.), le nom dont
signification est
,
détermination ,
est
.
complément,
emploie en arabe le génitif.
67- La détermination exprimée par le génjtif peut être fondée
ce
on
infinité de rapports différens.
Rapport d'une qualité à son sujet
sur une
:
*JlJf *-*-£». la sagesse de
Dieu.
ïÀJ I^Jj
Rapport
de la forint à la matière
Rapport
de la matière à la forme -:.
:
dirktms.
Rapport de la cause à
l'effet
Rapport
Rapport
de la
partie
œuf d'argent.
tli l'argent
^fjoJtî
des
^V f ^JU. le créateur de la terre.
:
de l'effet à la cause
un-
:
au tout :
là sagesse.
^jlff^
la chaleur du soleil
jOii"° J.T;
Rapport du tout à ses parties : UÎL^.
Rapport de la chose possédée au
le
commencernent
^ la totalité dés animaux.
possesseur
:
le trésor du sultan.
du possesseur à la chose
sultan de la terré et de la mer.
Rapport
de
^
^Udlif^U
:j^LJÎj ^Jf^UJ^
possédée
Rapport
de l'action à
l'objet : &&Î £xLja création
des deux.
Rapport
de
l'objet
(£ \JiX.'
iront à la
rencontre
âmes.
Tous
l'agent
de leur
ces
à
seigneur;
,
'pJà\ f/JU'
ceux
rapports et leurs subdivisions
ceUx
qui
qui font
sont
tort
partagés
à leurs
en
deux
41
SYNTAXE.
LA
DE
par ïes grammairiens : ils les
renfermant la valeur de la préposition
cjasses
position '^Je.
Ils
nomment
regardent tous comme
J tf,ou celle de la pré
premiers pAlQ jo*i. U et les
les
,
derniers/ ^-£ ^<!Uj L..
68- Les mots # *£■ tout mettent aussi au génitif le nom
qui leur sert de complément : mais il ne faut pas les considérer
et comme effectivement synonymes du
comme dés adjectifs
mot tous [omnes cuncti] ; ce sont de vrais noms qui signifient
-
,
,
totalité, universalité. On dit donc
*Xol Jf
+j*\j
l^*
les animaux
tous
#
ji* Jf"
toute
s*
^5
ls\
-
;
,
j^t
eux
son
,
sert à
qui
origine ;
o
UÎjà^l
la lettre
,
les animaux
,
les hommes
; à
l'universalité d'eux.
>
Le
un nom
,
aussi
qui
un nom
,
X-U-J pour
éprouver qui
sont ceux
œuvres.
à rendre l'idée de
privation
; aussi
opposition
signifie différence,
excepter,
complément
d'eux )
est
qui font de meilleures
ou
j~* incréé
,
est
met-
signifie progénitif. ^iJ£
ce
qui est créé ; fcj-^j «Lliufj *îj3yt £«.
et autres personnes (à la lettre, et la
diffé
au
,
OC'
tous
son
qui signifie sorte,
/j»wf Y$f c'est-à-dire, quoi d'hommes, ou
prement différence de
les vizirs, les kadhis
rence
à
les hommes ;
tous
-*
jQl lequel laquelle
proprement
il
retourne
hommes
qualité. Ainsi l'on dit
quel homme! ùLs ^*»fXjf
»
«-UUI '(X
l'universalité des choses ;
les
,
d'entre
.
'à^Jr J«ljJf
;
la totalité des hommes
la totalité d'eux
chose
:
,
vinrent.
génitif s'emploie encore pour indiquer un
rapport de
prééminence ; il donne alors au mot qui le précède la signifi
superlative. Exemples : H_>>îf J*^ ^a meilleure des créacures ; *kràlïjf Jl*f /^
^?/&r savant des philosophes. Les mots
cation
^^o* et
j* f
,
constructions
que
je
qui sont employés dans de semblables
regardés comme des noms, ainsi
ailleurs ; leur usage répond à-peu-près à celui du
et tous ceux
,
le dirai
doivent être
4^
DE, LA
SYNTAXE.
employé d'une manière abso
lue et sans concordance avec un nom exprimé : c'est comme si
l'on disôit en latin optimum creaturarum doctis'simum philosopha'
au lieu de
rum
optima creaturarum doctissimus philosopherum.
70. Le génitif s'emploie aussi comme déterminatif d'un ad
jectif ; mais il faut alors faire attention que l'adjectif renferme
implicitement un nom qui sert de véritable antécédent au terme
conséquent exprimé par le génitif. Ainsi lorsque l'on trouve
des
neutre
genre
latins
adjectifs
,
,
,
,
,
oll^f ^J>i
il
faut,
prompt dje calcul',
pour
çA^f
t\JiXS
violent de châtiment,
rendre raison de
se
l'emploi du génitif, observer
l'équivalent de c^U^lf ïSSj»^ posses
calcul olisjf *îv* ji possesseur de la
J
c-o
expressions
que
ces
seur
de la
sont
promptitude
du
,
violence du châtiment. De même,
*-^JJf o-^-â-
beau de
visage-,
deux
hommes
Jtxé
IC4
fji
équitables
j«XX»
d'entre vous le condamneront à fournir-une victime
arrive
jusqu*à
qui
la Caba,
oj^tf *iûfï juisJ "^ toute ame géûtera la mort, sont des
expressions équivalentes à *4j/f o-*» jï f-ÂÂCff cJLj fi «jul j
ip^ltfjjji. Cet usage des adjectifs, et sur- tout des adjectifs
verbaux pu noms d'agent, sera mieux
développé par la suite.
1
Les
noms
les
surnoms et les
propres
7
sobriquets ren
ferment souvent deux noms qui forment un
rapport. J'appelle
noms
propres ce que les grammairiens Arabes nomment ÎJU ;
surnoms, ce qu'ils nomment £&; et
sobriquets, ce qu'ils nomment
***^3J»
£Jv Ij.tx*
*j
-
-
.
,
,
,
oJLf
.pî
Les
mère,
Les
t
.
surnoms sont
^\ frère,
sobriquets,
dénomination
,
tiUUf
jliiï.
toujours composés
autres
ou
les titres
sont
tantôt
tantôt^composés,
II
ou
comme
en
est
semblables,
et
des
d'un
honorifiques compris
simples
Û%3\ JÏ\
,
-
de même des
comme
£\ pète,
mots
complément.
sous
la même
IL' lii
-
-
Wf;
&mJ\ ïXg sîJàJÎ'd-Âi
-
noms
qui peuvent
être
-
ou
DE
simples
«Jlf o^é
comme
,
Jj£
xJR juUi
-
<4jé
-
jllilf
-
propres composés
noms
"Jllf.
J.r$ p.)
jj£î
-
olé.
,
II y
.
que l'on
,
4}
SYNTAXE.
LA
ou
a
composés
comme
,
différentes espèces de
nomme
jj iu-*J
tSr>» et
-
première, dont j'ai parlé ailleurs (n.os 508 et 664,
n'éprouve aucune déclinaison, et ïes deux mots de
La
,
meurent
invariables. Dans la seconde
et
dans la troisième , dont
j'ai expliqué précédemment la nature (n.os 662 et 663 1" p.)
le nom qui sert de complément se met au génitif, comme on
le voit pour la seconde espèce dans JSjJ f o^& et «JJf oJyLc
,
,
,
,
,
pour la troisième , dans ï£> jJ*j et ca^ ^-li. Dans cette
troisième espèce , cependant on peut considérer les deux parties
du composé comme un seul mot
(a) ; et alors , le rapport cessant,
et
.
,
la seconde
décline
partie
n'est
plus régie
par la
première
,
et
le
tout se
la seconde déclinaison ( n.° 728 , 1!' part. p. 2py).
Dans
les surnoms il y a toujours un rapport formé de
72.
deux noms; et, par conséquent, le second de ces noms est
sur
toujours au génitif,
»>-»UJi£f -f ,jj\ ,jjj
-
mier des deux
dans
pris
de
son
Yakoub,
(a)
ôj
et
on
,
sont
JjjJ
j»>£
.
Il
ces
est
exemples:
j._Jb^ï
-
indifférent que le pre
qui entrent dans cette composition soit
acception naturelle, comme dans oj£*j Jj\ le père
noms
surnom
Pour les
ils
dans
comme
-
,
donné à
composés
de
indéclinables,
cette
un
homme dont le fils
troisième
comme
jjJlJU
espèce, qui
et
«Jjj^
ont
»
Ie
se nomme
pour seconde
premier
mot
partie
C>XZ
JhP
ayant toujours pour voyelle finale un fatha, et le second un kesra ;
les décline néanmoins
quelquefois sur la seconde déclinaison, en disant au
nominatif
*4j-^ et au génitif .et à l'accusatif lùZ^S» /Les grammairiens
qui admettent cette déclinaison forment aussi de ces noms des duels et des
pluriels. Ceux qui ne l'admettent pas suppléent au duel et au pluriel comme
pour les composés de l'espèce nommée jjituJ (n.° 709, l.re p.). Voye^
,
,
,
le Sihah ,
a
la racine
*j
.
,
44
Yakoub;
dans
ou
^J]JA
une
acception métaphorique,
de la
c'est-à-dire, le père
,
le père de la petite forteresse ,
se
SYNTAXE.
LA
DE
retire dans une tanière
sion
surnom
veut
.
,
composés
sont
se met
de deux
au
<^i^f
ou
expres
dire le vin.
métaphorique qui
73 Enfin dans les sobriquets
ils
,
dans;
renard, parce qu'il
au
itsA'^ï îf la mère des péchés,
et
,
forteresse
donné
comme
noms
ou
•
titres
formant
honorifiques quand
,
un
^3
génitif. Exemples ^Jc^liJf
»"•»'*,»
:
rapport
^a
gloire
,
le second
des dévots ;
-.'
■.•<*.»
l'honneur de l'Etat;
*)fetf. £& le soleil des vertus ; *)jôJf>^
QjjJj^ «JjosfT^L^J la gloire de l'Etat et de la religion; «pHVf^li
la
iMϱ\ llk> /? bon ordre du royaume.
de l'islamisme ;
couronne
composés d'un
plus grand nombre de mots et renferment plusieurs rapports :
alors chacun des mots qui entrent dans leur composition se dé
74- Quelquefois
les titres
honorifiques
sont
,
cline
comme
dans
ce
l'exige
la
du rapport. On
nature
d'Egypte
titre d'un khalife
voit
exemple
âB^jtj*^ qui
en
jjf ^i
un
>
signifie , celui qui paraît pour honorer la religion de Dieu et dans
lequel les trois mots jfjif ^ji et «Jlf sont au génitif, le pre
,
-
mier
jf>cj
régime de
comme
complément de j[j*f
plément de ^ i
comme
,
la
préposition J
et
le troisième *JJf
,
le second qj>
comme
com
..
7J
•
Les
~(j?&> (a),
noms
s'il s'en
composés
propres
rencontre
de
,
quelques-uns
nommée-
Tèspèce
totalement
sont
,
indéclinables.
j6.
Mais
une
autre
observation
briquet
devant être
placé après
nom et
le
ne sont
p.
sobriquet
(a) Voyeih première partie,
388.
importante
le
nom
,
,
on
c'est que , le
peut
,
quand le
chacun que d'un seul mot;
n.c
508,
p.
189 ;
n.°
745 p. 312
,
so
,
mettre
j et n.°
873*
DE
le
génitif, comme formant le complément du nom.
parlant d'un homme dont le nom est oJj Zeïd, et le
sobriquet
Ainsi
,
$5
SYNTAXE.
LA
en
au
sobriquet jj/* besace, on dira jjj oôj comme on dit *ÏIf o+â
Si cependant le nom avoit un article
il ne pourroit plus y
avoir de dépendance : ainsi l'on diroit jl> o^Usif
à cause que
.
,
,
9
le
nom
le
nom
alhâreth
a un
article
; car
qui sert d'antécédent à
prend point d'article (a).
ne
,
comme nous
le dirons ailleurs ,
rapport formé de deux
un
noms
Suivant les
,
grammairiens de Basra, dans le cas dont je parle il faut
le sobriquet au génitif, et l'on ne peut pas dire autrement
que jji=> jjj et È'ty qS\ ; mais les grammairiens de Coufa, permettent en
ce même cas
trois autres manières de s'exprimer i ,° de faire concorder en cas le
nom et le
sobriquet ce qui est la règle générale des appositifs comme on le
verra
par la suite ; exemple nomihatif jj£=z> o^aJL génitif jj^-» iVj*-L accu
satif \\j£=» f Ô^aZ. 2.0 de mettre le sobriquet au nominatif" à quelque cas
que
soit le nom, en sôus-entendant \j>l comme \\f \o^aZ>, c'est-à-dire,
\c^a2.
\j£=> Ij>1: 3.0 démettre le sobriquet à l'accusatif, à quelque cas que soit le
nom, en sous entendant o«
ÏA_If ou .^jâuJit nommé; comme /s ! 1
(a)
absolument
,
mettre
,
:
,
,
,
,
,
,
:
,
'
•
XjjS <££**»>
>
est-a-dir«,
c
Ebn-Maiec suit
[j^T ^-cûCXF
l'opinion
des
iX*»-uj
grammairiens
L_^s? 8^_« y| fi yjè-îj
Le
«
v
»
de
.
Basra;
car
il dit dans
XAlfiyya
^~JL}j *-^-*J 4^ ^-*'i
cî^> c*<>Jf £-*J"î «Jj ^*
ù~?\à o^^jj^ ^J^>. ôli
nom
un sumom
est
,
ou un nom
à
un autre
-.
sobriquet quand
tous
joint
(nom
surnom)
les deux sont simples, construis-les, sans
à
la
manière
des
en
noms
exception
rapport d'annexion; 'sinon, fais concorder le second avec le premier, suivant
les règles d'apposition ( ©Uîf ).
le
propre
sobriquet
est
,
ou
ou
ou un
,
:
mets-le le dernier. Si
,
,
»
?
(Man.
n.°
465
,
Voyei
/ ."
Ar. de la Bibl.
f. 19
aussi
imp.
n.° 1224, f- '4
recto ; et
map. Ar. de S. Germ.
verso.)
ce
fart. p. jop
,
que
note.
j'ai dit
sur
la forme de certains
noms
composés,
n.° 739,
^6
SYNTAXE.
LA
DE
préposition u>, sert souvent à
exprimer l'attribut sur-tout dans les propositions négatives*
ExempPe £>jJULS- l^p JLjUj *j)t Uj Dieu n'ignore pas ce que vous
faites (n.° 824, 1" p-).
78. Les noms qui servent à la numération, depuis trois jus
qu'à *//*•, et depuis cent et au-dessus, gouvernent le nom de
la chose nombrée au génitif. Je traiterai séparément de la syn
taxe des numératifs ; ce qui me dispense d'en parler ici.
70. Le génitif sert encore à caractériser le terme conséquent
de tout rapport qui a pour exposant une préposition ; c'est-à-dire
que les prépositions régissent leur complément au génitif. Les
prépositions ou les mots, regardés comme prépositions qui gou
vernent le génitif, sont tT>--ô-'figl-J-t2î- <>*•
(à* l£
2(î. et fj«c
lits.
^^*
^
f
Les
trois
mots
<**
(3
ù*- ôj
peuvent aussi être suivis de l'accusatif ( n.° 831, i.re p.). II faut
joindre aux prépositions qui gouvernent le génitif, la conjonction
j servant aux formules de 'serment ( n.° 883, irt p.) et la
même conjonction
nommée par les Arabes
j
çj>jjfj (n.° 84 1,
//' p. ) c'est-à-dire
tenant la place de cVj ; la conjonction ci
j
elle
a la même valeur
quand
(n.° 882 i.fe p.)\ et enfin «]J
et *>J^», employés comme
prépositions (n.° 835 1." p.) ainsi
dans
ces
que
exemples : *S1}\ ZX* depuis cette année-ci, A^Jf î&
depuis aujourd'hui (n.° 61).
Les adverbes <ji et L? signifiant il suffit, peuvent aussi
gou
verner un complément au génitif
(a).
80. Par la même raison les prépositions lorsqu'elles ont
pour complément des pronoms personnels exigent l'emploi des
pronoms affixes. Exemples : "Jl vers moi CXé. sur lui <2lu de toit
77. Le
génitif, précédé
de la
,
:
,
,
"
-
~
-
~
"
-
~
•
,
,
,
,
,
,
,
t
,
,
,
,
(a) Voyei
ce
fa* **'* ailleurs
(n,° 000, i.rep.).
<ïue
l'interjection JjJ
de l'adverbe
,
L* (n.° 898
■
,
1."
p<),
et
dtf
DE
LA
Il faut excepter ^
o^
affixes (n.° 895, //'/?.).
4l
SYNTAXE.
1>SS
et
-
,
qui
ne
prennent pas les'
prend quelquefois I'affixe de la troisième personne
explétif (n.° 841, i." p.).
oj
,
comme
préposition préfixe, admet rarement les affixes (n.° 826,
i.rt part.).
8 I On trouve quelquefois deux complémens distincts qui
et dont le rapport avec cet
n'ont qu'un même antécédent
antécédent est exprimé par une seule préposition. Exemple :
**j JUj »\j£\ j%JJ\ qc. cîljyUô ils
t'interrogeront au sujet du
mois inviolable (au sujet) du combat dans ce mois; c'est-à-dire,
ils t'interrogeront pour savoir s'il est permis de combattre dans le
mois inviolable. Dans ce cas', la construction est analogue à celle
dont nous avons parlé plus haut (n.° 62), dans laquelle il y
a deux nominatifs. Si
^& dans notre exemple semble avoir
il n'a véritablement qu'un
deux complémens grammaticaux
complément logique et son premier complément grammatical
j4^ff est réellement le complément de j On dit donc ^i
là
,
.
,
0'"'
<
S
^"
*
■>&
-
,
,
,
,
.
JUV J'j£\ j^i-ff au lieu de »Yy£\ j&J\ j J&? 0^ comme
on diroit j&ï*
Jus (^fj-^f j4^ le mois inviolable, combattre
pendant lui est un crime, au lieu de j&*» J'f£\ j$ÂJ\ j jUi
combattre pendant le mois inviolable est un crime (a).
*a9
,
jus
je propose ici n'est point admise, je crois par les gram
surplus je n'ai point remarqué d'autre endroit où elle
puisse avoir lieu, que le passage de l'Alcoran que j'ai cité, et qui se trouve
sur. 2
u. 2iy. A la manière dont Marracci traduit ce texte
Interrogabunt te de
mense Haram
lu 1^3 JU9
il
in
semble
ait
eo
indictum
est,
jrrœlium
qu'il
le
Beïdhawi
aucune
sur
mot
variante
Jus ; il observe
Cependant
n'indique
seulement que quelques-uns lisent */J
JUc5 Jyé en répétant la préposijion.
(a) L'analyse que
mairiens Arabes. Au
,
,
,
,
,
.
,
En suivant la
leçon ordinaire,
il
regarde Jus»
comme
un
appositif,tmj\jJ
48
du
82. L'interposition
complément,
doit toujours
ne
mot
U
entre une
rien à la syntaxe,
change
être mis
SYNTAXE.
LA
DE
(n.° 800,
génitif
au
CÂJ «i>lf «jîf ^.
P^rr
miséricorde de Dieu,
h«<?
P/w*
^wï/i"
>4
Le
ftfwrf
*/<? leurs
U doit être
mot
certes
,
péchés
regardé
le
complément
Exemples:
1." p.).
usé de douceur
as
ils
,
et
et son
Chj tlçj
leur
enfreint
o«f
X>^«J /?«/,
tu
préposition
se
ils
engagement.
repentiront.
ont
alors
envers eux.
été
comme
submergés.
explétif.
§. III. De l'Accusatif.
83. L'accusatif,
principaux
transitifs
,
fonctions
il
:
et
dans la
indique
les
il forme des
même
pourroient
seule
une
tination
d'exprimer les
,
,
comme
je
le dirai
ci-après
,
être
celle de former des adverbes dont la des
ramenées à
est
langue arabe, sert à deux usages
complémens immédiats des verbes
expressions adverbiales. Ces deux
circonstances accessoires d'une action;
pour cette raison la dénomination de cas adverbial conviendroit très-bien à l'accusatif arabe (n.° 717 , ire p.).
84* Le nom qui sert de complément objectif à un verbe
et
,
,
transitif (n.v 224,
dont le verbe
de
est
'/'/*•)
,
se met
l'antécédent
à l'accusaiif. Dans
et
le
nom
le
ce
rapport,
conséquent,
la
l'espèce nommée Jl^iVl JôJ c'est-à-dire, dont l'effet est de développer
comprise implicitement dans les mots le mois sacré. Voici ses termes:
,
une*idée
terminaison
DE
terminaison de l'accusatif
4?
SYNTAXE.
LA
d'ex posant, c'est -à- dire
sert
qu'elle
rapport de l'agent à
indique nature de ce rapport , qui
l'objet. Exemple : L* YJJ? ôj-^J 'J' il n'a jamais bu de vin.
la
est un
8 J Les verbes doublement transitifs c'-est-à-dire, qui ont deux
.
,
complémens objectifs,
les
g)
J'ai donné
mettent tous
ili\
mariage
en
ÏLaJ3»>*
Ils
86.
et son
que
ont
deux à l'accusatif. Ex.
:
\û*f) o^j3
à "Zeïd la file de
mon
frère.
\j-^" Jo-rtj [y^
donné à boire à Zeïd du vin
Le verbe abstrait
y)f qui exprime
attribut quelconque (n.°
,
rapport à un
attribut soit mis à l'accusatif.
empoisonné.
l'existence du
2 i o.
,
/."
sujet
,
p.) exige
,
cet
*J'Lg«i
Le sage
**£" S^*!*^ <3°"
sera
ne
^!F-■*, ft~*
point sage jusqu'à
'
Qy *""**!
•
qu'il dompte
ce
toutes ses
passions.
'
'
QjL_jM.lt l£_>f L?w»jl L«UÎjs
Quoi, donc' lorsque
nous serons
\5j£=>
devenus des
îjof
os et
de la
poussière
,
serons-nouS ressuscites!
fjsJtxâ. jf
Soye^
Le verbe
des
(jUi
quelquefois employé
87-
ï'J^Sz
pierres
xj*
ou
du fer.
ainsi que le Verbe être en
comme verbe attributif et
françojs ,
signifiant
exister, être existant ( n.° 219 ," //' p.); alors il n'y a point
d'attribut distinct du verbe : le sujet se met toujours au nomi
natif, comme celui de tout autre verbe (n.° 58); et l'on
doit bien se garder de le considérer comme attribut. Exemple :
>l$l» ï^i.] *J qU" qLî cid f jjilj i\^\ »Qjjj oJj U tfZS 'J ô tj
est
jjo-uJl
S'il n'a pas
11! partie.
,
d'enfans*
et
que
ses
père
et
mère héritent de
D
c.0
lui ,
des frères,
si
la mère
en ce cas
aucun
mère
sa
LA
aura
le tiers de la succession ; mais, s'il laisse
sixième. Le
aura un
-enfant n'est à
voit que les
texte
si des frères sont à 4u'r.
enfant,
et
oj-J frères
à la lettre:
signifie
lui
tJj
mots
SYNTAXE;
DE
,
sont
...
l'on
; et
le sujet de la
aussi sont-ib.au nominatif
(a).
proposition, et non l'attribut :
mais
cela
le
verbe
;
ô^
Quelquefois l'attribut est placé avant
met tou
ne
change .rien à la règle de dépendance ; et l'attribut se
jours en ce cas à l'accusatif. Exemple \j^> jl ô^ Xx*? au ^ S0lt
:
,
,
grand
ou
..'
petit.
88. Il
a
y
langue arabe comme je l'ai déjà dit
J.rf p. ) plusieurs verbes qui renferment l'idée
dans la
,
ailleurs (n.° 22 1 ,
,
de l'existence , avec abstraction de
tout
attribut déterminé
,
mais
modifiée seulement par quelque circonstance de temps , de
de localité , d'antériorité , de postériorité , de conti
,
durée
&c. Il arrive
nuité,
souvent
fait abstraction de
qu'on
idée
cette
(a) H n'est pas rare de trouver dans les livres arabes sOifc manuscrits, soit
imprimés, des fautes contre les deux règles que l'on vient d'exposer. Tantôt
râttrïbut après le verbe £}B?se trouve au nominatif, Comme °à)(f /L\jJ\
(jfc\J
,
Uv>tUf o'tjà-
J^
Gram.Arab.iL.
ceux
cette
^js
l'esprit {ibid.
p.
qui
faute},
*j\}o
on
l^yj
qu'il
j.p.U,
le
*J
était
comme
fonctionne
sujet
lit dans
tes hommes étoient sages, le monde seroit détruit (Erp.
est une faute, il falloitV lie
Autre exemple:
jtJLc
un
on
.
54). x,JjCo
étudié
est
n'y
de vraie science que
a
une
faute pour
grammaire
^(^.est pris
du verbe
l'ouvragé
il
la
*-jf éàïi
en est
les femmes
^yj:
autrement
qui
pour
plus
l'attribut,
ont
ce
èé mariées à
un
fils. Ka.lj
l'affixe du
-dans
mot
qui
L«JÎ_==ii.
tombent bien
J^f'^vfq
marchand qui avoit trois
lit ensuite
,
ce
et
intitulé Pars versimis Arabica, libri,
ylj^,fj_vlj J)»
sujet. II
n'épouse^ point
;
Ka( Vf j\s. V
n'ont pas bien
satif : ainsi
c'est
" tous
65,6, p. 49)
<j jBoaXLo
jiV<âJi
dans
1
des
"ijf
ne
souvent
pères, Ui&l
(et
dans,
mis à l'accu
Colaila,?.
faute;
fait
2,
de cela,
il faut
point
passage de l'AfcoranA. 4,
vos
caché
Tantôt
exemples
est une
est
ici
v.zo):
lLi.U r^iîl
DE
SYNTAXE.
LA
51
de vrais syno
,
qu'on emploie
aussi les grammairiens Arabes les
nymes du verbe abstrait
modificative
et
ces
verbes
comme
^tP:
(j^otji.1
appellent -ils
nière
surplus
au
,
proprement
être
un
les
qu'on
,
emploie
,
au
yù,\
matin,
être 'vers le milieu de là matinée,
^j&\
^
ils
durée du jour, ô^ être
pendant
.
De
jU
être
au
JJ?
être
quelque
devenir, Jm\
lever de l'aurore
pendant
^toute
la durée de la nuit ,
toute
ma
renferment pas
ne
attribut. Ces verbes sont,
soir, '1^>\ être
au
les sœurs du verbe
,
la
^)
n'être pas , JfjU être encore être continuellement, if> durer, per
sévérer à être, ^ji U
^J U cslîjf U ne pas cesser, être sans
,
-
-
discontinuer &c. Tous
,
l'accusatif.
mettent à
verbes étant suivis d'un attribut , le
ces
Exemples :
cîLUé IXN-c ouliîf J S U
,Ne
te
compte pas
au
éLàu
j-J^Jf ly;
nombre des hommes,
tant
oju
a
que la colère
te
dominera.
<
Car cette
chose
équivaut
à
est
cîlfi
une
abomination
et
une
horreur; c'est qu'ici l'affixe de *jt
cela.
exemple qui semble d'abord contraire à ce
ce
quj
que je dis ici. On y lit (sur. y, v. 83), fjlsi ^f VJ a-ols cjflâ. ($& Ul ;
semble devoir être traduit ainsi et la réponse de son peuple ne fut autre que de dire-.
ce
mais ou il faut reconnoître là une faute et lire ofj».
qui est le plus natu
rel »ou, si l'on ne veut point admettre de faute, il faut supposer avec Beïdhawi,
qu'il y a ellipse du su jet de ^ par exemple et que le sens- est aucune chose ne
ftt répondue (à la lettre, ne fut la réponse) de son peuple si ce n est qu'ils firent; alors
cl»lj» est attribut, et gç1 verbe abstrait. Beïdhawi dit: (j«i=u lT^ Lia. U
J'ai
remarqué,
dans l'AIcoran,
un
,
,
,
*
»
,
,
,
,
,
J£
Jv£*jJU ^a «Lï ^ç.9 **,fji»lj^Vlj
jfeXjp'
ik
ne
dirent rien
qui pût être
ils reconnurent les bons avis
ville
,
IjJl»
faï
et
les croyans
qui
qu'il
fjUlî» ô^J fï^ljé- ^j*
considéré comme
avec
une
réponse
à
ses
discours ,-mai{
par un-ordre de le faire sortir de leur
lui. On trouve de même, dans l'AIcoran,
leur donnait
étoient
*_#J
,
'J VJ ^Jy ô? Uj («"•** v'"f7)-
D
a
SYTCTAXE.
LA
DE
J2
U I ^_v f «Ul *-»^J. iJN-sJv-' f
Vous
étiei frères
,
au
matin
,
par là miséricorde de Dieu.
(^>\sLiMj\ f-^àj] £J>jJ» ^«ajj UfcJjw*s <<^X_* ,,_? J^mxa5
Tu
seras
deviendras,
renversé par
terre
dans l'arène oit ils
matin, la proie des
au
89. Remarquons,
en
combattent-,
et tu
hyènes affamées.
.passant, que
comme
les Arabes n'ont
qui réponde précisément à notre verbe, avoir, ils
y suppléent par le verbe '^W Ainsi au lieu de dire un roi avoit
un virir, mon
père avoit un chameau ils disent un roi, un vijjr
pa* de verbe
.
,
,
,
étoit à lui,
J^
J
jJjjtJ (jbcîIU
l^ i^\
,
ou
bien
;
mon
,
père,
chameau étoit à
w/z
chameau étoit à lui,
un
père, JSé-^é qf '.
autres particules qui,
mon
pO. Il y a plusieurs conjonctions et
étant placées devant un nom qui devroit être au nominatif,
exigent qu'on le mette à l'accusatif. Ces particules sont les con
jonctions <j] car, £>f que ^Cf mais ; l'adverbe conjonctif ]$
comme si ; les adverbes <~sd
plût à "Dieu que JiJ et ~J& peutêtre, Exemples :
,
,
Dieu
indulgent
est
£7/* jffw/'f £/>« tf/> ^k'/7 7
ijà)ÂZt/V
£rt
et
f«; entre
clément.
elle
ftvèjft' JjjÇJ /(a
debout,
mais
et
un
grand espacé,
oôj
Mahomet
Comme si Zeïd étoit
lui
un
jj/«j à Dieu que Mahomet fût
est
assis.
lion.
ici
présent!
,}
SYNTAXE.
LA
DE
ijjI^I}
fj^ JiJ
Peut-être Mahomet reviendrai- il
aujourd'hui.
Pour que l'influence de ces particules ait lieu, il faut
la particule ou, du moins y
que le' nom suive immédiatement
qu'il n'en soit séparé ;que par une préposition avec son com
ni.
,
plément : si le complément de la préposition est complexe
la particule n'en conserve pas moins son influence. Exemples l
,
«ilf
tjjà.\ ïj$)
Certes, dans cette vallée qui
,
cédé de l'adverbe
jULVf
hommes
02.
car
est sous un
rocher, il y
le
,
mette
et
l'accusatif,
à
dans celui-ci
il y a en cela, certes,
ont du
jugement.
qui
Quand
d'autres dieux que Dieut
la
qu'onFexempïe précédent
ne
pas
a
particule qÏ le sujet est
affirmatif J (n.° 84o, ?" p-)\
Quelquefois après
dans
Qjts^uT *S*x>\
qI
témoignage qu'il y
\Rendre7-v0us
pêche
**
ces
mêmes
un
morC
encore
ce
comme
qui
on
pré*
n'em
le voit
dyi'^'J^ &,'* j ùj
:
sujet
a un
de
pa'rticulès prennent
L/Jf* Ufcf ^l'*3
réflexion pùur
à la fin le
l'es
mono
t-k%J elles
syllabe U comme \3\
perdent leur influence sur le sujet qui les suit : on peut cepen
dant, après lîlf mettre le sujet h, l'accusatif; le mot U, en ce
-
,
-
-
-
,
,.
cas
,
est
explétif,
qu'il empêche
et on
le
nomme
àjIs^U
d'exercer
ma
qui empêche,
influence
parce
le-
particules
(n.° 890 i.re p.).
(^3 L'adverbe négatif H met quelquefois k l'accusatif le noir*
qui le suit ; dans ce cas l'accusatif perd sa voyelle nasale : mais
» ne soit ni un
1 „°
il faut pour cela
que le nom qui suit
nom
qui
ces
les suit
aucune
sur
,
.
,
,
nom
défini par
sa
nature,, comme
un
nom
propre, ni
un nom
DÉ
e,4
SYNTAXE.
LA
appellatif restreint par l'article jf ou parmi complément; 2.* qu'if
suive immédiatement la négation. Exemples
:
C'est ici le livre
au
sujet duquel il n'y
V.
Il
n'y
a
s
a
pas de doute.
*
pas de dieu, si
ce
n'est Dieu.
jfJJf j £jUj£V
//
On diroit,
n'y
au
homme dans la maison.
a aucun
contraire
,
^Uof^fJJf
j
Sf,
le
mot
(jUM
étant
séparé de Y par le terme circonstanciel jf<jJf j
o4> Si, après la particule V, il y a deux noms liés, par une
conjonction le second peut être mis au nominatif ou a l'accu
ou
satif. Exemple : ësf^fj' JXj
^[Pî/J^j*^ ^ n'y a (^ans h
maison) ni homme ni femme. Mais si, dans ce cas la particule néga
tive est répétée elle peut perdre totalement son influence. Elle
.
,
•
,
,
peut aussi influer sur la syntaxe des deux noms , ou sur celle
de l'un des deux seulement : ainsi l'on peut dire indifTéremment
enfin
ïîYJA Vj J^y X.ou ï*|^t Vy J4-3*
ïîf^l Vj Ja/) *V
pj.
VI
[U}S(
0»
Si le sujet dont la
on
particule V nie l'existence, a un
peut énoncer l'adjectif de trois manières et dire :
ji}Sf ou Ûlî JLi) V ou enfin
J£, S^ // n'f
,
/Sj pjj
dans la maison d'homme
pas
C}6.
ïî\£\
.
adjectif,
a
ou
'
qui dorme.
j^U
Les- deux
particules négatives U et *#, étant jointes à
sujet
qui constituent deux parties distinctes
de la proposition, et qui sont liés l'un à. l'autre
par l'idée de
le
ou»
verbe
abstrait
l'existence,
^ sous-entendu, gouvernent
un
et
à
un
attribut
^attribut à, l'accusatif.
Exemples; LIité
JLJjL;
Zeïd n'est pas
DE
fj^t» ô+j^
debout;
ici
il
LA
n'y
SYNTAXE.
a
jy
d'homme
point
qui
soit
présent
(a).
Pour que les deux négations V et U mettent l'attribut, comme
il vient d'être dit , à l'accusatif, il faut , i »° que l'attribut soit après.
particule d'exception *\ ne se trouve poinfc
entre le sujet et l'attribut^ 3.0
qu'on ne place point l'adverbe né
gatif q! (n.° 855 //• p.) après la négation U ^4.° que, si l'on
emploie la négationV, le sujet soit un nom appellatif indétermiril-.
Si le contraire de quelqu'une de ces circonstances a lieu, l'at-'
le
sujet
z.° que la
;
,
tribut doit être
au
pas debout; cjÏb *\
Mahomet
ne
o^.j fë ^ Zeïd n'est
o^'j U Zeïd n'est qu'un menteur; /Ji oJUï <jJ ^
nominatif. Ainsi l'on dit
,
dort, point; c-O^Uf H Dieu n'est point, menteur;
lieu que l'on
diroit, UsU ^LJf
V il
n'y
a
point
d'homme
au
qui
soit éternel.
QfJ. Pour distinguer les deux constructions du sujet précédé
de la négation H il faut observer que dans la première (n.° 9 3)
cette
négation est l'équivalent de 'il n'y a point, c'est-a-dire
,
,
,.
,
d'une
négation
et
du verbe
q& signifiant
l'existence réelle
et
faisant fonction de verbe concret;
truction , la
négation
en sorte
que, dans cette cons
nie absolument l'existence du sujet : dans la
(n.°o6),.au contraire, les négations UetS^
sont équivalentes à une
négation, et au verbe {$* faisant fonc
tion de verbe abstrait, ou, ce qui est la même chose, au verbe
seconde construction
fa} Beïdhawi, sur ce passage de l'AIcoran Yy& \o$> U celui-ci n'est pas:
homme (sur. 12 ,v. 32), remarque que KiJ est mis à l'accusatif, suivant, le
dialecte du- Hedjaz
dans lequel on construit U comme
/J^J parce que
,
«a
,
,
l'un
et
l'autre
lisent j£j
,
servent
à nier
une
circonstance d'état
suivant le dialecte de Témim. Voici
ses
,
et
il
ajoute que d'autres;
propres' paroles «J ^E Û&.
:
e^
SYNTAXE.
LA
DE
qu'eIIes ne nfent <ïue>
Arabes
relation de l'attribut au sujet. Auss? les grammairiens
nommênt-ils l'adverbe négatif Sf dans le premier cas j-Ul &
ils appellent la néga
négation du genre ; et dans le second cas
tion jLi Ju négation de circonstance d'état, ou J^) J^; j-»
négatif J$ .(n.° 499, '/>)
«* sorte
»
,
,
,
i
,
c'est-à-dire, négation" synonyme de
{j^
.
de
particule j', étant employée comme synonyme g
la suit à
(n.° 883 i.n p.); et signifiant avec, met le nom qui
l'accusatif. Exemples: îJiftîU^j J>M .^£11 î ^to ^ 7^i»
tfv<?r ta
femme; foôjj éLils U et f^ljj élf U, qu'as- tu de commun
98.
La
,
avec
Zêidl
particule Vf sinon, ïes prépositions UU. jU. \ô&
excepté et plusieurs autres mots qui servent à faire exception,
exigent dans certains cas qu'on fnette le nom qui les suit à
La
no.
-
-
,
,
,
influence que dans
quelques circonstances , que dans d'autres ils sont suivis du
nominatif ou du génitif , et que cette matière exige d'assez
l'accusatif;
longs
mais
détails
100.
,
Les
,
ils n'exercent
cette
en
traiterons dans
un
qui
servent
comme
nous
noms
jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf
,
brée à l'accusatif. Je
où je
chapitre séparé.
numération, depuis
mettent
le
nom
de la chose
ici de renvoyer
me contente
onje
nom-
chapitre
au
traiterai de la syntaxe des numératifs.
10 1. Les
indéclinables numératifs lsM- ^k" ou ^
aussi le nom qui les suit à l'accusatif. Exemples:
noms
combien, mettent
H£j> °JL» combien de d'irhems !
est
à la
de même de f oJ>
,
"ALj J£k" combien d' hommes Ml en
qui signifie
tant
de.
Si, cependant,' a vaut le nom indéclinable numératif, ou avant
ïa chose nombrée qui suit ce nom il survient une préposition,,
,
la chose nombrée
indéclinaWe
,
se met au
dans le
génitif,
premier
cas ;
comme
et
complément
dans le second
,
du
nom
comme
DE
de la
complément
préposition. Exemples
nables dont
:
foypÇ pour combien
combien d'hommes! Si les
J4*J>.ô? 1&&
de dirhems!
}i
SYNTAXE.
LA
de
mots
indécli
point employés
nom qui
interrogaiive^
exprime la chose nombrée se met au génitif singulier ou plu
riel. Exemple : ô &' u^-j
f-tLÏj'^ ^ je ne sais pas combien
nous* venons
d'une manière
parler
ne
sont
énonciativement, le
mais
—
d'hommes
Ces
tu as
tués. On peut dire aussi
'^
mots
7s&
-
'J^
-
-
\à*ê=>
et
que les grammairiens Arabes nomment
tituées (n.os 761 et 765 , //' p%).
JJ>.j
'J?
.
quelques autres sont ce
o^^f* expressions subs
On les
comprend aussi, avec les articles démonstratifs et les
adjectifs conjonctifs, parmi les noms d'une signification vague et
indéterminée- *>Â*, parce que leur signification demeure vague,
jusqu'à ce qu'elle soit déterminée par ïe nom qui indique de
quelle espèce de chdse il s'agit : aussi ce nom s'appelle-t-il alors
déterminatif.
1*j?
Les-
1 02.
mettent
le
pas
cette
deux
plément
cause
,
:
mesure
comme
,
J^-f*
de
boisseau,
mais
de cela ,
comme
ces
,
Exemples
le
le déterminatif du
sortes
&c.
:
deux livres d'huile.
drap ; Uôj' q$£>j
nom
qui sert d'antécédent
le conséquent n'est pas considéré comme
aunes
construction
finale
sa
de
de la chose mesurée à l'accusatif.
nom
lÂjJi o^[3^
Dans
noms
de
noms sont
nom
•appelés
de
ne
le
perd
com
mesure.
A
parfaits
noms de
comprend
jtûj
dixaines depuis
o_y-àç vingt jusqu'à ôj*^' quatre vingt dix
se
parce qu'ils
comportent de même par rapport au nom de la
chose nombrée
comme on le verra
quand je parlerai de la
âb
.
On
sous
cette
noms
dénomination les
-
,
-
,
,
syntaxe des numératifs.
103. L'accusatif sert
ici
exprimer le vocatif: nous n'en
traiterons dans un chapitre
d'exprimer le compellatif.
souvent à
parlerons point
parce que
séparé, de^différentes manières
,
nous
,
„
LA
DE
y»
L'accusatif s*empïoie
en
encore
dans certains
cas
que l'on déplore le malheur de
traiterons dans le même chapitre.
exclamation
Nous
SYNTAXE.
ou
,
quand il y a
quelque cliose.
,
I04- Outre toutes les différentes circonstances dont nous
avons
parlé jusqu'ici, dans lesquelles est exigé l'emploi de l'ac
cusatif, ce même cas sert généralement à indiquer,, sous une
forme adverbiale, tous les complémens circonstanciels ou déterminatifs qui pourrorent être exprimés d'une manière plus
développée soit par une proposition conjonctive soit -par une
préposition avec "son complément. C'est sur-tout sous ce point
de vue que l'accusatif doit être considéré'comme un cas elliptique
ou adverbial
qui supplée, avec un avantage immense, aux ad
,
,
,
verbes proprement dits , dont le nombre
arabe (n.os 844* et 84 5 , //' /?•)* En
est
infiniment
petit
en
effet, il forme autant
d'expressions
confplexes
incomplexes ou de pro
positions adverbiales qu'il peut en être besoin pour exprimer
adverbiales
ou
,
,
toutes
les circonstances modificatives du
l'attribut
de la
sujet
,
du verbe , de
entière. Ceci
proposition
exige quel
dévelpppémens préliminaires.
1
05. J'appelle expression adverbiale incomplexe, celle qui n'est
composée que d'un seul mot mis à l'accusatif, et qui renferme
le sens d'une préposition et du même mot servant de complé
ment à cette préposition ;
expression adverbiale complexe, celle
qui est équivalente à une préposition et à un complément com
plexe. Enfin il y a proposition adverbiale, lorsque le mot mis à
l'accusatif est équivalent à un sujet et à un attribut : elle peut
être aussi complexe ou incomplexe.
,
ou
toute
ques
Exemple
d'une
expression adverbiale incomplexe
Il
mourut
de faim*
v
DE
d'une
Exemples
j
..
i =
«cl
)$
complexe
:
j
» j
>jiS*** Uoi»jl lj*J~3
pendant un certain nombre de jours.
*
,
les hommes il, y
J^armi
adverbiale
expression
*'
Jeûnez
SYNTAXE.
LA
en
livrent leur propre vie pour
qui
a
mériter la bienveillance de Dieu.
d'une
Exemple
Entre^ par
\oJ* adorant,
Ce
est
(livre)
est
la porte
&-&'&Âj
pour
d'une
Exemple
adverbiale
proposition
proposition
la vérité,
en
en
incomplexe
adorant.
adore^
et
:
adverbiale
en
même temps.
complexe
:
confirmant la vérité des livres
qu'ils
possédoient déjà.
[JsoJi.*
confirmant,
IOo. H n'est
trouve
employé
allons
tanciels
107.
\ôJ> demain,
Exemples
des
et
il
confirme.
circonstances où l'accusatif
d'une manière absolue , dont
deux manières
on ne
puisse
se
rendre
;
pour le faire voir ,
les différentes espèces de termes circons
ces
parcourir
qui peuvent
leurs parties.
nous
^J"^-* y>J
pour
aucune
raison de l'une de
de
est
modifier les
et
propositions
ou
quelqu'une
Circonstances de temps.
iJ^»)l\
hier,
UJj
un
jour, iJ-Â-if aujourd'hui.
:
'.'■>*-
Jeêne^ pendant
un
1*1
"1
\
J
■*
certain nombre de
jours*
£o
LA
DE
jÇyillf
SYNTAXE.
i-Jw^jf
*XU$
Je l'ai tué Vannée dernière.
// rcgwtf v/ng/
i O8
ans
,
trois mois et
jour.
un
Circonstances d'étendue.
.
.
//j marchèrent quatre milles.
L~J"jS. *-i$J Vfj (jO*L>-^ j^"
marcha l'espace de deux ou trois pàrasanges.
"
II
109.
tiLi. à droite,
Clû CONSTANCES de Heur
f^Uj
à gauche,
fj-lj ÎJh
^w "
/**r
/?<2r derrière , lUf /wr devant.
Si les noms qui expriment des circonstance%de
/wr
w'r'
c^JLa.
lieu, doivent
complémens ils deviennent les antécédensd'un rap
de
port et perdent leur voyelle natale: le dom qui leur sert
conséquent, se met au génitif. Exemples : *-&-j£ *fjj derrière
la tente gJstCtf *Uf devant la mosquée.
I IO. Les noms appellatifs qui
désignent le lieu, la situation^
se mettent plus ordinairement à l'accusatif,
quand ils expriment
une idée
vague (a), comme devant, derrière à droite, à gauche,
prendre
des
,
,
.
,
.
,
en
haut,
en
bas, &c.
(a) Les termes circonstanciels de temps et de lieu sont ce que les Arabes
appellent t^b Ja*à*ô ir' y a certains cas où ils ne doivent pas être exprimés
par l'accusatif 5 et s'il se trouve des exemples contraires on doit les regarder
plutôt comme des licences que comme des exemples à imiter." Voici donc ce
qu'il faut observer
i.° Tout terme circonstanciel de temps, soii vague,
&£ comme IJL^.
:
,
:
,
pendant quelque temps,
soit
déterminé,
>. Jt
.â?
,
comme
|T.Â,.&
pendant
urt
DE
6l
SYNTAXE.
LA
Lorsqu'ils expriment une idée plus précise, comme la maison
le chemin, la ^mosquée oij emploie plus volontiers une préposition.
,
,
7
jnois
ï>,oJU CôUf pendant
,
i.° Tout
lieu
non
,
pour
un
petit nombre de jours se met bien à l'accusatif.
circonstanciel de lieu vague, c'est-à-dire, qui indique un
terme
sa
par
propre dénomination
le rapport dans
objet
aussi à Faccnsatif
,
lequel
IjL^.
comme
,
il.
se
,
Vtiw'
-
mais par
trouve
-
une
un
avec
fJ.Uu
dénomination
autre
<JU=*
-
gntt>
lSO-L auprès, JxlT
3.0 Tout
nom
&/e met encore
4.0
de
l_jo». l'intérieur
mesure
itinéraire,
comme
.L* mille, ±J»\3
00
enfin
U.
a.^
-
fj^»
*^J c°té'
"
dans
,
ne
désignent
On
àj'acçusatif.
coté de la maison
un
phètef ,j-y^
jfjjl
tanciel,
pas dire
tX^ô
yV
aux noms
o^Uâ
^y«o.
"
signifie
si le verbe
:
lui-même 4«B«<rc,
on
peut
mettre
une
le
autre
(joAissf
Ces observations,
pour
objet
Vojtei
le
-.
'
A>« de séjour
,
ou autre mot
•
,
terme
sorte
<*
se
^J\i
dedans,
fait
action,
une
<_j>*<à-» #f«
ne
doivent pas
-
~JJ± £îLï
ôt>-*2
-
jf»wf fr.^^ ci oûr
"$-$"-'
*UU- /jlXLi,:il faut
•
comme
dont ils
-
sont un terme
lli'f
se
l'accusatif; si. le
je m'assis à
sa
place;
circons
1}â
tenir,
verbe
d'action, comme J$"| manger, .Les
sa
/'o«
.fjjf t_>iLL (s o>i^=>f
circonstanciel à
muu
0«
„
été tué Hosain ;
séjour ,<comme II5
je mangeai à
au
a
mais il faut dire
'
le peut pas. On dira donc bien
«jLCi
parasange
.fjjf ôJlâ» ^12=^\ j'ai mangé
Jxiu (j cwf
qui signifient
distinction
signifie pas cela, mais
dira
Jjû>
y'rf/ prié dans la mosquée dit pro
suis demeuré au lieu où
.*
JJiji être assis,
ne
donc
^^Àjf
,
-
"
une
doit
.
tue ,
.1jjulVf,c$JLi;
lieu de séjour,
un
dormi hors de la maison
yV
Quant
pas
ne
Ji/JU'o«l*9f
^yJf (\ss* ^j o^to
faire
dehors A
le lieu où
tous
»
se mettre
de même
~
milieu, &C;
au
les noms qui indiquent
o^sC» mosquée, lieu d'adoration, Ji&â /«a oî) l'on
bat, mais qui
,
a.
met
à l'accusatif.
Aucontraire^
comme
qui
se
(^ ~'à^
-'
ô»j£ à droite', à gauche, derrière, devant, au-dessus, au-dessous;
lieu
-
ne
tuer,
on
mais
on
place.
j'emprunte d'un grammairien Arabe, n'ont
l'exposant est la préposition £
à
Scutari
imprimé
p. ^ et suiy.
reste, que
que les jermes circonstanciels où
jfc^kV f cj>j**
,
,
6%
DE
La chose
néanmoins
,
,
SYNTAXE.
LA
n'est pas nécessaire ; et on peut leur
en les mettant à l'accusatif, pourvu
,
donner la forme adverbiale
exprimé ne soit pas celui de. la préposition j
rapporté des exemples ailleurs (n.° 845 **'?>)'
que le
ai
sens
J'en
.
'
>
iii.
Circonstances de manière.
comprends sous cette dénomination toutes les- circons
tances qui tendent à modifier ou à déterminer à une significa
tion plus précise le sujet ou l'attribut ou même les complémens
Je
,
du
verbe,
112.
relatives1
ou
quelqu'un
des
i.° Circonstances de
au
sujet. Exemples
manière,
d'état
au
de
situation;
:
îoûc
E,ntre^pàr
circonstanciels*
termes
t^UJf fjUM
cette
porte
en
,
adorant.
^tVuÀ* ,ji»jVf j fyjôVj
Ne portc^ pas la désolation
brigandages.
o
o
Dans
deux
compris
exemples, foJc
circonstanciels
termes
comme
vous,
ces
la terre
sur
et
qui
dans le verbe. Ce
,
en
^tvuiu
se
y commettant des
sont
à
l'accusatif,
rapportent
sujet "iCil
circonstanciel , exprimé
au
terme
ici par un adjectif verbal , peut aussi
s'exprimer par le
d'action , comme dans cet exemple : UUj» û\
nom
q»J^3ô ^ô^f
ftySj
ceux
pu dire
qui
se
souviennent de Dieu
également ^y(.U'
,
debout ou assis. On aurait
^çv&U'.
exemple <j5J L&2 1U JyJT ïfj£ <^U*
<J* jJ?& ^ Ujij J-k^ 6?^ J^f o[>cw au matin de notre sé
paration, au jourfatal de leur départ, lorsque je me tenois près des
En voici
un
et
autre
:
buissons du lieu où campoit la tribu,
gens qui
pilent
des
coloquintes
t.
on
m'eût
tandis que
mes
pris
pour
un
de
ces
camarades, montés
DE
ï
leurs chameaux
sur
tenant,, est là pour
I
2.0
13*.
,
(a)
Circonstances
ils
,
d'action,
nom
en se
tenaient.
se
l'objet. Exemple :
che^ cette per
d'état relatives à
QliiiW-c>AjJ j'ai
CéakVôî*.
Uy'j
étoient arrêtés.
l&îj
63
SYNTAXE.
LA
rencontré le sultan
pleurant c'est-à-dire, et il pleuroit. Il arrive souvent dans
cette manière de s'exprimer
que le terme circonstanciel peut
de là pro
se
rapporter grammaticalement à plusieurs des termes
sonne ,
,
,
n'est donc que la construction ou les circons
du discours Qai peuvent, dans ce cas, déterminer auquel
position
tances
de
ces
;
ce
termes on
doit le rapporter. Dans
l'exemple cité, on
^%>U ^LtLJf o-jJ
amphibologie, en disant
?ôlc j'ai rencontré le sultan pleurant che^ cette personne.
auroit évité
toute
,
Ainsi, dans
ce vers
deSchanfari
,
<J^.j* UJl^ IXlâJU <>* ^-°'j
la construction seule prouve que le terme circonstanciel uJlâtombe sur j*c , et non sur ytibj^ , et que l'on doit traduire : au
pendant que j'étois tranquillement assis
à Gomaïsa deux, troupes causoierit ensemble à mon sujet (b).
Mais lorsque cette équivoque peut avoir lieu il est facile de
l'éviter, en exprimant d'une manière plus développée la cir
dans l'exemple précédent on
constance dont il s'agit. Ainsi
Uf j^-Â-j ^
auroit pu dire d(j^*j et il pleuroit. Exemples :
matin
qui
suivit
cette
nuit,
,
r
,
,
,
*—
L^i îoJLL \j\j «JU-û-! *^*3i quiconque sera rebelle à Dieu et à son
apôtre, Dieu le fera entrer dans le feu, y demeurant éternellement.
l^Jj fjJlî. y demeurant êternelhmtnt est pour lg^? ^^ j*j et il
,
y demeurera éternellement.
(a) Moallakad'Amri-alkaïs, versj.etj. On lit dans la glose.- *jJUo Jl*5 Uy»,
&vk* (^s- (J^é Ui'fj ^-i'ifj *._;>jjvv*-i> V Voyez Caab ben-Zoheir Carmen
panegyricum i?c. p. 50.
(b) Voye^
ma
Chrestomathie arabe,
1.
1, p. 320,
et t.
III
,
p. 8r
64
DE
Ces
termes
LA
SYNTAXE.
circonstanciels
sont ce
que les Arabes
appellent
état, c'est-à-dire, circonstance d'état.
JU.
4- A cette sorte de circonstances se rapportent toutes les
propositions dans lesquelles le verbe a pour complément un
sujet et un attribut dont la réunion pourroit former une pro
position complémentaire dans d'autres langues.
Les graminairiens Arabes ont fait des classes particulières des
verbes qui peuvent recevoir un complément de cette nature et
M
,
ont
nommé les uns, verbes de
autres, verbes de doute
conjecturer;
ou
cœiw,
de certitude ,
comme
comme
enfin, verbes inchoatifs
d'autres
,
savoir, croire; les
s'imaginer
comme
,
penser,
prendre
une
chose pour tel ou tel usage (a): mais c'est qu'ils n'ont pas assez
généralisé là destination de l'accusatif. Pour moi, ]e> ne vois
dans 'cet usage de l'accusatif qu'une application de la règle gé
nérale , suivant laquelle ce cas est employé comme une forme
adverbiale destinée à
suppléer.
f
Il
mis la
a
dessus de
et
indiquer une ellipse qu'il
quelques exemples :
En voici
vous
Uj
terre
,
ïUjfj Usiji J^V f
pour
comme
de même flX>
,
vous
Ils
ont
donnés,
dire
,
pris
(pour
)j~p>
(servir de) lit
une) voûte,
l^-fji
c'est-à-dire ê\L
$j
mes
prodiges
leur servir de
AÎ éyS=*J
1<==J
,
,
facile de
l$.iL
et
lé ciel (pour être au-
c'est-à-dire ,
^.CJ
est
Gsjji u£-ù ;
.
i
%-*\
et
les ayertissemens
qui
sujet de) plaisanterie.
leur
f!j£,,
ont
été
c'est-à-
.
(a) Pour ne pas m'exposer à des répétitions inutiles je renvoie, à cet égard,
quatrième- livre de cette Grammaire, qui contiendra l'exppsé de la syntaxe,
«uivant le système des grammairiens Arabes.
,
au
H
DE
tjfpf
N'imagine^
cause
Jif JL^ J
de
pas
ceux
Dieu, qu'ils soient
de
fjJLï ^joJI 0*7^
ont
qui
-»r»-
-
été tués
\s\y\
morts,
\<>
$5
SYNTAXE.
LA
-
,
en
•
combattant pour la
c'est-à-dire ,
cJy»l
j£jf
.
»^t
lt\/V*J *Jj^J AjI
//j
\o~*i
,
par rapport à cela que c'est
s'imaginent,
c est
,
ne
chose
pense pas, relativemi rit
doive arriver,
*>
'û)ï
,
j»*
l'heure du jugement dernier,
a
c'est à-dire
j
,
*yu
Igjf
dire
eux
,
que des
kÛ* cylj-^». l$jf
115.
de
sujets
qu'elle
.
fira voir que leurs actions
gémissemens. &*Sé. <^jfj-l».
C'est ainsi que Deu leur
pour
éloignée.
à-dire , tx^*j ^j!..
-
JV
une
,
ne seront
c'est -à-
.
Ce que je dis ici est si vrai, que l'on peut, suivant les
Arabes , construire les verbes de cœur , croir jtger,
grammairiens
,
qu'ils perdent toute influence tant sur le sujet
qui forment leur complément complexe, en
que
disant
par exemple au lieu de «iUU. fjJj oJâ-k je crois Zeïd
insensé [puto Zeïdum insanum] o£u> J>*U>- o^'j Z ïd est insensé,
savoir, de manière
sur
l'attribut
,
,
,
je crois [Zéidus insanus puto] ; ou bien JçU. o^J? o^'j Zeïd je
crois «est intense [Zeïdus puto insanus j';ou enfin, J^lâ. oJjJ oijJ»
y* crois, certes, Zeïd est insensé [ puto utique 'Zéidus insanus],
l I q. La même analyse servira à expliquer
l'usage de l'accu
les
a
un
toutes
fois
second
attribut
satif,
ajouté à celui qui
qu'il y
est compris dans la signification d'un verbe neutre ou dans celle
d'un verbe transitif à la voix objective, comme Ljusu» ^UJVf ^L*
,
,
,
,
l'homme
a
été créé
F 01 BLE:
/// PARTIE.
,
,
dans
cet
,
exemple
,
U»**^
£
est
pour
66
<J^. 13 f «i^k-
ftz .forte'
/ta£ de foi blesse
SYNTAXE.
LA
DE
^w'/7
«/
^/'^
,
ou
(J_*^é-f f JLâ ^é
f«
(a).
exprimé de la même
manière, après la particule IM voici, suivie de la préposition cj
et de son complément (n.° 824, / ."/».)• ExemP^e : «î'jti
^Jj
fif signifie b même chose
'rt & vo/7* ^#i j* f/«if debout; car
que ô^j ou {J>j il fut trouvé, il se trouva.
On
aussi
trouve
un terme
circonstanciel
ju
l
J«i 0>ii (j&Vl^ jÀ£ï&Jf JcVÂJSÎ
pris- l'infidélité en échange de la foi
JiyuJ'f
CV/k/
^«i
«2
Certes , ils
de leurs
,
Dans
satif,
a
Il8.
,
,
deux
et
C'est
*y* et UUJ sont à l'accu
circonstanciels de l'action exprimée par les
exemples
Ij^ajCJ
,
i.Te p.)
spécîficatif (n.°
,
le
nom
579, j."
lîy>j ^ je
comme
^y° i^y°
il m'a battu
seule fois ;
J*wf
.
l'accusatif,
une
,
encore comme termes
d'action (n.° 528
nom
égaré pat
révélée.
ces
JU
s'est
fait un bien mauvais marché en achetant, au prix
l'avantage d'être incrédules injustement à la parole
comme termes
verbes
jj*
<•
ont
âmes
que Dieu
le
*yw
bien mauvais sentier.
un
de manière relatives à l'action.
17. Circonstances
en
me
ï^yf j-^f plus
circonstanciels que le
nom
d'unité
(n.° 577, 1." p.), et
sont
employés souvent à
p.)
,
me
levai
en
me
tenant debout;
battant; ï^y* ^'^ il m'a battu.
habile, à battre.
(a) Par rapport à l'analyse de toutes ces propositions il faut voir ce que
j'ai dit des sur-attributs, dans la seconde édition de mes Principes de grammaire
générale, p. 276 et 6ujv.
,
DE
i io.
t>7
SYNTAXE.
LA
Circonstances de
comparaison,
II arrive très -fréquemment que l'on emploie le nom d'ac
tion d'un verbe mis à l'accusatif, pour exprimer une compa
raison , au lieu, de se servir de la préposition S comme avec
le même
nom
d'action
génitif,
au
de
ou
l'adverbe conjonctif
U^ de même que avec un des temps^du verbe. J'en ai donné
ailleurs un exemple (n.° 8^5 , //' p.) ; en voici un autre qui se
de la
première partie de cette Grammaire
(n.°4°4 )'- '& j iy«j *!yi 'à\ jnFoaf JfoJf ï'J*£=> Jaaj (^>lj ^
J^?j on lit aussi riddat (au lieu de rouddat), en transportant, le
trouve
dans
une note
kesra du dal inséré dans la troisième radicale,
transporte dans bia
I 20.
I^IL
kila.
et
CIRCONSTANCE^
l'attribut
exprimé
,
soit par
servant
soit par
Mdjectif,
le sujet est indiquée par le
un
nom
Jje cheval
Dieu
a
est
Ils sont comme des pierres
,
ici pour
est
ou
adjectif
être exprimé ou
,
grand
en,
de
,
à déterminer
un
simple
dont la relation
trempé
h
comme on
L§iHi/*ou l^uxj tf
à restreindre
un
verbe
ou
ra,
verbe concret, soit par
un
ou
été
au
avec
sous-entendu.
sueur.
puissance.
plus forts
que des pierres
en
dureté,
que les grammairiens Arabes appellent JÂ^' drteril faut rapporter à cette classe de termes circons
mination
tanciels , l'usage de l'accusatif apràkles noms indéterminés dont
C'est
ce
; et
nous avons
capacité,
parlé plus
haut
de pesanteur, de
,
et
après
longueur,
les
&c.
noms
(n.0$
de
101
mesures
et
Ej
de
102}.
68
SYNTAXE.
DE LA
12 1.
Circonstances de
motif,
d'intention.
emploie également l'accusatif pour indiquer le motif de
l'action comirre dans ces exemples : *J UoiU *^j^> je l'ai battu
On
,
jViU.J^'UÎJi4|olJâilJI
pour le corriger;
lui rendre honneur ,
122.
Dans
*
U le sultan
par respect pour lui.
les exemples que nous
se
leva pour
et
tous
avons
donnés
jusqu'ici
que le
sujet et le
propositions
et
verbe de ces propositions n'étoient point ^exprimés
que
il
falloit
supposer un
pour analyser ces expressions elliptiques
pronom personnel qui se rapportât à la personne ou à la chose
exprimée par le nom que la proposition adverbiale modifie.
II y a une autre espèce de proposition adverbiale dans laquelle
le sujet ou le verbe est exprimé ; alors la forme adverbiale tombe
uniquement sur le mot qui forme l'attribut, et que l'on place le
premier pour indiquer la nature de la proposition et sa dépen
dance de la proposition qu'elle modifie. Exemples :
adverbiales
des
,
nous
avons
vu
,
,
,
kJ,£=>\ LftX£i£
Pjjjfj JJsWfj (^yJÏijj** J^-J O*-*?/** c^Uâ* Lijf (JÔJ\j*
C'est lui qui a créé des jardins en forme de berceaux, et d'autres
qui ne sont point en forme de berceaux ; ainsi que les palmiers et
les grains dont le goût est varié. *-U=f UlU^ est
l'équivalent
de (jtiûê *Js=>\ ç^owjf
.
^jk' *â** ôy^- °fi «jmwî Vf <i><3^ Kîj ly» jd=>> Ija koU U
Une leur
est
annoncé aucune exhortation
envoyée par leur seigneur,
s'en
qu'ils
moquant, et avec le cœur occupé de toute
chose
et
'£$$ équivaut à ^V AjJli'T.
distrait.
aiftre
ne
Vécoutent
en
'KQ3
Un
séjour agréable est destiné aux hommes religieux
d'une éternelle demeure ,. dont les portes leur
,
des jardins'
seront ouvertes.
DE
Tamerlan
l'avant-garde de son
son
arrière-garde mise
le dos,
tourna
battue
plusieurs fois
l'ennemi (a),
6$
SYNTAXE.
LA
et
,
armée ayant été
désordre, pat
en
vengerai et je me laverai de cet opprobre quelque
malheur que puissent attirer sur moi les décrets célestes.
Certes, je
me
,
Quiconque désire
chose quelle qu'elle
Js» f Jf [>£=> i Ij^yj^» jf
Quiconque fera cela,
ou femme.
Dans le dernier
s
inclination le pousse
son
,
soit , bonne
,
.
chose
une
ou
mauvaise.
**^ MJ-^
i>^i=3
qo
la tête
aura
vers cette
^ * J** O* ^
coupée grand ou petit homme
,
,
exemple, \jt*.^ j\ ô« tj^'est pour o» «f J^J
même qU=» U HjI^ est pour ,jli=> U ^ l^JJj
-
«
JJaà^JI fj#~£p ; de
et «iff #li-i' ^J>-x LXJ1
,
—
â»
pour *lff A+&»
"^l ûiâ.jj
.
faj Voye^\^ Vie de Tamerlan par Ahmed ben-Arabschah de l'édition
donnée par M. Manger, t* I', p. 620. Je rapporte ce vers, comme on le lit
dans le man. Ar. n.° 790, de la Bibliothèque impériale.
,
Cette construction
parmi
au
à un
lieu du
édition,
eiç
sensible
t.
V
,
note 1
17 de Ml Larcher
une
avec
qui emploient
propositions
génitif appelé communément absolu. Oh
Xénophon [Cyrop.
to/k^ûi
assez
dans les
genre de construction, la
2.'
rapport
les Grecs,
sur
construction usitée
adverbiales le nominatif
peut consulter ^
le livre
vin
sur
ce
d'Hérodote*
p. ^.py. Aux exemples qu'il rapporte, je joins celui-ci de
c. III, §. 21): 0/ «.Moi 3 «Wîo,
titpofyvjLU'jiQpt oi%ç, cv toT
Jïax.m , x, ai [/m twLw <apoV "nvç àwwnïtç cthfttjuct ovltç. Les no
fmpo^vfÂûiiQ^L ovltç- oi clmumûi ovTiç ont- le même sens ici que des;
La
construction arabe qui dans ce cas, place l'attribut de la proposition»
génitifs.
adverbiale en premier lieu et le meta l'accusatif, en laissant son sujet au nomi
,
n
minatifs
-
,
,
natif, donne moins lieu
compare,
et
qui
a.
été
à
équivoque que la
quelquefois imitée par les
une
construction grecque que
Latin*.
je
lus
123. L'usage elliptique
ces
SYNTAXE.
LA
DE
yo
dé l'accusatif a lieu aussi
expressions adverbiales que les Arabes
dans^toutes
JUiVf *LaJ
nomment
,
et dont je
j'ai déjà parlé (n.os 762 874 et 876, 1." p.)
ëO
comme
dirai encore quelque chose en traitant de l'ellipse
prends garde à toi îAifs prends &c.
en
124. C'est encore par une ellipse semblable qu'on dit,
dont
,
,
,
,
parlant
de
Dieu,
Jiïpl^J,
et
«UU
;
le
est,
sens
loue
je
Dieu,
louange qui lui est due *J &*-^J' «dit &»' (ah
J 2 J". Quoique ce que nous avons dit pût suffire pour expli
nous observerons encore
quer l'usage elliptique de l'accusatif,
deux circonstances où l'ellipse indiquée par l'accusatif a quelque
chose de plus embarrassant pour les commençans. La première
de la
quand l'expression adverbiale ne modifie pas un des termes
seulement de la proposition précédente mais se rapporte à la
proposition toute entière ou même à une phrase composée de
la réunion de plusieurs propositions.
lieu
a
,
,
1
cîlilli*. ont été employés comme des noms de
pareil à celui qui a fait regarder le verbe ^Liï
le
dans
sens
optatif, qu'il soit exalté ! comme un nom propre de Dieu. On
pris
a aussi
employé la formule àjf qI^*,, et même le seul, mot ^1^*. suivi de
Si les
(a)
Dieu
Jy£,
mots
c'est par
,
un
une
comme
*jUsL*
formule admirative. Ainsi le
-.«"c
J'ai dit,
donc
»
n
.
poëte Ascha
^
-*
quand j'ai eu
—'
connoissanee de
sa
satif
Grand
jactance :
,
à
,
en
cause
citant
ce
vers
d' Ascha
d'un verbe sous-entendu
qu'éprouvant
;
,
dit
:
l'origine
«
a
dit:
t,J
Dieu,' qu'Alluma
/\t&Lf
de
impuissance pour comprendre
affirme que Dieu «iéprouve pas une telle impuissance
ce
*,,
est
fier!
Beïdhawi
»
et
abus
son
»tN«jJ^=>i Uf Jj»if
u&
si Ton disoit: Dieu seul, à
wjjJul
qui rien
*j
*ù[£lJ\
n'est
mis à l'accu-
est
expression vient de
qui va être dit on
c^f/Ju Uiu AjUiAjf
cette
ce
»
.
jJtN-âjj »jU&f
,
;
impossible, peut s'en faire une
c'est comme
idée.
DE
Alors il faut
encore
adverbiale , la convertir
SYNTAXE.
LA
,
pou/ saisir fe
en une
Jl
de
l'expression
proposition complète, à laquelle
sens
doit donner pour sujet le démonstratif f<>* ceci,
dans ces exemples :
on
ou
élli cela ,
comme
S'ils
un
plus grand nombre que cela ils auront en commun
la succession (ceci est) une loi qui vient de Dieu.
sont en
tiers de
*-lfj
,
:
est
un
terme
dans la
contenue
circonstanciel
qui
proposition précédente
qu'en traduisant
roit rendre littéralement
loi ; mais le
sens
est
développement que j'indique
de
f ji> ceci
%i*\
est une
S'il
laisse pas
et
que l'on ne pour
ainsi par manière de
,
ici ,
i^fj
est
conformé
,
l'équivaielft
loi.
j''</*i *\"A- *J, hA
-
,
rapporte à la loi
clàîé , si l'on fait attention que
ment au
ii-Lç>J
se
•-•fi-
-»
-
-
•-
•
■>■>*{?
qu'il ait pour héritiers ses père et
mère le tiers de la succession appartiendra à sa mère; mais, s'il a
des frères sa mère n'aura que le sixième après que l'on aura prélevé
les legs qu'il pourra avoir faits et les dettes. Vous ne s'ave^ pas qui
de vos pères ou de vos enfans a un droit
plus prochain à profter de
vos biens
ceci est un règlement précis qui vient de Dieu.
ne
d'enfans
et
,
,
,
,
:
On
mot
qui
peut rendre compte de l'emploi de l'accusatif dans le
LàJji , qu'eu Je regardant comme un terme circonstanciel
se
ne
rapporte
aux
sition
toute
entière
exprimées
dans les
propositions précé
premier exemple : mais il y
*ÀU^
dans ce dernier exemple, une propo
est insérée comme
par parenthèse entre le
de même que
ceci de particulier, que
dentes,
a
lois
dans le
,
E4
^
SYNTAXE.
LA
DE
^2
propositions auxquelles H se rapporte,
_I1 faut fJonc regarder l^j.y comme -l'équivalent de **o->yJ fji
ceci est un règlement.
126. Outre cette sorte d'analyse qui peut servir à expli
quer un grand nombre, de passages dans lesquels l'accusatif se
il s'en rencontre souvent ou l'emploi -de ce
trouve employé
même cas ne%emble pouvoir être rapporté à aucune règle géné
terme
circonstanciel
et
les
,
rale. Ces
sortes
de constructions tiennent moins à la syntaxe
langue qu'au style figuré. On ne peut les
expliquer que par des ellipses ; et il n'y a que le sens qui indique
quel est le mot sous-entendu qu'il faut suppléer, et qui est réel
ordinaire de la
,
lement l'antécédent dont le
plément.
C'est le second
mieux
que je
ce
veux
nom
cas
mis à l'accusatif
dont
dire par les
est
le
com
j'ai parlé. On comprendra
exemples
survans :
iv*j«jf **U IJS Jjà [jtxk^j" c5j^âJ-jJ l\j* \y^==' !y^
Ils ont d f: Soye^Jufs ou Chrétiens, vous sere^ conduits dans
bonne voie. Dis-leur, (sutve^j plutôt, fa religion d'Abraham, (qui
Uux_â
la
étoit)
orthodoxe.
Je n'insiste pas ici
U-yô. terme circonstanciel qui se rap
qui
l'équivalent de <j*i* y&j ; mais ce
porte Abraham,
veux faire
je
que
remarquer c'est que IL est à l'accusatif, quoi
que l'on ne voie dans la proposition aucun verbe transitif dont
il puisse être le complément., ,ni aucune autre circonstance
qui
l'accusatif.
C'est
a
ici
du
mot
paroisse exiger
qu'il y
ellipse
\yJ&
suive^ ; ce mot se trouve virtuellement compris dans l'expression
i^Uj jf tSy. \yjfsoyei Juifs ou Chrétiens, qui est la même chose
que si l'on avoit dit: i^f.lL f^jj suini la loi des Juifs.
à
et
sur
,
est
,
Ulï!/.».-.-.
i<£> °p <jx^\j ?} <3] UliJÎ Ui=, $$\ UX'J Uf
DE
JL-UI (£-£
ifyJA
SYNTAXE.
LA
73
{jj£-~l y^J &>J<iÀ-*9 IfrlJ^i* "-™»J ^J£->'
(S'y*
*-*f'
f&J
JLjJl JÂj ila:
Nous t'avons
communiqué la révélation, comme nous l'avons
communiquée à Noé et aux prophètes qui l'ont suivi. Nous avons
(lonné à David le psautier ; (nous avons envoyé) des apôtres dont
nous t'avons
déjà raconté l'histoire et des apôtres dont nous ne t'avons
encore raconté l'histoire. Dieu a
pas
parlé à Moïse face à face et
a
des
d'annoncer
aux hommes des ré
(il envoyé)
apôtres chargés
compenses et di les menacer de châtimens afin que les hommes
n'eussmt aucun prétexte à
alléguer contre Dieu après la mission
de ces apôtres.
Le mot ^mJ se trouve jusqu'à trois fois dans cette
phrase sans
l'on
voie
de
mot
il
que
quel
peut être le complément et sans
qu'on puisse le considérer comme un terme circonstanciel; mais
il est impossible de la traduire sans restituer un verbe dont
lL.j doit être le complément. Ce verbe est pour les deux pre
mières fois, Uil*jf nous avons
envoyé, dont la signification se trouve
virtuellement
dans
ces mots
nous avons donné à David
comprise
,
,
,
,
,
,
,
,
,
le
psautier
phètes
ou
;
car,
apôtres
comme notre
apôtre
le verbe
encore
Dieu n'accordant la révélation
,
,
c'est
comme
s'il avoit dit
David à qui mous
'JJ»j\
dans la dernière
il
partie
qu'ij est
a
avons
:
qu'à
Nous
ses
avons
pro
envoyé
révélé le psautier. C'est
envoyé, qu'il faut suppléer devant
3llJ
de notre
exemple ; et ce qui le fait con
noître c'est
virtuellement compris dans ces mots
Dieu avarié à Moïse
face à face, qui par la même raison que
nous avons donnée ci-dessus
sont
équivalens à cette propo
sition plus
développée : Dieu a envoyé pour apôtre1, Moïse à qui
il a parlé face à face,
,
,
,
,
Ainsi,
4oit
dans toutes les circonstances
regarder comme
certain
qu'il
y
a
parentes
ellipse
à
celles-ci,
d'un verbe,
et
on
que
SYNTAXE.
LA
DE
74
indique le complément de ce verbe ; et si l'on fait
ce
qui précède cette, expression elliptique, on n'aura
pas de peine à reconnoître quel est le verbe qu'il faut suppléer
dans chaque circonstance particulière pour rendre à la proposi
tion toutes ses parties intégrantes.
127. La règle que nous venons de donner, en considérant
l'accusatif comme une forme adverbiale elliptique est d'une si
grande vérité et son application e^t si générale que l'on peut
l'accusatif
attention à
,
,
,
,
même y rapporter les
autres
usages de
ce cas
exposés précédemment.
Ainsi quand nous avons dit (. n.os 87 et
8 8- )
,
verbe
(^
et
les verbes X^>f
-
J&\
-
<j*Uf
,
,
en
envisageant le
&c.
comme
où l'attribut
verbes abstraits , que , dans les
avons
quenqus
des
lié
au
propositions
sujet par quelqu'un de ces verbes, le mot qui exprime l'attribut se
met à l'accusatif, nous avons suivi
l'analogie des autres langues
dans
est
il y a réellement un verbe abstrait. Mais
la chose sous un autre point de vue qui
lesquelles
envisager
paroît plus exact,
peut
et dire
qu'il n'y a point,
dans la
on
me
langue arabe,
de verbe purement abstrait ; que les fonctions du verbe abstrait
sont
dans
remplies,
l'on établit
loin ;
avons
entre
le
cette
sujet
que le verbe ^ , ainsi que tous ïes autres que nous
d'abord considérés comme des verbes abstraits , sont de
et
véritables verbes attributifs
réelle
comme
sition
UsÇi qwO qIs^
proposition
de
,
qui
renferment l'idée de l'existence
attribut du
sujet. Alors l'analyse 'de cette propo
Lokman étoit sage est la même que celle
cette autre
^L^i
par la forme du rapport que
l'attribut, comme nous le dirons plus
langue,
et
Lokman,
,
15^t &^L ^U
Hosaïn
mourut
martyr,
le
sujet, comme &lL Hosaïn: yVest un
verbe attributif oui renferme en même
temps l'idée du verbe
abstrait
et
est
de l'attribut
c'est-à-dire, fut
J&
existant,
mourant; enfin
de même
que
U%-Ci sage,
d>U
mourut ,
est un terme
DE
circonstanciel
sous
une
ou
SYNTAXE.
LA
modificatif,
forme adverbiale
un
,
75
(n.° i\6) exprimé
qui équivaut à (£&£. ou à
sur-attribut
et
f£*& (a)'
128. On pourroit en dire autant de
tous
les accusatifs servant
complémens aux verbes transitifs ; car ce sont de véritables
déterminatifs /qui restreignent la signification de l'attribut com
pris dans le verbe en indiquant l'objet et le terme précjs de
de
,
tandis que certains verbes prennent leur
immédiatement , et le mettent à l'accusatif, un
l'action. En effet
complément
,
grand nombre d'autres ne le prennent que par l'entremise d'une
préposition : or, c'est un principe confirmé à chaque instant par
la grammaire de la langue arabe que l'adverbe est l'équivalent
d'une préposition et de son complément.
,
Mais
,
sans
insister
sur cette
observation
qui n'est pas moins frappante.
1 20. Nous avons vu
(n.os 1 00et
les
de
noms
nombrée
ou
poids
et
de
1
mesures
passons à
une autre
02) que plusieurs numératifs
,
mettent
mesurée à l'accusatif. Ces
semblent d'abord
,
,
le
nom
de la chose
,
mis à
l'accusatif,
noms
servir de
complément au numératif,ouau nom
de poids ou de mesure. La preuve cependant que ce ne sont pas
de véritables complémens c'est que les mots qui semblent faire
fonction d'antécédens ne perdent point leur voyelle nasale au
singulier, ou leur q finale au duel et au pluriel (n.° 738 //''p.):
On ne dit pasiUjjl^ç
tx>J cA'J ISft*-»-^» ma*s on dit
îla.^ y^it vingt hommes lx?J JLL>J une livre d'huile fj^*-^ t)fô^
deux boisseaux
d'orge. Ces accusatifs ne sont donc point des com
plémens objectifs mais des complémens circonstanciels ou dé
terminatifs sous une forme adverbiale à laquelle on a
recours^
,
,
,
,
,
-
~
,
,
,
,
(a)
,
C'est ainsi que l'on peut dire
0*?^'«£-''
J à la
Itttre,
non
LJiilr JoJ ^
Zéidus mendacem,
ou
oï^J^J
°»
in mendaci
,
bu
ex
ou
^
mendacibus*
l6
r
DE
LA
SYNTAXE.
,
permet pas de faire usage
le conséquent. On dit par la même
parce que la forme de l'antécédent
du
génitif pour exprimer
raison ,
et
ne
de, la même manière U* i j^V t
,
*
Jî plein
la
terre
d'or.
CHAPITRE VI.
E>e
l'usage
des Cas pour
exprimer
Complainte.
le
Compellatif et
la
130. J'ai défini ailleurs (n.d 55) ce que j'entends" par
compellatif. Les Arabes expriment cette idée par le mot ^iU»
qui signifie celui qui est appelé, et ils nomment *fi>XJf cj^â. ou
«fiLillf cj^a. particules d'appel les adverbes qui indiquent le
compellatif, et qui sont U Uf U* <jî et f
131. Comme les trois cas peuvent servir pour exprimer
le compellatif (n.°, 64) pour lequel les Grecs et les Latins ont
un cas
particulier nommé vocatif, nous devons rendre compte
ici des diverses circonstances qui déterminent l'usage des diffé
rens cas arabes
pour exprimer le compellatif.
132. Si ce que l'on appelle ^iLLjf est exprimé par un
nom
propre ou par un nom appellatif, mais déterminé à des
choses ou à des personnes présentes aux yeux de celui qui
appelle, soit réellement iLJUiLi., soit par une sorte de prosopopée et par une opération de l'esprit UÏCi le nom se met
au nominatif sans
voyelle nasale. Exemples : 0^ lô ô Mahomet!
ô
^llff l£jf Lj hommes que je vois! Qn dit de même *Ijcw Lj
ô ciel! si l'on regarde le ciel. Au duel et au
pluriel régulier,
on ne doit pas retrancher le
^ final. Exemples :
^^JU
ô vous deux que je vois! q^j lô ô prophètes qui êtes ici
présens!
Mais il faut pour cela que le nom appellatif n'ait ni complé
ment immédiat ni complément joint par une
préposition ni
,
-
-
-
.
,
,
,
,
,
y
DE
aucun
et
autre mot avec
d'attribut ,
ou
lequel
a
lieu,
«Jf J4^ Ij ô Abd-allah [ô
envers
que Zeïd! JLa.
«.^■Lj
SYNTAXE.
il
et
de
«
se met
une
"J^^L^ Ll
ô toi
L**». L> ô toi dont le
qui
visage
la montagne.
On emploie de même
o*.
Si
sujet
quelqu'une
à l'accusatif. Ainsi J'on
iU*3L>
!>£*• ^
as
est
relation de
conséquent.
serviteur de Dieu] !
les hommes! ou)
77
•
il soit dans
d'antécédent
de ces circonstances
ricordieux
LA
ô toi
\-£*?j ^
qui
es
toutes sortes
reçu
ô misé
meilleur
de biens!
ôHoi
qui
appelée
est
~J+£ Q\^Ki
beau!
dit,
montes
l'accusatif,
si la chose
exprimée par un nom appellatif ou un adjectif indéterminé,
c'est-à-dire, sans article. Exemple : llo Li ô prophète!
133* Lorsque le nom de la chose appelée est au nominatif,
on
peut le regarder, avec quelques grammairiens comme in
diquant l'ellipse de l'impératif *a»\ écoute, ou jUi' viens. Quand
il est à l'accusatif, on peut supposer qu'il y a ellipse
dejiM
,
j'appelle.
I
3 4« L'adjectif ou le nom appellatif joint au nom de celui
qu'on appelle et n'indiquant avec lui qu'un même individu, se
met indifféremment au nominatif ou à
l'accusatif. On dit donc
^jljf oZ^k Ç» ou £$JLff o^j£ Lj ô Mahomet le prophète / Jli>U)I jJj Li
Ou
JiUJf ô Zeïd le sage! Si c'est un nom. qui ait tin complément il faut le mettre au nominatif.
Exemple : *iff jUà. a*}^ ^
,
,
ô Abraham, ami de Dieu!
Cependant le mot ^ fils, se met
toujours dans ce cas a l'accusatif, avec cette particularité que
si les mots J>\ fils, ou
lu) fille, se trouvent entre deux noms
ils
propres
perdent toujours i'élif d'union et dans ce cas le
nom
propre qui les précède peut se mettre au nominatif ou à
l'accusatif. Ainsi l'on peut dire jj.> ^oôj ^ ou
j->^ ÛH «^3 ^
ô Zeïdfils d'Amrou! Si, au contraire ces mots ne sont
pas entre
deux noms propres
ils conservent leur élif d'union
et le
,
,
,
,
,
,
,
,
,
78
DE
SYNTAXE.
LA
précède se met toujours au nominatif. On dit donc
^\ 'Jj\ oôj.^î &} o^ J-^j ^ ~£*b o^oP*j v* Cette distinction dans la manière d'écrire les mots ^J et îUjJ quand ils sont
nom
les
qui
"
•
,
entre deux
noms
propres
compellatives ( n.°
,
739, t."
au nom
*A*^i, U
Ij
^sSU
e>M U
oût
ou
i^U L
-
^fU
ô
U
oCof Ij
Au lieu de
,
aux
et
-
bwU Ij ô
père! j?\
mon
formulés
appelée l'affixe
soit de la .manière
,
soit de l'une des manières suivantes
,
Us^lc. lô
-
de la chose
peut le faire
,
ordinaire
particulière
p.]»
ajoute
135* Quand
la première personne on
on
de
n'est pas
ou
Ij ô
mon
serviteur.
ma
mère!
on
Li
^»^è
-
peut dire
e>«flj.
particule U ne peut jamais être suivie immédiate
ment de l'article J f
Lors donc que le nom de la chose appelée
est restreint par un article on interpose entre ce nom et la parti
cule l'article démonstratif \ôJ> , ou les mots suivans composés de
'cet article ou de l'adverbe U
fô^jf Lg_*î tjjxjf Exemples:
ô
un tel!
loi»
^
J4j.lf
J^UJf l£jf Lj 0 hommes!
137- Quan£ï le nom de la chose appelée est restreint, soit
par l'article soit par un complément ou que c'est un nom
propre on peut supprimer la particule U Exemples : J»UJ f l£>l
136.
La
.
,
-
,
-
.
,
,
,
,
.
hommes!
U5j
Seigneur! $_$% cpfj^JÎ^li 0 Otor
/for Wwx e£ de la terre! <J*~>y. ô Joseph! On peut aussi retrancher
cette.
particule devant le nom conjonctif ^» Exemple : o*xSf ^
0
0
w/«
.
ô toi
■ft;.
qui
pas!
Lorsque le nom
ne meurs
138.
de trois, lettres
,
on- en
propre de la chose appelée a plus
retranche quelquefois la dernière lettre.
On peut
pareillement retrancher le s des noms propres fémi
qu'ils n'ont que trois lettres ; ainsi on peut dire :
^)Âj lô Ul Lj ù^s U v^j* Li au
jaà* Lj cw s»
nins , lors même
^f» U
-
-
-
-
-
-
?
DE
lieu de
*Jj«> Ij
(jf^iU
-
Ij
io
,
-
et
SYNTAXE.
LA
J^^^LiL»
ainsi des
^x*-i L»
-
-
7<?
<H*UjU»
-
^***»
^
~
autres.
<>».U». b ô mon ami!
Ce retranchement se nomme ^îUUtfl^j'.
139. Lorsqu'on appelle quelqu'un à son secours, ce que les
Arabes nomment *jU>lJ, on emploie le génitif précédé de la
particule 'J qui tient lieu de la préposition J mais à laquelle
On dit de même
^U» Ç»
,
au
lieu de
,
,
donne pour
afin d'éviter la confusion.
voyelle
fatha,
Exemple: o^jH^.ô Zâd (viens au secours J! Zeïd est ici hipersonne
que l'on appelle au secours-, oUx^if
Si l'on exprime aussi le nom de celui contre lequel on a besoin
de secours >Sa»\ [^ oU^Xil Ç on le met au génitif précédé de
la préposition J
Si l'on appelle au secours plusieurs personnes l'une après
l'autre en répétant devant chaque nom la particule Çj il faut
aussi employer chaque fois la préposition J avec un fatha. Si
au contraire, on ne
répète pas Ij mais qu'on joigne par une
conjonction les noms de ceux qu'on appelle au secours, on
emploiera, pour le premier nom, 'J par un fatha et pouf les
autres, J par un kesra. Ainsi l'on dira ^y* J&V Lf?'c£yO Li ô ma
famille! ô vous qui ressemble^ à ma famille! et, au contraire,
on
un
*
.1-
<"a
.
•
.
,
,
,
,
,
olXïllj J^^^-nfl Lj
ô vieillards
et
jeunes gens!
Dans
cet autre
exemple <_>'}U=JI J»UU U ô hommes (vene^ me secourir) contre le
menteur! le J du mot
^IxJl a un fatha, parce que les hommes
sont ceux qu'on
appelle au secours ; mais celui du mot c_jili=dJ
a un kesra
parce que le menteur est celui contre lequel on im
plore le secours des hommes.
l4o. On emploie aussi la même formule pour exprimer /Wmjtration t-xUiUf ; et le nom qui exprime le sujet de l'admiration
,
,
.
80
V
DE LA
\»
éi>~àâ.-l\
SYNTAXE.
se conforme
,
la chose dont
le secours
que celui
règles
mêmes
aux
oU£*LU
qui
implore
exprime
l4r. Après la particule de complainte fj nommée juj^f cJ>â.,
le nom qui exprime la chose dont on déplore la perte <_ijo£tf,
se met au nominatif ou à l'accusatif, en suivant, à cet égard,
les mêmes règles que nous venons d'exposer pour le compel
on
latif. Ainsi l'on dira o^L£
riom propre
au
nominatif;
hélas, Abd-allah!
nom a
un
fj
en
hélas
et
mettant
,
Mohammed!,
,
contraire
au
3^é
à
,
en mettant
dira
on
l'accusatif,
.
Jlf ô4é
à cause que
le
fj
ce
complément.
CHAPITRE
Syntaxe
du
Sujet
et
VII.
de l'Attribut.
ne suffit
pas que deux ou plusieurs mots soient
ensemble
pour qu'il en résulte un sens: il faut* qu'il
agrégés
de
y ait entre eux une relation de sujet et d'attribut ;
I42. Il
ces
t
qui
qu'un
parle, et
esprit et qu'un
qualité que l'on
mots, pour le moins, exprime la chose dont
est le sujet du
notre
jugement que
porte
autre mot
aperçoit
ou
dans
même
cette
En vain diroit- on
créatures de Dieu
,
;
plusieurs expriment
chose
,
frère
grammairien
produiroient point un sens ;
ment.
II
l'homme
en
est
est
sous
lequel
on
,
l'envisage.
Dieu, anges, hommes; les deux et la terre; les
les animaux raisonnables; Dieu lui-même ; mon
Michel le
idées isolées, mais
l'attribut
la
on
ne
:
toutes ces
contiendroient
tout autrement
fragile;
agrégations de mots ne
l'esprit que des
l'expression d'aucun juge
elles n'offriroient à
quand je dis. Dieu
est
sage;
tout
passe ; parce que, dans ces exemples;
les mots sont liés par la relation de sujet et
d'attribut.
Cette relation de sujet et d'attribut est nommée
les Arabes
par
*uy
DE
8l
SYNTAXE.
LA
iUl-f l'action
d'appuyer ; l'attribut, qui s'appuie en quelque sorte
sur le sujet, s'appelle o«S»a
appuyé; et le sujet, CJ\ o^» ce sur quoi
lors
une chose est appuyée. La réunion du sujet et de l'attribut
l'un
forme
ce
les
renferme
et
l'autre
même qu'un seul mot
que
l'on appelle «X?- somme, et que nous nommons proposition. Ainsi
/U oôj Zeïd (est) dormait, jjê cî>U Amrou est mort, o*sj je suis
tombé, sont des propositions.
1
43 Les propositions que je viens de donner pour exemples
sont en même temps des phrases ou ce que les Arabes appellent
ȕfc discours parce qu'elles offrent un sens parfait. Il n'en seroit
,
,
•
,
,
,
je disois si Zeïd dort, si Amrou étoit mort,
tombé; le sens demeureroit incomplet ; et il faudrait,
pas de même si
,
quiconque est
pour le compléter ajouter une autre proposition et dire par
exemple : Si Zeïd dort il oubliera son chagrin. Si Amrou étoit mort,
on ne redouteroit plus sa vengeance. Quiconque est tombé, a compas
,
,
,
,
'
sion de
auxquels
ceux
il arrive
un
pareil
malheur.
proposition «T?- peut être', ou nominale iLcwf ou ver
comprendre cette distinction il faut faire atten
tion que, dans la langue arabe, il n'est pas nécessaire d'employer
1
44*
L-a
bale iul*J
,
Pour
.
,
le verbe pour exprimer la relation du sujet et de l'attribut. On
dit^ic «Jlf Dieu indulgent -, Ja-£ î^Cê Mahmoud avare pour Dieu
,
est
indulgent
nominale.
Mahmoud
,
Si,
est avare.
contraire
Dans
l'attribut
ce
cas, la
proposition
est
verbe,
exprimé par
exemples g\ d>U mon frère est mort, i^àj *^
leur camarade est venu la proposition est verbale.
1
45* Quelquefois le mot qui devroit proprement être consi
dans
comme
au
ces
,
est
un
,
,
déré
comme
d'exprimer
On dit
,
un
l'attribut ,
terme
sous-entendu
pjir exemple oo^ltf j
,
^iLè=Jf J^ôjf
dans la
est
mosquée ;
//.* PARTIE.
,
et
circonstanciel
l'on
de
qui dépend
t>^4 Joseph dans
se contente
cet
la
mosquée,
Joseph £St
grammairiens
toi du nombre des menteurs; pour
tu es
du nombre des
menteurs.
Les
attribut.
F
82
DE
LA
SYNTAXE,
propositions Cisjô *£& propositions circonstancielles,
lieu comme dans le
quand elles' expriment une circonstance de
premier exemple ; et *l^£)î (£*£.&£*- u£ propositions qui imitent
la proposition circonstancielle quand la circonstance qui tient lieu
d'attribut est autre qu'une circonstance de lieu ainsi que dans
le second exemple et dans ceux-ci: JJ &± nous à Dieu, c'està-dire, nous appartenons à Dieu;^\ Ji Q^-f notre récompense
sur Dieu, c'est-à-dire, notre récompense repose sur Dieu, ou nous
nomment
ces
,
'
,
,
due par Dieu.
est
propositions nominales l'une des deux parties
constitutives de la proposition se nomme A&£* ; ce qui signifie
proprement le terme par lequel l'on commence et que nous pouvons
appeler l'inchoatif: l'autre se nommera. c'est-à-dire l'énonciatif
ou le
prédicat. C'est ordinairement (a) le sujet qui fait les fonc
tions d'inchoatif, et l'attribut qui occupe la place d'énonciatif.
1
4-7- Dans les propositions verbales ïes deux parties cons
titutives de la proposition sont le verbe Ji*> et Gagent JcU ;
les Arabes ne considèrent le sujet comme agent que quand il
est précédé du verbe.
l48'. II faut encore distinguer les propositions en simples et
composées. Les propositions simples sont celles dont nous avons
parlé jusqu'ici, et qui ne renferment qu'un sujet et un attribut,
ou
pour parler comme les grammairiens Arabes un inchoatif
et un prédicat si elles sont nominales
ou un verbe et son
si
elles
sont Verbales. J-es
agent
propositions circonstancielles
sont aussi comprises dans le nombre des
propositions simples.
Toutes ces sortes de propositions ne cesseat pokit d'être
simples
l46.
Dans les
,
,
,
,
,
-
,
,
,
,
,
(a)
Je dis ordinairement;, parce que, dans certains
et
cas,
les
grammairiens
regardent comme J^à. mjjrédicat, le véritable sujet de la proposition^
comme
fjwû* "ou inchoatif, le mot qui exprime l'attribut.
Arabes
*
DE
LA
83
SYNTAXE.
les
parties constitutives
deux sont complexes. Ainsi ces propositions, Le fils d'ArabLe khalife
schah (est) le plus éloquent des écrivains Arabes
mourir
son
Haroun, surnommé Raschid ,fit
v'iTJri^jafar et toute sa
sont
famille
simples comme celles-ci : Hariri (est/ éloquent.
Haroun tua Djafar.
Les propositions composées sont : 1 .° celles dont le sens n'est
complet que par la réunion d'une autre proposition telles que
celles que nous avons données plus haut pour exemples : Si Ztïd
dort, il oubliera son chagrin ...Si Amrou étoit mort, on ne redouteroit
plus sa vengeance ; 2.° celles dans lesquelles on trouve une pro
position complète et une portion d'une autre proposition. Ex.
ijaj.f» *.*$& oSj Zeïd son serviteur malade c'est-à-dire le servileur de Zeïd est malade ; îL«6û d>UjA*â. Djafar, son serviteur est
mort c'est-à-dire
le serviteur de Djafar est mort. Le premier de
fj&i Zeïd, et
ces deux exemples est composé d'un sujet ou
d'une" proposition nominale complète
jojiJ* ILo^lè son serviteur
(est) malade qui fait" ici la fonction de prédkat ou d'attribut.
Dans le second il y a un sujet ou inchoatif, Djafar, qui a pour
prédicat la proposition verbale complexe *wo"iû ôU son serviteur
est mort formée d'un verbe et d'un agent (a). 11 en est de même
de cet exemple Jjyultf OJÎ «Juf Dieu^aïme les gens pieux. Le
mot ûlf Dieu,
précédant le verbe, n'est point considéré comme
quand
l'une de leurs deux
.
.
.
toutes
ou
.
.
.
.
.
,
,
,
,
,
,
>
,
,
,
,
,
,
V
analysent toutes les propositions où il se
nominatif, ou; selon l'expression de quelques
sujets
un
absolu.
grammairiens,
Voyez, ci-devant, n.° 61 p. 38 de cette
nominatif
seconde partie, note (a).
Les grammairiens Arabes nomment ces propositions
(j^Âlff ofi *X?"
propositions à deux faces, c'est-à-dire, mixtes, parce qu'elles participent de la nature
des propositions nominales, en ce qu'elles ont un nom pour inchoatif et de celle
des propositions verbales, par leur prédicat composé d'un verbe et de son agent.
(a) C'est
rencontre
ainsi que les Arabes
deux
distincts
au
,
,
<J}
,
F
z
84
LA
DE
agent du verbe «!>.-£
SYNTAXE.
aime , mais
comme
inchoatif ou
sujet ;
son
formée du
complète i^J.
personnel de la troisième personne,
il qui existe virtuellement dans le Verbe et qui fait la fonction
d'agent. Ainsi ïes deux mots Ç*4 *JÎf signifient Dieu il aimé,
et forment une proposition
composée.
l4o« Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces déno
minations et sur les subdivisions des propositions nominales et
verbales : ce que nous venons d'en dire est plus que suffisant
pour, l'intelligence des règles que nous avons à exposer ici,
attribut
la
est
verbe aime
,
et
proposition
verbale
,
du pronom
,
*
,
,
,
par rapport à la syntaxe du sujet et de l'attribut; car nous
n'adoptons point , dans cette partie de la grammaire , le système
d'analyse
des
grammairiens Arabes.
1^0. Si le
verbe abstrait,
sujet
M
l'un de l'autre dans
et
l'attribut étaient
liés par le
toujours
n'y auroit aucune difficulté à les distinguer
chaque proposition : cela seroit d'autant plus
facile que l'attribut seroit toujours à l'accusatif, comme nous
l'avons dit précédemment (n.° 87). Mais le verbe abstrait n'est
plutôt il n'y a pas véritablement de
langue arabe (n.° 127) : de là il résulte
dans
les
propositions nominales (n.° i44) la relation de
que
l'attribut au sujet doit être indiquée d'une autre rnanière.
Quand le verbe ^e ou quelqu'un de ceux qui sont nommés
imparfaits et qui font la fonction de verbe abstrait sont expri
més et lient le sujet avec l'attribut, le
sujet se nomme o^fi
le nom du verbe ^ et l'attribut
ôU=^l le prédicat du verbe '$'.
I
I. Le nominatif est le cas
propre du sujet et de l'attribut
J
et
et
c'est
ce
cas
;
(n.os 57 5 9)
par
qu'on exprime dans les propo
pas toujours exprimé ,
verbe abstrait dans la
ou
,
,
,
,
,
,
sitions nominales l'idée de l'existence du sujet et de sa relation
idée qui , dans la
,
plupart des langues , s'exprime
à l'attribut
par le verbe abstrait. Ainsi
,
dans
ces mots
^j-L» Ûî
Dieu
(est)
DE
8j
SYNTAXE,
LA
libéral, le sujet est «Jl Dieu, et l'attribut />T libéral; la relation
du sujet à l'attribut est exprimée par le nominatif.
I<2. De cette manière d'exprimer la relation du sujet à
l'attribut , il naît
quelquefois une sorte d'obscurité et l'on peut
douter si deux mots qui sont au nominatif, et dont l'un est un
nom et l'autre un adjectif, forment réellement une
proposition
le
d'une
ou s'ils ne forrnent
sujet complexe
complète,
que
propo^
,
sition dont l'attribut doit être énoncé par d'autres mots. C'est.
ainsi que Deus justus en latin, peut former une proposition , et
,
Dieu
signifier
(est) juste, mais qu'il ne forme qu'un sujet com
plexe dans cette proposition :. Deus justus rectè judicat [le Dieu
juste juge équitablement ]
.
Plusieurs circonstances contribuent
cependant
à rendre cette
espèce d'obscurité extrêmement rare dans la langue arabe.
I
^}. On distingue facilement le sujet de l'attribut, quand le
sujet est un nom déterminé et l'attribut un nom ou un adjectif in
,
déterminé. La raison
que l'on
qu'une
ou
verra
même
ci -après,
partie
indéterminé ,
1^4-
Le
est
quand l'adjectif
de la
comme
nom
que , suivant la
en est
le
proposition
nom
même
déterminé,
règle de
ne
concordance
fait
avec
le
nom
il doit être déterminé
,
auquel
i.° par
sa
il
se
rapporte.
nature,
comme
les
propres ; 2,0 par l'article déterminatif [} f ; 5 .° par un com
plément, soit que ce complément sojt,un nom au génitif, ou
noms
un
pronom
nom
qui
a
affixe
un
il faut que le
sa
nature,
noms
ou
(n.os
autre
735
nom
complément
par
personnels
l'article,
sont
(a) Nous expliquerons
$6 1" p.)* Mais
pour complément soit
et
y
,
,
pour que le
déterminé ,
soit lui-même déterminé
,
ou
de
enfin
autrement
(a). Les pro
aussi déterminés par leur nature; enfin
ceci
ou
plus
en
détail
,
en
traitant
4e fe syntaxe die
l'article déterminatif.
F*
26
DE
LA
les articles démonstratifs le
personnels
qu'une
noms
,
Ainsi, dans
les
et
pareillement ;
sont
les articles démonstratifs
ou
il faut que
des trois manières
des
avec
SYNTAXE.
ces noms
si les pronoms
concordance
sont en
soient déterminés de
suivantes
quel
*■
indiquées précédemment.
^.J» (S»ji
[Josephus œgrotusj, ja-t>» ^ULULff [sultanus œgrotus), (J-^j yl
Twmf œgrotus,,
f
O^U* [pattr Josephi œgrotus] ja-iy-* <J* /wzftr
il n'y a point' de
tf*.jp£ [Ule œgrotus], j^- ^ [hoc bonum]
doute que les mots
j*jji malade et _>^ /wî, ne forment les
toutes
propositions
,
,
,
,
attributs
,
et
qu'il
malade, le
(est)
malade, il
ne
faille traduire,
père
de
Joseph (est)
(est) bon ;
(est)- malade, cela
forment les attributs ,
qui
Joseph (est)
sont
malade
parce
indéterminés
les
malade le sultan
,
père (est)
que ja-tj* et jlà.,
et qu'au contraire
,
mon
,
les sujets
sont déterminées.
expressions qui indiquent
^
grammairiens Arabes établissent pour règle, qu'il
est de la nature du sujet, ou.
plutôt de l'inchoatif d'être déter
miné ; et de celle de l'attribut ou du prédicat, d'être indéter-miné: mais cette règle est sujette à beaucoup d'exceptions%
I
^ 6- Lorsque le sujet et l'attribut sont l'un et l'autre déter
minés, on emploie souvent, pour les distinguer, et pour empê
cher qu'on ne les cd|ifonde en une seule
partie constitutive de
la proposition, 'les pronoms personnels,
que l'on place entre le
sujet et l'attribut ; et alors toute équivoque est impossible C'est
toutes
5 -Les
I
,
'-
ce
qu'on
lui,
eux
h
le rivant
,
^^0"J^y> lîlï Dieu,
l'existant par lui-même ;jùft
Sjj > (jtâj ceux-là,
voit dans les
et
l'aliment du feu ;
se contenter
de, ce
exemples
suivans
£jliL/J y>J**N
que l'on
:
la richesse elle , la
,
Clj* jipf
cîtf i'
disposition
hçmmt,
possède
Lif
le,
moi,
ton
lui,
Câ^\fC^J \y>
Dieu; que l'on
seigneur
doit traduire ainsi : Dieu est le vivant et l'existant
lui même;
;
cet
lui, moi;
par
-
DE
ceux-là
seront
LA
l'aliment du
tj
SYNTAXE.
la richesse
feu;
est
la
à
disposition
se
que l'on possède ; cet hommeilà, c'est moi ; je suis le
Seigneur ton Dieu. Dans toutes ces propositions, les pronoms
personnels remplacent le verbe abstrait , et distinguent le sujet
contenter
de
ce
de l'attribut
;
mais
,
outre
cela
ils donnent à
,
l'expression
une
d'énergie ou d'emphase qui ne peut être rendue en
françois que par ces tournures: C'est Dieu qui est le vivant Ù"£. ;
ce sont ceux-là
qui seront l'aliment du feu; c'est la disposition à se
contenter de ce
que l'on possède qui est la richesse ; c'est moi qui suis
cet homme-là ; c'est moi
qui suis le Seigneur>ton Dieu.
Les Arabes nomment dans ce cas, le pronom JLliJfj^i
pronom de séparation ; d'autres le nomment il> soutien, pilier
sorte
,
,
*
,
>
parce qu'il
d'attribut ,
empêche que le mot qui te suit ne perde la qualité
de même que, dans une maison, le pilier empêche le
toit de tomber
(a)..
Remarquons en passant que, lors même que le sujet
pronom personnel de la première ou de la seconde per
on
emploie toujours celui de la troisième personne pour
V ÇT.
est un
sonne
,
tribut,
comme
:
,
,
pour séparer le sujet deTat^le voit dans les derniers exemples, et dans
séparation c'est-à-dire
pronom de
ceux-ci
,,
y
on
»U^ &*"S 0K> Jr* ^ Je
suts
^a vaie> ^a v^rit^ et ^a
jJUif jyy> ûf je suis la lumière du monde.
levée,
1^8. Toute équivoque est
encore
mis à
l'accusatif,
particules
à
(a) Voye£
le
mairien/ on
comme
est
qu'iï est précédé de quelqu'une des
qJ ^f &c. (n.Q 90) ; car ces parti
l'attribut qui demeure au nominatif. II
sur
-
,
,
^l^kVf ZSj*j*>page tjf, et la
nuscrit arabe de la BibL
le sujet
>
cause
indéclinables
cules n'influent pas
quand
vie
imp.
n.° 1195 A
,
ne doit
pas considérer dans
des pronoms \. il Les appelle
,
f. 94
ce
Çramm^ire d'Ebn Farhâr
recto.
Suivant
ce
,
ma
dernier gram
cas-là, les pronoms personnels
Ji-Là <1J-â. particules
de
séparation.
Y
4
88
DE
arrive souvent,, dans
ce cas
verbe affirmatif
J
Certes, Dieu
ou un
,
SYNTAXE.
LA
,
que l'on
personnel (a). Exemples
pronom
le troisième
est
devant l'attribut l'ad
met
entre
trois personnes
jj^UJf ^t J-lij jJ *Jlf oj
Car Dieu
:
(b).
:""
assurément plein de bonté pour .les hommes,
est
jMJfigdfiiî-irs1j
Car Dieu
assurément le
est
et
fort
le sage.
(J&'J f tpJ f éUJ
C'est toi
j^rd wo«j
Dans
f Vj?
cas, si le
le libéral.
hériterons de la
^«f
CV/r
es
j>j* I ci^ o^ Ui
y
CV
qui
«m/
^«/
possession de la
jt/ât to/z
terre.
seigneur.
personnel, on emploie
les affixes qui servent d'accusatif; et alors, si l'on met un pro
nom
personnel entre le sujet et l'attribut on prend celui dé la
même personne à laquelle appartient l'affixe. On ne dit pas
cjUbpfjJfe éLiJ., ni l$Sj jt> £] comme dans le cas dont nous avons
parlé précédemment (n.° 157); mais on dit, <1>LJ^JI ôif t^-JJ
ce
sujet
est un
pronom
,
,
,
et
Câij bf 5j
(a)
nom
Dans
ce
.
cas, le
de la conjonction
du moins
,
par
(b) Alcoran,
£jj
un
sur.
qJ fl*f
sujet
n'est
plus inchoatif
; car
il
de l'essence de l'inchoatif de n' être
point
est
antécédent sensible
/,
v.
S2.
*
fôJiû*
"Jà.'sj jLU.
: on
le
nomme
régi
a
DE
II
159-
n'y
a
que difficulté à
avoir lieu
que deux
distinguer
Sp
SYNTAXE.
LA
le
pourroit éprouver quel
pourroit
seroient incomplexes et
où l'on
cas
sujet
de l'attribut. Cela
parce que l'un et l'autre
indéterminés , ou parce que l'un et l'autre seroient déterminés sans
ou
,
signe sensible qui les séparât l'un de l'autre.
60. Le premier cas n'a jamais lieu -r suivant les grammai
riens Arabes qui veulent que le sujet ne puisse être indéter
miné que dans les circonstances suivantes : 1 .° quand la pro
position est circonstancielle ( n.° 1 4 5 ) et 4ue ^e terme circons
tanciel considéré comme attribut précède le sujet ; exemple :
jl> ts&l] j il y a un âne dans la mosquée ; 1° quand le sujet
est
précédé d'une particule d'interrogation, jljJf j ^U-if JlJ»
y a-t-il un-homme dans la maison! 3.0 quand il est précédé' d'un
adverbe négatif, jîôJf J txil U il n'y a personne dans la maison;
4.° quand le sujet est un diminutif; 5.0 quand il est précédé de
l'adverbe d'affirmation J ; 6.° quand c'est un nom d'une signi
fication générale comme Js* ; 7.0 quand la proposition exprime
un vœu, comme *££&. *2U, salut sur vous! 8.°
quand c'est un
mot
qui renferme l'équivalent de la conjonction si (n.os 343»
2' p. )
//' p. et 5 1
comme
[f* quiconque U quoi que ce soit
que. Dans la plupart de ces circonstances, et dans quelques
autres que j'omets
il n'y a lieu à aucune équivoque (a).
qu'il
y eût
aucun
1
,
»
,
,
,
,
,
,
,
,
(a^ Ebn-Farhât dit
joint
f û-t'j
miné
à
un
adjectif,ou
O;^-5
,
»
ou
comme
de la Bibl.
,
e"fin
>
>
«_*1» j*u
un nom
ou
imp. n.° 1295 A
ment une sorte
Quoique
,
,
suivant les
,
tt
qui
<'^U*»j
f. 9 1
de détermination
d'être déterminé
rencontre
que le sujet peut être encore indéterminé , quand if est
que c'est un adjectif verbal suivi d'un complément comme
a
Pour
jUr*
recto.
«»
âne d'un jardinier.
) Dans,
incomplète
grammairiens
complément
un autre nom
,
ces
comme
Arabes
,
je
par
exemple,
cas
,
il y
a
Ar.
réelle'
le dirai ailleurs.
il soit de la
de celle de l'attribut d'être indéterminé
quelquefois. Djewhari,
( Voye-^
deux derniers
indéter
man.
au mot
nature
,
du
sujet
le contraire
.«L, dit qu'il y
se
a en
SYNTAXE.
LA
DE
pQ
quelques exemples qui semblent contraires à
ceci, il faut les expliquer au moyen d'une ellipse (a).
l6l. Si le sujet est indéterminé, mais complexe, il n'y a
lieu à aucune équivoque comme on le voit dans ces exemples :
Si l'on
trouve
,
^i^/.
Z)^
paroles obligeantes
Une
servante
théiste ,
Syrie
un
vers
quand
village
même celle-ci
nommé
de Hasan
,y\\ c>^
Et il
ajoute
«
.,.-*,..-:
(est)
meilleure
qu'une servante poly
paroi troit plus belle.
vous
>
à
°ù l'on vendoit des vins célèbres
,.
et
il cite
il
est
formé.
■*
:
,
et
*\ja
l'eau
sont
le
à l'accusatif
mélange dont
attribut de
comme
'^
f
sujet de ce verbe est indéterminé, et son attribut
qui, dit-il, est permis) parce qu'il s'agit ici d'un nom d'espèce
nom
»
déterminé;,
»
ou.
»
cela seroit mauvais.
ce
*
.~
l'indulgence (sont) préférables
procédés. $.
que le miel
que le poète a mis
que le
en sorte
*-.
de
et
vraie croyante
£?k diroit du vin de Béit-ras
>>
$.-
.
--
aumône suivie de mauvais
une
ce
.r.
ou
appellatif: mais, ajoute-t-il,
si l'attribut étoit
un
nom
déterminé, pur,
»
'gJLl ï*àk iJjkAj'^ qIPJJJ <j^â. Jw^qI^c^ ^o célJi j'U U"JJ
Au
fut
et
1
surplus on peut remarquer que
opposée, s Uj 3Clc l|a.[j^ q^Xj
,
le
poëte auroit pu dire si la
,
rime
ne
^k? /r mélange dont il est formé est du
de l'eau et alors la construction seroit rentrée dans la
règle commune.
J'expliquerai ailleurs ce qu'on entend pat détermination pure ou parfaite.
s'y
mitl
,
(a) En voici- un exempie,( Alcor. sur. 12, v. 1?}.--Jacob voyant la chemise de
Joseph teinte de sang, que ses autres enfans lui présentoient comme une preuve
que son fjls,Ghéri avoit été dévoré par les bêtes,, leur répond :
jà^Jl^'Jt
\j~*\ *JCl*Àif vos âmes vous ont suggéré quelque chose de (criminelj ; et 41 ajoute.
DE
62.
1
Le second
résuite
en
une
II
n'y en a
exemples
les
pi
SYNTAXE.
LA
mais il
est rare
qu'il
complexe,
comme
dans
fréquent ;
cas est assez
véritable difficulté.
aucune
quand
suivans
:
-'
**
»
-
-
■>*
le. sujet est
~~o
*
j'
**
*"°
j
j\"
*-*"â.
JjCj*M) JLysI< (j Ajfy«f Q?*f*^ Jrr?tMif JX«
de
ceux
La ressemblance
qui dépensent leurs richesses pour la
cause de Dieu
(est) comme la ressemblance d'un grain qui a produit
sept épis; c'est-à-dire, c<ux qui dépensent leurs biens pour la cause
de Dieu sont semblables à un grain qui a produit sept épis.
JbUd 'Z[m c>^jf
,
La
j*s-r?" j*yÂ5
religion
qu'il
; ce
aux
yeux de Dieu
semble que l'on devroit traduire, ainsi
est
convenable. Mais Beïdhawi dit que
et
que l'attribut
est, mais
fjjt^jbj
le
est
Il
$
sujet
est
en
-
«->JjS
$
»
l'islamisme.
(est)
est sous
-entendu
;
ces
que
à moi, c'est
deux
attribut
cet
est
entendu
sous-
et
,
de même de
-
"*
»
JiJj *ilf.
„
i
une
JLy<?"jl^>
cet
autre
l'attribut;
ce
sens
Djélal-eddin
dit,
et
,
que, suivant
revient
qui
passage (sur. 61,
patience
qu'un sujet,
que le
(jj*\
convenable.
patience
affaire
: c'est-à-dire
$\S£*
jSà
^—
*J
Cijd^
mon
forment
mots ne
de
user
v.
ij)
au
lg~.y
^'
:
-
lui,
(jC»\
même.
i£jà.\Z
4
'
"*
«
,Â* j-«J
et une autre
chose qui
vous
fera plaisir,
une
assistance de la
part de Dieu, efune victoire prochaine. Suivant Beïdhawi si l'on suppose le sens
fini
avant_^j il y a un sujet sous-entendu qui peut être ^ et se rapporte à
,
,
(jjà.\>
dontj^,J
ou
Dans
ner
,
bien l'on peut considérer (jj^
&c.
est
f
comme un
nominatif qui
est
le
sujet
l'attribut.
les
exemples pareils, il faut avoir recours à une ellipse pour rame
l'expression à l'analogie grammaticale. Si, par exempje, on trouve ^li Js**
tous
il faut faire attention que le
un
complément ;
ou
de
tout autre
mot
J£*
universalité suppose toujours
il y a ellipse du complément
que, par conséquent
que l'ensemble du discours
,
la totalité des hommes périt, c'est-à-»dire ,
tous
pourroit exiger
les hommes
sont
,
et
que le
mortels.
après
f
lui
^»LLff
sens est
,
,
DE
p2
Dans
sence
le
ces
de
exemples
du verbe abstrait
étant
sujet
II n'en
est
le
est
sujet
SYNTAXE.
LA
propositions
nominales
(n.° *44)
,
ab
peut faire aucune difficulté parce que
est suffisamment distingué de l'attribut.'
ne
complexe
r
,
pas de même de certaines propositions nominales
incomplexe : le sens de ces propositions peut être
dont,
équi
voque. Ainsi *)^Dy«j l£j£ peut signifier Mahomet (est) l'apotre
de Dieu, ou Mahomet l'apôtre de Dieu. JlT "^ ^ peut signifier
Ali
le lieutenant de Dieu,
est
ou
AU le lieutenant de Dieu. La
qu'ici le sujet et l'attribut sont déterminés : le sujet,
par la qualité même de nom propre ; l'attribut parce que c'est
un nom
appellatif suivi d'un complément déterminé (n.° i $<£)■
raison
en est
,
est évident que pour traduire Mahomet l'apôtre de Dieu,
le
lieutenant
de Dieu il faudroit que ces mots fussent suivis de
Ali
quelques autres mots que l'on pût regarder comme l'attribut du
Mais il
i
,
de fa
sujet et le complément
dans les
exemples
constituent
alors à
distinct
une
eux
séquent
donnés
,
,
ou
sont
isolés
il
comme
,
mots
qui
forment
certain
proposition
qu'ils
proposition complète et que par con
trouver un sujet distinct et un attribut
une
,
est
,
doit y
,
(a).
CHAPITRE
Des
163.
toute son
Complémens
Quoique
complémens,
(a)
s'ils
suivis d'une série de
nouvelle
seuls
on
proposition :
il
nous
ayons
en
général..
déjà parlé plusieurs
fois des
pas inutile de traiter ici ce sujet dans
d'indiquer en détail les différentes sortes
ne sera
étendue ,
et
Cette réflexion suffit
pour déterminer le
La;.£
(Jm \cJt> celui-ci, qui est avancé en âge,
L^'^i
est
à
VIII.
l'accusatif,
comme
terme
est mon
sens
mari
circonstanciel
de
ces
(Alcor.
(n.° 104)
proposition*
11
v.jz)',
sur.
,
pour
,
£, J>1
DE
de
complémens
Arabes
les
et
,
SYNTAXE.
LA
que leur donnent les
noms
de
cela facilitera
:
93
que
l'intelligence
la syntaxe des diverses sortes de
concernant
ce
grammairiens
nous avons
à dire
complémens
et
,
qui leur servent d'antécédens:
1 64c Les principales parties du discours sont les noms ïes
verbes et les adjectifs. Les noms servent ordinairement de sujets
les adjectifs d'attribut ; les verbes lient ïe sujet avec l'attribut et
leur influence
les
sur
mots
,
,
ils renferment l'idée du verbe
souvent
peuvent être modifiés
noms
minés par des
conjonctives ;
adjectifs
qui n'a
,
expliqués
,
des
appositifs
rien de
ce
celle de l'attribut. Les
et
restreints
,
ou
,
des
commun avec ce
déter
ou
propositions
que
nous en
et ne donne lieu qu'à des rapports
tendons par complémens
d'identité , et , par conséquent , à des règles de concordance. Les
,
complémens
restreindre la
ou
quer
verbes
bien aussi à modifier
servent
,
noms
,
des
même celle de la
expli
,
adjectifs
proposition
sont point
rapports qu'ils expriment
souvent
mais les
des
signification
déterminer
,
toute
ne
,
des
entière:
des rapports
des rapports de relation , s'il est permis de
d'identité ;
s'exprimer ainsi. Si je dis , le juste David , roi d'Lsraël et prophète ,
ce sont
et
il est
âgé;
l'assistance
contre ce
Dans le
sujet
lo«*
,
.
^JlçJXâ [^s. qU^LU «JJtJ
<Jaô
l'attribut
l'attribut d'un
»
ou
»
,
bien
(^sû
1^£
étant
^.-i
un terme
quelques-uns
sujet sous-entendu
est
l'attribut ,
comme
iSj-ij £)**""$'
sur. 12
vous
et
^ remarque que
»
f?'
(estj
celui dont ilfaut
v. ip ).
raconte^ ( Alcor.
exemple, suivant le commentateur Beïdhawi,
que
premier
Dieu
une
c>**
et
J»
circonstanciel d'état
lisent
,
ou
bien
les deux mots
répétition
*4-?ï?
de
lâwi
,
un
imphrer
,
et
«
alors
,
qui
dit-il
,
second attribut du
^*j f jjt>
fji
est
modifie le
ce
le
sujet
mot est
sujet f oJ> ;
forment ensemble le sujet,
ftxÂ.»
J^3"!/ J*^ d* *-*^J ^.-s d-*^ iô&j
p4
DE
LA
SYNTAXE.
pénitence que par ses vertus ïes mots juste,
David, roi, prophète grand, expriment tous des idées différentes,
mais qui ne sont que des manières diverses d'envisagerun même
sujet qui est David: ce sont des rapports d'identité. Au contraire,
les mots Israël vertus pénitence expriment des idées d'objets
réels ou intellectuels qui sont hors de David, et qui n'ont avec
David que des rapports de relation : ce sont des complémens.
l6j' Les complémens ont des relations plus ou moins
étroites, plus ou moins nécessaires, avec leurs antécédens; et,
àVaison de cela je les ai distingués en complémens objectifs;
modificatifs et circonstanciels (n.° 24) : à raison de leur expres
sion ils sont complexes ou incomplexes. Mais sans revenir
sur ces distinctions
que nous avons exposées ailleurs entrons
dans quelques détails sur la manière dont les Arabes envisagent
et sur les noms
ce sujet
qu'ils donnent aux diverses sortes de
complémens.
I OO. Les complémens des verbes sont tous
désignés sous
aussi
grand
par
sa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
le
de
nom
Jy>«
de l'action. Mais
cette
La
imparfait.
gouvernés
pur,
ou
qui
sont
la seconde ,
le
patient
dénomination
et
ou
qui reçoit l'impression
subdivise
se
en
£j^>j°*& Jyài patient
première
classe
à l'accusatif
comprend
les
zjHo
Jy*J>
qui n'est
pas
complémens,
immédiatement par le verbe;
que le verbe ne gouverne que médiatement
d'une préposition. Ces derniers sont donc for
j[L
^ cj^i
appelle- t.-on j»*^£j 3^
préposition
aussi les
j^£
167.
,
ceux
secours
més d'une
:
c'est à-dire
pur, ou, parfait,
patient
avec
,
ou
,
et
du
nom
qu'elle régit
•
Les
complémens des noms, que l'on peut regarder
complémens modificatifs ou circonstanciels ont
le génitif pour cas caractéristique ainsi
que nous l'avons dit
Le
(n.° 66).
rapport qui est entre les deux noms dont l'un fait la
comme
des
,
,
DE
fonction d'antécédent
ment,
se nomme
,
et
SYNTAXE.
LA
l'autre celle de
p$
complé
conséquent
s'appelle t>l—1*
ou
LJ>\Jo\ annexion l'antécédent
,
conséquent jJJf cjLL* ^z/i reçoit une annexe.
1 68. Les
complémens modificatifs, qui expriment une cir
annexé ,
et
constance
entière,
leur
le
du
sujet
ou
nomment
se
de l'attribut ,
JU.
ou
même de la
état, circonstance d'état
proposition
l'accusatif
:
caractéristique (n.° io4).
complémens spécificatifs qui expriment la nature
de la chose nombrée, mesurée ou pesée (n.a 102) ou
qui déter
minent l'objet spécial d'une qualité vague
comme
agréable
est
cas
I OO.
Les
,
,
,
À LIRE,
désagréable
PAR
VOIX, &c.
SA
ont
aussi l'accusatif
caractéristique. L'espèce de rapport à laquelle ils appar
tiennent, se nomme y^^J spécification; l'antécédent se nomme
llf spécifié et le conséquent ou complément jZ^e spécificatif.
I7O. Revenons maintenant aux complémens des verbes,
complémens qui, comme nous l'avons dit, sont appelés <Jj*jû
patiens, ou z-f* Jj-*à* patiens parfaits. Ils se partagent en cinq
cas
pour
«j
,
subdivisions
i.°
:
^Ut* Jj*** patient absolu,
d'action du verbe. C'est le
nom
verbe
lui-même,
à
verbe d'une
un
il s'est assis
et
en
le
nom
joint
au
,
i.r'p. )
,
modifié par
frappé d'un
Je l'ai frappé
jô^U principe ; c'est-à-dire,
d'action du verbe
Kjye^^> j'ai frappé en frappant, ou
signification analogue comme \%j*ï jj^.
s'as seyant. On
d'action
Je l'ai
nom
comme
d'unité j n.° 5 77 ,
nom
ou
en
coup,
le
un
et
le frappant ,
comprend
sous cette
n.° 5 70
spécificatif {
adjectif. Exemples
nom
il m'a
et
frappé de
il m'a frappé
classe le
,
J."p.)
:
deux coups.
en me
perçant.
,
$6
DE
LA
SYNTAXE.
Je l'ai
Dans les deux
douloureux.
frappé d'un coup
premiers exemples
le
,
d'action
nom
est em
ployé <>^j=>liçU pour donner de l'énergie ; dans le troisième,
non d'unité i f<i*Jaf
pour numération ; dans le quatrième
,
comme
comme
spécificatif j^ljUJ pour spécifier ; enfin dans le cinquième,
comme simple nom d'action
py^jJ pour qualifier.
2.°
Jj*à* ou simplement Jj*iû le patient; c'est l'objet de
l'action, le véritable complément objectif du verbe. Exemple:
Vjlp o^i j'ai tué Amrou. Si le verbe a plusieurs complémens
objectifs on les distingue en premier et second patient Jj f Jjiài
et qL> J^**?
Exemple : L^cû^ \jl±. £)L£c ££*l»\ j'ai fait man
nom
*->
,
,
,
.
ger à Othman du
en
pain empoisonné. Certains verbes peuvent même
jusqu'à trois suivant la manière de parler des gram
Arabes (n.° ii4). Exemple: L^Il'^fUÊf J«lljf ^jj
avoir
,
mairiens
il fera voir
hommes
(que) leurs œuvres (sont) mauvaises.
3«° %è Jj*** patient dans lequel, c'est-à-dire, complément qui
aux
,
le lieu,
exprime
pliait (jfjk
dire,
terme
ou
vase
de
le temps de l'action
lieu,
et
yl*j}\ ^jf&
circonstanciel dé lieu
ou
on
;
vase
de temps
le
nomme
aussi
de temps, c'est-k-
(n.os
107
et
100).
AL\ qa ^ysU patient à cause
Jjaiu
duquel; c'est-àterme
dire ,
circonstanciel exprimant le motif de l'action
1 2 1
4. *J
ou
(n.°
Ex.
:
*J
^!>£=J *ëU»X Jj oûJà je suis sorti au-devant
j.
de lui pour
lui faire honneur.
j .° î^>
tanciel
Jjiai
patient avec lequel, c'est-à-dire terme circons
exprimant la personne ou la chose qui a pris part k
l'action. Ce
signifiant £
ft^jj
,
complément exige l'emploi
avec, et
ô*a^> U
de la
gouvernant l'accusatif
qu'as-tu fait
avec
conjonction j
(n.° 98) Exemple:
.
Zeïdl
171.
DE
LA
171. Par la manière
dont
suiv.)
*j
Jj*iû
97
envisagé
nous avons
tous
circonstanciels comme des formes adverbiales
plémens
et
SYNTAXE.
il
,
ne nous
ou
reste à
considérer ici
,
les
com
(n.os 1 o4
que le
soit immé
plus en détail,
véritable complément objectif du verbe ,
préposition soit médiat et avec l'intermède d'une
prepo:.itiô'n. Nous parlerons ensuite du complément des noms
ou du
rapport nommé *-*U»J annexion ; et enfin de ce qui con
cerne les
complémens des noms d'action et des adjectifs ver
diat
et sans
,
,
baux.
CHAPITRE
IX.
Complépiens objectifs tant immédiats que médiats
des Verbes et, des changement qu'ils éprouvent quand
Des
,
les verbes passent
172. Nous
tion
et
,
,
distingué les
complémens,
nous avons appelé
susceptibles
ment
la voix
leurs
avec
i.T€ p.)
avons
a
d'avoir des
c'est-à-dire
sans
,
objective.
verbes , à raison de leur rela
transitifs et intransitifs (n.° 224,
verbes transitifs tous ceux qui étant
en
complémens
l'intermède
observé aussi
les prennent immédiate
d'aucune préposition,
,
qu'il y a des verbes
doublement transitifs, c'est-à-dire, qui, étant susceptibles de
deux complémens les prennent tous deux immédiatement.
173. Le complément d'un verbe transitif et les deux com
plémens d'un verbe doublement transitif sont toujours à l'accu
satif (n.os 84 et 8 5 ) Quand le complément objectif d'un verbe
transitif est placé par inversion avant le verbe, on indique alors le
plus souvent le rapport par la préposition J. Exemple : rULi^jf
Îj*j**-> Ujy^! si vous interprète^ cette vision (a).
Nous
avons
(n.°
225, i.rt p.)
,
.
(a)
Cet
exemple
est
tiré de l'AIcoran,
//.' PARTIE.
sur.
12,
v.ff;
et
Beïdhawi remarque,
G
p8"
174.
SYNTAXE.
LA
DE
pourroit, comme je l'ai dit ailleurs (n.° 128),
considérer tous les complémens des veïbes transitinV comme dés
complémens circonstanciels exprimés sous une forme elliptique
On
l'observation que je viens de faire sur ce
lieu dans le cas d'inversion, fortifie singulièreitient cette
ou
adverbiale
qui
a
et
;
manière de voir. Mais ,
la théorie de
quoique
des
idée
cette
paroisse simplifier
pas éloigner de la
me
pour
l'usage
cette
partie de la syntaxe je con
d'envisager
sidérerai ces complémens' comme des complémens objectifs
placés sous l'influence directe du verbe influence qui est indi
cas
me
ne
,
manière ordinaire
,
,
,
par l'accusatif.
175. II n'y a que
quée
apprendre quels
l'usage
sont entre
et
les dictionnaires
les verbes
ceux
qui puissent
qui gouvernent immé*
diatement leur
ment au
complément , et ceux qui le gouvernent médiatemoyen d'une préposition. Le même verbe peut être tran
sitif dans
une
acception
et
,
verbe intransitif peut aussi
varier
prépositions
d'exprimer la
son
complément. Ainsi
,
et
sa
manières
intransitif dans
se
lier à
signification
à raison de
du rapport
nature
Le même
une autre.
complémens
ses
qui
par diverses
différentes
ces
est entre
ki
et
ji ~jk.se ré
ô-çjï signifie
^ j~j± être hors de..., n'être pas susceptible de ;
4! é^" Partir Pourallerà'
JtJ 'JLI signifie entrer dans, un
lieu, ou chei une personne; Ji Ji.S surprendre quelqu'un en
volter
contre
.
.
sortir de ;
.
...
...
entrant
dans l'endroit où il est, &c.
n'appartiennent point
176.
à
cette
cèdent
«
»
II
convenable de considérer
Jj-UJf «-jyiij
se
,
«
i
sa' force
fait pour le
Des. détails
est
nom
car
objet
cet
moindre
»
ce
qui
arrive
aux.
ici pour
fortifier l'influence de Vantéle verbe,
ajoute-t-il, est mis après1 son
J est
quand
d'agent.
sur
grammaire.
occasion, que la «préposition
complément
cela
est
à la
,
et
on
le
fortifie
au
moyen de
J
,
comme
DE
verbes transitifs
de la voix
et à
leurs
subjective
177* Lorsqu'un
SYNTAXE.
LA
5>p
complémens quand ces verbes passent
,
à la 'voix
objective.
verbe transitif
à la voix sub
employé
est
jective d'une manière relative, il y a nécessairement un sujet in
diqué implicitement ou explicitement un verbe et Un compiément objectif
comme dans ces
propositions «jjJj (jlLÛJf Ju>
le sultan tua son v'iiir ; olà.f Jus // tua son frère. Dans la première,
le sujet est exprimé explicitement ; dans la seconde \ il se trouve
implicitement dans le verbe.
178. Si ce verbe passe à la voix objective, le sujet disparoîtra ,«et le complément objectif prendra sa place. On dira :
j-tj^ J^5 ou (jlililJl jjjj Jiàj' le vijir ou le vijir du sultan fut
,
c j
-
j
.
te
,
tué;
jUZJUJf y>\
du verbe
ce
qui
jxs le frère du sultan fut tué. Dans
plus J*li
l'agent.
agent, mais
ne se nomme
tient lieu de
I7Q. Tel est,
je l«ai
comme
dit ailleurs
cas, le
ce
sujet
JcUff ^ooUJf
(a),
le
principal
usage de la voix objective : c'est de pouvoir exprimer une action
en ne la considérant
que par rapport à celui qui en reçoit l'imfaisant abstraction du sujet. Si l'on veut ne pas faire
abstraction totale du sujet , mais seulement fixer principalement
pres$on
,
et
l'attention" sur la personne
et
qui
sous
en
reçoit l'impression
la forme d'un
sition
,
et
ou
dire le
de construction
terme
vijjrfut
,
la chose
on
qui
l'objet
de l'action
peut ajouter le sujet
circonstanciel
tué PAR
est rare en
est
LE
,
au
ou
moyen d'une
sultan
:
mais
ce
agent
prépo
genre
arabe.
IoO. Le verbe
plus,
comme on
transitif, en passant à la voix objective, n'a
voit, de complément objectif. 11 n'en est pas
de même des verbes doublement transitifs. Ceux-ci
(a) Voye-^
mes
Principes
de
grammaire générale,
z.c édit. p.
conservent
212
et suiv.
G
2
DE
IOO
SYNTAXE.
LA
complémens sous la forme de complément
tandis que ïe premier devient le sujet de la proposition.
Ainsi l'on dit, àja voix subjective: U^wi $\S> *jr>jj QLkuJf jil.
U sultan donna à boire à son vl^ir de l'eau empoisonnée (à la
lettre abreuva son viçir d'eau empoisonnée ) ; et à la voix objective
ïe second de leurs
,
,
,
L^lcÛvi U Jjjj-Ji JH» h vlVr reçut pour boisson une
(à la lettre,^/ abreuvé d'une eau empoisonnée).
t
eau
empoisonnée
subjective : fj-sfc^ Çjj' f>£ o^'j J&l
habit magnifique ; ^CA^=> *^p <J»y Jf
On dira de même , à la voix
Zéid
gratifié
a
Aio'ise
dira
:
a
Amrou d'un
apporté
un
livre à
ÎJ-isJ» IJJp ,J£ ^Lf
son
peuple.
Amrou
a
été
A la voix
gratifié
objective
d'un
,
on
habit%iagni-
peuple de Ado'ise a reçu un livre (a).
8
s'explique tout naturellement en
considérant le second complément comme un terme circonstan
ciel exprimé sous une forme elliptique ou adverbiale ; mais si
l'on veut le considérer comme jm second complément immé
diat du.verbe il faut, pour développer ïe sens contenu dans ces
propositions tant actives que passives et se rendre raison du
double complément de ces verbes observer qu'ils renfertient
l'équivalent de deux' propositions l'une principale et l'autre
subordonnée qui ont chacune leur sujet et leur attribut. Dans
chacune de ces propositions le verbe est relatif, c'est-à-dire
qu'il a un complément objectif, mais de telle manière que «le
complément objectif du premier verbe est aussi le sujet du
second. Dans l'expression arabe, un seul verbe, réunissant les
fique ; Çllf^j-* *JJ jjf
1
I
.
le
Cette construction
,
,
,
,
,
,
,
,
attributs* des
(a)
On
deux
pourroit trouver
Et
Mais
cette
dont ij
sujets, gouverne immédiatement
manière de
s'agit
,
est
une
mutata
construction semblable dans
suos
s'exprimer
requierunt jlumina
est
la même que celle-ci
plutôt
:
un
ce vers
les deux
de
Virgile:
cursus.
hellénisme. La construction
Ab Mo edocti
sumus
musicam.
DE
LA
IOI
SYNTAXE.
superflu d'exprimer séparément lé sujet
delà seconde proposition, qui n'est autre que le complément
du premier verbe»: ainsi Uj^ tàbJf ojd>f est l'équivalent de cette
phrase : J'ai mis ton fils en cet état que ton fils a mangé de la
viande ; c'est-à-dire j'ai fait que ton fils a mangé de- la viande.
Le sujet de la première proposition est je l'attribut est ai mis
le complément objectif du verbe est ton fils: ton fils est aussi
le sujet de la seconde, proposition ; a mangé est l'attribut de cette
seconde proposition; de la viande est le complément objectif
du verbe a mangé. Or le verbe o*jJ»Î renfermant l'idée des
deux attributs ai mis et a mangé, c'est pour cela qu'il gouverne
Immédiatement les deux complémens.
182. Le verbe transitif, en passant à la voix objective
cesse
comme nous l'avons dit, d'avoir un
complément; il cesse
donc en quelque sorte d'être transitif.
complémens
;
et
il
est
,
,
,
,
r
,
,
,
Mais
sî le verbe
,
passant à' la voix
par
conséquent
tir la
dessus
est
,
est
objective
,
un
de
et nous verrons
transitif,
ses
il devient
raison, reprenons
,
doublement
simplement
l'exemple que
deux
il conserve,
complémens
transitif. Pour
nous
avons
que des deux verbes
,
,
en
et
apporté
dont le
renfermé dans le verbe doublement transitif , if
,
en sen
n'y
ci-
sens
en
a
qu'un qui passe à la voix objective. UJk cèlXf £>Ï*L\
l'équivalent de j'ai mis ton fils en cet état que ton fils a mangé
de la-viande ; L*k CêSi\ Iai»f est l'équivalent de ton fils a été m'rs
en cet état,
qu'il a mangé de la viande. Par le développement de
cette expression on voit
que tomfils, qui dans fa premrcre pioposition, étoit le complément objectif du verbe mettre, en de
vient le sujet: mais de la viande, complément objectif du verbe
manger dans la première proposition ne change pas de nature
par le changement de voix ; il demeure complément objectif du
verbe manger, et voilà pourquoi en arabe il reste à l'accusatif.
réellement
est
,
,
,
,
DE
102
183.
LA
SYNTAXE.
H est bon de faire ici
jT
une
observation
particulière
sur
objective Jj t qui revient fréquemment
dans l'AIcoran, comme dans cette phrase : Cji£J\ Jjjjf ^>.S3\
ceux
qui. ont reçu le livre. Le-verbe Jf venir a pour complément
objectif le terme vers lequel on vient. Ce complément, objec
tif qui en latin et dans beaucoup d'autres langues s'exprime
est lui-même en
par une préposition suivie d'un complément
le verbe
,
et
,
à la voix
,
,
,
,
,
,
arabe le
complément
immédiat du verbe
et se met
,
par consé-
(cheç) moi. Ce
même verbe à la quatrième forme doit signifier ftire venir,
apporter; et par cette raison il reçoit deux complémens objec
tifs celui qui exprime la chose apportée et celui qui exprimé
la personne ou le lieu qui est le terme de l'action et il gou
verne ces deux complémens à l'accusatif. Cette explication suffiroit pour rendre compte des phrases dans lesquelles cette
quatrième forme est employée à la voix subjective ; mais elle
quent à l'accusatif:
Cèjà*\ t>Lïf
ton
frère
est venu
,
,
,
,
,
seroit pas suffisante pour rendre compte cle celles dans
lesquelles elle est employée à la voix objective. Pour avoir une
ne
solution
générale applicable
quatrième
avec
forme du verbe
jf
à foutes les circonstances où la
se
trouve
deux accusatifs , soit à la voix
faut avoir
égard
fications que
ce
à la
génération
verbe
a
reçues,
,
soit à la voix
objective
avec
subjective
un
seul il
successive des différentes
faire venir,
c'est
,
signi
à-peu-près la
'*
même chose
qu'amener, apporter; apporter quelque chose à quel
qu'un est une expression très-souvent synonyme de donner ; et
dopner^fuelque chose à quelqu'un, c 'est faire qu'il prenne ou qu'il
reçoive cette chose. Appliquons ce développement à quejqua
exemples : l^Ui%lJl>u( Dieu leur a donné un livre ; cela est
équivalent à Dieu lésa mis dans cet état, qu'ils ont reçu un livre.'
Autre exemple : ^•Udg J>£J
g J^jf^'i JLtf ^7^ celui qui
a donné de
l'argent à ses païens, aux orphelins. et aux pauvres, est
,
LA
DE
*0}
SYNTAXE.
ont
l'équivalent de celui qui a mis ses parens &c.en cet état, qu'ils
reçu de l'argent.
Prenons un exemple semblable à la voix objective.
ôUpf f^l Nous avons vu que la phrase active qui répond
à celle-ci, étant développée, signifie: Dieu les a mis en cet
état, qu'ils ont reçu un livre. En employant la tournure pas
sive le complément objectif du premier verbe doit en devenir
le sujet, et le sujet doit se changer en complément. La pro
position subordonnée ne doit éprouver aucun changement, et,
,
,
par conséquent
le verbe recevoir doit
,
conserver son
sujet
arrive ici
et
en
;
complément. C'est effectivement ce qui
on
trouvera
qu'elle signifie :
développant la phrase passive
Ils ont été mis en cet état qu'ils ont reçu un livre ; et voilà
comme
pourquoi ÇU/"'est à l'accusatif dans la phrase passive»,
dans la phrase active. Autre exemple : L_ij <j»*£j cs»j-* ây *-*
son
car
,
,
,
'fij
&■
ôjrp^ *?5''
prophètes ont reçu
a
4™ ^°ÎSe
JéSUS
€t
de la part de leur
°nt
nÇU'
£t CC
t"* ^
Seigneur (a).
signification faire venir, qui est la
forme on ne pourrait pas rendre
quatrième
Signification primitive
la voix .objective.
raison des phrases dans lesquelles ce verbe est employé à
eos
liber
venit
forme,
pour ad eos
Effectivement, si l'on dit, à la première
ou ïta ut veniretad
venire
librum
Deus
on doit dire, à la quatrième forme,
fecit
'eos. et par conséquent, à la voixobjective.de cette même forme, Uber factus
si c'étoit-là le développement
est à Deo ira ut veniret ad eos. Or on voit que
de la phrase passive, ce ne seroit pas liber, mai? eos, qui seroit le complément
liber qui dans
objectif du verbe venire de la proposition subordonnée; que
la proposition active seroit le complément objectif du verbe fecit de la proposi
le sujet du même
tion principale, deviendrait, dans la proposition passive
en
sorte que la pcoverbe, et que par conséquent, il seroit mis au nominatif ;
(a)
J'ai dit que si l'on s'en tenait à fa
de cette
,
,
r.
,
,
,
position
passive devroit
Ce n'est pas
être
gratuitement
t_>]U£p fer**
que
>
je suppose
•
que
£\
,
signifiant donner quelque
G4
104
84-
I
J'ai dit
précédemment qu'il y
complément un sujet et un attribut
pour
et
SYNTAXE.
LA
DE
dont Ia^réunion semble former
taire
LmJ
^l—ili
comme
,
ils
^jjtxlf f^tjo-f
passent à la voix
ont
la
pris
culté
circonstanciel
un terme
I
8^
(n.°
Parmi ces* verbes
•
que Zéid étoit sage,
pour jouet. Si
ne
,
verbes
ces
proposition complé
doit faire
considérant, ainsi que je l'ai fait,
en
,
cru
religion
mentaire demeure à l'accusatif. Cela
ont
deux à l'accusatif
tous
l'attribut de la
objective,
qui
proposition complémen
une
^LjJo- j'ai
fo^jj
des verbes
a
cet
aucune
attribut
diffi
comme
i4)«
i
il y
qui sont doublement tran
voix objective, ils conservent
en a
sitifs. Quand ceux-ci passent à la
un
complément complexe formé d'un
sujet
d'un
et
attribut,
ou
plutôt un complément immédiat et un terme circonstanciel ellip
tique, qui est une véritable proposition adverbiale Kn.° 1 1 j).
Exemple : *J^^ XîU£f *JtJf &jj.j Dieu leur montrera leurs 'œuvres
mauvaises; pour *%aà
Igjf kJL£ f
UJf
^-Jj4 Dieu leurfera voir leurs
clair que XJUpf leurs œuvres
qu'elles
une
de
la
partie
proposition distincte de Is^L mau
vaises, puisque, si ces deux mots formoient une seule partie de
la proposition, il faudroit dire jLiLp^AJl^f ; car Jll£[ étant
r
mauvaises. II
sont
œuvres,
est
constitue
,
"
-
~
j
•
>
1
t
1
détermine par le
<>j
.
complément
le fût par l'article
jectif
chose à
quelqu'un,
reçoive
et
£
,
il seroit nécessaire que l'ad
J f Supposons
.
étant doublement transitif
quelque
chose
cela
,
que
cette
équîv aut
proposition
k faire que
quelqu'un
J^f, qui est le verbe
la quatrième forme de
propre pour signifier donner,
~j£ qui signifie
la
recevoir.
main
Ainsi
la signification
prendre
propre de fjcil est faire
prendre faire recevoir. Il est m|me vraisemblable que gf dans le
fo donner,
doit
origine mot J&\ mal prononcé: car, parmi les nations mêmes àqui
ou
prenne
;
est
si
vrai, que
est
,
avec
,
,
,
la
langue
sens
au
son
arabe
est
nonciation du aïn
naturelle
avec
,
celle de
il y
a
Vélif.
beaucoup
de gens
qui confondent la pro
'
DE
pjjsse à la voix
objective ;
on
105
SYNTAXE.
LA
dira iuU-^
.j£JUÉf q^j
voir que leurs œifvres sont mauvaises.
186. Ce n'est pas seulement le véritable
leurfera
on
ob
complément
jectif ou JJljC* (n.° 170) des verbes transitifs à la voix sub
jective qui peut devenir le sujet des mêmes verbes quand ces
verbes passent à la voix objective 11 y a quelques complémens
ou termes circonstanciels
qui peuvent devenir sujets de la pro
position lorsqu'on lui donne la forme passive.
1
87. Un de ces complémens est le nom d'action du verbe
lui-même, nommé jjJLi et ^iXS Jj*à* (n.° 170); car, au lieu
que l'on dit à la voix subjective ^Cf^ £>y° il a frappé en frappant
*j
,
,
,
,
ou
un
par
marche,
coup,
on
été frappé ,
[88.
YJ^'JC
il
marché
a
une
marche
marchant
ou
objective, <Sy° Ciy°
peut, dire, à la voix
J*»j~>?
en
a
par
un
une
coup
a
été marchée.
complément que l'on peut employer de la
même manière est celui qui indique l'action par une circons
tance de temps ou de lieu qui en est inséparable ; c'est le
jui
<JyjC> nommé aussi yUpf^ (j>U=Uf cj>k (n.° 170). Ainsi
comjA l'on dit sous la forme active CyJ fj^s jll // marcha
Un
autre
,
,
,
un mois et un
jour, Ju5L>
dire aussi
sous
jour furent
marchés
SLCofjL,
la forme
,
iu"ib
passive
// marcha trois milles
:
J^fJ^.
pj-lSjjJçà JL^
un
,
on
mois
peut
et un
trois milles furent marchés
(a).
Enfin il y a une troisième manière d'employer les
verbes à la voix objective, c'est de ne leur donner aucun sujet
1
8p.
déterjniné
;
alors ils
se
absolument de la même
(a)
dam
et
Archiâ
C'est ainsi que Cicéron
constipent
manièrf qu'à
a
dit
:
leurs
complémens
subjective.
Cette
Hune video mihi principem et ad suscipienhorum studiorum exstitisse. (Orat. prQ
ad INGREDIENDAM tationem
poetâ. )
avec
la voix
106
DE
SYNTAXE.
LA
de construction n'a lieu que par rapport aux complémens
médiats des verbes , complémens -dont le rapport est indiqué par
sorte
On peut comparer cet usage de la voix objec
tive à celui de la même voix chez les Latins , quand elle est
une
préposition.
employée de la manière vulgairement quoiqu'improprement^
appelée impersonnelle comme, itum est, ventum est, conclamatun
Comme donc on dit, à la voix subjective jlL } ^
£^>>J il a eu
besoin d'argent, jyu ;ULf ^y» ^-jà- il sortit de la ville, ou) ^é ù*ôà
,
,
,
il
colère
entra en
«JU» /'/ dit cela
arrivé
on
,
déterminé
,
*
c—'
-
contre
-
dira de même
à
,
j^Li ^ iwC-â.f
-
il lui rendit compte de
qui étoit
la voix objective sans un sujet
o^—
*X>olU ^» -rj-=»
j3 ci* 4>4*
par la voix
objective
,
terminé. Ainsi il faudra dire
devint nécessaire ;
entra en
ou
l'ordre
compte
ou
1^0.
pu
colère
de
fut
on
donnant
en
,
:
On
eut
sortit de la ville,
la colère s'alluma
ou
donné de le tuer;
an
au
pourra rendre en
la voix subjective;
verbe
besoin d*argent ,
la ville
ou
Zéid ;
contre
dit,
ou
il
qui
,
étant
transitifs par rapport
sujet
un
on
ou
donna iordrt
fut dit;
à
dé
l'argent
fut évacuée; on
le compte fut rendu de ce qui étoit- arrivé.
Tous les complémens médiats des verbes
ceux
ce
-
*4-^*J j^~ J**- 13—V ^4. j**^ *• ce qu'on ne
françois que par le sujet indéterminé on, avec
ou
-
Zéid, *LJù J*\ il donna ordre de le tuer,
j;JÂ.-L* oj.Zà.f
,
-
un
o%vndit
^
intransitifs,
de leurs
com
intransitifs par rapport aux autres (n.° 22 5, i."p.),
plémens ,
se construisent avec la voix
objective de même qu'avec la voix
sont
subjective.
Ainsi
,
comme
IWdit,
à la voix
j
1
,
subjective
1
jj-f lH*W '<>rf) o>*l
J'ai ordonné à Zéid de
Il conduisit Zéid de
tuer
Bagdad
Amrou ;
à Médine;
,
.
Z* jW/tf//
O/irar
on
/;*//• /jat /**
prophète quelques
amena au
dit de même
«?
Zéid
a
Il
On
amena au
hommes d'entre les
reçu l'ordre de
Zéid fut conduit de
tuer
Bagdad
fut impossible
prophète quelques
prendre;
la voix
employant
en
,
de le
des
objective
Arabes;
:
Amrou ;
à Médine ;
prendre ;
hommes d'entre les Arabes
CHAPITRE
Syntaxe
I07.
SYNTAXE.
LA
DE
(a).
X.
Complémens
des Noms.
Les rapports qui ont lieu entre les noms, et que les
Arabes nomment *Jw»l annexion, influent sur la forme exté10 T.
rieure des
noms
complémens
(a)
de
C'en .ainsi
qu'on
\Jû.y.J,\ ^JlLmJJj
envoyé;
qui
ces
sont
les antécédens et, les
rapports
,
et sur
lit dans l'AIcoran
certes,
nous
r
ajjf
Jlwjf ^~jâ3\ ^lZZjJlS
à
ceux
vers
pareillement
qui
ad eos] est une construction pareille
[missum
fuit
JjCJf Ju.jf
voix subjective A^Jf UJUAf [misimus ad eos].
et, certes,
nous
ou
signification.
demanderons compte à
demanderons conipte
conséquens
leur
ceux
lesquels
ont
on a
été envoyés.
à celle de la
CI08
DE
10,2. Leur influence
les effets suivans
:
SYNTAXE»
LA
la forme extérieure consiste dans
sur
i.° U antécédent
les
voyelle nasale; car,
avoir place qu'à la fin
•ou
<jU* perd son tanmn
nasales ne pouvant jamais
Ou
voyelles
des
mots
,
les deux
et
mots
seul
faire
qui
sont
,
le pre
se
décline
qu'un
voyelle nasale. Au duel,
perdre
et au
pluriel régulier masculin Fannexion fait perdre à l'antécé
dent la syllabe q ou q Je renvoie à cet égard à ce que j'ai
dit ailleurs (n.os 738 et 739 //' p.). Si le complément, est un
autres
changefnens
pronom affixe cela donne lieu à quelques
comme
dans les inflexions de l'antécédent
je Tai exposé en
son lieu-,
(n.os 806 et 807 //'/?*)*
en
annexion
étant censés n'en
,
mier doit nécessairement
plus
sa
,
.
,
,
,
,
,
,
2.0
Si l'antécédent
en ce cas comme
3.0
Le
I93.
conséquent
de la seconde déclinaison
noms
<JJf
L'influence de
que l'antécédent
en ce
de la
cjll*
ce
qui
,
il
première (n.°7 38 T.i.re p.).
au
génitif (n.° 66).
doit être mis
même rapport
le
sur
étoit indéterminé
sens
©JXIj
,
consiste
devient dé
qu'il ne doit point avoir d'article
déterminatif. Mais ceci exige quelques distinctions ; car le rap
port d'annexion ne produit pas toujours cet effet sur l'antécé
dent qui dans certains cas reste indéterminé.
I o4« Pcftir connoître quelle
règle on doit suivre à cet égard,
l'on
il faut savoir que
distingue deux sortes d'annexion nom
mées l'une annexion pure ou parfaite ïÀLê «jUU
et annexion
logique ï^J^» iiu=f ; l'autre, annexion imparfaite iûù£^ «J^j)
et annexion
purement grammaticale f^àsj *jLï>f
terminé
'
les
est
*JjÂi
,
;
d'où il suit
,
,
,
,
,
,
,
.
L'annexion
parfaite exprime ou un rapport de propriété j?Ui^i.ôU dont la préposition J à pourroit êtrel'expor
sant, et dans lequel le conséquent est absolument différent de
l'antécédent, comme celui-ci £jJ *3U l'esclave de Zéid; ou
I
p^
.
,
,
,
DE
LA
SYNTAXE.
rapport du genre à
un
I0£
la
l'espèce {j*LM dont
l'exposant et dans lequel
être
,
pourroit
partie du conséquent
s'oie o^i Hâa. une boîte
,
comme
,
ceux-ci
,
préposition ^
l'antécédent
>?>»» uy
est
de
une
robe de
une
d'or.
Quelques grammairiens admettent
représentant la préposition
j dans. Exemple : j4^ Ay° un jeûne d'un jour.
1 06. Dans l'annexion parfaite l'antécédent est ordinairement
,
aussi le rapport d'annexion
comme
,
,
indéterminé
un nom
l'effet de leur union
ces
exemples j-Îf
:
ma sœur
le
et
,
et
,
est
le
conséquent
un
nom
déterminé
de déterminer l'antécédent
comme
,
*"ïU. l'esclave d' Amrou, Jso. \ L*\la
; et
dans
servante
de
QUâLJf^jjj le viyir du sultan. Quelquefois l'antécédent
conséquent sont
d'état
indéterminés
:
alors l'antécédent
demeure indéterminé
*Uî
change
J4j ï*î>*f
ne
point
femme d'un barbier, Jliu jl>* un âne d'un marchand d 'herbages
JU uaL» un possesseur de richesses. Dans ce cas, quoique l'anté
cédent ne devienne pas déterminé ^jj^> il perd cependant
quel
et
,
,
comme
une
,
,
que chose de
(a)
On
sent
£un jardinier
,
signification
sa
,
,
qu'Ebn-JVIalec exprime
Retranchez le
noun
dans l'antécédent de
»sina,
il devient , suivant les
en effet,
que ces expressions un vi^ir d'un sultan un âne
moins vagues que celles-ci-, un viçir un âne g mais ne sont
individualisées, comme si l'on disoit le vijjr du sultan , l'âne
\ll M «sus vj x^j
«
et
bien,
sont
pas déterminées et
du jardinier. C'est ce
»
vague (a) ,
le
ou
tout
ainsi dans
son
Aljyya
■
:
fj isj j jl ^ ^yjJ'ètàj
le tanwin
qui suitfcla voyelle caractéristique
rapport d'annexion
,
comme
dans
des cas;
l'exemple
touri
conséquent au génitif: sous-entendêz de, ou dans, quand
cette préposition est la seule
qui convienne; dans tout- autre cas sous-entendez
à et rendez l'antécédent/wrrtra/dr/i/ou déterminé
par le conséquent.
Ar.
de
la
Bibl.
(Mss.
imp. n.° 129, f. 17 recto; et Mss. de S. G. n.° 465,
f. 102 rect». )
et mettez
<
»
,
»
,
»
.
LA
DE
1 10
SYNTAXE.
particularisé iy^>^ Jamais l'antécédent
ne
peut avoir l'article déterminatif (a).
107. L'annexion imparfaite est celle dans laquelle l'anté
cédent exprime un attribut une qualité et est ou un adjectif
verbal ( n.° 617, /." p.), ou l'un de ces adjectifs que l'on
appelle *-§li* ïXf qualificatifs assimilés (n.°62i 1." p.) et
grammairiens
Arabes
.
,
,
,
,
d'un
le
f
verbe,
le
sujet
complément
Exemple : <>jJ ^>J^° à la lettre,
un
frappant de Zeïd; c'est-à-dire un homme qui frappe Zàd. Ici
cj>jU> fait la fonction de verbe et c^j celle de complément
objectif du verbe. L'expression conforme à l'analogie grammaticale seroit donc fouj Mj*"^ un frappant Zéid, et le rap
port d'annexion tient ici la pl;ice du rapport de l'agent a
l'objet de l'action ou ce qui est, la même chose du verbe J*j
le, conséquent est,
dcint l'antécédent
ou
est
l'attribut.
ou
,
,
,
,
(a)
Tel
,
,
le sentiment des divers
est
grammairiens Arabes que j'ai consultés,
de tous les écrivains anciens : mais j'ai
je
l'usage
remarqué dans divers auteurs moins anciens, tels que Makrizi, Soyouti, Abou'Imahasen,^c. un grand nombre^ d'exemples contraires à cette règle, et dans
lesquels l'antécédent et le conséquent ont l'un et l'autre l'article déterminatif.
et
tel
est
aussi
,
crois
constant
,
Je n'ai observé cela que dans, les rapports de la chose à la matière dont elle
faite , comme ceux-ci la boite d'or la croix de bois. Exemples :
,
est
,
,
Des billots de bois.
Il lui ordçnna de
vérifier ce que. l'on fabriqitoit de
[ le jfcudi saint ].
";,»,
kharoubasK d'or pour les distrik-
fions du jeudi des lentilles
1î*^°j &S^^ ci <->f^f gLJJjf ^4*^ M^ljf ljZXi fjjLÙi\'J^\J
^^ &V; x*£j cJ^:Jt Jflj*=>j ôj&. ô'j £& v^=j tf
7/
enjoignit
aux
Chrétiens de porter des vêiemfhs noirs
des croix de bois; il leur fut
de
ne
mettre
défendu de
que des selles de bois
sur
,
et
de suspendre à leur cou
Servir de chevaux pour monture,
les mulets et les ânes
qu'ils monteraient.
se
et
ordonni
DE
à
son
LA
complément objectif
ia'J\ (j-uâ. Jaj
un
SYNTAXE.
tu
I I I
JyùC (nF 170).
homme beau de
visagt.
Autre
L'annexion
exemple:
entre
l'ad
jectif beau et le nom visage tient ici la place d'un rapport dans
lequel le nom visage seroit le sujet ou *\o&+ et l'adjectif beau
seroit X attribut J**. L'expression conforme à
l'analogie gramma-.
ticàle seroit donc ,j-ûâ.
un homme dont le
*-<gJLj J4.J
visage est beau,
ou*l^4-j ^jl^. JLj un homme beau quant au visage.
,
.
I^>8.
sur
Cette
espèce d'annexion
l'antécédent, qui
n'a
demeure dans
aucune
influence
logique
signification vague et in
lors
même
le
,
que
conséquent est déterminé , soit
de sa nature , soit par l'article Jf Si donc l'on veut déterminer
l'antécédent , il faut lui donner l'article. On dit donc :
sa
déterminée
.
Ceux
ù ^r yjt <j
Celui
de la
qui s'acquittent
ojULf f
la tête du
qui frappe
prière.
pécheur.
«-a.JJf ^j^Ji- O^J£
Mohammed le beau de visage.
o
•>
e
Une victime
Ce dernier
ce.
exemple
genre d'annexion
car, si
£JU
'
qui
,
ne
t"°
J
$
arrive
pris
jusqu'à
la Caba.
de l'AIcoran
rend
point
prouve bien que
l'antécédent déterminé ;
,
eût été déterminé par le complément C^SZJl
fallu que le nom 4** le fût aussi par l'article.
Une autre preuve dqgcette vérité , c'est qu# l'on
,
il auroit
peut
mettre
espèce d'annexion après, la particule <lj qui ne souffre
jamate à sa suite que des expressions indéterminées. Exemple :
jSJi JJj içMJu f çfjA JiV l A-kâ U*». \J Cij ily a beaucoup de gens
cette
,
LA
DE
112
dont le
leurGpoir, qui ont conçu de grandes -espérances,
en nous
qu'Cmettent
cœur est
SYNTAXE.
troublé pmr
l'effroi,
dont
l'esprit
est
peu
fécond' en
ressources,
Les quatre rapports d'annexion que contient cet exemple,
ne peuvent être qu'indéterminés , puisqu'ils sont dans la dé
de
pendance
Çij
.
.
.
Mais il faut observer que , pour donner l'article 'J f à l'antécé
dent, il faut que le conséquent soit lui-même déterminé pa,r cet
article,
ipUJf [y^-if ou que le conséquent soit
rapport d'annexion complet dont le second terme
comme dans
lui-même
un
ait l'article
,
,
à\S4\ ,»fj djjUJf ; ou enfin que Fajiduel ou au pluriel
comme
t\->J UjL*Jf et
ne
au
peut pas dire
singulier, avec l'article,
comme
dans
-
-
-
■■«„,,
técédent soit
"°
-
oj)
*
au
lyjULff
.
On
"°
,
ojLJLfî ; avec les affixes, cela peut avoir lieu. On dit bien
(àlijCc et éLjjllJf Je reviendrai tà-dessus dans peu.
i\jJ
.
C'est
IOO.
les deux
un
termes ne
principe général di^apport d'annexion,
doivent pas être identiques c'est-à-dire
que
,
que
doit pas être , sous le même nom , ou sous
un autre nom , la même chose
que l'antécédent. On ne doit pas
non plus établir un rapport a"annexion entre deux mots qui
le
complément
ne
forment par leur réunion que le
d'un seul
unique
être,
adjectif,
adjectif
qu'il
Ces
sortes d'annexion ont lieu
qualifie.
cependant quelque
fois ; mais elles doivent s'expliquer par des ellipses. Exemples:
ne
entre un nom et son
nom
et
ou un
le
et
nom
jjS=> ivç*-^ Saidde besact, c'est-à-dire, Saïd (surnommé) besace (a):
(jz&£ pj
le jour du jeudi
(a)' Voyei ci-devant
(b)
Cette
n.°
j6
,
c'est-à-dire
et
,
le jour
ibid.
(nommé) jeudi' (b);
(a).
espèce de rapport est nommée *J } \jn J) ^j $ Jj^jf jiJ&f annexion
,
pages 44
f;
,
et
note
DE
^jVf
is\>U» /#
prière
SYNTAXE.
LA
I I
3
de la première* c'est-à-dire, la- première prière ;
<L*ll£ <j^£ «« wr/ <& turban c'est-à-dire
,
Pour
,
«72
turban usé.
développer ces constructions il faut considérer ces expressions elliptiques comme l'équivalent de celles-ci : JXU o»*~
jj£j Sa'id nommé du surnom de besace; ^^x^U JJéi»JL\ ^J\ le jour
,
é^Vf *éuJf ïsX^ la prière de la première
Aw*; &L£ ^0 <Jk ,^£- z//ze rAoj^ z/j& ^ /# nature) de turban,
200. Cette dernière construction dans
laquelle l'adjectif, ou
nommé du
surnom
de jeudi ;
,
fait la fonction ,
est en rapport d'annexion avec
qui
et
le
qu'il qualifie
prend pour son complément est d'un
usage assez fréquent, et elle opère même une sorte de déter
mination imparfaite du nom qui sert de complément (n.°
196),
C'est ce qu'on sentira mieux par quelques exemples. Exemples :
un nom
le
en
nom
,
La chose
qui plaît
,
le plus
Ne sois pas le
aux
hommes, c'est
premier à refuser d'y
ce
qui
est
défendu.
croire.
Vous êtes la meilleure nation qui ait paru dans le genre humain.
de deux
mots dont l'un est en
croupe sur l'autre ou le suit inséparablement. C'est
précisément le cas dont j'ai parlé dans la note (a) sur le n.° 739 de la première
partie, p. jop et il en résulte que j'ai eu raison de m'écarter du sentiment
d'Erpénius.
Le mot (__j 5 fj__„jj' signifie une série de plusieurs mots distincts l'un de
l'autre, qui n'indiquent cependant qu'un seul objet et sous un seul point de vue,
Oo.IJjUacU çVaJj (j^ Jt JLftÔJf * VyîuXT JU G*J V î Jfy'J* Oi[>Xiff
,
,
,
*
(Mss.
Ar.'de la Bibl.
imp.
n.°
//.' PARTIE.
1
326 ).
H
I
LA
DE
i£
tJCL> (joli
Le
Dieu)
premier édifice qui
,
SYNTAXE.
jj-^M!
£?j
ait été donné,
c'est assurément celui
qui
est
Jj' oj
<~*x
aux
à la
,
hommes
(pour y adorer
Mecque.
Lorsqu'un nom qui est duel logiquement, c'est-à-dire;
d'annexion avec
qui exprime la valeur du duel est en rapport
duel
l'antécédent
nombre
un complément qui est lui-même au
le mettre aussi au
se met mieux au pluriel : on peut cependant
dernier cas est rare.
singulier ou même au duel \ mais ce
si vous revenei tous
Exemple: tX^J>' iU^o&> *»t j] ^y^' ÔJ
deux à Dieu par la. pénitence, car vos cœurs à l'un et à l'autre se
sont détournés.
(a). Puisqu'il s'agit de deux personnes, le mot
cœurs est logiquement duel ; mais il est mis au pluriel gramma
avec le pronom
tical
parce qu'il est en rapport d'annexion
duel UJ^, qui lui sert de complément. On auroit pu dire, mais
moins élégamment UX>-b et U^=>l4-k
Il faut cependant excepter de cette règle ïes deux mots
S( et \xfc qui ont la forme grammaticale du duel et ne se
joignent jamais qu'à àes complémens du même nombre (n.° 210).
202. II y a un assez grand nombre de noms qui ne sont
jamais employés hors d'un rapport d'annexion dont le second
201.
,
,
,
.
.
,
.
,
,
,
terme est
exprimé
ou
sous-eh tendu-. Les
uns
exigent absolument
que le conséquent soit exprime : tels sont ^possesseur yjl
possesseurs J** ressemblance (J^* exception. Les autres supposent
,
,
,
mais
complément peut être sousentendu ; et alors le nom qui sert d'antécédent prend le tanw'Mi
et quelquefois l'article en compensation du
conséquent dont on
fait ellipse. De ce nombre sont JJT" totalité,
^joJu partie, [cf qud,
ou
plutôt quoi, quJle sorte. Exemples :
toujours
complément
un
:
ce
y
(a) Alcoran sur. 66, v. 4. Voyez le Comment,
imp. n.° 1234, f. 82 verso, et le man. Ar. de
,
Bibl.
sur
KAlfyya,
man.
S. G. n.° 465
,
Ar. delà
f. 135
verso-
LA
DE
//
faut point que le
devance point le jour dans
dans
soleil
ne
une
sa course ; et
f^&
«a*J
Parmi
envoyés
d'une portion.
ces
d'une
portion
nous
,
est
Descende^
ces
astres)
est
ne
court
,
£)*
quelque
noms glorieux.
est
203.
-"
->.-,.-"
U-Lïi
d'entre
soye^ ennemis les
et
#l_jfc>Vf «JU
manière que
vous
eux au-
eux.
J
J
uns
autres.
^ Uf
fjftôù*
l'appeliez
des
à lui
,
appartiennent
les
pour U ô»\ 'Ji */p quelque nom que ce soit que.
Les mots qui ne peuvent point être employés hors
d'un rapport d'annexion
pour
la totalité d'eux.
l£u
pour
pour &«*? d'une portion d'entre
JLJ^I
ont
(de
JuMjJf- CSlLï
avons 'élevé une portion
$"a-*J
s
li U.f
chamn
5
sphère particulière*
---
jjJu
la lune ; la nuit aussi
atteigne
J/ chacun, à la lettre, la totalité,
dessus
I I
SYNTAXE.
complément
,
restent
un nom
indéterminés
déterminé.
,
lors même
Exemples
qu'ils
:
'
OA / combien d'autres femmes que toi dupes de mon inconstance,
malgré la blancheur qui relevait leurs charmes , ont reçu de moi un
,
divorce
sans
retour!
j^£ 'V)a
Ztytf j'ai
cji ^c
■
.
L_^yii
visité, à la
faveur
£-i>5 o-sj-k"
de la nuit,
Jj'
j^ ^4^
d'autres
beaucoup
femmes que toi enceintes ou nourrices; pour moi, celles-ci ont oublié
l'enfant âgé à peine d'un an et que couvraient encore les amulettes
du premier âge.
,
,
H
2
II^
SYNTAXE.
LA
DE
si les
J^Jl* étoient-,
pourroient ni être
et de ci remplaçant côj (n.os 84 1
sous la dépendance. de l/j
et 882 i.re p.) ni être joints aux adjectifs ëjjj* -*Li4*
cJ4-*
sont
indéterminés.
et
75°^* qui
204- Les Arabes* comprennent parmi les noms qui ne sont
point employés hors d'un rapport d'annexion et qui sont in
déclinables beaucoup de mots que l'on peut regarder comme
des adverbes, des adverbes conjonctifs, ou des prépositions;
mais leur manière d'envisager ces mots me paroît la plus juste.
Tels sontô^c che^{n.° 84-0, i.re p.) <joJ auprès, M
lorsque, en
parlant d'un événement passé f M lorsque, en parlant d'un événe
ment futur, 0J0. en
quelque lieu que &c. Les mots 51 et «*>!». ont
une
pour complément
proposition soit nominale, soit verbale
(n.° 1 44) Exemples :
Dans
ces
deux
exemples,
et
mots >-«-*
déterminés par l'annexion de l'affixe <J
ils
,
ne
,
-
,
,
•>
,
,
,
,
,
•
->«f
Mon
père
père
est
j
e
O
Par-tout
Quant
ou se
à l'adverbe
qu'une proposition
viendrai-
te
Le mot
j»f
lorsque
mort,
c
j..
Zéid étoit *mir.
%
o
Je m1assiérai \par-tout où
-S
ïiL
c^f
quand
est venu,
r
Mon
if
'juj
j
.
-*
tu
,
il
Exemple:
le soleil
assis.
£s^o.
après
lui
JJ^FoilL- îSfdJÎ
/'<
ne
peut avoir
lèvera.
quand
M prend un tanwin
quand il sert
trouver,
né.
sultan, je m'y tiendrai.
conjonctif fij
verbale.
seras
est
,£
(jUiUJf lUf
tiendra le
Zéid
se
de
complément^
DE
autre nom
SYNTAXE.
LA
II
il y
comme
,
en ce
a une
/C*jf cl
Nous les
perceronsvde
turban ; c'est-à-dire
lances au-dessous de la ceinture
nos
20
J. Plusieurs
du
tions
temps,
sur
,
des
o-*j
imitent la construction de if
alors le
complément :
d'annexion
,
perd
épées
nos
,
t
après
replis du
à l'endroit des
qui indiquent le
et
,
temps,
^^
et
temps
,
ïes por-
heure,
propositions pour
d'antécédent à
qui
voyelle nasale comme
ce
genre. Exemples :
sert
nom
ou
*J.U
*£ jour,
prennent des
sa
les rapports de
et non
la tête.
noms
comme
,
fej—~° <W t-^f ô^ °&*-£-i
ç&'jp>ï <&&*
&?&■
les avoir frappés du tranchant de
tous
7
/." p.): alors
jour-là (n.° 857,
<&»y.
ellipse, dont ce tanwin est la compensation.
oÂÂ. a quelquefois pour complément un nom isolé
une
proposition ; mais ce cas est très-rare. Exemple :
un
cela
,
ce
rapport
lieu dans
a
C'est-là le jour auquel la justice des hommes justes leur sera utile.
-*
'
L—SfeJjXo
Quand elle
Zd
paix (a été)
pareillement
sur
sur
moi)
moi
au
vint dans
au
jour
.Vf (JOk.
Q.
son
logis.
jour auquel je
où je mourrai,
suis
et au
né,
jour,
et
(elle sera
où je
ressus
citerai vivant.
dJLtf *)
j^Jf ^ àXi ly.
A lui appartiendra la
royauté
,
au
jour
où l'on
sonnera
de la
trompette.
Donne-moi du
répit jusqu'au jour où
ils
seront
rappelés
«3
a
la
wr.
I
I I
8
Depuis
le
.-
SYNTAXE.
LA
DE
jour qu'il
A-A— ^w
r
J
parlé.
O' <^J
I
Z)<2«J" /* #ot/m:
-
m'eut
^w'i/
cacha,
—
i- v
Au jour où ils
se
ont
paru.
On voit par ce dernier exemple , que le complément., dans ce
nominale ; mais cela
genre de rapport, peut être une proposition
n'a lieu que pour les propositions qui expriment un sens passé.,
Quand le sens est futur , la proposition qui forme le complément
doit être nécessairement
ici la même distinction
et
proposition verbale (n.° i44)« C'est
que nous avons déjà établie entre i]
une
'*
fi] (n.°2o4).
qui expriment le temps ou les portions
du temps ceux qui s'emploient d'une manière vague et indé
terminée sont les seuls avec lesquels ce genre de construction
puisse avoir îieu. La raison en est que ce sont les seuls qui
^soient réellement synonymes de if On ne pourroit pas employer
de cette manière les mots jW jour, opposé à nuit, 54^ mis>
Parmi ïes
noms
,
,
.
*Jc«, année
206.
!>3j
,
&c.
Dans la constructiorf dont il
s'agit,
autres, peuvent aussi être
les
mots
/»y-â*-
indéclinables,
employés
ayant toujours un fatha pour voyelle finale. Ainsi, au lieu de
çslJ *£>\ô&- cir-'i^- fj^. Ô-? ô?—SâJ-J *1j <ÎJ on peut dije
£&k /»y îixS> ci^'iU. S^j Ija yy£* 'J£ jj C'est un nouveau
trait de conformité entre ces noms
employés dans un sens vague,
et
comme
-
,
-
-
.
et
les
noms
indéclinables if
et
fif fa).
'
■—
(a)
Suivant
.:
h
Ebn-Ma|ec, quand
.
t
,
les
mots
^a.
■'
-
^Sl
-
tïj
-
iJ&
DE
LA
I IQ;
SYNTAXE.
s'emploient qu'en rapport d'an
nexion les uns, comme nous l'avons dit, exigent que le con
séquent de ce rapport soit exprimé ; les autres souffreru^j'ellipse
du conséquent. Nous en avons donné des exemples. "Nous
devons ajouter que dans le cas où cette ellipse a lieu plusieurs
de ces mots deviennent indéclinables, et prennent pour voyelle
finale un dhamma. Ces mots sont JL^i avant, o^é? après, «_*!*.
suffisamment, jïè différemment, <j3ï sans, Jjf premièrement Jâ
Parmi les
207*
qui
noms
ne
,
,
,
,
haut,
en
^b
*Lif devant,
ont
(jU.
le même
Si
adroite
,
au-
dessous,
,
sens.
mêmes
ces
derrière
*fjij derrière, i^>
."JUti à gauche,, et plusieurs autres qui
o^
au-dessus ,
sont
noms
employés
d'une manière
absolue,
complément sous-entendu , ils suivent la syntaxe com
S'ils ont un complément exprimé , ik se conforment aussi
et sans un
mune.
règles ordinaires. Il
aux
sont en
rapport d'annexion
de
arrive même
et
,
prétérit
complément
ployer comme indéclinables;
est au
Quand
ou
que
il faut
damne
,
contraire
au
que le verbe de la
on
peut décliner
que, dans
proposition qui
ces
noms
ou
,
une
leur
les
sert
em
il vaut mieux prendre ce dernier parti»
proposition complémentaire est à l'aoriste,
composée d'un inchoatif et d'un prédicat (n.° 146)
mais
le verbe de la
proposition est
employer ces noms de temps comme déclinables. 1 bn-Malec ne con
pas cependant ceux qui, en ce cas, les emploient comme indéclinables.
cette
IJXbj
«
,
,
assez souvent
Les
,
,jJi
noms
indéclinables
L-Jj
assimilés
\jS~m J iSj**
}_>£•!
c_
^>j
au mot
if et.employés
J
dans {cvmême
*?
—
sens
,
iJ^J
peuvent être
employer comme indéclinabies
d'un
ils
suivis
sont
verbe
indéclinable
(c'est-à-dire ait
quand
et devant un
Devant
un verbe décliné
à
l'aoriste),
prétérit).
(c'est-à-dire,
«inchoatif, décfine-les : cependant ceux qui, dans ce cas, ne les déclinent
»
»
ou
déclinés
:
ri
•est
préférable
de les
,
,
»
»
pas
,
ne
doivent pas être taxés d'erreur.
(Mss. Ar. de laBibl.imp.
recto.)
n.° moi
»
,f. 17
et
t8;Mss. Ar.deS.Germ.
f. I06
K4
n.°
465
,
LA
DE
120
même
phrase
comme
peut les
on
,
regarder
comme
l'on
indéclinables, selon l'analyse que
•*
Il y
*'•
J'en ai
</ 6AJ
homme
a un
che^
dix , il
pris
0^*.>
J'en ai
pris
***?
Oij
n'y
'
,.
ou
adopte. Exemples :
davantage.
moi, pas
en
4
.„r.
a
pas
davantage,
Kj^uf tivà^v9
dix , cela
ôî*
ur?
le commandement
appartient
déclinables
*
,.!*,--
je.
A lui
SYNTAXE.
suffit.
me
-**^ '
"
(cela)
avant
et
après (cela).
exemple pris de l'AIcoran on doit suivant quel
lire oaj ^ Jto ^—* auparavant et après,
ques grammairiens
parce que ïes mots.cv** et J4» sont pris, selon eux, dans un
Dans
cet
,
,
,
,
sens
absolu.
U-lf cj^
Jjf JUAlt'f ji>JU
.
Quel que soit celui
J'ai
d'entre
voyagé
nous sur
avec ces
lequel la mort tombera en premier,
gens-là
Jjf
(J^
\,
t,..,
et sans
(eux).
ftW fôôf
Commence cela de
-»
,
•
—
J{A
(son) origine.
§*,,
Ces gens sont venus; Zéid étoit devant
J.T.ïf T.
(eux)
et
,
Amrou derrière
(eux),
JVJjf ££ ££\ te ^ ÙÏJJÏJ, '^
J'avale le vin à
h
peine avaler,
grands
sans
être
traits
,
suffoqué,
moi
qui
l'eau la
,
auparavant,
plus fraîche.
pouvois
DE
12 1
SYNTAXE.
LA
.AW avons tué ces lions semblables aux lions de Khafayya
ce
goûté le plaisir de v'iderdes coupes
moment, ils n'ont plus
de vin.
depuis
remplies
:
^
exemples, les mots «Slo et f<>Jusont dé
clinés parce que le poëte les a employés d'une manière absolue.
étant employés
Tous les mots dont il vient d'être parlé
avec le dhamma pour voyelle finale
comme indéclinables
deviennent de véritables adverbes (n.° 850, i.rep.); et pour
s'exprimer exactement il faut dire qu'ils renferment la valeur
de leur terme conséquent
et non pas qu'il y a ellipse de ce
conséquent (a).
208. l$o3 auprès est encore un nom qui ne se trouve point
Dans' ces deux derniers
,
,
,
,
,
,
C'est
(a)
qu'Ebn-Malec exprime
ce
LJ>tXc U
cvi txîiJ "c^-
»
pour terminaison
•»
»
j
un
»
o—Iâ. tv£»
J^=> JÂ*
tj-£li U
dhamma. Les
fif IL*.^j
mots
fJLÂ.9
-
om
-
*
ÎjO^'J
lui-même le
en
lui donnant
en
oJLâ»
"[!« f
-
-
**
...
Oji,ceux
<îUI exP«ment les
six
la droite, le dessus le dessous ),
_>«©
Jjf
^j ^M*
,
»
^Uj -*.gw>U
,
sens
j
(jf [j^ii
c>-»(>*
ja&
»
"
:
manque de son complément renfermant
complément qui lui manque, faites-le indéclinable,
mot
du
U
«jf'o^fj (i/ij
|j%i
Si le
,wj J
c_j
l^—
J-*j
«
LjU
ainsi
.
Mais
régions (le devant,
et
le
mot
.U,
,
le derrière
que
manière absolue
d'indiquer
et
à la suite de
indéterminée.
,
suivent la même
donne la terminaison de l'accusatif à Ao
on
nous venons
la
celui-ci, quand
autres
mots
emploie
d'une
et aux
on
les
gauche,
règle que
»
Ce que
je dis ici, que la règle dont il s'agit n'a d'application que quand
j. ^ê
JL-JLs» &c. renferment en eux-mêmes leur complément
les
mots
est
si vrai
du
-
,
,
complément
dans
ce cas,
,
que les "grammairiens Arabes admettent le
,
sans
que l'antécédent
l'antécédent
J4si
-
o*4
en
ou
cas
renferme la valeur
autre
se
décline,
où il y
,
et
mais
a
ellipse
veulent que,
sans
tatiwin>
LA. SYNTAXE.
DE
122
hors d'un rapport d'annexion. On le
et l'on dit IjûJ,
J^ (a).
20p. ^
à la
préposition ^
à cette même classe de
appartient
avec
joint
dit aussi
,
On
noms.
£> comme nom indéclinable.
admettent l'expression «w J^ -, comme
UU,
dans
adverbial
un sens
2IO. Parmi les mots
Quelques grammairiens
Îùj& ^. On dit aussi
IsL-îf ensemble (n.° 850, /." p.).
pour
,
qui
ne
se rencontrent
que dans
doit être néces
jamais
rapport d'annexion , et dont le conséquent
sairement exprimé , nous devons faire une mention
un
àkT
u^"
et
deux. Le
tous
du genre
complément
nom
déterminé,
pronoms
■
ces
spéciale de
joint à un
à un complément,
conséquent qu'un,
mots se
le second
et
peuvent avoir pour
ne
soit de
personnels
premier
masculin,
du genre féminin. Ils
de
sa
nature
,
comme
les
les articles démonstratifs
,
'
■—
f
propres , ïes
soit par l'article
noms
,
—
/
comme
si le
étoit
conséquent
exprimé.
Ils citent pour
exemple
d'un
ce vers
poète,
*
ma
-
<*
•
^
CjJofjJdf jûii J,y>
«
»
Avant
(cela)
chaque
,
*.
chef de famille
sentiment d'affection ait détourné
dans
lequel
mais
non
dans le
on
compris quant
,
mot
Suivant
exemples
J^-ÀL*
dit
Aj£
cette
que
(Mss.
au sens
,
,
c&éi ,j*'
la
étant
aucun
sous
sans
»
-entendit
c_j«0^£
,
qui parle-^j.âlXl Ji+ji*,
imp.
,
J^ji {y»_y»^\ *J et Jj f
1.-.
I-*
JJo j^aj et Ju f
'
'
'
^
fd-J l*>jf*
,
c
complémens
Ar. de la Bibl.
de l'AIcoran
est
faveur
en sa
q*j
que nul
des chefs.
parenté,
sa
peut prononcer ainsi, dans deux des
on
de
-
.
1234, f. 6j
f. 108 .recto.)
n.°
lisent, en suivant
prononciation reçue.
recto, et n.° 1291,
f. 18
recto;
.
^
Dans le dialecte des Arabes de Kaïs
(a)
qui
fléchi
et
complément cîlfi
/
Mss. Ar. de S. G. n.° 465
teurs
convoqué
a
^
jjjè <J,J*Jf(jiyj J*9
selon l'intention de celui
analyse
donnés
sous-entendant les
en
^e
to-8'
—
,
mime
j'ai
_*
»j
~
^
oJuîc Ç£
ce.
,
on
dit
dialecte, *JoJ
/ajJ \a
[\*
au
.
Quelques leo?
lieu de
#JjJ ^a
,
déterminatif;
et ce
conséquent
il
se
tratif cslli se
doit être
I23
au
duel
ou
,
du moins
le pronom affixe U nous,
à
deux
personnes , ou l'article démons
rapporte
rapportant pareillement à deux choses. Exemples :
avoir la valeur d'un duel
quand
SYNTAXE.
LA
DE
comme
,
**°
'
*
Ler deux hommes
■"
j
.
"'
'
les deux
et
femmes.
câfi Ufc U*
Tous deux
Zf bien
.
le mal
et
ont
certaine manière, d'être
et
nous avons
terme,
un
de
fait
cela.
et tous
deux
ne
sont
qu'une
présenter (a).
se
peut pas donner pour conséquent à ^ et, lx){ deux
individus exprimés isolément l'un de l'autre. Ainsi l'on ne doit
On
ne
pas dire v-Fj
o^j $C
Zéid
llj*ifcfj Jfj cxjj
On
tion
trouve
tyCQf
et
deux Zéid
Amrou
tous
et
Amrou; il faudroit dire
les deux.
cependant quelques exemples
mais c'est
;
tous
une
licence.
Exemple
cette construc
:
l5-«*
a^JJ otjSUff j.
de
lSO^^J eW^J ce' $?
frère et mon ami me trouvent tous deux pour appui
infortunes, et lorsqu'ils sont 'en butte à l'adversité.
Mon
leurs
dans
qui sert d'antécédent à un rapport d'annexion
peut avoir plusieurs conséquens liés par des conjonctions. Ex. :
211.
Le
nom
,
*•.««
j'SLàJJfJ
•
(a)
Celui
qui
Je
sais d'où
dentiers
ne
mots.
ow.
Jéi\ tic
sait les choses cachées et les choses
ce vers est
tiré
,
et
je
présentes.
doute du véritable
sens
des deux
124
DE
LA
SYNTAXE.
La création des deux et de la
terre.
Quelquefois aussi plusieurs antécédens n'ont qu'un seul
conséquent placé après ïe dernier des antécédens. Exemple :
\'& JSJ> [^ Ji-jj IsTàttî £** que Dieu coupe la main et h pied
de celui qui a fait cela. Dans ce cas il y a ellipse du conséquent
après le premier antécédent.
sans
qu'il
213. L'ellipse du conséquent a lieu quelquefois
se trouve, comme dans l'exemple précédent
exprimé après un
second antécédent. Exemple : JJû,f *f lllï <^yf pour
^Uj'élii ^yî
*1* JJûif Âf dormiras -tu au-dessus av cela ou au-dessous! Dans
212.
,
,
,
passage, qui est de l'AIcoran, à ce que je crois, il vaudrait
mieux lire ^y f On a déjà vu d'autres exemples d'une semblable
ce
.
tels» que JJà ^» i£ô ^
tous de peu d'autorité.
ellipse
sont
-
,
-
Jj f ^ (n.° 2.07 note) ; mais ils
,
2l4- L'ellipse de l'antécédent a lieu plus régulièrement,
quand il se trouve déjà exprimé dans un autre rapport. Ex. :
T'imagines -tu donc que tout homme que tu vois est (réellement)
un homme
(digne de ce nom), et que (tout) feu que l'on allume durant
la nuit est (réellement) un feu (signal d'hospitalité) (a)!
L'ellipse de ce genre n'a rien de surprenant ni d'embarras
sant
puisqu'il ne s'agit que de suppléer, dans le second rapport
d'annexion, un antécédent déjà exprimé dans le rapport pré
,
cédent.
(a) Les Arabes hospitaliers allumoient des feux sur les lieux élevés , pour que
les voyageurs , avertis par ce signal , vinssent chercher un asile et des rafraîchissemens sous leurs tentes. Je conjecture que c'est cet usage qu'avoit en Vue
le poète duquel ce vers est tiré.
DE
L'ellipse
2 I X.
técédent
a
LA
quelque
SYNTAXE.
chose de
différent de celui
est
que rien
plus
qui
n'indique
125
dur
quand
exprimé dans
trouve
se
cet an
,
le
la valeur de l'antécédent
premier rapport et
qu'il faut suppléer. Exemple: «jàVI
jojj
ils recherchent les biens casuels de
monde , mais Dieu recherche
,
ce
"amÇ
UI<>Jf (J»3*
Ôj^j>î
(les biens durables) de la vie future, ou (les œuvres qui ont pour objet)
la vie future (a). On voit que le sens reste ici un peu incertain,
parce qu'on ne peut guère supposer que le second rapport
d'annexion ait pour antécédent ,
qui signifie des biens matériels,
j»Jé
et
qu'il faut, par conséquent,
jlJ les biens durables
comme
iSùf.
,
jSvi' mJ$\ oô.fj j'ai
qui appartient à
vu
lui
ou
le
premier le mot
sensibles, sujets aux accidens
supposer un autre antécédent,
comme
,
,
JJ^ les
le Ta'imi ,
Autre
œuvres.
(l'homme
de
exemple:
cette
famille)
a
plu
de Taim
la descendance d'Adi. Comme il y
sieurs familles dont les
auteurs se
Ta'imi
suffit
ne
de l'une
pas pour
nommoient Taim, le
désigner précisément
un
mot
descendant
familles ; c'est pour cela que , dans
le
ajoute que descendant de Taim dont il s'agit,
exemple,
appartient à celle des familles de ce nom dont la généalogie re
ou
de l'autre de
cet
ces
on
monte
à Adi
:
mais l'antécédent dont iLï
sous-entendu ;
ce
peut être <jô.f
est
le
complément
,
est
homme.
un
C'est
précisément ce qui a lieu dans les exemples que j'ai
déjà rapportés ailleurs (n.° 662, i.n p. note) et dans toutes les
constructions pareilles. îjjàLi & ô^£ jLjj^Udf *CYf cx-Sk* U est
\
,
—
"
S
%
„
*.
mC
~g
.mO
Z,
expression elliptique pour
^f iL-Jj^Uff IGVf o-îl^lt
<>*£
<Axl\
arrivé
le règne NASÉRiquE,
j~?wf
Ôj^* lP
lorsque fut
je veux dire, le règne de Mélic-alnaser Mohammed fils de Kélaoun.
M
une
2 1
6. C'est
(a) Dans
cet
une
exemple,
règle générale
tiré de
l'AIcoran,
que les deux termes
on
lit communément
îii.Vf
qui
.
Il6
LA
DE
forment
un
SYNTAXE.
rapport d'annexion ,
l'un de l'autre',
et
doivent
ne
être
point
séparés
que le
l'antécédent. Cette
conséquent doit suivre immédiatement
règle cependant est susceptible de certaines
,
,
exception*: quelques-unes
concernent
où l'antécédent
d'action
est un nom
particulièrement les cas
adjectif verbal ; nous
ou un
parlerons dans les chapitres suivans en traitant de la syntaxe
spéciale de ces deux. espèces de mots. Mais on peut aussi", sur
tout en poésie, dans les
rapports d'annexion entre deux noms,
séparer l'antécédent du conséquent. En voici divers exemples :
en
,
XQij iU\j
La brebis entend la voix,
pJJL.
On diroit que le
efflanqué auquel
Je
on
«-JfttU oLîJf (J)
C«e
Dïeu , de
par
^i J> &lj
Al Çf
^JiJ^ û^
bidet, ô Abou-Asem
a
mis
maître.
son
de Zéid,
,
est un
âne
un mors.
échappé, et déjà le descendant de Morad avait trempé
épêe
sang du fils d'Abou LE MAITRE DES LIEUX
MARÉCAGEUX, Taleb ; c'est-à-dire, du fils d'Abou- Taleb,
me
qui
suis
dans le
son
,
étoit maître des
terres
(j*j&.
basses situées
4p. tJ^oUCfl EL
Comme si U livre étoit écrit de la main,
c'est-à-dire,
Ils
étoit écrit
sont tous
pas de
un
jour de la
deux les frères, À
Waset
entre
Basra.
L>
un JOUR,
main d'un
LA
et
d'un
Juif;
Juif.
guerre, de
quiconque
n'a
frère.
OmO
Lorsqu'il se
nettoie la
bouche,
,£,
est
abreuvé de l'eau,
le CURE-
'
LA SYNTAXE.
DE
DENT ,
de
de
sa
salive; c'est-à-dire
salive.
sa
,
c'est-à-dire
sonne une
,
les
•
jour
au
,
LES A UTEURS
'
PERSONNE, il? lui
de
auteurs
noble progéniture
,
au
jour
La construction naturelle
iU
"
f
~
produit une noble progéniture
DE SES JOURS EN SA
sance;
où
ICI ôi"l
«fûJfl
-J
*j
•
ont
est
*
oit! if
//j
2J
abreuvé de l'eau
cure-dent
son
,
1
en
ses
ou
jours
ils lui
ont
ont
ont
donné la nais
produit
en sa
per
donné la naissance.
arabe eût été
Âl^î
«j
ofLUfjôûil
ÎJ (a).
exemples et tous les autres de ce genre ne doivent être
regardés que comme des licences poétiques autorisées par la
nécessité du mètre ou de la rime ; il n'y. a que l'interposition
d'un serment entre les deux termes du rapport qui est permise
même hors de la nécessité (b).
Ces
■
,
,
(a) II y
(n.° 204).
a
C'est
(b)
ici
ce
pléonasme remarquable;
un
qu'enseigne Ebn-Malec,
**}•>
fôJ .f
»
»
Ce que les
ou
cas
de nécessité.
grammairiens appellent
que l'antécédent, soit le sujet
un
terme
( Mss.
u o
)
est
synonyme de
if
termes:»
fôva»^ fj'j-^fj
(Js*-
J^**
l'interposition du serment; et l'on trouve
terme
étranger, d'une épithète, ou d'un
«
^^Àswf
ou
>
c'est
l'agent,
une
ou
le
partie de la proposition
complément du verbe,
circonstanciel.
Ar. de la Bibl.
recto.
âCf
:
:
:
«f i$r—Â^V
ne
vocatif, dans le
autre
f.
**J
peut point taxer de faute
des exemples de l'interposition d'un
«
On
c>
en ces
car
,
imp.
n.°
1
234, f. 67
recto;
Mss. Ar. de S. G. n.° 465.,
ïlB
SYNTAXE.
LA
DE
CHAPITRE XI.
des Noms d'action.
Syntaxe particulière
c'est que le
principe
ou
défini ailleurs
(n.° 528, 1/' p.) ce que
Arabes
nom d'action J—Wf
les
t
appelé par
et nous avons rendu raison de cette dernière
jô^>,
Nous
2 17.
avons
pZJ'
nom
dénomination
Nous
(a).
aussi observé que les
avons
noms
(a) Nous avons observé, dans l'endroit auquel nous renvoyons ici (n.° 5x9,
p.), que parmi les grammairiens Arabes, les uns regardent la troisième
du prétérit comme le thème ou la racine éty
personne du singulier masculin
mologique et que suivant d'autres, la véritable racine est le nom d'action,
en considérant le nom d'action,
Nous avons justifié cette dernière opinion
et nous avons même
ou nom abstrait, comme la racine logique;
supposé
à
cause décela, et sous ce
/."
qucc'étoit
point de vue, qu'on
(n.° 528,
p.)
l'avoit appelé
*o**alo principe. Je ne veux pas dissimuler cependant que quel$
ques grammairiens semblent avoir pris le mot J^cuô dans un sens contraire,
comme s'il signifioit l'idée qui sort ou provient du verbe. C'est, je crois, la pensée
SacHfez que le nom qui
d'un commentateur de \Alfiyya d'Ebn-Malec, qui dit :
d'un
de
l'action
l'idée
de la manièred'être
ou
celle
qui
provient
agent,
exprime
ij*
,
,
,
,
«
-
.
.
^
«
«
»
»
propre à
un
individu,
se
divise
en
deux classes
,
&c.
^A^âlU
»
fwf
/jf
AA
Itol^jÔ^-ô ^f iujJLàj ^Xaj^fJiO-i X^J-ûJf jf CJj^àJo J^çlîJf tj* J&êïï
recto; Gramm. Ar. Agrumia^/Vw,
jÔ^clUJ (Mss. Ar. de S. G. n.° 465 f
,
éd. de Th. Obicin, p.
198).
Au reste, l'auteur du
beaucoup
de
mon
m
.
cpUjj**Jf cj^O
opinion :
car
,
ou
Traité des
il décrit ainsi le
fo^al»
^
»
d'où
est
il*, jb^oj
dérivé
cJ*f^
et
provient
(Mss.
le verbe
son
;
Ar. de la Bibl.
Molhat alirab, dit aussi que le masdar
Et dans
»
imp.
est
commentaire,, il ajoute
£i*
«
•
mC
définitions s'approche
«
,
Le masdar est le
~
m£
^Jcàf (jôJ\
n.°
nom
*
€.mP
ru'Vf J>
1326). Meïdani,
*°
jô^It
dans
son
la racine d'où dérive le verbe:
qu'on
l'a nommé masdar, parce que
d'action
DE
d'action
divisent
se
mim* aux radicales,
ajouter
sans
Mais
un
l^;jô^"»
J^tj^- jô^û»
en
et
mim
aux
dérivés de la forme
s'applique qu'aux
ne
du verbe. Les
primitive
,
qui
et
,
8.
II faut
dits,
JÔ^Hl îûj
e* *<>■«■=*
encore
noms
sont
<L.'»
d'action dé
régulièrement
division.
noms
d'action propre.
,
noms
d'action dérivés, suivant une forme
dont ils expriment l'action , comme :
l'action de
(jjâ. tristesse,
ex
principe et ceux que l'on appelle
qui tiennent lieu du principe ; ou du
première dénomination ne convient qu'aux
—
,
-cette
les
entre
noms
,
d'action
noms
d'action de û>yo frapper,
noms
>
distinguer
nommés jù
c'est-à-dire ,
d'action. La
(_>>-»
forment
,
de <>> louer, doivenHêtre classés dans
nom
se
ne
Au contraire, vj^-*
liient
qui
un
doivent pas, quoiqu'ils aient un mim être
comme
appartenant à la première de ces deux divisions.
regardés
2 1
2p
qui ajoutent
d'action
noms
rivés de la troisième forme du verbe
de la forme «JLéUu
d'action
noms
radicales.
distinction
cette
I
SYNTAXE.
LA
régulière,
du verbe
frapper, -de LSy° frapper;
de
(j>Â être
triste ;
âpre raboteux ;
itvJXLj' l'action de parler a quelqu'un de lis" parler ;
ïla^U rencontre, de J'Y rencontrer quelqu'un;
Jj^=>f l'action d'honorer, de ~pj&=>\ honorer;
iiyAà.
àpreté,
de
être
Jj-ii.
,
,
\*
*
'
-
m
iiï l'action
-
de U*J
d'apprendre,
apprendre s'instruire,;
,
oj& l'action de contrefaire le mort, de ôj& contrefaire le mort;
*fj.$ij fuite de ij^jf #« zw/V en fuite fuir ;
,
»
»
c'est de lui que
spnt
dérivés du
,
provient
nom
le
verbe,
d'action
»
,
et
que le
i_JLé
prétérit,
et
l'impératit
jL-iàVf yô~éi L, J^X* "Jflw f j^l
Oj-iJf ^.j J^-» ôj^'j MJ^J VJ^ CîUjAi
II.' PARTIE.
l'aoriste
(Alan',
de M.
Marcel).
I
JUl^f
victoire, de
jî>/*i rougeur,
de
SYNTAXE.
LA
DE
Ijo
_j-é*j[
~JJc*\
*m secouru
être
Dieu, vaincre;
de
rouge;
'J£âlJ solliciter;
sf^jj-y noirceur foncée de ifjlj être d'un noirfoncé ;
jjL&y sollicitation,
de
&c.
,
La seconde dénomination convient
point dérivés
dont ils
,
d'une manière
expriment
^lj lusïration,
de
UJj
être
jt
/rfv<?Â-,
tenant
Tels
,
.re
purifier,
verbe dont le
d'action
,
verbe dont le
l'action de
lieu de
nom
d'action devroit
nom
analogie y^jj ;
l'action de se laver, faisant la fonction
Js*^f se laver,
6^
et
:
ablution, faisant la fonction de
suivant 1
,
^1
r
l'action.
régulière
sont
qui ne sont
analogique du verbe'
noms
aux
parler,
eSCi
,
nom
d'action
de
est
faisant la fonction de
vrai
nom
JUxpJ;
nom
d'action du verbe
nom
diction de
d'acjion
,
jX parler
et
à
quelqu'un.
2 I O.
II
est encore
nition que noué
comprenons également sous cette* dénomination lesabstraits dérivés, soit des verbes qui expriment une action,
i.r'p.)f
noms
avons
nécessaire d'observer que , suivant, la défi
donnée ailleurs du nom d'action (n.° 528,
nous
Jx3' l'action de tuer, de "{yS tuer ; soit des verbes qui
expriment une impression reçue, comme fUiàjf l'accident d'être
sevré de fù^l être sevré ; soit enfin de ceux qui n'expriment
qu'une' simple manière d'être, comme j [>£•_] rougeur, de jJ^\
comme
,
être rouge;
.rU^J
220. Les
tortuosité, de
~yk]
être tortu.
je l'ai fait voir ailleurs f
de véritables noms abstraits destinés à exprimer une action ou
une manière d'être 'indépendamment de tout
sujet, objet, ou
autre idée accessoire, et étant, par cela même,
susceptibles du
sens
passif,
noms
d'action étant
comme
du
sens
,
comme
actif (n.° j4j
j
1"
p-)f il semble
DE
qu'on
I
13
devroit
en faire
usage que lorsqu'on veut exprimer
la manière d'être , abstraction faite de toutes ces idées
ne
l'action
syntaxe:
la
ou
accessoires. Le contraire,
cependant,
lieu;
a souvent
il arrive
et
fréquemment que l'on emploie le nom d'action, comme l'on
pourroit employer le verbe lui-même, avec un sujet et un com
Cet usage du
plément objectif (a)
à quelques règles de
m
noms
,
dont
et
nous
;
il est,
si le verbe
allons
comme
mais
,
à cette
de
espèce
de la nature du verbe d'où
ou
intransitif: il
si le verbe
dans le
tion peut être
,
occuper.
participe
lui, transitif,
est neutre ;
d'action donne lieu
particulières
nous
d'action
22 1. Le nom
il vient
syntaxe
nom
est
actif,
actif
ou
avec
le
est
le
neutre,
nom
d'ac
dans le
sens
employé
passif (n.°-c.4$ i." p.).
S'il s'agit d'un nom d'action provenant d'un verbe transitif,
il peut avoir un sujet et un complément objectif.
22 2. Le sujet seul ou le complément seul étant exprimés
sens
,
,
ils peuvent être
c'est-à-diïe,
en
rapport d'annexion
être
nom
d'action,
Exemple:
gouvernés
génitif par
^Ui JJ&ï ^3 wt fcpj'd jLààxlf ô^=J ta manière dont Abraham
demanda pardon pour son père, fut (de dire) : O toi qui es notre Sei
gneur, reçois ma prière (à la lettre, et fuit deprecatio Abrahœ pro
suo).
"f£jt^ mis
ce nom.
au
pâtre
>
j\Js^ÇJ
,
génitif
au
réellement le
est
vroit êtreUIf Dieu,
u
(a)
,
est
Cette
espèce
sous-entendu. C'est
■
I
complément du nom d'action
sujet ; le complément objectif, qui de-
comme
d'abus dans
ce
.1.1
i
l'usage
du
nom
dont
,
abstrait
on
s'assurera
t
I
est
r
i
.
semblable à celui
par lequel, dans plusieurs langues, l'infinitif, dont la fonction propre est de lier
l'idée de l'existence avec celle d'un attribut sans exprimer le sujet dans lequel
,
se
trouve
moins
en
l'existence
,
devient
fait la fonction
cipes de grammaire générale
,
,
,
contre sa nature,
étant
i.c
joint
à
édit, p. 194
un
mode
personnel,
un
sujet déterminé. Voye^
et
p. 195
,
not*
(i).
I
2
ou
mes
du
Prin
substituant le verbe
en
SYNTAXE.
LA
DE
Ij2
au nom
d'action ,
et
disant :
jÇ£j*J J*à*«I
*JV *Jl7 [deprecatus est Abraham Deum pro pâtre suo] Abraham
demanda pardon a Dieu pour son-père en disant &c. Autre exemple:
jX£ «Ui J^ ^lliVt ^Uj V l'homme ne se lasse point de demander
,
,
le bonheur. Si l'on substitue le verbe
au nom
d'action *Uo
on
,
sentira que le sujet est Vhommt, et le complément objectif h
bonheur: car le sens est, de cela qu'il demande le bonheur. De même,
dans
en
,
demandant
demandé
Jijlj ÏE ô^i
phrase tibîsiJ
cette
ta
ta-
brebis , le
sens est
//
a
commis
cîU?sj JU (jL
une
£«
injustice
rf/û
qu'il a
brebis.
On peut aussi
dans le même k.:s, si le
exprime
nominatif,
exprime complément
objectif, le mettre à l'accusatif: mais cela n'a guère lieu que
quand le nom d'action est séparé du nom qui exprime le sujet
Ou le complément objectif, par un terme circonstanciel qui
empêche «le rapport d'annexion rapport dans lequel les deux
termes doivent se suivre immédiatement (n.° 216). Exemples:
223.
le sujet
,
ïe
,
et
mettre au
nom
le
s'il
,
L'action de donner à manger ,
y
En
frappant
%
en un
_>
,
avec nos
jour de famine à un orphelin,
,
j
mO
les têtes de certaines gens,
épées
nous
les
avpns abattues:
--y
Unxj
des
noms
Le
(a)
J»jj
et
d'action
nom
à
sont
l'accusatif comme
lUUJ
d'action,
et
complémens objectifs
c-Zh».
en ce cas
-là,
Cette manière de construire le
doit
nom
conserver son
d'action
comme
tanwin
(a),
le verbe lui-même,
doit pas être regardée comme un motif suffisant pour envisager le nom
d'action comme un véritable infinitif, un mode du verbe.- Les Latins ont quel
ne
^
quefois employé
le
nom
d'action de la même manière,
comme
dans
ces
DE
SYNTAXE.
LA
1\J
prendre l'article détewnrnatif ; et dans ce cas
complément objectif peut suivre immédiatement le nom
Il peut aussi
le
d'action.
,
,
Exemples
:
.*
J
"*
-
w
Jfsfô^l uUCÏIff
Foible
1
§t
•«"■■»
mon
224»
sitif
nom
*-*.*.'
J
"*
.
Q&
JCil tj
Le
sujet
et
le
par le
peut'
on
d'action
,
le
c'est-à-dire ,
,
le
sujet
en
rapport d'annexion
d'action
génitif,
Exemples
Si Dieu
n
Ce fut
en
le
et
le
le sujet
au
soit
conservant au
en
lui donnant l'article
avec
un
nominatif,
soit enfin
,
terme
circons
:
Oi>-«»àJ' t***"W &*-*i
avoit pas
auroit été
en
rapport d'annexion
mettant en
^•jVf
terre
tanwin, soit
son
avec
complément objectif
complément objectif au génitif, et
au
l'accusatif,
sujet au nominatif; ou enfin mettre
et le complément objectif à l'accusatif,
le
e-~
complément ^objectif d'un verbe tran
nom d'action
étant exprimés l'un et
mettre
ou mettre
tanciel.
ennemis;
i
OJj-i»
ïe
en
-
ennemi).
à
nom
a ses'
_,****
(>*»f *jaA-11 (2ji 0<nÎ t\ï>
d'entre la cavalerie agile savent que j'ai frappé,
m'a jamais empêché de porter un coup sur l'oreille.
o>^-ff
représenté
l'autre,
l'action de nuire
concerne
*'
i
.
Z^J" premiers
que la peur ne
(de
qui
en ce
•
«
opposé
dévastée.
cette année
/jwujf
A\if
les hommes les
que le
khalife fit
?£ i
i])
uns aux
mourir
autres, la
Djafar.
exemples: Qtttd tibi Kanc curatio estremi Quid tibi nos tactio est/ ( foy^Schultens,
Instit. ad fund. ling. hlebr. p. 287.) C'est encore une construction analogue a
celle-ci que l'on observe dans ce passage de Cicéron ( in Pison. j: Jamne vides,
iellutt , jamue sentis, quoi sit homtnurn querela frsntis tua r
I
34
LA
DE
Souvenez-vous
de Dieu
,
SYNTAXE.
comme vous
Mémorial de la miséricorde de
mon
vous
souvent^ de
vos
pères.
serviteur.
seigneur envers son
Ce genre de construction ,. où le sujet est mis au génitif, et
le complément objectif à l'accusatif , est le plus ordinaire. Le
truction dans
tif,
et
ïe
sujet
plément objectif
Il
défendit
écrivant,
ïe
laquelle
au
fort usité; je
est aussi
contraire, cependant,
complément objectif
nominatif. Cela
est un
que
l'appelât
qui
pronom
et
lieu
ïe
est
sur-tout
sujet un
mis
fût, en lui adressant
seigneur et notre maître.
,
la cons
géni
au
quand
nom.
le
com
Exemples :
la parole
ce
que
notre
,
a
dire
veux
ou
lui
Ses deux
pieds de devant semblent examiner les cailloux dans
la plus grande ardeur du jour, comme les
changeurs examinent des
pièces d'argent (pour recevoir les bonnes et rejeter les mauvaises). '*
,
o
^liiwf ^
L'action d*aller
le peut
(à
la
en
lettre,
pèlerinage
itio
j'ai parlé
,
J'ai
qui
appris
J'ai
a
la maison sainte,
pour
quiconque
domûs, quicumque potest).
Voici maintenant des
mais
o*_lÂ;f IL
sont
exemples des
plus rares :
que Zéid
a
autres
constructionsdont
répudié aujourd'hui Hind.
appris que Mahmoud
a
tué
son
frère.
DE
Je suis charmé que
SYNTAXE.
LA
ment
,
les
avec
fonctions.
noms
Exemples
qui
,
sans
a
être
noms
iMaù'
tu as
que
données dans les
tu seras
fait don
de
cent
en
font les
compté parmi
eux.
«3Jw
de chameaux aban
femelles
pâturages.
«Ayjf **â.j3 J^J-ff
Un homme
d'action ,
rare
/»[>^ff cïLï>£*J
les hommes généreux ,
Uiyjf iyÙI éljUâ^
^/?w
lieu, quoique plus
:
"Ai*
En fréquentant
Amrou le jour du, vendredi.
Mohammed attende
2.7A. La même sorte de syntaxe
IJ5
qui
a
donné
baiser
un
*■&* (J-*
a son
épouse,
est
obligé à
la
purification.,
Les
et
mots
ïjJuz
cependant
-
>liîé
-
jlIâj»
point des noms d*action,
complémens objectifs p|j£if
ne sont
ils gouvernent ïes
-
Ub>ff oUf et *&>>jj à l'accusatif.
226. S'il s'agit d'un nom d'action provenant d'un verbe
neutre ou d'un verbe intransitif, il ne peut avoir de complé
ment objectif du moins immédiat, puisque les verbes de cette
sorte n'en ont
point : alors le sujet du verbe se joint ordinaire
ment au nom d'action par un rapport d'annexion. Exemples :
jj
J
'
La noirceur de leurs
La chute de Zéid à
On
pourroit aussi,
en ce
-°*
*"°
visages
terre eut
m'a
surpris.
lieu de ta
cas, donner
au
sorte.
nom
d'action f©
U
136*
tanwin,
natif,
ou
l'article déterminatif,
sur- tout
circonstanciel
s'il étoit
mais
;
Ce que
227.
au
-id'ajouter
l'onferoit,
lieu du
nom
l^j-twCo fjl^i. fJJ^
22o.
nom
constructj|>ii
sujet
au
nomi
d'action par minterme
n'est pas usitée (a);
dit relativement
leur second
que
a
du
mettre le
à des verbes transitifs
,
aux noms
d'action
s'applique également
Amrou du
Les
conduisent à
complément objectif
employé le verbe lui-rnême
d'action. Ainsi l'on dira
o^jà
on
ne
à l'accu
si l'on eût
comme
manger
et
d'action. dérivés des verbes doublement transitifs ; il
aux noms
satif,
séparé
cette
nous avons
qui appartiennent
s'agit
SYNTAXE.
LA
DE
trouva mauvais
:
iLaLl^J fj*>ji=> ^fUIf <*>]
que Mohammed eût fait
pain empoisonné.
noms
l'égard
d'action dérivés des verbes intransitifs
de leurs
se
verbes
complémens
se
joignent à leurs complémens
prépositions. Ainsi l'on dit :
,
comme
ces
eux-mêmes; c'est-à-dire qu'ils
indirects
avec
les mêmes
Je n'ai pas le
Sa révolte
(a) Je
dis ceci
pouvoir de faire cela;
le sultan
contre
eut
lieu dans
ce
pays ;
l'autorité de Martellotto
( Jnstit. ling. Arab.
d'action régit à la
parler des grammairiens Arabes, le
verbe régit le sujet au nominatif. Ascbmouni dans son Commentaire sur
VAlfiyya
d'Ebn-Malec, indique deux exceptions à la règle générale dont je parle : mais
il ne fait pas exception du cas dont il
s'agit ; donc il en admet la possibilité.
jl nous apprend même que les grammairiens de Basra permettent de mettt*
le sujet du nom d'action au nominatif, quand le nom d'action a la
significa
tion passive et qu'Ebn-Malec dans un de ses
ouvrages a adopté ce sentiment.
principalement
sur
p. 443 ) , et cela paroît conforme à la règle
manière du verbe; car, selon la façon de
générale, que
le
nom
,
,
Ainsi l'on
(
pourrait
jourd'hui. (Mss. Ar.
,
dire
,
jjïj 'J^Jf *j£j J^£\ j'admire
de laBibl.
imp.
n.°
1234, f. 68 recto.)
que Zeïd ait été tué au-
DE
de
d'expulser
de même que l'on diroit <2))>
il se révolta
contre
le
sultan,
137
tXa>\ £■[>»• f
tJX*
L'action
SYNTAXE.
LA
ce
lieu
ceux
qui Vhabitoient;
J* jôà il a pu cela, J* ^Ja. (jUiLif
*x> J*ÂjL\ /'/ l'en
fit sortir.
II arrive néanmoins
quelquefois que les noms d'action
complément au moyen d'une préposition.,
joignent
quoique le verbe dont ils représentent la signification soit
transitif, et prenne son complément immédiatement. Cela a lieu
sur-tout lorsqu'il y a inversion, et
que le complément est placé
avant le nom d'action; et la même chose arrive
quelquefois
comme on l'a vu
précédemment au complément objectif des
verbes (n.° 173).
220.
à leur
se
,
y
,
230. Les
truisent
noms
d'action dérivés des verbes abstraits
leur
se cons
leur attribut à l'accusatif.
sujet
génitif
Exemple ^oJÎ J^»f ^0 '£ \3jja ^UjVt oj^i c'est m des articles
fondamentaux de la religion que l'homme est créé.
avec
et
au
:
,
231. Les
sitifs
,
d'action, quoique
dérivés de verbes
tran
employés d'une manière vague et indéter
complément , soit parce que le complément est
peuvent être
minée ,
et sans
suffisamment
parce
noms
qu'on
indiqué
par ce qui précède ou ce qui suit , soit
n'a pas intention de le déterminer.
Exemples :
fclff
ù4&jJ=a\
«J
ji£=>j *iff Ju^> ,*;é
Détourner de la voie de Dieu
yeux de Dieu
un
plus grand
QUa.Li
A la lettre
éj*»3 jf
,
et
ô^>
être incrédule
en
lui, c'est
aux
crime.
iJjjèéJi
csfLili
qUj^ '(ytâÂÏ
le divorce deux
fois, et ensuite garder avec bons
traitemens, renvoyer avec bienfaits: c'est-à-dire le divorce peut se
fiire jusqu'à deux fois; ensuite il faut, ou garder sa femme en vivant
ou
:
,
,
I38
bien
lui
elle
SYNTAXE.
LA
DE
la renvoyer
(par un
faisant quelque gratification.
avec
,
ou
troisième divorce
absolu),
en
2^2. De tout ce que nous avons dit, il résulte que, le verbe
étant représenté par le nom d'action, le sujet, qui, de sa nature,
doit être au nominatif ( n.° 58), se trouve souvent au génitif
comme
complément du nom d'action et que le complément
objectif du verbe se trouve aussi fréquemment au génitif, quoi
que, de sa nature il dût être à l'accusatif {n.° 85 ).
Or il peut arriver que le nom qui sert de sujet ou de com
plément objectif, doive être en concordance de cas avec un
adjectif ou* un appositif ou même avec un autre nom joint au
premier par une conjonction.
,
,
,
,
Dans
le
ce cas
nom avec
maticale
; on
,
on
peut
lequel
ils
mettre ces autres mots au
génitif comme
rapport de concordance gram
ne considérant que leur rapport
ont un
peut aussi
,
en
représenté par le nom d'action*, les mettre
nominatif,
auquel ils se rapportent fait fonction
de sujet et à l'accusatif, s'il fait fonction de complément objec
tif. Exemple:
logique avec
le verbe
si le
au
nom
,
En
soir il
quitté sa demeure, et il a poussé (son
chameau) comme un homme qui cherche h rattraper son bien qu'on
lui a enlevé, et qui a éprouvé Une injuste violence,
poursuit (le ra
visseur) (a).
sorte
IjilîHf
qui
est au
qu'un
est
ici
au
génitif,
fonction de sujet
,
a
nominatif, quoiqu'il
parce que
le
sens
ce
étant
(a) Je ne garantis pas d'avoir bien
point à fanalyse grammaticale.
Huit
dernier
Ui
saisi le
se
rapp'orté
mot
à
oîiltl
fait réellement la
ijlÉdr^lilirôte «J»
sens
de
ce
vers; mais cela
ne
DE
Au#e
LA
SYNTAXE.
l}$
exemple : lM\^yji.\ 'Jé=>\ £J>ji j'ai
manger du pain
^f
meitre
au
'.-",/"a
et
de la viande.- On peut
génitif,
comme
jllii
en
dans
,
; ou à
'*
horreur l'action de
exemple
cet
l'accusatif,
en«con'
i
.
,
^
J-V^f comme complément objectif du verbe J—è»»
s
en
représenté par le nom (Faction J^f ; ou enfin au nominatif»
i
envisageant j4^- comme le sujet du verbe passif J*%>f repré
senté par le même nom d'action (a).
2^3. Tout ce que nous avons dit sur la syntaxe des noms
d'action n'a d'application à ces noms qu'autant qu'ils sont em
ployés 'd'une manière qui représente effectivement le verbe, c'està-dire qu'autant qu'ils renferment l'idée de l'existence jointe
sidérant
**
'
tmO
,
,
,
à celle du
quelle
sens
,
on
la valeur d'un attribut. La marque à la
reconnoît que les noms d'action sont employés en ce
temps
,
et
c'est que l'on peut alors leur substituer le verbe
des deux
ésfù^*
avec une
qu'elles donnent au
verbe la valeur du nom d'action; ce sont yf pour le passé et le
futur (n.° 880, j.rt p.) et U pour le présent (n.° 890, //'/?.).
Faute de cette «condition le nom d'action perd son influence
verbale, et n'agit plus sur les autres parties du discours qu'à la
panière des noms. Ainsi, si l'on dit jl> ôj^op> *J f^lï ôjj^
je passai, et voilà qu'il crioit (comme) la voix d'un âne il ne faut
pas croire que ô^> soit ici à l'accusatif comme complément
objectif gouverné par le nom d'action oj^» : car le nom oj-*
i^'est point équivalent à oJ-^j q\ (b) ; il n'exprime point une
particules
nommées
,
parce
,
,
,
(a) Cette dernière construction est remarquable : elle prouve ce que j'ai dit
plus d'une fois, que fe nom d'action est susceptible du sens passif comme du
sens actif.
Voyei le man. Ar. de S. G. n.° 465 f. 1 1 a recto et le man. de là
Bibl. imp. n.° iaj4, f. 69 recto.
,
,
(b)
oy»
»
comme
représentant l'action
du verbe
Î^J+
,
n'est pas propre
l4o
idée d'existence
c'est
valent de
de temps. Si donc
et
d>jr^
est
à l'accusatif
,
(n.° io4), renfermant l'équi
ou
de ô^> kÂaS qui ressemble
voix,
circonstanciel
terme
comme
SYNTAXE.
LA
DE
o^i" comme
la
kla voix.
Le
2^4*
quand
sous
il
d'action
nom
est au
celle de
pluriel (a)
nom
d'unité
,
son
influence verbale
k forme de
il
qua,nd
ou
,
aussi,
perd
ou sous
est
diminutif,
ou
modifié , soit par
un
complément soit *par
Quelques-unes de ces conditions
quelque
cependant sont sujettes à des exceptions. Ainsi l'on trouve des
exemples de noms d'action au pluriel ou sous la forme du nom
d'unité qui gouvernent leur complément à l'accusatif, à la ma
adjectif interposé
entre ce nom et son
autre terme
,
accessoire.
,
,
nière des verbes.
**
2^ 5* Ofl trouve quelquefois le nom d'action gouvernant un
complément à l'accusatif, sans cependant qu'on puisse lui subs
tituer l'une des particules <jf ou U suivie du verbe ; mais c'est
qu'alors le nom d'action remplace le verbe lui-même à un mode
personnel en sorte même qu'il est censé renfermer en lui-même
,
le pronom ,
sujet
du verbe.
t>Jl*3Jf Jt>J JUf
.
Exemple
*&y*^ J^ (J1^ t£^ éfc^ ci*
^-jjJ Hj^i
Ils passent dans la
:
plaine; leurs sacs sont légers (et vides):
épouvantables vont fondre sur moi du côté
mais bientôt des malheurs
de Darin. A moi
ment
un nom
jO^a-iJI jfe»f.
donc, Zora'ik tandis que les hommes sont distraits
d'action
,
jJl
«ai
Voye^ ci-devant,
,
n.°
mais
a
(a) Quelques grammairiens Arabes
point de pluriel; mais
le masdar n'a
uombre,
il
cesse
d'être
nom
d'action,
un
nom
qui remplace
un
nom
d'action
18, p. 129.
donnent même pour règle générale que
cela veut dire que quand il passe à ce
,
i
DE
par leurs nombreux
troupeaux
travaux ;
fait un
'l4*
SYNTAXE.
à moi
,
que j'enlève à la hâte les
afin
subtil renard.
ici pour IJ&J& ; mais c'est une
peut rendre raison par une etlîpse.
Vi^i
dont
comme
,
LA
2^6.
Nous
avons vu
poétique,
tournure
est
on
que , dans les rapports
doit suivre immédiatement l'antécé
précédemment
d'annexion ïe complément
,
cependant lorsque l'antécédent est un nom d'action il
est
permis d'interposer son complément objectif entre l'antécé
dent et le conséquent. C'est ainsi qu'on lit dans l'AIcoran :
dent
//
:
,
,
a
génies,
paru beau à bien des polythéistes que leurs camarades
les faux dieux) tuassent leurs enfans (a).
Elles
(les sauterelles) font sortir le grain des riches épis qui
plaine comme le fléau nettoie le coton de ses graines.
crnoient la
Nous les
font fuir
,
avons
mis
en
fuite
et
poursuivis
cette
exception
est
(a) Sur. 6,
v.
i)j. On lit ordinairement
fe\J=sjJii £}¥.(
g+and nombre d'entre eux
-
SVlf
à
comme
une autre
le
meurtre de leurs
leçon,
l'accusatif,
on met
/oj
comme
enfans
:
mais
à la voix
ont
un terme
fait trouver
bon à
un
DjSfal-eddin remarquequc,
objective,
complément objectif,
conséquent annexé'j qu'il y a alors, a la vérité,
comme
:
JJ& ^Jf^L-II '^m. jJié-A ^y
les (démonsJ camarades des polythéistes
>•
éperviers
c'est que le
rapport très-immé
facile à sentir
complément objectif du nom d'action a un
diat avec lui, et ne peut pas être regardé
étranger à ce rapport.
suivant
les
comme
,
l'émouchet.
La raison de
«
(les
et
JJLs
au
nominatif,
*k%i'au génitif,
séparation entre
une
i42
Dî LA
SYNTAXE.
CHAPITRE XII.
Syntaxe particulière
aux
Adjectifs verbaux
Règles de dépendance.
des
,
par rapport
précédemment (n.° 70) que les
adjectifs prennent souvent des complémens à la manière des
et que le
noms
génitif est le cas qui caractérise ces- corn plé*
mens : mais il arrive aussi très-fréquemment que les adjectifs
verbaux exercent sur ïes noms et les pronoms qui sont, à
la même influence
en rapport de dépendance
leur égard
Qu'exercent les verbes. L'usage de ces adjectifs donne lieu k
diverses règles de syntaxe qu'il est à propos de développer ici.
238. Je renferme sous le nom commun d'adjectifs verbaux
trois sortes d'adjectifs que.Ies Arabes dis
ou dérivés des verbes
tinguent par les trois dénominations de noms d'agent Jxlklf twj,
noms de patient JJ*k-l\
j£j ( n.° 6 1 7 ^re p.) qualificatifs dssimilés «4^** *X? (n.° 621 //' p.). Je nommerai ces derniers, ad
jectifs verbaux simplement qualificatifs. Les noms d'agent dérivent
de la voix subjective des verbes ; les noms de patient de la voix
objective (n.°6io, 1" p.) ; les adjectifs verbaux simplement
qualificatifs, de la voix subjective. Lès noms d'agent et de. pa
tient tiennent un peu de la nature des participes parce qu'ils
237.
J'ai
déjà,
observé
,
,
,
,
,
,
,
,
»
,
f
»
et le conséquent
parce que le complément objectif est
les deux termes, mais que cela ne nuit point à leur relation.»
l'antécédent
entre
VoyeiMiS.
,
Ar. de S. G. n.°
465
,
f.
1
09
recto et verso.
placé
'
DE
l43
SYNTAXE.
LA
peuvent être employés de manière à indiquer une circonstance
accessoire de temps, et qu'ils expriment l'attribut renfermé dans
leur signification, comme accidentel et passager: cependant,
par eux-mêmes aucune circonstance de
temps liée à l'idée de l'existence , je ne les considère point
comme de vrais
participes. Les simples qualificatifs qui indiquent
ils
comme
n'indiquent
qualités habituelles et subsistantes n'ont pas même cette
nuance qui rapproche les noms d'agent et de patient de la valeur
du verbe. Ainsi pj+, simple qualificatif, signifie peureux timide ;
mais &jl â. nom d'agent, signifie effrayé, craignant. 11 est impos
sible cependant d'établir une ligne de démarcation précise entre
les noms d'agent et les simples qualificatifs et il arrive souvent
qu'ils s'emploient les uns pour les autres.
des
,
,
,
,
La manière dont
les
sur
mots avec
même ,
nous
ces
trois
sortes
ils
lesquels
considérerons ici
d'adjectifs verbaux influent
sont en
rapport
,
n'étant pas la
chaque espèce séparément.
•
%. I." Syntaxe
des
Adjectifs verbaux appelés
Noms d'agent.
23c. Le nom d'agent, ou adjectif verbal dérivé de la voix
subjective suit la nature du verbe dont il est formé ; il est,
,
lui
comme
240.
,
Le
actif
nom
ou
neutre, transitif
d'agent
sert
ou
souvent^
intransitif.
comme
le verbe, à
expri
l'attribut d'un sujet. Le sujet du verbe devant se mettre au,nominatif (n.° 5 8), toutes les fois que le nom d'agent a un sujet,
mer
on
peut le
mettre
aussi
au
nominatif. Ainsi l'on dira
15^ 1sJj\ Amrou dont le père
a
tué Mahmoud;
•à*0
le fils de Zéid
diroit
\Îj*j£ îy\ 'JxJi Ji' tjôJlj^F
24
1
.
Si le
épousera
nom
demain Zobéide
d'agent
est
et
»ôwôj f
;
j*
employé
îj* *XjJ
Jj.UJf jjLp
<h>li
o4j
de même que l'on
«ijl
pour
IÇu oôj
exprimer
.
une
ï44
qualité sans
et
aucune
inhérente
père
se
satif,
circonstance de temps
sujet, on peut le mettre
Ou dira donc bien ^¥4
au
sujet.
avec son
tient debout. On
le considérant
en
SYNTAXE.
LA
DE
pourroit
aussi
,- et comme
en
rapport
habituelle
d'annexion^
/«Uf 04j Zéid dont U
le
mettre
sujet
à l'accu
circonstanciel détermi
comme un terme
complément objectif d'un verbe;
ou le mettre au nominatif, en l'envisageant comme le sujet' d'un
yerbe : mais dans ce cas le nom d'agent rentre" dans la classe
des adjectifs verbaux simplement qualificatifs dont nous, parlerons plus loin.
242. Cette construction dans laquelle lé nom qui dans la
vérité est le sujet de l'adjectif verbal ou nom d'agent est
mis au génitif, et gouverné par cet adjectif, n'a guère lieu
que pour les noms d'agent dérivés des verbes neutres. On l'em
ploie aussi quelquefois pour les noms d'agent dérivés des verbes
transitifs, quand ils n'ont point de complément' exprimé ; la
raison en est qu'alors ces noms d'agent rentrent encore dans
la classe des simples qualificatifs. Exemple :
natif (n.°
1
o4)
,
ou comme
le
,
,
,
k
,
,
,
,
,
L'homme dont le
,
est
compatissant ne fait jamais aucune
injustice quoiqu'il ait lui-même éprouvé l'injustice des autres; et
l'homme généreux ne repousse jamais (ceux qui ont recours à luï),\
cœur
,
,
quoiqu'il,
ait ressenti les
effets
d'une
ingratitude
criminelle.
exemple, ol&Jf ^f">Jf tient lieu de pAj 1Û>* cjoJf ;
et l'on a pu employer' le
rapport d'annexion, parce que £Ïj
n'est point réellement ici nom d'agent mais
simple adjectif,
et est
de
comme /.S
équivalent
f&j.
Dans
cet
,
,
Les
d'agent dérivés des verbes dont la signification est relative (n,° 223 /." p,)9 sont pareillement relatif?.
Us peuvent donc avoir un ou plusieurs complémens objectifs
243.
noms
,
médiats
■
médiats
sont
ou
l4S
SYNTAXE.
LA
DE
selon que ïes verbes d'où ils dérivent
,
transitifs , ou doublement transitifs.
immédiats
intransitifs ,
l'adjectif verbal se joint à
son
complément par la même préposition que l'on empïoieroit
avec le verbe lui-même. Exemples :
244*
Si le verbe
£)j£iU
rJ
J**"
intransitif ,
est
lui obéissent.
tous
£)yLjLï l> JiUj *Ilf Uj Dieu n'ignore pas ce que
jj>ôj> ^^ïjs" ci* 'à»f £)f
2.^%.
Le
nom
certainement Dieu peut tout.
d'agent se joint souvent à son complément
préposition J quoique le verbe d'où il
par le moyen de la
dérive soit transitif;
,
qui
complément précède
que le
arrive aussi
ce
a
quand il y
nom
d'agent.
lieu
le
complément objectif
(n.° 173). Exemples :
au
Et ils
Nous
ne
répondons pas
La même chose
dans
cet
l'oreille
faites.
vous
a
nous ont
inversion
,
et
La même chose
des verbes eux-mêmes
adorés.
de la conservation de
lieu
a
quelquefois
sans
qui
ce
est
inversion
caché.
,
comme
exemple cx^U û^U»f <^>jXlU Qjiuu» des gens qui prêtent
au
mensonge qui mangent des alimens impurs. Le verbe
:
,
complément par le
'moyen de la préposition J et par conséquent la même ma
nière de s'exprimer doit avoir lieu avec l'adjectif verbal tUali ;
f-f* signifiant fréter l'oreille,
,
son
gouverne
,
mais il n'en
est
l'adjectif verbal
raison du
cpi'en
246.
pas de même du verbe
ôy^=f
n'est construit ici
parallélisme.
transitif,
Si le verbe est
/// PARTIE.
le
'JJ=*\
avec
nom
,
et
la
je pense
que
préposition J
d'agent
peut
.
K
régir
1^6
son
LA
DE
complément
SYNTAXE.
de deux manières. i.° Il peut le régir à l'accu
le régiroit le verbe. Exemples :
satif , de même que
A-àw
les
jL-JU?
suivras pas leur kibla
Tu
ne
uns
des
£*L£ ££U4 ojI v*
et ils ne suivront pas la kibta
«^Uj>.»j L»j
,
autres,
Hâtei~vous d'arriver à ce jardin qui a été préparépour
généreux, et pour ceux qui étouffent leur colère.
Du nombre de
de leur
jupe
et
,
ces
enfans qu'elles
qui
ont atteint
ont
portés
l'adolescence
en
les hommes
liant les cordons
sans
éprouver
aucun
accident,
JJL
Ils
leur conduite,
ajouté que
ont
£ui j-ac A»j> J &Jl ljJl>9
j-*
au
milieu de leur
d'être indulgens pour leursfautes, etdtne
se
permettre
peuple,
aucun
étoit
excès.
exemple fait voir que ïes pluriels irréguliers
égard comme les pluriels réguliers.
comportent
2.0 Le nom d'agent peut aussi régir son complément
génitif. Exemples:
Ce dernier
à cet
,
,
/JvUJf f-fl^ <^uf I^-jJ
Seigneur, tu rassembleras les
Ceux
Dans
qui
ce
m.
croient
dernier
(j*^-J Jo
éprouvera la
ame
, -?.
'J
hommes.
•>-?
.
*f*
mort.
-
%"?
qu'ils
comparaîtront devant leur
cas
ïe
,
au
«Ji-ifi
oJ-Ll
Toute
•
se
nom
d'agent
seigneur.
peut avoir l'article
déterminatif,
pourvu que le
miné,
l'article,
ou
par
serviteur,
ou
par
un
I
SYNTAXE.
LA
DE
soit lui-même déter
complément
celui
^lu^UJÎ
comme,
ait
complément qui
ij
article
cet
le
qui frappe
comme
,
&0 ijAj ojllff celui qui frappe ta tête du serviteur; mais
on ne
déterminatif à l'antécédent, si le consé
peut pas donner l'article
est
quent
indéterminé,
serviteur /ou s'il
est
cû£ ÙjL*S\
comme
déterminé de
viteur. Ces constructions
d'agent
d'agent
est
au
est au
singulier
duel
ou au
celui
qui frappe
interdites
pluriel. Exemple
saurais
qJ^
quand
lorsque
qui y
me
qui
son ser
le
nom
le
nom
:
U.UyuCif
ont
celui
L>J^\
peuvent avoir lieu
Si les deux habitans d'Aden
ne
i\jJ ^
«^é^UJf
^iui L_^àc L^j cn«D <>U
de moi , pour moi je
ni
cependant,
,
un
manière que de l'une
Ainsi l'on ne pourroit pas dire
qu'on vient d'indiquer.
£\(j,)JLJ\ celui qui frappe Zéid,
le serviteur de Zéid, ni
qui frappe
toute autre
des deux
frappe
celui
jj-c UaÂj
fixé leur séjour ,
passer d'eux
un
se
qJ
passent
seul jour.
247- Lorsque le nom d'agent gouverne son complément
à l'accusatif, à la manière des verbes transitifs il ne perd point
il ne perd pas non plus sa
son tanwin. Au duel et au pluriel
finale y ou y; ce qui effectivement ne doit pas avoir lieu
puisque la suppression du tanwin et du y final est un effet du
rapport d'annexion. On peut cependant au duel et au pluriel
supprimer le q final et dire foLjjWj^-M les deux qui frappent
Zéid et îoôj fjjjtUf ceux qui frappent Zéid, comme si l'antécé
dent appartenoit à un rapport d'annexion (a).
Le nom d'agent peut aussi, dans le même cas avoir l'article
,
,
,
,
,
,
,
,
(a) Voye^ le
imp. n.° 1*34,
Commentaire d'Aschmouni
f. 64
recto
,
«t
sur
VAlfiyya,
la Grammaire d'Ebn-Farhât
man.
,
Ar. de ta Bibl.
n.° 1295
A, f.
verso.
K2
106
1^8
DE
LA
SYNTAXE.
déterminatif, parce que le complément objectif mis à l'accusatif
n'opère point, comme ïe complément des rapports d'annexion,
la détermination de l'antécédent.
248«
Si le
complément objectif
est
un
pronom
on
peut
les
isolés
l'accu
pronoms
employer
composés qui représentent
satif ( n.° 8 1 3 , i.rep. ) , ou les pronoms affixes (n.° 8o4 , i> rep.)> Si
l'on
les affixes
emploie
si l'antécédent
remment
dire
est un
perdre
«--jLjjLâJf
cslij_jjLJLff
et
ou
tanwin; mais,
il
sain,,
pluriel
pourra indiffé
l'antécédent
,
duel
un
ou
conserver
son
perdra
son
final. Ainsi l'on pourra
q
«LSjlâJf les deux personnes qui
SjijLcJl ceux qui te frappent.
et
On
,
le frappent;
emploie assez souvent en ce cas-là pour la première 3
personne du singulier l'affixe <> dont la destination propre est
de représenter l'accusatif, et qui à cause de cela ne se joint;
pas aux noms mais aux verbes (n.° 806, 1." p.). Exemples :
,
,
,
,
,
,
,
.
Usere^-vous
envers
f.
1-
•■»
•.?•!-
moi de bonne foi!
Celui
me
qui vient me trouver pour recevoir de
point frustré de son espoir.
tiendre^-vous parole!
moi
quelque don,
n'est
*£-ÎXé. <>s^.f JULJJf^Âc
Il y a un autre que l'Antéchrist
que lui pour vous.
Mon ami
y
m
en
ne
ait d'autres
étoit à
charge.
m'est pas à
qui m'inspire plus
charge, quoique parmi
qui pussent fournir
aux
besoins de
de crainte
les hommes il
mon
ami, s'il
DE
LA
Me permettez-vous de
se
passe dans
l'enfer) !
ï4p
SYNTAXE.
regarder,
(a).
en sorte
que
je regarde (ce qui
Cet usage de I'affixe £ prouve que l'on doit, ou du moins
que l'on peut , dans ces cas-là , -envisager les pronoms affixes
complémens objectifs mis à l'accusatif.
24o» Si le nom d'agent provient d'un verbe doublement tran
sitif qui a deux complémens objectifs immédiats (n.° 172), ou
d'un verbe qui a pour régime un sujet et un attribut (n.° 1 i4),
on peut user de la même syntaxe avec le nom
d'agent et lui
ou bien mettre le pre
donner pour régime deux accusatifs
mier complément en rapport d'annexion au génitif, et mettre
le second à l'accusatif. On dira donc \j^> Çy' foJj) ^Ui Lif
ou [>îfu»
Ijy où) ^.^Cit je revêtirai Zéid d'un bel habit. On dira
de même 5U lé IJI^ qUj' é>jf J* ou &U ^j> ^11? ôJ'f J* est-ce
que tu crois que Zéid est (un homme) sensé!
Par la même raison on joindra si l'on veut deux affixes
au nom
d'agent et l'on dira 'L-SZLLJl celui qui te l'a donné;
\&ù)àS celui qui me l'a fait manger.
2^0. Nous venons de voir (n.° 247) que les duels et pluriels
masculins réguliers du nom d'agent peuvent perdre leur y final,
quand ils sont les antécédens d'un rapport dont le conséquent
comme
des
,
,
■.
,
,
,
,
'
"'
"
v
de l'AIcoran
tirç
(sur. 37 v. // et ftfj.- on le lit
exemple
manières.
de
Celle
que j'aj adoptée est une de celles
l'explique
plusieurs
On
dit
Beïdhawi
qui
peut aussi supposer que celui qui parle
que propose
adresse la parole aux anges ; et que le pronom affixe tient lieu du pronom
isolé, comme dans ce passage : Ce sont eux qui ordonnent le bien et qui le mettent en
«pratique.» ^*_fyLf,J^tà-Ltt r^çy» JLJHf «^j ^ L&J3JL} ôsLlî. jl
(a)
Cet
est
,
et on
:
,
«
»
»
JuJULLltlj^C*- Q*j*^\
man.
Ar. de la BLbi.
imp.
n.°
Voyelle Commentaire
1
d'Aschmouni
sur
YAlfiyya*
23^4, f. i^recto.
K;
DE
j.50
LA
SYNTAXE.
l'accusatif. La même chose peut avoir lieu quand iïsjont
suivis de leur sujet au nominatif. Ainsi l'on peut dire _x*i \ *U.
\o^ «fjif (jiljliJf ou bien efj_=J s^Lj'LaJÎ l'émir, dont les deux
à
est
frères
ont
tué Mohammed ,
le
251. Lorsque
génitif,
s'il
autre nom
se
ticale
; ou
le
à
avec
lui
en cas
,
on
peut
mettre
observant la concordance gramma
l'accusatif, en se conformant à la concor
génitif,
mettre
<
d'agent gouverne son complément au
après ce. complément immédiat quelque
doive concorder
cet autre nom au
(a).
nom
trouve
qui
est venu
en
d'agent exprimant le même rapport
un véri
que le verbe leur complément est toujours logiquement
table complément objectif. Exemples :
dance
logique :
car
,
les
noms
,
Quiconque se lève (pour travailler)
et
cherche à
acquérir de l'honneur
des richesses.
O"? 0.9* ^' ^j
t5'J"^
^i* j'
Envoies-tu , pour venir à notre secours,
frère d'Aoun le fils de Mikhrak!
•'•
(jP*
ut
o&^î ô«jf J*
Dinar, ou bien Abd-rabbi
^H^^"0
-
-
c^>^-^ ZP,~^J *P^-M ut "(J1^1 rJ-4- (S^-^j V^ O^ ~& ^ Ô]
\j\^Ls* y&lj juxàîij iCkirjlJiit J^lâ.j A-UôVf ^w
Certes, c'est Dieu qui ouvre la graine' et
le vivant du mort;
éclore l'aurore;
la lune
un
qui fait
qui fait
le noyau pour faire sortir
sortir le mort du vivant.
.; qui fait
.
de la nuit le temps du repos
moyen de calculer le temps
et ses
,
.
du soleil
révolutions
(h).
de
n.® 1295
A,
(b).
(a) J'emprunte cette règle d'Ebn-Farhât, man. Ar. delà Bibi. împ.
f. 106
et
verso.
Alcor.
^JlJJf Jiiâ.
;
sur.
6,
mais la
96 et 97. Hincfcelmann a imprimé, dans son édidon,
leçon que je suis est celle des manuscrits, et elle est con
v
firmée par l'autorité de
.
Djélal-eddin
et
des
grammairiens Arabes.
DE
LA
SYNTAXE.
15
I
Ce dernier
exemple offre les différentes constructions du nom
d'agent. Le même adjectif verbal Ju-lâ. qui gouverne le nom
JlUf au génitif, gouverne à l'accusatif les noms JU^Ji et yX)\
qui sont plus éloignés.
2^2. Quand le nom d'agent doublement transitif gouverne
son premier
complément au génitif et son second à l'accusatif,
on
peut interposer le second complément entre le nom d'agent
et le premier
complément qui sont en rapport d'annexion.
Exemples :
,
t
*Uswf *Lii «jU
Quiconque
a
recours
tssffjlwj J^fj <iUy
à toi
est
&*
assuré de voir
par de riches dons , tandis que d'autres que toi
à ceux qui sont dans le besoin.
Ne
t'imagine
promesses (a).
Zfâ.
d'agent
Tout
sur son
pas que Dieu
ce
que
nous
jective
serviteurs de Veffet de
ses
avons
dit de l'influence du
tous
les
ou
rarement
(a)
noms
tant
Alcor.
nom
d'agent
les formes de verbes dérivés, mais
restrictions.
adjectifs verbaux
dérivés de la voix sub
primitif soient de la forme comrmine J*-U\
JU* Jyti et JUiu qui ont une valeur empha
fréquentative. Cela a lieu aussi quelquefois mais
avec ceux des formes J**i et
J^à Exemple :
-
,
,
,
ses
des verbes
du verbe
des formes
tique
comblés
refusent leurs bienfaits
complément, s'applique
subjective
i.° 11 faut que les
^*
frustre
à
adjectifs
primitifs que de toutes
cependant sous certaines
Jfj
ses vœux
verbaux formés de la voix
ou
ou
^sy
.
sur
14,
v.
47. On lit aussi *JL*,
oa2-j <J?^
K 4
LA
DE
1^2
filles
JO^wa- jeunes
SYNTAXE.
dont l'une ressemble à la nouvelle
,
l'autre h l'astre dé la nuit dans
son
tune,
et
plein.
d'agent est employé sans article, il faut qu'il
exprime un événement présent ou futur : s'il exprime un événe
ment passé, il ne peut plus être qu'en rapport d'annexion à la ma
et
nière des noms
gouverner son complément au génitif (a).
Avec l'article il s'emploie indifféremment pour tous les temps.
3.0 II faut, dans 4e même cas, qu'il soit employé comme
attribut d'une proposition ou comme adjectif servant à qua
lifier un nom, soit qu'il soit en concordance avec le nom^
homme monté
comme 11}* <-^%>l3 J^>f
<-^j/* ïai passé près d'un
2.0 Si le
nom
,
,
,
à cheval
ou
,
ULji 144= [3
que le
souvent
comme
,
o-^.y à*\ a»
à
Mais
monté
il arrive
cheval.
trouver,
la forme adverbiale
sous
Zéid est
venu me
sous-entendu.
est
nom
—
Exemple :
le sentiment unanime des
grammairiens que j'ai lus et des scocependant dans l'AIcoran même plusieurs pas*
sages où le nom d'agent sans article, et gouvernant son complément à l'accusatif,
semble devoir nécessairement être traduit par le passé. Les scoliastes, pour
ne
point déroger à la règle dont il s'agit, supposent qu'il y a dans ces passages
une
énallage de temps, le passé étant employé pour le présent, par une sorte de
prosopopée. Pour moi, je doute beaucoup de la vérité de cette règle, qui ne ms
(a)
Tel
est
liastes de l'AIcoran. Il
se trouve
pâroît fondée sur aucune raison solide. Le vers que je citerai tout-à-i'heure,
ï'J& A>[jjf me paroît absolument contraire à cette règle; car on ne peut y tra
duire les verbes j.«àJ> et
^J que par le passé, ce qui exige que l'on donne
aussi à J?(j la valeur du passé. Je sens bien que l'on pourroit lire ëjjs? À>\jjf
,
,
ce
qui
détruiroit
l'objection ;
deux commentateurs
d'un
et
d'agent
l'autorité desquels
à
changeroit
la
mesure.
D'ailleurs les
je cite ce vers, le donnent pour exemple
<•
qualifier un nom sous-entendu (j
qCv
C5 y*>y *—
Cj?ji>-->:
complément à l'accusatif; ce qui ne permet point de substituer
voyelles. Vbye^ Mss. Ar. de la Bibi. imp. n.° 1*14, f. 6.0 verso. et
nom
gouvernant
d'autres
sur
mais aussi cela
servant
«•■«
uri
Mss. Ar. de S. G. n.° 465
A
,•
f.
i
j
3
recta.
■
DE
Jcjjf Juj9 t^jfj U^âj yi
Comme
(un bouquetin) qui
roche pour la briser; il
brisé que
sa
propre
ne
lui
I
SYNTAXE.
LA
Lj^jaI, l*y «j-^ Ày^*
w/z
,
a
53
/o^r,
frappoit
fait aucun mal,
et
de
sa corne une
le
bouquetin n'a
corne.
Observons que le
d'agent ayant l'article déter
minatif équivaut à un adjectif conjonctif et à un verbe. Ainsi
f^1yf"Jj'Uu f f ji> est équivalent de \*f^ «y f Jui ^jJf foi» celuici dont le père a tué Amrou (n.° 703 //' p.).
2^4«
nom
,
S. IL Syntaxe
des
Adjectifs
Noms
verbaux
appelés
de patient.
adjectifs verbaux dérivés de la voix objective des
verbes tant primitifs que dérivés et nommés noms de patient,
suivent en général, pour leur syntaxe, à l'égard des noms qui
leur servent de sujet et de complément les mêmes règles que
les noms d'agent, autant que le permet la différence des signi
fications de l'actif et du passif. L'influence de ces adjectifs est
donc celle qu'exerceroit le verbe lui-même.
Les verbes neutres n'ayant point de voix objective il n'en
peut être question ici.
2?<. Les
,
,
,
2^6.
Les verbes transitifs
passant à la
signification
passive prennent pour sujet grammatical le mot qui formoit
leur complément immédiat lorsqu'ils étoient à la voix sub
jective comme je l'ai exposé précédemment (n.° 178). II
en est de même des
adjectifs verbaux dérivés de leur voix
objective.
2
J yr II faut observer ici que l'adjectif verbal formé de la
voix objective s'emploie, aussi-bien que îa voix objective elle,
en
,
,
même
,
de trois manières différentes.
personne
sur
laquelle
tombe l'action.
1
.° II
qualifie
la chose»ou la
Exemple: ôyj-H^Î w^
I}4
DE
SYNTAXE.
LA
c'est-à-dire, qui
les hommes battus,
ont
été battus ,
ou
que l'on
a
battus
(n.oi 178 et 1 86).
qualifie l'action même exprimée par ïeverbe à la vonf
subjective (n.° 187). Exemple: ù^^Xlùj^l le coupfrappéy
c'est-à-dire qui a été frappé ou que l'on a frappé.
3.0 II qualifie une chose ou une personne qui ne serviroit
que de complément indirect au verbe mis à la voix subjec
tive (n.° 189) ; et le plus souvent, dans ce cas, il n'est joint à
aucun nom
le nom étant sous- entendu. Exemples : ^îyif
*lo
çfJi&\ le lieu d'où l'on est sorti; *yi JJy>.<>lU le lieu où l'on
2.0 II
,
,
,
est
entré.
Le
2^8.
Exemple
jectif verbal
tanciel
nom
«yf ali. Jyi.0 o^.j
:
On peut aussi le
l'accusatif
du
sujet
patient
se
met
Zéid dont le père
génitif,
en
est
au
nominatif
tué en cet instant.
établissant
entre
l'ad
rapport d'annexion ; ou le mettre à
forme adverbiale comme complément circons
et son
sous
: on
mettre au
de
sujet
un
,
dira donc bien <_jV f
"Jyli ô^.j
ou
ÇiVf JyX»
.
objective d'un
l'adjectif
verbe doublement transitif, il gouverne nécessairement à l'ac
cusatif le second complément objectif du verbe. On dira donc
C^Ji VoXs, J*** dôj l'esclave de Zéid a été gratifié d'une pièce
2^Q.
d'argent.
260.
verbaux
verbal dérive de la voix
Si
Ce que
qui
sont
disons ici de la syntaxe des adjectifs
dérivés des verbes à la voix objective, s'apnous
plique aussi à quelques adjectifs de la forme Ju*> qui ont la
signification passive.
26 1 Les conditions requises pour que ïes noms d'agent
exercent sur leur sujet et sur leurs
complémens la même in
fluence que le verbe (n.°2j3) sont également applicables aux
nomi de patient.
262. Observons que, pour se rendre raison de la manière
.
,
DE
dont
SYNTAXE.
LA
155
verbaux dérivés de ïa
arabe les
emploie
adjectifs
des
il
verbes
faut
le plus souvent analyser ces
objective
expressions en substituant à ces adjectifs ïe verbe lui-même au
prétérit ou à l'aoriste de la voix objective en suppléant un sujet
qui est sous-entendu et enfin en substituant l'adjectif conjonctif
tjjJf à l'article Jl ou les noms conjonctifs ^ ou Li s'il n'y a
point d'article. Exemples :
on
en
voix
,
,
,
,
,
Les mères nourriront leurs
obligé de fournir à
U
qui
il
}J'^>\
est
né
//
h*
U
ïjy
est
un
un
fils
est
l'équivalent
enfant.
grande
de
oJj
mère soit
l'équivalent
ans
entiers,
et
le père
sera
de
Sij
*J
J^]j <jôj\ J»->ff
grevée
«J
par
son
û\j \$» qui
l'homme à
ni
un
soit à
qui
enfant,
que
ce
né.
Jy>\ tjôâs
Quant
deux
leur subsistance.
^tf«£ /?rfj qu'une
père par son fils.
est
enfans
aux
UlJf
pyramides
célébrité, elles
jUltf l$xé oô^-If ify>Vi
dont
sont au
on
parle
tant>
qui
ont
Lof
acquis
une
si
nombre de trois.
l^fl jUllf l^é oïsCÎltf est la même chose que Ulé oI>^ cfc^
UÀJf jUj jjf desquelles il est parlé, qui sont montrées au doigt.
Ces verbes passifs qui n'ont point de sujet grammatical, doivent
être expliqués ainsi en substituant l'actif au passif, ^yû^ûi <jJ\
U^ÔjJ^j J»wt Iw* <&nf /« hommes parlent et qu'ils montrent
au
doigt.
,
,
I<j6
SYNTAXE.
LA
DE
jlS'VJS Xx&$f'j&^
Z<?
f Âon/n
pratiqué
,
lequel
un
glacis.
/?dr
c'est
**?.
marche ,
on
t»l
âylllf
qui
et
est
très -fréquemment
^j— £» U *£ ciUo L%
**s
ou
ce
q^s^Uu U
qui est la même chose Ijjsjlkjj j»UJt
l'endroit par lequel les hommes marchent et qu'ils pratiquent,
J^lîf
*a»
âjfoltî
l'équivalent
est
,
,
Dirige-nous
as
de
vers
le droit chemin,
comblés de grâces ,
oyàiif^
&U
et
,
qui
le chemin de
vers
n'ont point été
c'est-à-dire,
un
objet
ceux
^«oj invectum non est cum iracundiâ) , ou,
même chose , quoique d'une manière plus déterminée
ce
cwtfra
(X»f
IfÂJLé L^àX'/l
J'ai
multiplié
idiotisme de la
contre
lesquels
les
exemples
langue arabe
s'est pas mis
tu
qui-est^Ia
,
qj jJt
colère.
en
parce que cet
des comsaisi
difficilement
analyse
de cette
est
que
(à la lettre,
kjléô-^'f lH<^
on ne
,
de colère.
,
mençans.
S. III. Syntaxe
Adjectifs
des
ment
263»
Les
adjectifs
verbaux
simple
QUALIFICATIFS.
s'agit ici sont dérivés des verbes,
espèces d'adjectifs dont nous avons
dont il
aussi- bien que les deux
parlé jusqu'ici ; mais il y a cette différence , que toutes les formes
tles verbes , soit primitifs , soit dérivés , donnent naissance à des
noms
d'agent et
miers , de la voix
à des
noms
subjective
suivant des formes fixes
,
et
de
et
tifs dont il
sont
ils
les
,
déterminées
minée ,
s'agit ici ne
quoique souvent
noms
d'agent.
patient qui
dérivent
les derniers , de la voix
se
assujettis
à
les pre
objective
adjec
,
lieu que les
; au
aucune
confondent
,
,
à cet
forme déter
égard
,
avec
l64-
SYNTAXE.
LA
DE
I
57
adjectifs diffèrent aussi des noms d'agent, et de
signification et aux rapports dont ils sont
Ces
quant à leur
patient
susceptibles.
i.° Les adjectifs verbaux, appelés
peuvent avoir,
noms
les verbes d'où ils
comme
d'agent et de patient
dérivent, une signi
,
signification relative ; et dans ce dernier
complémens objectifs les adjectifs verbaux simple
ment qualificatifs n'ont point de complémens objectifs ; ils n'ont
que des complémens circonstanciels. II y a donc à cet égard
la même différence qu'il y a
entre ces deux sortes d'adjectifs
entre les participes et les simples ad
en latin ou en françois
des
verbes ; par exemple entre temperans par
jectifs dérivés
ticipe dans ces phrases temperans famœ ou principes tempérantes
imperium prudentia, et le même-mot simple adjectif dans celleci hominis frugi et temperantis functus officium ; entre doctus, par
ticipe quand on dit doctus musicam et adjectif lorsqu'on dit
homo doctus. La même différence se remarque, en françois, entre
ces deux expressions un homme tempérant et un prince tempérant
la rigueur de l'autorité par une sage prudence.
2.° Les noms d'agent et de patient renferment, du moins jus
qu'à un certain point l'idée de la production de l'attribut qu'ils
fication absolue ,
cas
,
ils
ont
ou une
des
:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
expriment
,
comme
liée à
une
circonstance accessoire de temps
;
que , s'ils avôient des formes diverses pour exprimer le
ïe présent et le futur , ils seroient de véritables participes.
en sorte
passé
,
adjectifs simplement qualificatifs comme je f rouge f.jf
généreux &jy2i noble, n'expriment qu'une qualification dépouillée
Les
,
,
,
de
idée accessoire.
toute autre
265»
Les
soit dérivés
comme
action
J^k
qui
,
adjectifs verbaux formés des verbes soit primitifs,
qui n'expriment qu'une simple manière d'être,
être pur,
ne
sort
^S.
pas du
être beau,
sujet
,
itî^J
comme
être droit,
iU"
se
tenir
ou une
debout,
I
58
LA
DE
SYNTAXE.
doivent être considérés très -souvent
classe des
aient la forme des
^JaÂJf j.*U
cœur,
verbaux
adjectifs
appartenant à la
comme
simplement qualificatifs quoiqu'ils
,
d'agent. Exemples : oiàJf y^ pur de
de ventre,
Ç|)f J**** tempéré d'air, c'est-
noms
mince
tempéré, ^pû-VI jsy&^ droit de mœurs. Il en est
de même des adjectifs verbaux dérivés de la voix objective des
verbes simplement transitifs, comme .eUjJf otf£»« (un homme)
exaucé dans ses prières.
266. Quoique ïes adjectifs simplement qualificatifs tels que
beau, sage, modeste, rouge, n'aient point rje complémens objectifs,
ils peuvent être modifiés par des complémens circonstanciels.
On peut dire, un homme beau de taille, un jeune homme sage dans
un
sa dépense un philosophe modeste dans ses paroles
enfant roux
de cheveux. Pour peu qu'on fasse attention à ces expressions,
on reconnoîtra que les adjectifs beau, sage, modeste, roux, qua
lifient beaucoup moins ici les noms homme jeune homme
philosophe, enfant, avec lesquels ils sont en concordance, que
les noms taille, dépense, paroles, cheveux, qui leur servent de
complémens circonstanciels. Cela est si vrai que l'on pourroit
à-dire
,
d'un climat
,
,
,
,
,
,
dire
:
un
laid,
homme
mais beau de
taille;
un
jeune
homme
cor
rompu, mais sage dans sa
modeste dans ses paroles ;
Veut-on donc réduire
faudra dire
:
un
homme
dépense ; un philosophe orgueilleux, mais
un
enfant très- blanc, roux de cheveux,
ces
expressions à leur juste valeur, il
dont la taille est belle; un jeune homme
dépense
sage c'est-à-dire, bien réglée; un philosophe
dont les paroles sont modestes; un enfant dont les cheveux sont roux,
Ces adjectifs avec leur complément circonstanciel forment
donc réellement une proposition conjonctive, qui a pour sujet
le complément circonstanciel et pour attribut l'adjectif; et cette
proposition entière forme la qualification complexe du nom
auquel elle est jointe par l'adjectif conjonctif. Ainsi dans le
dont la
est
,
,
,
,
,
DE
dernier
LA
SYNTAXE.
159
le
exemple l'adjectif roux qualifie
la proposition conjonctive dont les cheveux sont
nom
enfant.
,
nom
cheveux ; mais
roux,
qualifie
le
Les Arabes
2.&J.
l'adjectif et
le
nom
de trois manières
expriment cette sorte de rapport entre
qui lui sert de complément circonstanciel,
:
l'adjectif son tanwin ou son article déter
minatif, et ils .mettent le complément au nominatif. Exemples :
t_>y| ,^0» Ja'j (£*U. ou ojjf q^âH est venu me trouver un homme
1
.° Ils conservent à
dont le père
près
est
beau ;
tÀjl\
d'un homme laid de
g.*?
Ja-Jj cpjj* ou*-^alJ gù j'ai passé
visage.
2° Ils mettent les deux mots
étant
plément
au
il
génitif.
*-*~â.j ^^â.
»â.JJ f qZâ J*Jj £ijj»
ou
rapport d'annexion le
Exemples : * a.y f ^^â J^J
,
—
est venu me
ou
en
trouver un
homme beau de
f^&Jïj 0^- j'ai passé près
com-
ç^L?»
visage;
d'un homme
beau de
visage.
3.0 Ils conservent à l'adjectif le tanwin ou l'article et mettent
le complément à l'accusatif, sous forme de terme circonstanciel.
Exemples : L|4"J &***■ J4-J à^- ou *-?-j^ ^.^..â. il est venu me
,
trouver
un
homme beau de
visage ;
JL^jJj ^jJiô. j'ai passé près d'un
article
,
—
§îLj ^^i. Ji-^Jj ojj*
homme beau de
il imite le
plément
déterminatif (n.° 1 20) ; s'il a
objectif du verbe (n.° 85).
est sans
L
terme
l'article
,
visage.
Si le
ou
com
circonstanciel
il imite le
appelé
complément
Le
de
premier genre de syntaxe est conforme à l'analyse logique
ces
expressions : le second est contraire à cette analyse ; et,
quoique formant
une
un
rapport d'annexion
,
véritable détermination de l'antécédent
peut-il
le soit
être déterminé par l'article
pareillement.
il
:
ne renferme pas
aussi l'antécédent
pourvu que le conséquent
Le troisième genre de syntaxe exprime bien
,
iô'o
DE
le double rapport
SYNTAXE.
LA
existe
qui
entre
l'adjectif
ïe
et
nom
le même
le
qu'il
adjectif
qualifie grammaticalement et entre
qu'il qualifie logiquement.
268. Le nom qui dans cette expression est en rapport
d'annexion avec l'adjectif et lui sert de complément se nomme
en arabe L^ cause
parce que c'est lui qui est cause que la
qualification exprimée par l'adjectif est appliquée au nom qua
lifié par cet adjectif. On le nomme aussi par la même raison
cjyl^LIf 4>1^ c'est-à-dire, la cause qui rend le nom qualifié
susceptible de'la qualification. Quant à l'adjectif qualificatif, il
se nomme
lfi-+» relatif à la cause. En effet quand je dis un
,
et
nom
,
,
,
,
,
,
,
,
,
enfant
de chefeux ,
roux
la
sont
ce
les cheveux de
lui fais de
de
cause
l'application que je
l'on peut dire avec vérité que cette épithète
tsxfoccasionnellement , mais non réellement (a).
sont
et
cet
enfant
l'épithète
ne
qui
roux;
lui convient
2Ô0. Dans les trois genres de syntaxe dont je viens de
parler, l'adjectif verbal qui forme l'antécédent du rapport, peut
être
employé avec ou sans article déterminatif; et le nom qui
complément de cet adjectif, peut être ou indéterminé
forme le
,
déterminé
ou
i.° par l'article
article
,
dans
:
ce
il peut être déterminé,
2.0 par un complément qui ait cet
dernier
cas
déterminatif,
un affixe
4«°
3 .° par
par un complément déterminé
affixe. II en résulte un grand nombre de
,
lui-même par un
constructions différentes , dont les
(a) L'adjectifqualificatif
dis
un
,
o*J
e*t ou
homme sage, ou occasionne par
enfant roux de cheveux.
un
unes sont
réel,
une cause
tout-à-fait
rejetées
effectif "&*£». comme quand je
étrangère, comme dans l'exemple
,
Voy eiTh. Obicin Grammatica Arab. Agrumia appellata p. 130; Ebn-Farhât,
Ar. de la Bibl. imp. n.° 1295 A, f. 12,2 verso ; les commentaires sur
KAlfiyya
,
,
ms.
d'Ebn-Malec
n.°
465, f.
,
ms.
120
Ar. de la Bibl.
imp.
n.°
1234, f. jx
recto, et ms.
Ar. de S. G.
recto.
par
DE
LA
l6l
SYNTAXE./
par les
grammairiens ; d'autres désapprouvées et dont cepen
a des
exemples ; d'autres tolérées, mais d'un usage rare;
d'autres enfin généralement admises et d'un usage fréquent
mais plus ou moins élégantes. Nous n'indiquerons ici que les
,
dant il y
,
principales.
Constructions
désapprouvées
â.j tfZô. fyLj
Lj fj^\ i>j)
«J?»j ly»Â \)aj
*u
«
of
of *_a»j
un
,
mais dont il y
homme beau de
Zéid beau de
un
visage.
père
père
est
est
beau de
beau de
Constructions tolérées, mais d'un usage
i
â^~
5^
$j£-
JtAj
ij*»*.
jAj
t
un
exemples.
visage.
homme dont le
Zéid dont le
Q^f o-îj
des
a
homme beau de
visage.
visage.
rare.
visage.
%„*o
jusjf
*â.j lyï JJLj )
un
homme dont le
père
est
beau de
Constructions bonnes.
i— lyl
*—*—
*>ii J4j
^J (J^*
l
—
J^J
ÂJLj ^i, ^J^/,
\
II.' PARTIE.
un
honune beau de
visage,
L
visage.
l6:
DE
*
-»
•-
*--
«h
*
$1-»-
--
^
jYi
Ol
*a., [.i-«o.
y^.3 )
*_a.j q^ua. Ja-j
—
j
.»
.
^
.
J
.
„
,,-yf
—
I
i
)
(j-^^f 0^3
*->o
j>*»^
*,.,*„,•'*$;)
f ia.
I
of
ou\\
a-j
(J-^^ ^3
02lf *Aj
(J-»^f 0^3
*—
Zfwf ^&zk <fc
?'
0
,
,
j
j
,,*■%
visage.
visage.
"Z-èid dont le
s
_,j* $
.,
.,
père
est
beau de
visage.
|
Constructions
.
be-au de
^J
oVf *a.j
«
est
..
o^^1 °°J
'
père
<>jj
g—*-j
—
homme dont le
^
j...'* $.,
^—^j o*^'
*
SYNTAXE.
J4»j
jL a.^f ^j^-^f
'
un
LA
\
(
rejetées.
Zéid beau de
Z<?if</ «sfofff /<?
visage.
^«
«f
£&zz/ <//»
visage.
270. L'adjectif verbal simplement qualificatif peut
,
même
DE
lorsqu'il est joint
LA
à l'article
déterminatif, prendre les affixe!. Ex.
»j^J\j Q>Jji\ joivîjf y]à521\ j^iff
qui a la tête forte, et qui l'a petite.
27 1
l6y
SYNTAXE.
celui
qui
est
laid de figure,
II faut observer que, dans toutes les constructions dont
de parler , l'adjectif verbal doit concorder en cas
.
nous venons
avec
met
cela
le
auquel
nom
donc
au
change
il
se
nominatif,
rien , du
reste
grammaticalement.
rapporte
au
,
à
à
On le
l'accusatif,
génitif
que
des
nVis
l'application
règles que
ou
sans
Exemple : J>Sj f£f i£ \ ^ <££* oJU iLi ô~** &Lo
tu as été mis à
l'épreuve par l'attaque d'un cavalier au cœur intré
pide, éprouvé par l'infortune dont l'épée n'est point émoussée et
n a
point perdu son tranchant.
Je reviendrai là-dessus quand je traiterai de la concordance.
272. Observez aussi que le complément des noms d'agent
étant mis à l'accusatif, on peut le placer avant son antécédent,
comme on
peut le faire avec le verbe lui-même; ce qui ne peut
pas avoir lieu avec les adjectifs verbaux simplement qualificatifs.
avons
données.
,
CHAPITRE
Syntaxe
XIII.
Complémens objectifs des Verbes,
Complémens, dans le cas d'inversion.
des
et autres
273 Selon la constructionMâpïus ordinaire en arabe dans
propositions verbales (n.° 1 4-4) on place d'abord le verbe,
en second lieu le
sujet et ensuite le complément objectif du
verbe
soit immédiat
comme dans \j!e oûj J^9 Zéid a tué
.
,
les
»
,
,
,
Amrou, soit médiat
comme dans iNjJj
,
jj^f j> Amrou a passé près
On peut néanmoins placer le complément objectif
avant le verbe , ainsi
que nous le dirons quand nous parlerons de
la construction.
Exemple : «JXUf aJU £*. uûjj»} ^ô^ uup
de Zéid.
,
'"L2
164.
il
DE
dirigé une partie
a
une autre
Nous
SYNTAXE.
LA
d'entre
eux
,
et
l'égarement a
été prédestiné pour
partie.
rendu compte d'une
déjà
avons
autre
construction
complément objectif du verbe est mis au
^<le la proposition sous forme de nominatif
et remplacé après le verbe par un pronom
absolu (ri.9 62)
personnel qui ïe représente et nous avons fait connoître de
quelle manière les grammairiens Arabes analysent ces proposi
tions (n.° 1 4^ ). On petit dire
suivant cette construction^
jJ^ilJf èCXs. gL ^,y une partie, l'égarement a été prédestiné sur
le
laquelle
dans
commencement
,
,
,
,
elle
,
lieu de
au
sur une
jJ^U.jf ^a
^jj3 <Ji.
On diroit de même
partie.
l'égarement a été prédestiné
o^.j *i*$ jj!f Amrou, Zeïd l'a
lieu de
\jlf- i>J) J^ Zéid a tué Amrou.
des'exprimer le verbe, soit transitif, soit
ïntransitif perd son influence sur son complément objectif im
médiat ou médiat parce qu'il exerce cette influence sur le pro
nom qui représente ce
complément r on appelle cette sorte de
construction Ju^if ce qui signifie A« détourné ou distrait de son
objet; le complément objectif se nomme Hé^uCif l'objet du
quel est détournée ou distraite l'influence du verbe; et enfin le
pronom, qui, en attirant sur lui-même l'influence du verbe, la
distrait de dessus le complément objectif, se nomme
^è&lf
tué ;
au
Dans
cette
manière
,
,
,
,
ce
qui
détourne
Mais il
lieu dans,
ce
cas,
indispensable
ainsi
objectif
Exemples
ou
distrait.
est encore un autre
:
et
qui
même
elle consiste à
déplacé
,
et
genre de syntaxe qui peut avoir
est
quelquefois d'une obligation
l'accusatif le
mettre à
représenté
par
un
:
%
*-?
Si
*
J
~
'
ô-$" *-Hfà
tu rencontres
Zéid,
'
fjoj (jf
amené
complément
pronom
-le moi.
personnel.
DE
*aJ_&
i^?
Toutes les fois que
tu
*j
ôj3-« [><f
passeras
65
1
\
SYNTAXE.
LA
w^=»
d' Amrou, salue-le.
auprès
l'exemple que j'ai donné, il n'y a qu'un
instant (a) 011 lit iJXU f &Û& ^ lïujj et non pas £&*
274* Tantôt le complément objectif, ainsi déplacé doit
C'est ainsi que dans
,
.
,
,
nécessairement être mis
rement être mis à
être admis
au
l'accusatif.
tantôt il doit nécessai
nominatif,
Quelquefois
indifféremment. Enfin il y
a
l'un
ou
l'autre
cas
peut
des circonstances où
cependant exclure l'usage de
l'autre. Je vais entrer
quelques détails,
le complément objectif, placé avant le verbe
est
Si
275*
précédé de quelque conjonction conditionnelle ou suppositive
de quelque adverbe conjonctif ou excitatif ou en général,, de
quelque mot qui soit propre aux propositions verbales il faut
nécessairement mettre le complément objectif à l'accusatif. La
raison en est que vu la liaison qui est entre le' mot qui pré
le complément
cède ce complément et le verbe qui le suit
ne
considéré
comme le sujet ou l'rnchoatif
être
déplacé
peut
d'une proposition nominale. On dira donc nécessairement
l'un des. deux
est
préférable,
sans
la-dessus dans
,
,
,
,
,
,
,
■
Si Amrou eût tué Zeïd, il auroit rendu servie*
en
a
tous
les, hommes
général.
(JjJJa. U*
ouï de Mohammed
Ça donc, j'ai
Toutes tes
&J.A o**A»
fois
(ajCet exemple
est
que
je
ItX-éJ^
une
2ub
chose
verrai Alahmoud
tiré de l'AIcoran,
sur.
,
qui
je
7 ,v. ji.
m'a attristé.
l'honorerai.
l66
On
au
ne
SYNTAXE.
LA
DE
pas dite dans
pourroit
exemples oJjji
ces
nominatif.
<>*-*?
-
ïj*£
-
!
précédé d'un
complément objectif déplacé
mot dont l'usage soit d'être mis devant le sujet ou inchoatif
le complément objectif doit être
des propositions nominales
Si le
276.
est
,
nécessairement mis
nominatif. II
au
en est
de même si
,
entre
complément objectif déplacé et le verbe il
mot qui par sa nature
doive être toujours au commencement
d'une proposition. Dans ces deux cas le complément objectif
déplacé ne peut être considéré que comme le sujet ou inchoatif
d'une proposition composée (n.° i48) et, par conséquent il ne
peut être mis à aucun autre cas qu'au nominatif. Exemples :
le
,
se trouve un
,
,
,
,
,
jflé
*->j-«ûj
voilà
cJj fif^
l^c. l£j ja LiLU I>f^
*-^fj J* o*Àj
1£!16*\S
*I».V
as- tu
o*£
jXj'jjfJ
i*JUsi IkXAAj
je
n
voila,
Fatime.
,
point parlé a Aiohammedi
j'aime Abou-becr.
certes
<jf 2fp
Zeïd.
qu' Ali passe auprès de
Zeïd!
vu
ai
qu' Amrou frappe
si
je
rencontre
Amrou ,
je
le tuerai.
Dans ïes deux premiers exemples, le nominatif est
\>l signifiant voilà,
ne se
place que devant
que
et
le
exigé, parce
indiquant un événement subit (a),
sujet ou l'attribut d'une proposition
nominale.
Dans les quatre derniers exemples , on doit employer ïe nomi
natif, parce qu'il est de la nature de Ji adverbe interrogalif ,
(a-)
On
imprévu
nomme
ï \â. UU f
dans
I>f
.
ce
cas-là l'adverbe
fif
adverbe
exprimant
un
événement
DE
LA
l6j
SYNTAXE.
U adverbe négatif, de J adverbe affirmatif,
de
de
et
^[con
ainsi que de tous les mots qui ren
ferment la valeur d'une condition ou d'une supposition , d'être
jonction conditionnelle,
à la tête d'une
proposition ou d'une phrase (a).
complément objectif déplacé dépend d'un verbe
277.
une
prière, un ordre ou une défense, c'est-à-dire,
qui exprime
qui soit à l'impératif, ou à l'aoriste conditionnel ou énergique
dans le sens impératif ou prohibitif, on peut le mettre au nomi
natif et à l'accusatif; mais l'accusatif est préférable. Exemple :
toujours
Si le
V
^^ICff ^*"i-UÏ
aie
pitié de ton
soit du
II
serviteur ,
nombre des
en
est
&£*>■'kJ\
éèc^- '^K^lty
Mon
permets pas que le fils de
et ne
ton
Dieu,
serviteur
infidèles.
de même si ïe
ticule dont
le
complément
est
précédé d'une par
employée avec
ordinaire soit d'être
plus
l'usage
verbale
comme les adverbes
proposition
interrogatifs les
et
V
U
adverbes négatifs
l'adverbe conjonctif c^L quand il
ïi'est pas joint au mot U Exemples :
une
,
,
,
,
.
*jçJïI f^= o-^âj t^C^s fJL)j u
Je n'ai pas parlé à Zeïd; et quelque part que je rencontre Amrou,
(à(J\
je
te
«-? o*»*
l'amènerai.
//
Dans
ce
jl^ff îdjoJ ^f UJ jçIj jjôîJf V
ne
faut point que le soleil atteigne la
dernier
plément est 'au
exemple erapr^ité de
nominatif, quoique précédé
•—
(a)
verbe
,
,
La même chose
j3 interposé
,
,
a
entre
lieu dans
le
ce
l'AIcoran
et
le verbe:
,
à
cause
IsCUi
«JUli»
(jùiau U,Uj ensuite
'«nvoyé un profond sommeil qui s'est emparé d'une portion d'entre vous
•utre portion étoit
agitée par ses propres pensées.
>£«Jul *£*-^l
i\9
*-*J}*>j /*£-**;
com
\
,
passage de l'AIcoran
complément déplacé
le
,
de V.
T
,
,
lune.
,
de
J'ad-
Ji.if ^*
Dieu
vous
tandis
qu'une
L4
a
IÔ'S
L'adVerbe
SYNTAXE.
LA
DE
interrogatif J*.
forme,
une
exception
exigeait
,
absolument, quand il précède le complément objectif déplacé,
que
ce
complément
soit à l'accusatif.
employer le nominatif ou l'accusatif,
quand la proposition birse trouve l'inversion est jointe immédia
tement à une
proposition verbale; mais l'accusatif est préférable.
C'est ainsi que Ujj.9 est mis à l'accusatif dans l'exemple que j'ai
278.
On peut
encore
,
cité de l'AIcoran
:
iJ^àJl +£&
^
uyj.9j {£&*> v*4j* il
été
dirigé
a
une autre
partie.
prédestiné pour
cette
Uù>3
proposition
^ ^jji parce que
à
la
est jointe immédiatement
la
conjonction J
proposition
par
verbale ^ô^ &o>. Si l'on eût interposé le mot l^f
quant à, il
auroit mieux valu dire Jjâ. ^Js l!of^.
On suivroit aussi la même règle quand le verbe de la pre
mière proposition seroit neutre ou passif. Ainsi l'on diroit pa
reillement «J^LJf *&*)& ^30. tëjjjj ^Jji isoJà>\ une partie a été
dirigée, et l'égarement a été prédestiné sur une autre partie.
2-JQ' Si la proposition où se trouVe l'inversion est jointe
immédiatement par une conjonction à l'une de ces propositions
composées que l'on nomme propositions à deuxfaces (n.° 1 48 note),
parce qu'elles imitent par leur inchoatif les propositions nomi
nales et ,~ par leur prédicat composé les propositions verbales,
le complément objectif déolacé se met indifféremment au nomi
une
partie,
l'égarement
et
On dit £*.
,
a
et non
,
,
,
,
natif
,
ou
***>£
à l'accusatif. On dira donc indistinctement
tî^J
ou
bien
li^Ja. ^^J£j
Omar
tous
les
prévus
a
été tué,
et
J-ù' ^J
j'ai
blessé
Amrou.
280. Dans
dentes,
on
nominatif
1*>J4.
peut
est
tu as
employer
préférable.
tué
cas
Zeïd,
non
le nominatif
par les
ou
Ainsi l'on peut dire
et tu as
règles précé
l'accusatif;
a»
f
mais le
û&'jïiùà fo^j
blessé Abd-al{ak ; mais il
vaut
DE
mieux dire
l^J-â.
âof
LA
oSlj
I
SYNTAXE.
ixJ&
o>—
Jj
sous
,
o'p
la forme d'une
proposition composée.
28 I. Toutes les règles précédentes s'appliquent également,
comme je l'ai dit au commencement de ce chapitre (n.^273),
au complément immédiat des verbes transitifs et au complément
médiat des verbes intransitifs ; et de même qu'on dit ajc^fU oJj
et iLcJl^fôJj U je n'ai point parlé àZeïd, on dit aussi
oj3* ^ <^j
et
o3>* '^M3 ^ je na* point passé auprès de Zéid.
282. Elles ont aussi leur application lorsque le complé
ment déplacé par l'inversion n'est point le complément objectif
du verbe mais le second terme d'un rapport d'annexion qui a
pour antécédent Ie*compIément du verbe. Exemples
«j
«j
,
,
:
«JmCcM^s wé Ju\
./e fl'tfi
OU
/?o/k£ /?W^'
oiM£
o~^i=>
fjoj, U
serviteur de Zéid.
û«
tMj ou «Lciu oj*«f ftJoj Lo
Je n'ai point donné ordre de tuer Zéid.
juLcJù
Les
Arabes
mots-oJJx
oj^f U
et
J*3'
,
dans
exemples,
ces
sont ce
que les
appellent l$*Z, (n,° 268).
283*
La chose seroit
encore
la
même,
si le
complément dé^
étoit le
complément objectif ou circonstanciel d'un -second
servant de proposition qualificative au complément du
premier verbe comme dans ces exemples :
placé
verbe
,
«JsftJ loô>î
Je n'ai
«Jj<
os&£=» U t>Jj
parlé
fi>^a.f
JV n'ai
0^3
vu
ou
à personne
*-*
jj-^
personne
ou
«JJiJ fo^â-f oUi=»
qui
*r^
fouj
U
ait rencontré Zeïd.
3~° ^à^\ O^fj fjn£ ^»
qui jait passé près
d' Amrou.
jU^se.JjLi. f<lif o^fl J* ,oûj ou *Jo.î? ^s[J» fjlkf o^ foûj ji
Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un de ceux qui ont1 voyagé avec Zeïd!
DE
Ï70
LA
SYNTAXE.
*
*
t.
.
284*
Verbaux
server
Enfin
sans
exercer aucune
Ainsi l'on
ne
Zeïd! parce que
o4)
les
l'article déterminatif J f
que l'article a ,
que la proposition
sur ce
ce cas
:
,
la raison
la valeur
proposition
ne
28 J. Toutes les règles
tion dans
,
avant
peut avoir
ne
qui précède son antécédent
o-*I
toi
qui frappes
antécédent de la
placé
proposition conjonctive IjjULff qui équivaut à «jj^J (jô)\
dernière
con
conjonctive
direïL>jLUf ÔJf fS^jf est-ce
étant
adjectifs-
de manière à
et
influence
peut pas
avec
dans
restriction, c'est
l'adjectif conjonctif,
peut
ont
'
la valeur du verbe ,
de cette
de
lieu
règles
soient
employés
qu'ils
pourvu
,
mêmes
ces
aucune
,
influence
sur
,
cette
oôj
.
de syntaxe dont il vient d'être ques
réduisent à mettre au. nominatif ou
chapitre se
à l'accusatif un complément objectif, ou autre
que l'on a
et
a substitué
mis
on
avant son antécédent, et auquel
déplacé
un
pronom affixe qui occupe dans la proposition la place propre
à ce complément. Par cette inversion, et par la substitution de
et
ce nom se trouve isolé
ce pronom au nom qu'il représente
étranger en quelque sorte à la proposition. Si l'on réfléchit
ce
,
,
.
,
,
,
,
que ïe véritable motif de cette construction irrégulière est de
fixer spécialement l'attention de ceux qui écoutent sur le nom
ainsi
déplacé,
de le mettre
vient
en
on
au
sentira que l'on ne
de la
commencement
quelque
le
sorte
saire , le nominatif étoit le
ployer
,
ïes deux
dont il
sujet,
et
pouvoit mieux faire que
proposition dont il de
que, par
,
une
suite néces
qu'il convenoit le mieux d'em
indiquant une dépendance ,et le
parfaitement indépendant (n,os 62 et 6 3).
certains cas on emploie l'accusatif, les
autres
cas
cas
s'agit étant
cependant, dans
grammairiens Arabes ont recours pour rendre raison de cela,
à une ellipse, et ils supposent qu'on doit sous-entendre devant
ce nom un verbe
auquel il sert de complément.' Ce verbe est
nom
Si
,
,
DE
LA
SYNTAXE.
le verbe même de la
171
proposition s'il est transitif, ou un
signification analogue si celui-là est intransitif.
Ainsi, pour analyser ces propositions ^JL? IXà \o^.j^ si Amrou
eût tué Zéid
oj>>* foj+£ W* toutes les fois que je passerai
de
Mahmoud, ils les rétablissent ainsi dans leur intégrité
auprès
jjl£ *JUi» foô) Jx?JJ et <^>jj* ïSjik ojjW^ \$£>. Cette analyse
est si peu naturelle que l'on ne sauroit donner aux proposi
tions ainsi analysées un sens plausible.
Rien n'est plus facile cependant que de se rendre compte de
cette syntaxe particulière; il suffit de considérer l'accusatif comme
ou
,
verbe d'une
,
,
*->
*.j
,
une
forme adverbiale ,
Le
sens
sera
fois,
et
le
nom comme un terme
circonstanciel.
littéral des deux
propositions données pour exemples
Toutes les
Si , par rapport à Zeïd, Amrou l'eût tué.
à l'égard de Mahmoud, que je passerai près de lui. Cette syn
donc
:
taxe rentre tout
..
naturellement dans
des usages les plus fréet l'on y a recours , quand
un
quens de l'accusatif (n.os io4 et suiv.) ;
quelque circonstance ne permet pas d'employer le nominatif.
CHAPITRE
Syntaxe
286.
autre
des
XIV,
Propositions complémentaires.
proposition peut avoir pour complément une
proposition. De ces deux propositions qui forment un
Une
rapport, l'une peut être nommée antécédente,
et
l'autre consé
complémentaire (n.os 28 -33J.
Comme c'est le verbe qui caractérise essentiellement la na
ture des
propositions, c'est principalement le verbe des propo
1
sitions complémentaires que nous avons à considérer ici.
être
287. Le rapport qui est entre deux propositions peut
indiqué par une conjonction comme £>l si, exprimant une
quente
ou
,
,
DE
I72
SYNTAXE.
LA
supposition ^ que, <J afin que;
ou
par les prépositions J pour, et^ Jjo. jusque après lesquelles
on sous-entend la conjonction Q-f (n.os 827 et 830, //' p,). Il
peut l'être aussi par le mode du verbe de la proposition con
séquente et même dans les propositions conditionnelles et
condition
,
°J si exprimant
,
une
,
,
,
,
suppositives , par ïe temps ou le mode des verbes des deux pro
positions , tant de celle qui sert d'antécédent que de celle qui
sert de
J'ai suffisamment développé cela en traitant
complément.
(n.° 4.6 et suiv.).
288. Je n'ajoute à cet égard qu'une observation c'est que
les verbes qui gouvernent ordinairement leur -complément par
le moyen d'une préposition fa conservent aussi lorsqu'ils ont
pour complément une proposition dans laquelle le verbe est pré*
cédé de la Conjonction q\. Ainsi l'on dit <>^Jo ^f ^éjtviu Ifj
Une put pas m'atteindre. Le verbe antécédent régit alors la pro
position qui lui sert de complément comme il régiroit le nom
d'action dont elle est l'équivalent ; (J^jù-ï <jf <J* est ^a même
chose que (^=>\j\\ J*
28p. Le rapport entre la proposition antécédente et la
proposition complémentaire n'est pas toujours indiqué par un
exposant tel qu'une conjonction ou une préposition : la seule
apposition d'un verbe à un autre verbe indique que la secondfr
proposition est complémentaire (n.os 336 et 337, /." p-) ; fe
verbe de la proposition complémentaire est toujours, en ce cas,
à l'aoriste du mode indicatif.
Exemples :
des modes
,
,
,
•
//
entra
Ils allèrent
eux;
,
et
dans
trouver
une caverne
pour
s'y
mettre
les renards pour les prier de
de leur donner du
secours contre
les
aigles.
à l'ombre.
se
confiédérer avec
LA
DE
Quoique
mer
le
l'on
de
sens
SYNTAXE.
173
que l'on doive même
puisse
propositions complémentaires
et
ces
souvent
en
expri
françois par
pour, afin de, afin que, les Arabes ne ïes considèrent cependant que
comme des termes circonstanciels qui expriment une circons
tance future ou présente que l'on -auroit pu de même rendre par
un adjectif verbal ; ainsi l'on auroit pu dire Uj ^UIL^ et ^J?U :
aussi peut-on souvent employer, pour les traduire, le participe
ou le
gérondif ( n.° 337, 1." p. ).
290. II y a des verbes qui sont toujours ou presque toujours
employés à régir immédiatement d'autres verbes qui leur servent
de complémens. Tels sont ceux que-Ies Arabes nomment JJàà\
ïSjÛll] verbes de proximité' parce qu'ils exprimentun événement
futur et prochain, et ceux qu'ils nomment *UiV[ ^jUif verbes
inchoatifs parce qu'ils expriment la même idée que nous ren
dons en françois par commencer à se mettre à.
Les verbes de proximité sont : <J*s. il peut se faire que,
20 I
peut-être que ; W Lij^=> <2sb£f il a été sur le point de, il s'en est
peu fallu que. .ne, et quelques autres moins usités. Les verbes
fj*s.. et ôj.^ne sont d'usage qu'au prétérit. Le premier se joint
plus ordinairement au verbe qui lui sert de complément, par le
moyen de la conjonction yf ; le verbe 5^*, au contraire, et les
autres se
joignent lé^plus souvent immédiatement au verbe
de la proposition complémentaire. Cependant on trouve aussi
Remployé sans la conjonction ^f, et ils* et SJj\ employés
avec cette conjonction. Exemples :
,
,
,
.
-
-
.
,
j
-!*•:
»
*
J.
A
,
-
-
.
i,; >.-..»-
,*.-
,
■>->'..
•
?
.
Il peut se faire que quelque chose vous
dant cela vous soit
avantageux ; et il peut
quelque, chose
,
et
que cela
vous
--
J
'
s
'
déplaise et que cepen
se
faire que vêus aimie^
soit mauvais.
,
Arrivcra-t-il donc , si l'on
ne
SYNTAXE.
LA
DE
Iy4
vous
ordonne de combattre, que
combattiez pas!
ô-* ^3^ tin c^*
Peut-être quelque voyageur en passant apercevra-t-il ton feu :
attires un hite che^ moi, tu seras affranchi.
J^jjjii lSju» ô-^f.ôj
tu
vous
'ft&^ajl
Peu s'en
faut
-H5-
t_i-*Mt
que l'éclair
l?J^'
si
*.**
leur ravisse la vue,
ne
Le verbe SU^» étant
précédé d'une négation» on doit
faire tomber, en françois la négation sur le verbe de la propo
sition complémentaire. Exemples :
20 2.
,
Q.
Pf?/ jV/z
Qu'ont
rien de
ce
donc ces
est
!Vp .; LiL^ra Los
fallu qu'ils
gens-là!
peu s'en
-
le fissent pas.
faut qu'ils
ne
comprennent
que l'on dit.
203. Lesverbes inchoatifs
^ai?
ne
g)ô
-
$&
Ils
.
à.
Exemples:
//j-
r*
mirent tous deux à
l*i>»i "jli
Lorsque
Hatem
à la recherche de
disputer
mit à le lécher
se
<jo.f
-
l'un
'
-ïlijf-J^f
avec sa
contre
-
<if LU
des chameaux , il
hommes ; mais il
ne
les
l'autre.
langue.^
<j«£Jf c?"^ (S^* cJ^ j*J'Ui
fut venu auprès
ces
Jiâ.
signifient, commeje l'ai dit, commencera,
se mettre
Il
sont
trouva
se
pas.
mit à aller
DE
LA
SYNTAXE.
I75
2o4« II y a aussi des verbes qui gouvernent des propositions
complémentaires composées seulement d'un sujet et d'un attri
but sans que le verbe être y soit exprimé. C'est ainsi que l'on
,
sapientem assumsi eum mihi amicum, c'est-à-dire,
tu es sapiens assumsi eum ut esset mihi amicus;
et en françois je te crois sage, c'est-à-dire ,je crois que tu es sage.
J'en ai parlé précédemment (n.°* 1 i4 et 115).
dit,
existimo te
,
existimo illud quod
,
,
proposition toute entière peut servir de complé
ment aune préposition : ce qui n'a rien d'extraordinaire lorsque
cette proposition commence par l'un des mots conjonctifs ^»
celui qui, celui que ou U ce qui ce que ; car ces mots renfermant
réellement la valeur des mots l'homme qui, l'homme que, et la
chose qui, la chose que peuvent servir tout ensemble de com
plément à une préposition et d'adjectif conjonctif formant le
sujet ou le complément du verbe de la proposition conjonctive.
Exemples : l#U>f U ^c l<j.;Jl* je l'ai interrogée sur CE qui lui est
20
J.
Une
,
,
,
,
,
.
,
jj'...;.
.
.
j
,-.
f
•
.
,
^ o^if je m en
trerai; c'est-à-dire, j 'emmènerai
arrive; «jcaaj
.
.
irai
AVEC CEUX
QUE je
rencon
rencontrerai.^ La même
chose peut avoir lieu avec l'adjectif conjonctif <j(Ù\, quand
son antécédent n'est pas exprimé.
Mais ce qui mérite d'être observé c'est que l'on trouve quel
ceux
que je
,
,
quefois un verbe servant immédiatement de complément à une
préposition ; le conjonctif qui devroit servir de sujet au verbe,'
et le nom
qui devroit servir de complément à la préposition
étant l'un et l'autre sous-entendus. Exemples :
,
loU.
qÛJ( JLJlis Vj
quej 'aï passée n 'est pas (celle d'un homme qui)
a
joui du sommeil, et dont le flanc s'est reposé sur une couche molle.
On voit que âlL <JJJ U est .une expression elliptique qui
revient à celle-ci, *U J4-J J^* <i^ ^.
Par
ta
vie ! la nuit
*JaU «IL (£J U Cè^ié
\n6
SYNTAXE.
LA
DE
Uj»~aj oJUf j**-^ l£ Lï ^*[j
jPû r Z)/Yw / (dit un Arabe à qui l'on annonçoit qu'il lui étoit né
une
fille), ce n'est pas" là un enfant (dont on puisse dire ) : Le bel
*-sJ^
enfant !
Sa seule
U>jJJ>3
'LX-j
défense, ce
f
sont
des
pleurs ; son
armure,
des habits
de soie.
IJS JlJL» ixJy
oJ^Jf IsJo j* Lé est l'équivalent de
oJp f 1*J comme on ïe voit par via traduction.
*—
Ji ii
,
y a eftcore un autre" cas où le verbe, et même une
entière , peut devenir le complément immédiat d'une
2o6. U
proposition
préposition ; c'est lorsque cette proposition abstraction faite des
rapports qui existent entre les mots qui la composent et de la
valeur de chacun d'eux en particulier est envisagée comme le
,
,
nom
d'un être intellectuel. C'est ainsi que
soucie pas du
TU
qu'en
l'auras.
l'usage
dira-t-on.
Exemple
du L'ON DIT
et
:
Un
jUj [Ljf. ^é J^L^jf
disons
:
Je
ne me
mieux que deux
il
vous a
interdit
UN TEL A DIT.
CHAPITRE
Syntaxe
nous
tiens vaut
des Verbes
XV.
admiratifs
exclamatifs.
et
297, On peut, comme nous l'avons dit ailleurs (n.° 502,
i.r'p.), former de chaque verbe trilitère primitif, un verbe exclamat
if ou admiratif <S*sd\ JUi La forme de ce verbe est >iil U
et
y^\ Sous la première de ces deux formes 7 le nom ouïe pro
nom
qui désigne la personne ou la chose qui est l'objet de l'admi.
.
ration
se
*^.o^Lar
met
Si .c'est
est
à
se
l'accusatif,
un
de la
,
pronom,
première
place immédiatement après
comme
on
fooj -^jJ\
emploie
U
0
les affixes
personne, il faut
se
le
verbe,
et
que. Zéid est beau!
; et si ce pronom
servir de i'affixe £,
parce
SYNTAXE.
LA
DE
parce que ïes pronoms affixes représentent ici
//' p.
)
Sous la deuxième forme
.
l'admiration
ci
,
doit
Exemples
.
se mettre
d'esprit
à
*****
lui!
souffrir!
j*^pf
a
il possède!
o*
son
,
amitié seroit
<?\
e
s
Ojfj ^ £-Çwt
et
ils verront très-clairement.
infiniment précieuse, si
elle étoit
est
..]'.
•
el*\
digne d'admiration la figure de ce prophète, duquel l'excel
relevée par des qualités estimables,
que l'on sous-entend le nom ou
devroit exprimer l'objet de l'admiration ; mais
II arrive
le pronom
ce cas est
aucune
'■
est
208.
qui
quelquefois
très-rare,
obscurité
u>s»f^ t_yti
,
et
n'a lieu que
comme
L»
clans
ces
quand
il n'en peut résulter
exemples
fj^». *â^3 î4^*^ *Li-^îj
:
<£* ^ ' (jj^
Que Dieu récompense
est
fidèle
promesses.
Elle
toute
<*•
quelle finesse
en
*U J'\:«
lence
qu'ils auront
quel rare mérite paroît
reçue! quelle étendue d'éloquence
//r entendront alors
ses
mol
belle ame!
e
à
le
«^ Jc^^ âQ* J-frk[j
J
Certes
qui exprime l'objet de
génitif précédé de la particule
,
terrible le feu
sera
♦ôJu& .JJC*Jl *JLo t^liU
il
l'accusatif (n.° 806,
:
Oh ! combien
Q«^//f
au
177
récompense)
,
très -tempérant
et
et
pour moi (car c'est de sa grâce que vient
qu'il comble de biens Rébia! Certes (Rébia)
très-généreux.
II.1 PARTIE.
M
I78
jcXa*l3 LojJ
lT'/7
s'il
£r£
jouit
gloire
LA
DE
(jfa fiXA-f* l-g-*^ *-~llï ,Jij q| <3Ui>3
trépas il en sera surpris couvert de glaire; et
jour de vie ah! combien il sera digne d'une
,jjiX*uJ
du
surpris
encore
sans
d'un
,
,
bornes!
.
Dans
ces
t^jsLïj,
SYNTAXE.
et
exemples
de même
„
*
c
s
es
_
Uj-Ssfj" t_?*t U est pour «LoJ o*fU
Jtxâ-fJ est pour fîx^ «i^Cl» ^^LfJ.
,
20p. On peut interposer entre le verbe admiratif et son
complément une préposition avec son complément, un terme
circonstanciel de temps ou de lieu, un adverbe, ou un compel
latif. Exemple:
,
Q«e son aspect est beau au jour des combats ! que
abondans au temps de la disette!
ses
dons
sont
Les verbes admiratifs jîf uvent avoir pour
complément
verbe précédé des mots <jf et U, qui , comme je l'ai dit ailleurs,
3 OO.
un
donnent
et
aux
temps du verbe la valeur des
noms
d'action
(n.os 889
8qo, i,re p.). Exemples:
%
O
-i *,
ami!
qu'il est convenable
patient (dans l'adversité) !
mon
Combien il
est
Ut>ju.-if
j* sont
d'occuper
301.
à
un
homme sage de
beau à l'homme de dire la vérité!
honteux pour lui de dire le
//j
%
combiettiUh
mensonge!
ijjîiij ^u nyj v^'3 ty>ôJu*
avancés les
le premier
se montrer
rang
premiers
:
combien
nous
eussions désiré
!
Les verbes nommés par les ? Arabes
£«jjÇ ^jdfjUifc
.
DE
verbes de
louange
particulière. Ces
et
pour le blâme,
SYNTAXE.
LA
de blâme
(n.°
verbes sont, pour la
doivent être suivi» de leur
qui
nominatif.
Ce
sujet
louange,
être mauvais (a). Ce
J-L
doit être
I70,
500, //' p.) , ont aussi
agent,
sujet grammatical,
appellatif,
un nom
syntaxe
.Uj être bon, et
des verbes neutres,
sont
ou
une
et ce nom
au
doit
genre de détermina
^f mais de ce
employé ^4, c'est-à-dire, pour
lequel
toute entière comprise sous le nom appellaexprimer l'espèce
latif (n.° 770, //' p.). Si le sujet, au lieu d'être incomplexe,
être déterminé par l'article
l'article
tion dans
iUil
comme
de
plusieurs
nier de
y}S3\
Il
J-L
est
la demeure
,
rapport d'annexion
est
,
complexe et formé
il suffit que le der-
ces noms
très -rare que les verbes
grammatical un
Jij
,
soit déterminé par l'article,
est l'esclave de l'ami de
mauvais
«->a.U>
est
à„un
mauvaise
noms en
,
est
ou
à
nom
plusieurs
lîù beau
d'un sultan,
est un
tsJj J-^-j
jUi
et
homme,
,
ou
bien
aient pour
J*L
un nom
^UiU J^â 'Jù
J^j
l'infidèle.
appellatif, soit indéterminé,
individus
*ÙU
comme
sujet
soit déterminé
propre
beau
,
comme
est un
favori
mauvais est Zeïd.
propositions composées des verbes de louange et
de blâme et d'un nom appellatif pris dans toute l'étendue dont
il est susceptible expriment nécessairement des idées générales
comme je.ùi\
j*jù beau est le poète : car ici le poète ne signifie pas
tel ou tel poëte en particulier ; mais il est pris pour tous les poètes,
comme quand nous disons, le poète ressemble au peintre. Lors
cependant qu'on emploie ces expressions c'est ordinairement
202. Les
,
,
,
,
1
(a)
Les verbes l*u
masculin,
auquel
et
L'JLi
^yjù
»
et au
et
et
l^j
ô-^>
n'ont que
cette
pour le féminin.
pluriel Lju
troisième personne pour le
Cependant
on a
dit
quelquefois
,
2VU
I$0
SYNTAXE.
LA
DE
l'application à quelqu'un en particulier. On déter
mine donc ces propositions générales à un sujet particulier en
ajoutant le nom qui exprime ce sujet, et qui doit toujours' être
en
pour
faire
,
déterminé
nexion ;
Beau,
,
est
est mauvais
Agréable
est
le serviteur,
père
est
du
Beau
est
an
bel homme.
serviteur; c'est-à-dire,
ton
ton
serviteur
serviteur.
est
la cantatrice
la cantatrice du sultan ; c'est-à-
,
la cantatrice du sultan
Beau
,
l'homme, Zeïd; c'est-à-dire, Zeïd
"*
du
soit par les articles , soit par
aussi au nominatif. Exemples :
sa nature
et ce nom se met
Mauvais
dire,
soit par
est
*
j
le page , le page du
vi^ir est beau page.
est
le poète
,
agréable
-y
père
j
'■>t"°
du
e
viijr; c'est-à-dire,
toi; c'est-à-dire,
•
cantatrice.
tu es un
i
On voit par ces exemples que le
dividus , est le véritable sujet logique
nom
qui
a
le page
beau poète.
qui exprime
les in
pour attribut
com
et du
appellatif
plexe la proposition composée
de
au
verbe.
sert
sujet grammatical
qui
Si le nom qui exprime le sujet individuel est connu,
303*
parce qu'il a déjà été énoncé, on peut le sous- entendre. Ainsi
met dans la bouche de
Mahomet ayant déjà parlé de Job
:
l*j
Dieu ces paroles oJôJf
IJjU. "oliô^-J Cj nous l'avons trouvé
le
est
excellent
serviteur, sous-entendant Job; c'est-à-dire,
patient ;
du verbe
nom
A
J
,
Job
est
excellent serviteur.
,
DE
On peut aussi
si, le verbe
reconnoître
sous-entendre tout-à-fâît le
quelquefois
nom
sujet grammatical du verbe,
de
genre féminin, il est facile
devroit former le
appellatif qui
sur- tout
loi
SYNTAXE;
LA
quel
étant du
le
est
sujet
sous
-entendu. Cela néanmoins
arrive très-rarement.
204-
Une
entendre le
(ou,
qui
ce
syntaxe très
autre
la même
ordinaire
du verbe de
sujet grammatical
est
-
chose, de lui
c'est 'de
,
louange
donner pour
sous-
de blâme
ou
sujet vague
elle, compris virtuel
le pronom de la troisième personne il
lement dans le verbe lui-même) , et d'ajouter, sous forme de
ou
le
l'accusatif,
sujet grammatical. Ce
circonstanciel à
terme
fbrmer le
indéterminé. Ainsi , dans
dire, (>Jj Xaj fJO
jjVJfeif
305.
jju
.
qui
ce
j
enfans
de
Tagleb
un
^-i
,
leur mère
*■£*** «>.*-»
#-****
le même
et sous
,
nom
'
"°
a$£ J»sUf
mauvais est
%
{j^
,
sous
celle de
pléonasme. Exemple
jj'j
*-.
auroit pu
on
&C*
,
du verbe
forme
j*
fy^M »Hj ^fj
Les
l«ù
donnés ,
QUa-UJI
-
j«*0
répéter deux fois
grammatical
j1— *~
alors doit
exemples
ôjf [jtçLi
-
On peut aussi
forme de sujet
circonstanciel ;
les
CS><MC \0^s-
-
*)&• \*~As-
tous
qui auroit dû
toujours être
même
nom
nom
-*
•
'
■•
fa
terme
:
**
0.y^^*^'j
l'étalon, leur étalon,
dont la croupe
en
dé
jument
fait d'étalon, et
de
la
et
charnée,
qui déguise maigreur ses flancs par un embonpoint
postiche; c'est-à-dire, l'étalon (ou le père dont les enfans de
Tagleb tirent leur origine) est mauvais étalon, en tant qu'étalon.
306.
est une
Le verbe *U être mauvais,
former des verbes
trilitères,
conforment
mêmes
se
(a)
Suivant les
aux
commentateurs
en
règles
de
et tous ceux
qfte Fon peut
les assimilant à 'Ju
de syntaxe
ïAlfiyjia
est
et
J^i*
(a).
d'Ebn-Malec
,
les- verbes de
M 3
182
DE
307. II
SYNTAXE.
LA
de même du verbe tjl»
en est
fi ô»i être excel
ou
lent et avec une négation , fi <1>â. V n'être pas excellent, fi fait ici
la fonction de sujet grammatical , et demeure toujours invariable
,
le verbe. On dit donc, *ÂJab fi C>S. Fatime
comme
ïouange
AaJ>
%
«
et
; et
de
dérivés des verbes trilitères, doivent
blâme,
Assimile le verbe
aucune restrictfon
»
verbe Isu
en
verbe
s[Z. "au
,
donne pour
exemple
sens
ce
passage de l'AIcoran
«*■£'
est'
/'/
n.° i2£i, f.
78
21
1234, f.
verso, et
)
Cependant Djewhari
l'on puisse donner aussi
27
verso.
*j
assimilé
.
en
,
sans
tout au
,
-.j
%
ïZ^f^j*-*-*
bien abominable
est
Dieu
a un
fils. (
recto; et
,
en
fait^de parole,
et
Mss. Arab. de la Bibl.- imp.
Mss. Arab. de S. G. n.° 465,
,.
ainsi que
,
à
ces
PfjpJ*
l'ai
je
déjà dit (n.°
%erbes la forme
.~
jj4-.
dit:
(*Py> f-fr^'j-^ ô—t rj-*- ^'ij^f
fo^ô *wf ; c'est-à-dire, à la lettre,
propos qu'ils ont tenu fen disant} que
1
Jjl9
qui
verbe trilitère
tout
,
»
.
(*ft£!r*î lût* .dont Ie
f.
de
et
wwJ ;
,
fais un^verbe de la forme
excellente
êtrejde la forme
c'est effectivement le sentiment d'Ebn-Malec lui-même,
»
On
est
z
Jjtj
•*
500 i.re p. note), veut que
je rapporterai ici son texte:
,
«°
oXJL9 iX-âJl cjJijlà. t£vww
yj*»^-
JJ^ qV fi] ^JUJf y^. UJ]} jil
yfj »(j2j\ ^ms*. <J^j
"ÛV *Tif j] Ulif jj&y y
jZoVf qI CSUij J^vJj J*?-^J Jï-iJl jf^â. j «4-ÎL> liV *Jjf jf -.ô^f
U Js^oili U** U
I^Acf Uj ôijf
U
d£1a£â}i Jiij Ujftîlj ybS J^J rW ^
<£* J^Cjf ^ 1
JcLBf JÛ l^GJU j ûk"
Cfe d>&
(Mss.
Ar. de la Bibf.
imp.
Le manuscrit porte
faute du
sens
copiste.
dans la
note
Je
à
,
&SI îjé
n.°
1
dans le
ne
vers
traduis
laquelle je
^ii Sj^i
tjf fî ^1
IjSljî U
246.)
cité
point
renvoie.
,
ce
/^JL f ;
mais c'est évidemment
texte, parce que
j'en
une
ai donné ie
DE
et
y^-tf ItVj»
1$}
SYNTAXE.
LA
^ Musulmans
sont
excellens. Du reste,
suit la même syntaxe que l»j
On peut cependant supprimer fi
ce
verbe
.
verbe l*j
,
et autres
ou, suivant
il
une
excellent
est
syntaxe
en
,
verbes de louange
tant
dire,
,
et
et
de blâme ,
comme avec
ùiéLj ^j
le
v^-
>
particulière à celui-ci, JU/, c>-JJj J*-^*
qu'homme Zeïd; c'est- a-dire, Zéid est
,
homme excellent.
Quand
on
emploie ce verbe
plus ordinairement
on
l'article démonstratif
sans
ua
fi,
prononce
On peut construire fous les verbes d'admiration formés des
verbes
trilitères,
comme
Ç*L quand
,
CHAPITRE
Concordance du Verbe
308.
.
il n'est pas
d'une
à fi
^
XVL
avec
le
La concordance étant destinée à,
différens
joint
Sujet»
mettre
entre
les-
la même liaison
qui est entre
les diverses idées qui concourent à former un jugement de notre
esprit, il est naturel que le verbe qui indique l'existence du
sujet
mots
et sa
le sujet
proposition
relation à l'attribut, soit assujetti
nombre
a
concorder
avec
genre,
personne aussi peut-on
poser pour règle générale que le verbe arabe doit avoir avec
son
sujet tous ces caractères de concordance. Cette règle
en
néanmoins
lieu
en
est
sur-tout
sujette
lorsque
à
le
et en
:
grand nombre d'exceptions, qui
verbe précède le sujet (a).
un
ont
(a) Je n'ai aucun égard ici au système des grammairiens Arabes qui ne
regardent, en général, le mot qui fait les fonctions de suj'.t d'une proposi
tion, comme le vrai sujet du verbe ou l'agent, que quand il est placé après
te verbe. Voye^ ci-devant n.° 147.
,,
,
M
4
I
84
DE
Le
sujet pouvant
allons exposer les
deux
ces
règles
placé
avant
nom.
ou
après
le
verbe,
nous
de concordance relatives à chacun de
le
nom
qui
sert
doit faire concorder le verbe
on
le
être
cas.
3°9* Lorsque
„
SYNTAXE.
LA
^Exemples
produit
en
sujet précède le verbe,
genre
et en
nombre
avec
:
oi)wy*J
Dieu
de
V
iaJL^I ft>4-^
«»f
les créatures , ensuite il les rend à la vie.
La
femme d'A^i^
passion.
Sollïcitoit
son
Notre argent que voici
Les vraies croyantes
esclave de condescendre à
nous a
sont-
sa
été rendu.
elles de retour!
31O. La même chose a lieu si le sujet du verbe est sousi entendu,
parce qu'il est défe connu, ayant été exprimé au
Exemple:
paravant.
5**" *> £t*j «^ 'fyS* £Mj j Jé^> juTr *su 1 ^ J#jjf ^js lîî
*-ii>J
Quand
le scheïkh
main dans
son
de couleurs
et a
poids
qu'elle
fini
en
tira
loisir; il les
*Jt>o
cSdo o-wil
q-^
oyr'
complimens et ses vœux il mit la
-divers papiers écrits en toute sorte
ses
,
remit à la vieille courbée
sous
le
lui ordonna de chercher, dans l'assemblée, ceux
croiroit susceptibles d'être
dupes, et de présenter un- de ces
papiers
avec
sac et
des années,
o^-** ^jj oÀJf
eut
les
et
à chacun de
actes
de
ceux
dont la main lui semblerait
familiarisée
bienfaisance.
\
DE
Les verbes
SYNTAXE.
LA
I
85
jU.f jjjf JjU JJ»f sont au singulier et au
masculin parce qu'ils ont pour sujet le pronom y» il sousentendu qui se rapporte au mot ^jJJf le scheïkh.
Le verbe 1$*S est au pluriel et au féminin
parce qu'il a
le
elles
sous-entendu
se
pour sujet
pronom ^
qui
rapporte à
LtUj des papiers.
-
-
-
,
,
,
,
,
Enfin les verbes
"Â>yu
-
féminin , parce
qu'il*
entendu, qui
rapporte à
se
ont
,
Ô^Ljf
pour
jyk
-
cl>ïff
sont au
singulier
sujet ïe
pronom j^ elle,
vieille femme.
et au
sous-
311. II faut seulement observer que , le sujet , ou le nom
auquel se rapporte le pronom sous-entendu qui fait la fonction
de
étant
pluriel irrégulier, le verbe peut se mettre
et se met même le
plus ordinairement au singulier féminin.
Ainsi dans l'exemple précédent ©n auroit pu dire ôÂ^-f' au
lieu de \j^* Cela a également lieu soit que le pluriel irré
gulier provienne d'un singulier masculin ou d'un singulier fé
minin. La raison de cette concordance est que tout pluriel
sujet,
un
,
,
.
,
,
irrégulier est censé renfermer la valeur du mot iLéUif une troupe
qui est singulier et féminin.
Cependant, si le pluriel irrégulier exprime des 'êtres raisonnables du genre masculin, comme
^U des hommes, ïJ&>JA*
des anges on doit mettre le verbe au pluriel masculin. Exemple:
jl^jJL iCjXiJ JtlJUL iCjÛ* °fQ*, ûy?\>**ï '*SZJiJ& Dieu a des
,
'
,
a»
relèvent pour veiller
anges qui
les autres durant le jour.
se
sur vous
,
les
uns
pendant
la nuit,
312. Lorsque le verbe précède le sujet, si le sujet est un
nom singulier et masculin, la concordance est
toujours observée. Exemple: fjjj^i qU^JUJI «Lof Satan lui
fit oublier le sou
venir de
313»
son
seigneur.
sujet
Si le
est un nom
singulier
feminin , le verbe doit
186
DE
concorder
avec
ïe
sujet
LA
en
SYNTAXE.
nombre
;
mais il peut n'être
concordance pour ie genre.
II faut se rappeler ici la distinction que
point
nous avons
eu
faite
(n.° 6/4, //' p.) du féminin réel c-^UÎf "jù^- c'est-àdire qui exprime un être du sexe féminin et du féminin de
convention o^Kxlf juïâ.j.Xe ou métaphorique ^vJLJf cs^Uê-, qui
ailleurs
,
,
,
est
"
"
purement grammatical.
3l4« Si le sujet du genre féminin
qu'il
suive immédiatement le
féminin
:
si le
nom
verbe peut être mis
est de le mettre au
féminin réel,
et
verbe, le verbe
doit être mis
au
suit pas immédiatement le verbe
ne
au
est un
masciiin
ou
,
le
féminin ; mais le mieux
au
féminin. Exemples
:
>fC J
La
dit,
femme d'A^i^
fuJû jji *4_r^ ci j~* ci^'
Celle dans la maison de
à
laquelle
*-*)^SL>
il étoit, le pressa de
se
rendre*
son amour.
I.
*>•
»-
L'une d'entre
315»
Si le
sujet
est
*<-.
vous a
un
-•? s,
séduit
un
homme.
féminin de convention
,
on
peut
le verbe à tel; genre que l'on veut , soit qu'il précède
immédiatement ou médiatement son sujet. Dans le second casA
mettre
le verbe
est
mieux
au
iCâs
Afin
masculin.
j*CUé (jcUif Ôj^J
que les hommes n'aient
r*f^
Ils voient
quelle
v*
a
Exemples
aucun
:
>àuJ
prétexte
contre vous.
C?«!*y^ ^^.Û^o^ÛjS^ft*
été la
fin
de
cmx
qui
les
ont
précédés»
^Li^ ^£JÙG ïjcJJI
cM*i
«icVJfJ* £>^ «y
l'écume s'en est allée ; et lorsque l'écume
ôobi
fij^ *-jj-*j
/,* lait pur est celui dont
s'en est allée le lait est nu.
187
SYNTAXE.
LA
DE
o*
,
316.
met au
Si
le^ verbe
masculin.
d'innocent que la
La raison de
du
séparé
est
Exemple: XiJ f ^1 oLb V^^ij
cette
sous
Vj
U i/
,
on
»^y
le
tf «*
d'Ebn-alola.
servante
c'est que
mais le mot
concordance est facile à sentir
ïe vrai sujet du verbe n'est pas ie
oÂ\ aucun,
sujet féminin par
qui
nom
suit Vf
,
;
-entendu.
cependant aussi faire concorder le verbe en genre
nom
qui suit Vf Ainsi, dans notre exemple, on pourroit
On peut
avec
le
.
dire oui Vf
317.
sujet un
U.
ô~£=>j
Les verbes lii
nom
cation
J~j
-
appellatif pris
(n.° 301 ) peuvent
lorsque le sujet est féminin
,
et autres
dans
toute
être mis
semblables , ayant pour
l'étendue de sa signifi
masculin
au
féminin,
ou au
plus élégant dejnettre le
verbe au masculin ; ainsi il vaut mieux dire o—>Jj oV^>Vf l*j que
i^ùj ëîj^Vf cx#i Zeinab est excellente femme.
318. Lorsque le sujet est un nom pluriel masculin le verbe
placé avant le sujet se met ordinairement au singulier. Exemples :
mais il
:
est
,
p
Est-ce que
nous
\
^
9
*J f
,j*t\
croirons,
u? jj^y f
comme ont cru
les insensés!
VJj* [j-JJi &tôJ\ J4MJ
Ceux qui étoient impies changèrent ses paroles.
319. Si le sujet est un pluriel irrégulier venant d'un sin
gulier masculin, le verbe peut être mis au singulier féminin.
,
Exemples
:
-1»:
Leurs
cœurs
.,
se
.
.j
sont
jJ.f.
.
,.r. cl.
endurcis
après
cela.
ï88
DE
D'autres
envoyés
avant toi ont été
j
£VAz
/// <2//mï
/2
mettre
peut pas
de
£jyj pluriel
.»-
est
ïe verbe
^f fils,
et avec
venoient les trouver.
masculin
féminin
au
les
menteurr.
,
envoyés
pluriel
un
traités de
c*
-
parce que leurs
,
le sujet
Lorsque
SYNTAXE.
LA
mais
:
mots
régulier
le peut
on
pareils
à celui-là
ayant la terminaison des pluriels masculins réguliers ,
servent
pas cependant la forme de leur singulier ; car
riels
de vrais
sont
J>£jf>^! lyJ
320.
nom
qui
pluriels
rompus
ôJU Les enfans d'Israël
on ne
,
ne
avec
qui,
con
plu
irréguliers. Exemple :
ou
ont
ces
dit.
On peut aussi mettre le verbe au féminin, lorsque le
le suit et qui lui sert de sujet, est un nom collectif,
.comme
*y nation,
comme
Àè
brebis ,
ou un nom
qui exprime
j-/J»
Exemples
j^iji J»
oiseau.
une
espèce entière^
:
u
jj-jo. ^Aj ^ jh c^r, r ç\
Je voyois que je portois sur ma tête du
pain dont les
mangeoient.
*-*?
>
oiseaux
3j|*Jf o^J tôl-âJjf ç>^3 ^^ J* JtjUj^Jf oJu^i "S^4^f ç>^'
^cî*
Z^J"
«■
Juifs
véritable
ont
dit,
v; et
«-
Les Chrétiens ne professent
les Chrétiens
point une religion véritable.
ont
dit,
«•
Les
point
Juifs
ne
»
vfâî v; <iyp f iM ^
es*
religion
professent
une
j**ft aj^f j4?j ^j
DE
Autour des parcs qui
c
étoit leur
l'abri de
leur
qui
sur
les
sa
ont
:
terres
leur
ni la
nourriture que le vent
,
seigneur qui s'avançoit
vengeance ; ni les ombres de la nuit, ni la clarté du
été d'aucun
32
Le
sujet
étant
ni leurs
lui;
secours contre
,
.
contre eux , au
ses
chevaux,
à
jour,
ni leurs
coups.
pluriel féminin,
un
mi'
ni la fuite , n'ont pu les mettre
résistance,
chameaux n'ont pu les soustraire à
I
qui soufre
pour étancher leur soif, de la
brûlées de l'ardeur du soleil. Mais
contentent
se
maître et
lieu de la nuit
ne
servent
fournissent
auxquels il ne faut d'autre
qui s'élève
vapeur
tout autre
un
meurtriers
dans les déserts ,
8p
d'asile à leurs troupeaux ,
rempart de braves guerriers dont les coups
à la pâture des loups et des corbeaux ; des
que lui auroit trouvé
chevaux
1
SYNTAXE.
LA
le verbe
qui
le
pré*
cède peut être au singulier masculin , pourvu que le sujet soit
un féminin de convention ou un
pluriel irrégulier. Exemples :
Les mauvaises actions
il
en
sera
de même de
mauvaises actions
qu'ils
d'entre
ceux
qu'ils
avôient faites , sont tombées
auront
'
faites
.Vf
Quelques femmes
Mes filles
ceux
qui
On
m
ont
pleuré
leur
ce
•
,
*-.
tomberont
sont
impies ; les
sur eux.
'u-'-
de la ville dirent.
malheur,
'aimaient ; ensuite ils
peuple qui
sur eux:
se sont
ainsi que
ma
femme
et tous
séparés.
quelquefois des pluriels féminins réguliers
verbe masculin singulier comme dans l'exemple
joints
sujvant : ^y^aj.îà" oÏJaI^ ZJSJ^M c^U. fif quand les vraies
croyantes viennent vers toi pour chercher un refuge, éprouve-les.
trouve
à
un
aussi
,
Mais
exemples sont rares
ces
des licences. Dans
cordance par
le
SYNTAXE.
LA
DE
ipO
,
et
peuvent être
regardés comme
celui-ci, l'on peut justifier le défaut
du pronom affixe
l'interposition
entre
de
con
le verbe
et
sujet (a).
322.
féminin
;
Les
noms
mais
,
comme ce sont
aussi concorder
•■*-
1-
des tribus Arabes sont ordinairement du
avec
.
j
*
j
des
des verbes
pluriels
§•',-?.. Si
s^,
noms
•.-.-»
,
ils peuvent
masculins.
Exemples :
collectifs
-.--•-
->
«
■>
1
-
-
-
-
-;
familles d'Amer fils de Sasaa, d'Okaïl et de Koschéir, et
les enfans de Kélab fils de Rébia fils d'Amer, se rassemblèrent, et
s' étant plaints réciproquement de la conduite de Seïfeddaula a leur
égard, ils convinrent de se liguer tous ensemble.
Z^J
o6ijf L|,
7.. p J T
y^jL ijlSZi
o-Ç^j ****** é$j£=>j3 Uj
les génies sont également en ton pouvoir; comment
çjtjlsjf <UjJÂj >jyi\
Zer hommes
et
cjUu
la tribu de Kélab pourroit- elle
même! Ils
(comme)
mort
fjl£ ^XlîjJf ^j>Àj\ iALé
espérer
de demeurer maîtresse d'elle-*
t'ont point abandonné par une révolte criminelle; mais
s'éloigne d'une cihrne , quand elle offre pour boisson une
ne
on
assurée.
323.
que le
Le duel
est
sujet
pluriel. Exemples
aux
mêmes
règles
de concordance
:
grammairiens justifient cette concordance en sous-entendant le
pluriel irrégulier "^LljJi les femmes ou en disant que l'article dans t^uAlif
est pour l'adjectif conjonctif ^'ilJf pluriel irrégulier.
H y a aussi des grammairiens qui autorisent sans restriction cette concor»
dance irrégulière, tant au singulier qu'au pluriel, et qui permettent de~ dire
ïj$3 rlls une telk a <#/ /oïjjw^ff oJU /« (femmes nommées j Hind ont dit.
(a)
Certains
,
,
,
DE
SYNTAXE.
LA
Deux hommes
Les dtux
*
~
* *
^LiLsJ
•
Lorsque deux
~
$
j
ont
dit.
dirent.
pieds
*
ipi
..
-
-»..
~
^f ^iv_>«^ qUjuLL o^
corps de troupes d'entre
•
il
avôient conçu le projet
vous
de se comporter lâchement.
324. Quoique,
l'avons
le sujet il soit d'usage de
avec le sujet
pluriel ou duel ,
précède
lier
comme nous
,
faire concorder le verbe
Exemples
a
nombre
le verbe
mettre
au
singu
peut aussi
genre avec le sujet.
cependant
et en
le verbe
on
:
A-*-â*j
Il
en
dit, quand
i>*-m
combattu
qu'éloignés,
oL^*f o^j
en
personne
l'ont laissé sain
*^-*^
contre
et
'{Jï^y*-^ J^M[. <J>3*
les rebelles,
et
tous,
tant
proches
sauf.
peuple a combattu pour toi et le secours qu'ils t'ont donné
fait gloire : s'ils t'eussent manqué de foi, tu aurois été couvert
de confusion.
Mon
,
ta
a
Les jeunes femmes
de la
vieillesse,
et
ont
elles
vu
ont
briller sur
mon
visage les poils blancs
fraîcheur de leurs
détourné de moi la
joues (a).
fa)
On désiime ordinairement
£>*è.\yj\ ^JUâf
quelque*
ce
les puces m'ont
tribut Arabes.
genre de
concordance,
Il
paroît qu'elle
mangé.
sous cette
est
formule
particulière
à
LA
DE
I(?2
SYNTAXE.
Dans ïes temps compos-és du verbe £)»
de l'aoriste d'un autre verbe , si le sujet est
ou
du-
et
32^.
placé
prétérit
les
entre
conforme, pour le verbe (jt**, aux règles de
verbes,
concordance du verbe précédant le sujet , et pour le second ,
deux
on se
à celles de la concordance du verbe
Tout
326.
nous
ce
de
venons
que
les troisièmes persomies des verbes
dire,
les
:
premières
personnes concordent toujours
genre
nom ou le pronom qui leur sert de sujet.
séparé
du
ait lieu
exception qui
sujet par Vf sinon
sujet.
n'a lieu que pour
et en
en
La seule
le
placé après
et
secondes
nombre
avec
ici, c'est quand ïe verbe
[n.° 316). Exemple
:
le
est
oif Vf sU. U
n'est réellement pas une
exception, le sujet du verbe sU. n'étant pas ojf toi, mais le mot
sous-entendu ùâ\ aucun homme.
il n'est
venu
que toi
(ôfemme).
Mais
ce
327. Lorsque le sujet est un nom collectif et qu'il précède
ïe verbe, on met ordinairement le verbe au pluriel. Exemples:
05j»xLiàj
Mais la
Une
Une
plupart
portion
partie
génitif, précédé
exemples
4
II
des
/J«vJJl jj&s) i^S+J*
des hommes
d'entre
d'entre
328. Quelquefois
V
eux
le
eux
ne
sont
pas reconnaissons.
les hommes.
craignent
entendoient la
sujet semble
parole de Dieu.
exprimé par un nom
prépositions ^ou
u,
comme
dans
au
ces
:
ne nous est
pas
venu
de
-
//
suffit
prédicateur
-~
ni de moniteur.
"°
de Dieu pour témoin.
Mais
ht
Majs
ces sortes
françoises
nures
ellipse
,
et
SYNTAXE.
LA
d'expressions
est
approchantes des tour
traduis, renferment une
assez
,
les
lesquelles je
par
le verbe
I$>3
réellement
en
concordance
avec
je .sujet
>ous-entçndu
quj est *& une chose, ou o^ quelqu'un.
sujet est composé, c'est-a-çfyre, s'jl est formé de
329plusieurs sujets partiels le verbe peut encore être ,p,lacé avant
qu
après le sujet : si le verbe est, pjfacé avarie le sujet coujposé
on
peut le mettre au pluriel comme dans l'exempte suivant
Si le
•
,
,
,
,
bJ^ nous
iU; Uic^U*. '-iùci.lj ÔjfJ
autant
n
nous sera nécessaire. On peut aussi le
qu'il
prendrons
au
mettre
singulier, en le faisant concorder avec celui des sujets
[Wrtiels qui le suit immédiatement. Exemples :
viendrons moi
ui
Marie
Aaron
et
K,
r
j
*
,
*
parlèrent
.*.
j
J
.
..
Afoïse.
contre
j
j
j
*
et vous, et nous
s
^
.
.
**»lj (J)£. ^.^_;t\j| «j^Jj 022* oV^**^'j
Aaron
et ses
fils
mettront
leurs mains
sur sa
tête.
33Q* 3ï le verbe est après le sujet composé il se met au
duel lorsque le sujet composé n'exprime que deux- indivi
dus et au pluriel lorsqu'il en exprime un plus grand nombre.
Exemples :
,
,
,
,
•—'
,
-
-
*
•<■*
-
i-i
*<."
%
*
-
^
"_j
lièvre .disputèrent un jour ù qui des deux
veroit le premier, et ifs prirent pour but la montagne.
JJne
tortue, et un
arri-
\jU\2 qtëj\i ^£Jf
Le
ventre et
les deux
pieds disputèrent
33 !• Quant à la concordance du genre
sujets partiels sont de différens genres, on
//.' PARTIE.
ensemble.
dans
met
ce cas
,
si îe<
ordinairement
N
'
Ip4
le verbe
et
SYNTAXE.
Exemple : ^ of<3w*-u *jîJf «J-*ij J^JI
masculin.
au
jJLiJf o^j>*?i i*5^
Dieu
LA
DE
la paresse
l'excès du sommeil
et
attirent la
éloignent
de
pauvreté (a).
sujet étant complexe
,
et formé de deux noms
332. -Le
appellatifs en rapport d'annexion, c'est-à-dire, dont le second
sert de
complément au premier, il n'est pas rare quelle verbe
s'accorde en genre* avec le nom qui forme le complément du
rapport d'annexion quoique suivant la règle ordinaire il dût
s'accorder avec l'antécédent qui est le vrai sujet grammatical
On peut regarder la concordance, en ce cas, comme une
concordance logique parce qu'on y a plus égard au rapport
logique qui unit les idées, qu'au rapport grammatical qui se
,
,
,
,
,
les
trouve entre
Et effectivement
mots.
semble transporter au
d'annexion , le genre qui
qui
(a)
On
qui
sert
concordance
d'antécédent
n'appartient dans
la réalité
au
,
rapport
qu'au
nom
quelquefois le. verbe au gçnre masculin après plusieun
Exemple \^a\& £ji\\ /**oîJf -le soleil dit
,
du genre féminin.
sujets partiels
vent
même
trouve
nom
cette
,
:
disputèrent ensemble.
Quelquefois aussi, le sujet étant suivi de plusieurs verbes, les uns se con
règle de concordance ordinaire, tandis que les autres s'en éloignent.
forment à îa
J
.
Exemple
:
J
J
'
fjjjj
de peaux de paon,
On
£ "f
1'*'*
Iy1j ^^UÎJ f
-
trouve
et
ne
aussi le duel
et
un
le
J
j*
-
j
j
"*
les belettes
pluriel employés concurremment
IjijCj ^ JjJJl'j jÙjê^J^
frappoknt point ; U^j
^jiLyiaJf /*ijj'
-
ijJLi fj^J vj*j~éJf
se
revêtirent
avec
le même
vinrent pour leur rendre visite.
sujet. Exemples r.^bj^Li
chèvre, ils
J
l'die
et
pour le bélier
et
la
Ufjj JU^sCif j fyèijjlîl JjliLkfj j£fl
l'hirondelle
'firent
communauté de vie,
et
elles
s'aperçurent
jour qu'elles étoient menacées par des chasseurs.
Ces
exemples
sont
tirés des fables de Lokman
,
faire autorité. Je n'ai pas observé ces concordances
auteurs et je les regarde comme des fautes.
,
qui
irrégulières
ouvrage
ne
peut
point
dans les bon»
DE
qui
forme le
en
LA
complément
SYNTAXE.
Ip5
n'a lieu que dans les cas où l'on
supprimer l'antécédent , et se con
,
pourroit sans nuire au sens
tenter d'exprimer le conséquent (a). Exemples
,
,
Au jour où
toute ame trouvera ce
.j*$
La miséricorde de Dieu
$
,
est
JUof iXjf^iâjf tÀy o-^J^
.
:
qu'elle aura fait
'..-.i'i.',» ,<\.
proche
fM
de
ceux
qui font
tous
ils combattent
le bien.
Σ' cr^='J
<>—*' J-^* cr-rV
7&W ils repoussent les insultes,
de bien,
avec
bravoure;
cependant, quand il se présente la plus redoutable des troupes
ennemies à laquelle il faut donner la chasse, je suis encore plus
brave
qu'eux
tous.
Vous êtes le meilleur des
peuples qui
ait été
produit parmi
les
hommes.
Lorsque je lui
(dinars), tous mes
C'est
a
de
somme
trente
mille
gloire suffisante pour toi qu'unefemme des plus illustres
khalife.
,
nourri du même sein, et toi, et le
On
les
'.
une
entendis prononcer la
membres se relâchèrent.
vers
trouve un autre
exemple
de concordance
-logique
dans
suivans:
(a) Voyr^ les;
Bibl. imp. n.°
1 a
commentaires
;4 f. 64
,
sur
recto, et
Mss. Ar. de la
KAlfiyya d'Ebn-Malec,
Mss. de S. G. n.°
465
,
f.
1
pi
recto.
Ni
l$6
DE
LA
SYNTAXE.
J.«^.ji J^tjJf. ^j cîj-j]' h*"?
Arrête^- vous,
d'une habitation
neuse
traces ne sont
nord
qui
Le
dance
■4-j
ont
nom
avec
point
encore
sillonné
Taudhih
et
effacées malgré
les
l'erivi
a
cette
quant
sujet
,
aux
qui
,
quant
ici de
sert
exprimé
ou
sous-entendu
au
parce
,
Si
un
genre
toujours
et
,
vents
et
dont les
du midi
et
du
sujet est en concor
qu'il représente le mot
,
la concordance du
et au
nombre
en
personne
la même concordance
;
le verbe
même verbe
avec
a
le
sujet
lieu s'il y
la même personne.
plusieurs sujets qui soient de
335.
Mikrat,
règles pour concorder avec le sujet,
règles peuvent se réduire à deux.
: ces
personnes
Le verbe s^accorde
334.
,
solitude!
le verbe féminin ôJiki
doit aussi suivre certaines
a
,
,
conjonctif U
avec son
*$"*
amis ;
vent,' qui est du genre féminin.
333* ^ous avolls vu ce qui concerne
verbe
o*
pleurons au souvenir d'une amante,
qui étoit placée au pied de cette colline sablon
mes
Dahoul, tîdumal
entre
,
uj-**j S*^^" c53^=»i
a
plusieurs sujets
de différentes
personnes, il s'accorde en personne- avec celui des sujets
comme disent ordinairement les
grammairiens , est de la
qui,
per
la
plus noble; c'est-à-dire, de celle dont la relation est
plus proche avec celui qui parle : la première personne a la pré
sonne
férence
sur
les deux aiftfes
lu.*
IxJC^lô»
Nous viendrons moi
et
Dans
et
la seconde
VJtXà.^
et vous,
sur
ôijfl lîf
et nous en
la troisième: Ex.
:
Uoo.
prendrons autant qu'il
nécessaire.
nous sera
Aioi
,
le jeune homme
ces
exemples
,
nous
irons jusque-la , et
le verbe
est à
nous
adorerons.
-
la première personne, parce
DE
que l'un des
Pans
sonne.
l'Un
venons
ceux
personne
de donner
de, ton parti,
on
,
se
l'exemple suivant
seconde
Le
336.
par
il
,
rapporte
le verbe
de la seconde
personne
est
à la
est
sujets auxquels
se
^fet*
,
I
SYNTAXE.
LA
,1
et
est
de cette même per
sujets, dont
ayantdeux
l'autre de la troisième, il
conformément à la
£• *»f
pj
<jS>S ô5~j
règle
nous
que
[^j-**^ c^JJ^j é>jf /<?/' et
trouvez-vous devant Dieu
avec
Aaron.
que nous exprimons en françois
rend ordinairement en arabe par la troisième personne
sujet indéterminé
pluriel masculin. Exemple : \j-fj on raconte.
337. On peut aussi employer, comme en latin, la voix
objective d'une manière indéterminée: "J-^S '/ est dit, on dit;
*<>» [ventum est cum eofu on l'a amené (n.° 189).
du
t»
??8. Il
se rencontre
asseif* souvent des verbes dont le sujet
point exprime. Ils repondent a ceux que les grammairiens
appellent ordinairement verbes impersonnels : tels sont par
exemple, les verbes latins pluit, fulgurat. Dans not,re langue É
nest
,
le
sujet
de
personne
nrabe
:
ces
il,
ces
verbes
comme
verbes
masculin. On
ne
se
est
//
exprimé .par
pleut, il
mettent à
doit pas croire
véritablement de sujet;
car
proposition qui exprimât un
II y a donc ici une ellipse.
ellipse,
le pronom delà troisième
de même en
tonne. Il en est
la troisième personne et au
que ces verbes n'aient pas
il seroit absurde de supposer
attribut
sans
relation à
aucun
une
sujet.
Pour concevoir la raison de ce^te
if faut faire attention que la plupart des verbes que l'on
emploie
connues
ainsi , expriment des effets dont les
,
au
moins du
commun
causes ne sont
point
des hommes. C'est pour cela
que ïe
sujet n'est exprimé que d'une manière indéterminée.
Ainsi, lorsqu'on dit // pleut c'est comme si l'on disoit, la
,
causf inconnue de
laquelle provient
la
pluie, pleut.
où l'on peut rendre raison de l'ellipse,
pronom de la', troisième personne le sujet
cars
en
une
Il
y
a
d'autres
substituant
chose
:
au
ainsi
,
ip8
DE
SYNTAXE.
LA
l'on dit, il arriva qu'il mourut- le lendemain, c'est comme
si l'on disoit , une chose aniva , et cette chose est qu'il mourut le
lorsque
lendemain. Mais, dans
de la troisième
est
cas-là même,
ce
personne n'indique qu'un
déterminé ensuite par la
nous
exprimons
personne
:
Ce que
la
troisième
per
pronowWle
mettant le Verbe à la troisième
propositioryMMijonctive.
par le
françois
l'indiquent
en
sonne, les Arabes
voit que ïe pronom
sujet indéterminé , qui
on
ainsi ils disent
en
j^i
il
a
CHAPITRE
plu, iî
'
//
a
neigé.
XVII.
Règles de dépendance et de concordance qu'on doit observer
lorsqu'un même nom sert de sujet à plusieurs verbes, ou
de
sujet à
enfin
un
d'attribut
complément à
à plusieurs propositions.
verbe
et
de
un
autre
,
ou
Il peut arriver qu'un même nom serve de sujet à
deux verbes , ou même à un plus grand nombre ; il peut arriver
339»
pareillement que le même nom serve de sujet à un verbe et
de complément à un autre. Cette sorte de lutte entre deux
parties du discours qui exercent une influence ou pareille ou
différente sur le même mot, est nommée, par ïes grammairiens
Arabes
contestation au sujet du
régime Jlàff J Pj^.< H ne
faut pas perdre de vue que suivant ces grammairiens le sujet
d'un verbe est régi par ce verbe, comme le complément (n,°42).
Pour ne point embrouiller là question dont il s'agit nous
ne
supposerons que deiftc verbes qui exercent une influence
commune sur un même mot, et nous n'entrerons
point dans
des
diverses
l'examen
opinions qui partagent les grammairiens.
d'abord
ce
Voyons
qui a lieu, lorsque le même nom* sert de
sujet à plusieurs verbes/
,
,
,
,
DE
Si le
34o«
il
n'y
sujet, suivant
SYNTAXE.
LA
Jes
qui sert de sujet est placé
concordent
verbes
Ies;deux
difficulté;
a aucune
les
règles
ordinaires.
•
•,---
Ils commandent
(a)
et
H
bon de
est
point
dans
,
que le véritable
//' p. ,* n.°
148
,
rappeler
cette
leva
se
et
bien,
est
qui
ce
le
Exemples:
1 r.
-
avec
-»
-
.
-
'
Marie
n'est
Ip?
verbes ,
avant
nom
ici que
construction
,
,
sujet est le pronom
p. ). L'auteur du
2.*
pleura (a).
et
défendent
suivant les
le
sujet
ce
qui
'grammairiens
du verbe
,
est
Arabes
mais t$h
sur
,
IjJ*
inchoatif,
caché spus la forme, du verbe
commentaire
mal.
( n.°.jli4,
XAlfiyya dit, en.expli-
s'agit ÇÏfcn-Malec a eu soin de. dire, si deux antécédent
qu;'ik précèdent pour faire sentir que la contestation, ne peut^
«pas avoir lieu quand les deux antécédens sont placés après le régime, comme
dans Zéid s'est levé et s'est assis, parce qu'alors chacun des deux antécédens"
«.épuise sa, propre influence sur le pronom qu'il' îenfe'rme et qui se rapporté
au nom
qui précède il n'y a donc pas de contestation entre eux. Cette con
testation au contraire a. lieu quand les deux antécédens précèdent, leur
«régime, comme dans cet exemple, s'est levé et s'est assis Zéid tar chacun des
deux antécédens est en rapport logique avec Zéid, et est propre à* régir ce
nom j mais l'un des deux seulement exerce son. influence
grammaticale sur le
mot Zéid, et l'autre ne l'exerce
que sur le pronom qui représente ce nom.
quant le
»
dont il
cas
agissent sur
:
un nom
,
»
»
:
,
,
:
»
»
»
»
Voici le
texte
d'Ebn-Malec
O-ijj-iL ^jijÀXù» c?S^Î^
et
de
cW
son commentateur:
é>^.
*
Pjl^-Of qI (J«é L^-<>JlJ
JLO
JLO
r<jyrç
le
man.
Ar. de S. G. n.°
465 f. 68
,
recto.
N4
Jlji
106
LÀ
DE
34 f
SYNTAXE:
Si les deux verbes; précèdent le sujet
•
,
l'un des deux
pfoùr sujet le nom exprimé, et il sïïrf lés règles
exposées précécferrfifienr(nv0* jii et survâii^j ;
l'autre a40bur sujet le pronoifr sons-etftendu qui représente ce
censé avoir
est
de concordance
nom
il doit être
et
,
avec ce nom.
genre
concordance
en
Exemples
exacte
de nombre
et
de
:
<j)\.Xj\ ^(j^.* {y^^-4:
Tes deux
fils font te
bien ■éi pratiquent le mal.
,
*
Tes tdeux esclaves
*■*
*.
ont
prévafiqué
-
commis des violences,;
et
premier exemple le verbe #,w exerce son influence
sujet S^ù\ et a cause de celJjft- est au singulier, c|ctôfié[t!8 lé Êuj'éî soit au' duel Conforméiftérît a fà concordance ôrefinàïre (ii.° 32 j); maïs le verbe yU^ est au duel, parce qu'il
a
pour sujet le pronom sous-entei'idu L^ , ou, pour parler
Dans le
sur
,
le
,
,
,
c&mirlë
ïà
gralîfnlaïîrens Arabes 1$ tenniftaïsbn q\
ïes
Voyelle
,
f'
qui
est
Dans le second'
le pronom
exemple
éxëtce st>rr rfiffiiè'Wc'ê s*ûr fé
est au
singulier
qu'il à pour su1 jet
,
c'es't te
sujet é\3lz
le second
^
affixe
,
nominatif du. duel
verbe,
,
au
-premier
et
qui, a
plutôt
(n.° 8 14>
OU
tferbe Jy
causé
contraire,
qui
décela,
est au
duel,
ïë prdnbm
sous- entendu l^ ou la
parce
minaison, f-, pronom affixe nominatifdu duel.
De ces deux manières de s'exprimer, la seconde est la
plus
aiitorîsée.
cas,
l'influence
Quelques grairimaîrîeiis
commune
mettent de dira
:
verbes
et
de
des deux verbes
cs'Ujf
3*42- Lorsque
admettent
sur
aussi,
le même
dans
sujet;
ce
ter
et per
^^J o^.
le même
complément
nom- sert
à l'autre
manière dont les deux verbes
sont
,
de
sujet
à l'un dés deux
il faut faire attention à la
disposés.
DE
ji^.
Si f'ôri
complément
,
d'abord le. verbe auquel le nom sert de
ensuite celui aûcfuef il sert de sujet , on sousmet
et
entendrà toiit-à-faît le
'nominatif,
comme
complément,
Exemples
sujet.
*.-
J'ai
2ÔI
SYNTAXE.
LA
-
.,,-
frappé (Zéid)
J 'ai passé (près d'Âmrôù)
.
et
,
nom
âù
..,
Ze'id m'a
Amrou
et
,
oti mettra lé
et
:
a
frappé;
passé près
de moi.
cependant de substituer
un
pronom affixe au nom pour servir de complément au premier
verbe et de dire: oôj ôîj^j *-*iH» je l'ai frappé et Zéid m'a
frappé; c'ést-à-dire j'ai frappé Zéid, et il m'a frappé.
$44- Si l'on met d'abord le verbe auquel ïe nom sert de
sujet, et ensuite celui auquel il sert de complément, on sup
primera tout- a- fait ïe complément, et On observera, pour la
concordance du premier verne avec le sujet les régies ordi
Quelques grammairiens
permettent
,
,
,
,
,
naires.
Exemple o^J-N o^J^j d£3-"*
frappé, je (les) ai frappés.
:
les deux Zéids m'ont
et
On peut aussi
ment, et donner
exprimer ïe
avec
m'ont frappé,
la forme de
et
,
complé
la terminaison
qui représente
ai
et tous
deux m'ont
ce
qui indique sa
sujet. Exemples :
téf fecïds ; c'esi-k-âtrc , lesZeids
j'ai frappé
je les
et
J'ai frappé,
sujet
le pronom
Ils m'ont frappé,
sous
verbe dont ^influence auroit dû s'exercer
au
sur ce nom comme sur son
concordance
nom
frappas.
frappé
,
les deux Ze'ids
;
c'est- à-
diie, j'ai frappé les deux Zéids et les *dcux "ÈéUfs m'ont frappé.
,
DE
202
345
S'il
•
attribut,
commun
à deux
malade,
et
SYNTAXE.
d'un verbe
s'agit
tel que
LA
0?
qui
doive avoir
'^devenir,
être,
propositions
Zéid étoit malade
,
,
comme
on
dans
peut
se
sujet
un
et un
que l'attribut soit
et
exemple j'étois
contenter d'exprimer
cet
,
l'attribut,
supprimant tout-à-fait pour la se
conde fois
ou ïe
représentant par un pronom isolé composé
(n.° 813, i.r,p.). On dira donc : li_^j*ï ùî'j ô^j o-» j'étois et
seule fois
une
le
,
uA) O^j «lû^c*-&'je l'étais et Zéid
UiJji oJJ 0^' o-Xï" j'étois, et Zéid
Zéid étoit malade ;oull«iJ>«
était malade;
était
ou
enfin oGf
,
malade, cela, c'est-à-dire, Zéid étoit malade
La
de
première
ces
trois manières de
,
et
je l'étois.
s'exprimer
est
la
plus
autorisée.
Ceci suppose que ïes deux sujets sont du même genre et du
même nombre : dans ïe cas contraire , il faudroit répéter l'attribut.
La même chose à -peu
346.
verbes,
tels que
^0
-près
a
lieu par rapport
C>^. juger qui
aux
pour complé
proposition entière", formée d'un sujet et d'un attribut,
mis tous deux* à l'accusatif ( n." 1 1 4 )
comme dans cet
exemple : CltU fou) o31k j'ai cru Ze'id savant; c'est-à-dire j'ai
croire ,
,
ont
ment une
>
,
que Zéid étoit savant. Il peut arriver que l'attribut soit com
mun à deux
propositions , et par conséquent à deux sujets diffé
cru
rens, et que le nom qui dans l'une des propositions est le sujet
du verbe troire , soit dans l'autre le sujet de la,
proposition com
plémentaire.
Tel
Zéid
En
n.°
savant.
précédent,
est cet
:
conformant à
se
on
exemple
pourra dire
'Zéid'm'a
ce
en
qu'on
arabe
:
cru
savant, et j'ai
cru
vient de lire dans le
HtU
fjoj olitj J^i»
Yo^.j oXlU^olIf &X
enfin foJj oJîxbj <>^>
// m'a cru, et j'ai cru Zéid savant youbienlltU
il
me
Va cru,
■\ PJ* H
cru
et
m a
j'ai
cru
cru, et
Zéid savant,
et
il
Zéid javant;
ou
j'ai cru Zéid savant, cela; c'est-à:dire,;'<w
me l'g. cru.
.
DE
Entre
LA
SYNTAXE.
trois manières de
ces
203
s^xprimer,
la
est
la
différent,
il
première
autorisée.
plus
Si les
sujets étoient de genre ou
faudroit répéter l'attribut. Exemple :
de nombre
,^jja.f I^Fj fô^J &»[ ^llkjj^f
Je
regarde Zéid et Amrou comme mes deux frères et tous deux
regardent aussi comme leur frère (à la lettre existimo, et existimant me fratrem Zéidum et Amrum fratres).
,
me
,
,
Quelques grammairiens
mules suivantes
et
•/* f/»/r,
Dans
ils
rt
me
ils
lyfj ïiXjJ
me
croient, Zéid
ce
dernier
exemple
sur son
sujet,
,
oui'
le croient, Zéid
d'influence
qUJoj
en
ce
cas
les deux for
:
ijjji^î
Je crois,
autorisent
les
,
et
et
(^'ULa-^ (ji»f
Amrou
(mes)
Amrou
(mes)
deux frères;
deux
frères.
c'est le second verbe
noms
qui n'a point
Zéid et Amrou, sujet du verbe
étant sous-entendus.
Si c'étoit le
prerrîier verbe dont le sujet fut sous-entendu et
( Zéid et Amr&u ) me 'croient leur frère et je crois
mes deux
frères ( à ïa lettre existimànt me fra
existimo Zéidum et Amrum fratres)
on rîour'roit
,
que l'on dit,
Zéid et Amrou
trem
,
et
ego
s'exprimer
,
,
,
en
arabe des trois manières suivantes:
i^j^f !>£j \q^j
ils
croient
q&ÎJ èy&
crois Zéid et Amrou
je
(mes)
(leur)frère ; ou bien Ùj'i^îT f£pj f ouj ^t fj 4 U&j
ils me croient et je crois Zéid et Àmrou
(mes) deux frères, celafxyu.
enfin
^j±.f £pj ftûj ,jJ»fj <£ukJ ils me croient etje crois Zéid et
Amrou (mes) deux frères. '
me
,
et
"
deux frères,
«
,
,
•
J*C>4
LÀ SYNTAXE.
DE
XVIII.
CHAPITRE
Concordance du Sujet
^4c7'
I
L
n'y
a
quand l'attribut est
et
de l'Attribut.
de concordance entré le
sujet e d'attribut, qv.a
adjectif; et il faut bien prendre garde, à cet
uii
adjectifs un grand nombre de mots
être rendus en françois et dans d'autres langues par
des adjectifs, mais qui eii arabe sont de véritables noms tels; c|ue
j^i. bien, j-s mal et tous les mots qui expriment une icl'éë
comparative ou superlative, et qui sont He la forme "^iàf
Ces noms répondent à-pëu-près au genre neutre des adjectifs
latins employés sans aucun nom auquel ils se rapportent, ou
avec le mot
quid, comme bohuth malum melius, melius quid,
C'est ainsi qu'on dit en arabe :
&C.
majus quid,
de Considérer
égard
qui peuvent
,
comme
,
,
,
t
.
,
,
-
•
,.
.,$.-, 5
Une Servante vraie croyante
qu'une
servante
Les bonnes
de
ton
^
j
$
œuvres sont
meilleure
est
melius
[est
auïd)
excellentes
quant h leur
La sédition
fsunt optimum quid] auprès
récompense.
JjiiJf '^A ô-if JÙLÎJLff'
est
pire [ gravïùs quid] que te
La concordance
entre
le
meurtre.
sujet et f attribitt
que le nombre et le genre.
Les règles de cette concordance
349.
*
polythéiste.
seigneur,
348.
-
ne
concerné
peu-près les
mêmes que celles de la concordance du verbe avec le
sujet.
3 j O. L attribut étant placé après le sujet , concorde avec
sont
à
lui
en
genre
nombre
et en
SYNTAXE.
LA
DE
(n.° 300)
2p$
à moins que le
,
pluriel irrégulier; car alors l'attribut peut
(n.° 311). Exemples :
gulier
soit
être
un
sujet
au
ne
sin
féminin
Ses père
$
et
mère étoient vrais croyans.
»
•
j
"**
j
J '
e~*
.
-
ïj-^oy oj^lj Vj}-^' ls9?
Les coeurs sont aveugles quoique les yeux soient clairvoyans.
,
fjjj (^aJ L^o U LXAs. LsJAà. (\**j£
jour-là il y aura des visages baissés
iÂAi.
En
ce
fatigués,
feu
°y^j
vers
,
abattus de lassitude
,
qui supporteront
la
terre
,
la violence d'un
'ardent.
35 I. Si l'attribut précède le sujet, ce qui a lieu dans ïes
propositions interrogatives et négatives et que le sujet soit un
pluriel ou un duel on doit mettre l'attribut au singulier. Ex. :
,
,
oiUpf *J_-^l3f
Est-ce que les deux hommes entrent!
Les hommes
point.
ne sortent
3 J2. Si le sujet est un nom collectif, l'attribut peut être au
pluriel. Exemple : ôy^Ji «JJ^ tous lui obéissent (n.° 320).
353* Si le sujet grammatical, étant du masculin, a pour
complément un nom féminin qui soit le véritable sujet logique
•
,
Pattribut peut se rapporter au sujet logique
minin. L'attribut peut pareillement être mis
,
sujet grammatical, étarit
masculin
qui puisse
(n.° 332). Exemples :
nom
du féminin
,
a
être considéré
être mis
et
au
pour
comme
au
fé
masculin , si le
complément
le
un
sujet logique
206
DE
Tbw/*
Za
secouer
vz/£
<&
ame
l'esprit qui
SYNTAXE.
LA
éprouvera
la mort.
considère l'issue des évênemens, aide à
la paresse.
Commettre des actions, criminelles, c'est
ils comptent pour
Dans
titre de
un
dernier
ce
gloire
de
che^
renoncer
exemple, *à)yé»
à
eux un
ce
mérite,
est
qui
et
honnête.
féminin
singulier j
pluriel irrégulier (n.° 311).
est au
qu'il concorde avec j^'j^M
3 < 4- Le sujet, étant un pronom ou un article démonstratif,
peut être du singulier féminin lorsque l'attribut est un pluriel
féminin régulier ou un pluriel irrégulier. Ex. : «»f iji>» éh
parce
,
,
,
ce
sont là les lois de
35£
.
cib'fji.t
&
ce sont
là
vos sœurs.
rappeler ici qu'il y a un cas où l'attribut
à l'accusatif, quoique le sujet soit au nominatif:
propositions adverbiales qui sont exprimées sous
Nous devons
doit' être mis
c'est dans les
forme de
Dieu;
circonstanciels
où l'attribut
placé le pre
mier. Nous en avons
exemples ailleurs (n.° 1,22). On
peut encore y joindre celui-ci: *-é<jJ£ iS>}^ (£*-a iJ^î^i cs^j
l^_iUiu./£ ne suis pas un de ces hommes incapables de supporter la
soif, qui conduisent le soir leurs troupeaux au pâturage les jeunes
chameaux étant séparés (de leurs mères de peur qu'ils ne les tètent).
Nous renvoyons au chapitre suivant une autre observation
concernant les adjectifs qui concordent en même temps avec
termes
,
et
est
donné des
h
,
deux
et
noms
,
qualificatifs
demment
attributs par rapport à l'un ,de ces
par rapport à l'autre. II en a déjà été parlé
comme
(n.° 271),
noms
précé
,
DE
SYNTAXE.
LA
CHAPITRE
Concordance des
et
356
On
.
dance des
avec
les
Adjectifs
,
sition dont ïes
qui
ce
le
,
concor
des pronoms ,
,
forment l'attribut d'une propo
ces mots
noms sont
la
concerne
des articles démonstratifs
,
démonstratifs
les Noms.
avec
précédemment
adjectifs
quand
noms
XIX.
des Articles
,
des Pronoms,
a vu
207
sujet (n.os 348
Nous allons considérer ici les
et
et
suivans}.
les articles démons
adjectifs
simplement qualificatifs et formant avec le nom
auquel ils se rapportent une seule partie du discours soit le
sujet soit l'attribut soit un complément quelconque.
3 57* Sous ce point de vue, les adjectifs sont nommés ç^i
qualificatifs, et le nom auquel ils se rapportent est appelé oj**i
qualifié. Ils appartiennent à la classe des parties du discours que
les grammairiens Arabes désignent sous le nom de ifjj termes
qui suivent, c'est-à-dire qui se conforment, pour la syntaxe à
un autre mot dont ils sont comme ïes accessoires. Je
parlerai
plus en détail de cela dans le chapitre suivanj, en traitant de
la concordance des appositifs.
358. L'adjectif, considéré comme qualificatif doit concor
der avec le nom qu'il qualifie ou ce qui est la même chose
auquel il se rapporte relativement à quatre choses : 1 ,° la qualité
tratifs
et
comme
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
de défini
*
359*-
ou
d'ipdéfini
,
2.0 le nombre
,
^€s art^es démonstratifs fi
3.0 le genre 4«° le cas.
\ô* <il[i et autres,
,
-
-
étant définis de leur nature ,
ne
peuvent se joindre qu'à des noms
définis soit par l'article déterminatif, soit autrement : ils doivent
aussi concorder avec ïes noms en nombre et en
genre. Quant
aux cas
,
ils n'en
ont
point,
si
ce
n'est
au
duel
:
à
ce
nombre,
2Ç)8
DE
LA
les
SYNTAXE.
auxquels ils se rapportent.
3 60. Les prqnorns ne sont jamais employés à qualifier les
mais seulement à les représenter, lis ont au surplus avec
noms
}es*noms qu'ils représentent, Ja même concordance de genre ej
de nombre que les adjectifs ont avec Jes noms qu'ils qualifient.
361. Nous avons dit que l'adjectif s'accorde avec ie nom
par rapport à la qualité çje défini ou d'indéfini ; c'esjt-à-dire $ue
l'adjectif doit entre défini qu déterminé par Parade. J}, coûtes
les fois que le nom est déterminé soit par l'article \}\ spû par un
complément déterminatif, soit enfin par la qualité de nom
propre. Àipsi l'on doit dire : iJ^ff oUi=Jf le livre^excellent;
ils concordent
en cas avec
noms
,
,
,
,
'&h^ dPJ* 4-^C Idjhte
excellent de Aîo'ise ;
pj^==>J>]
iJûf
sort
respectable ; &*Y] ££jî»J le fidèle Abraham. Si, au contraire,
nom étoit indéterminé, l'adjectif deyroit l'être pareillement.
livre
le
ouf* j oljj' j'ai lu dans un vieux livre.
362. La valeur de l'adjectif est quelquefois exprimée par une
proposition soit verbale sbit nominale soit circonstancielle.
Cette sorte de proposition que l'on pourroit nommer adjtctive
bu qualificative étant de sa nature, indéterminée, ne se joint
qu'à des noms indéterminés. Exemple : IjLj J^Jj <^fy> j'ai passé
près d'un hommk (qui) dormait; iyi est la même chose que
Çxemple
:
(j^f-
,
,
,
,
,
,
i*-jli dormant. Exemples
:
Des
paroles obligeantes ej de l'indulgence valent
aumône (que) suivent de maiivais procédés,
mieux
qu'une
«
S'ils
d'autres
te
traitent de menteur,
envoyés (qui)
mission).
f
on
a
accusé de
mensonae avant
avôient donné des. s
ignés cvidens
(de
toi
leur
s,*
Si
DE
Le premier
200;
SYNTAXE.
LA
temple (qui)
été bâti pour les hommes
a
oUCIf If \^> oUï^tfcyljf <uUuiUÇff osQé Jjjf
CVrf /ai
sens
clair,
363*
plus
^wi
r'#
envoyé
(lesquels)
Ces
souvent
sortes
,
sont
livre
ce
la
<it>Jtj*
des
versets
(qui) renferme
de
ce livre.
partie fondamental
d'un
propositions peuvent et doivent même,ïe
en
françois sous forme de propo
de
être rendues
sitions
comme
je
iyJ
dormoit
:
conjonctives,
par les mots qui
caractère essentiel
viens de le faire
mais
,
en
arabe
,
en
traduisant
elles diffèrent
des
,
pour sujet
propositions qui
par
l'adjectif conjonctif (jJJf ; car, l'adjectif conjonctif étant, de sa
nature défini ou déterminé, les règles de concordance du nom
qualifié avec l'adjectif qualificatif ne permettent pas de mettre un
nom indéterminé en
rapport avec une proposition qui a pour
sujet cet adjectif conjonctif (n.° 3 6 1 ). On ne peut donc pas dire :
IjJj (jiÀ.Jf Jij^ ojj-» Et il n'y a point, en arabe d'autre adjectif
conjonctif qu'on puisse employer, quand l'antécédent est indé
terminé ; car ^ et U sont des noms conjonctifs qui renferment
en même
temps la valeur de l'antécédent, et qui signifient celui
qui ou celui que, la chose qui ou la chose que.
Les propositions qui sont jointes à un antécédent par l'ad
jectif conjonctif, équivalent donc à un adjectif déterminé par
l'article Jf : celles au contraire dont je parle ici, et que j'ap
pelle propositions qualificatives équivalent à un adjectif indéterminé. Ainsi Ji> IS (jù—tt <JXlX\ le roi qui est juste, est la
iUJf cslillf le roi juste ; jç>*î <AX* un roi (qui)
est juste, est la même chose que £filé <^i un roi juste.
364* Lorsqu'une proposition qualificative est formée d'un
verbe qui a un sujet différent du nom qualifié par cette propoi
un
,
ont
,
•
,
,
—
/// PARTIE.
O
DE
2 1©
LA
SYNTAXE.
qu'elle renferme un pronom affixe qui se rapporte
au nom qu'elle qualifie. C'est ce pronom qui forme réellement
la connexion du nom qualifié avec la proposition qui le qualifie.
Exemples :
sition , il faut
5*1*
A
-»
J'ai marié
'Amrou aimoit
C».
J
fils
elle).
mon
à
-
une
■>
-
•
"
(à
la
lettre,
femme qu'aimoit Amrou (à
la
lettre,
passai près d'un homme
le père de LUI dormant).
Je
\ -*
\J
, S
dont le
..
-
père
.•'f
«f
->
dormoil
•
-
-
On retranche
est
cependant assez souvent ce pronom, quand il
suffisamment indiqué par le sens. Exemple :.
<>4*m jj*j #i£> fcÀcTjîjif l>
Je ne sais si c'est Véloignement et la longueur du temps qui ont
altéré leurs senti mens, ou si c'est de l'argent (que) ils ont reçu,
yufyu
*f
Le poëte auroit dû dire ejJUf JU de l'argent ils ont reçu LUI ;
mais il a supprimé le pronom t lui, sans qu'il en résulte aucune
obscurité.
365*
et
joint
suivant
à
On
une
ce
quelquefois un nom restreint, par l'article,
proposition qualificative ou à un de ces mots qui,
que
trouve
nous avons
dit ailleurs
,
restent
indéterminés , lors
complément, tels que jï Jji; (n.° 202) ;
mais, outre que ces exemples sont rares cela n'a jamais lieu que
quand l'article est employé pour donner au nom appellatif toute
la latitude dont ce nom est susceptible
<jJU?. (n.° 770, i."p.): cÀiX»
U
il
ne
convient
J»-_>JJ <#&?
Exemple
pas à un homme, qud
qu'il soit, tel que toi. On diroit de même <&&* Ji-j-fy à un
même
qu'ils
ont un
,
,
homme
quelconque, (qui] te ressemble.
DE
366.
2H-
SYNTAXE.
LA
La concordance de
l'adjectif avec le nom par rapport
ne souffre
au cas
point d'exception si ce n'est dans les cir
constances que nous avons
indiquées en parlant de l'influence
de la particule négative (n.° 05 ) et du compellatif (n.° 1 34).
367 Si un nom a plusieurs adjectifs, on peut quelquefois se dis
,
,
,
.
penser de ïes mettre
en
concordance de
cas avec
lui; mais il faut,
pour cela , que le nom soit tellement déterminé par lui-même ,
que les adjectifs ne soient point nécessaires à sa détermination ,
dans
comme
cet
exemple
J-fiiJf *Jjiuî J^UJf oûjj oJ>* j'ai
:
de Zéid le sage , le généreux , te vertueux. Zéid, nom
étant
suffisamment désigné par lui-même, on peut
propre,
mettre tous les adjectifs au nominatif ou à l'accusatif. Dans le
passé près
premier
je
cas
dire. Si
veux
mination
de
cas
entend y> il est, et dans le second , ^ f
les adjectifs sont nécessaires pour la déter
on sous
,
tous
précise
du
aveclui. Si
un
-
nom
à cette détermination
ou
,
ils doivent
,
seul
on
peut
être
tous
mettre
les
concordance
en
seulement
partie
ou une
est
nécessaire
autres au
nominatif
à l'accusatif,
368
nombre
Quant
.
avec
le
à la concordance de
nom
il
auquel
ia même que celle du verbe
ïui sert de sujet (n.os 309
se
l'adjectif en
rapporte , elle
avec
le
nom
qui
est
le
genre
et
en
général
précède et qui
,
en
,
311). Ce que nous disons ici des
commun aux
est
adjectifs
pronoms, soit isolés, soit affixes.
Lorsque le nom est singulier, ou duel, et masculin, la con
-
cordance
Si ïe
est
est
toujours régulière.
singulier
pareillement régulière.
nom est
Mais si le
,
ou
duel ,
et
féminin , la concordance
pluriel, soit masculin pourvu que ce
pluriel régulier soit féminin on le fait concorder
le plus ordinairement avec des
adjectifs et des pronoms singuliers
et féminins. Exemples :
ne
soit pas
un
nom
est un
,
,
,
O2
SYNTAXE.
LA
DE
212
'ù^>kl\ -aLUsJJj cfc^!} *^-*4^
'qa
<^3%^\ V—a. (j'y.'i l^.j
jLo^Llf J^fj ZâÂJÎ^ t_>_ÂoJf
O*-
*—
Les hommes
l'objet
de leurs
amoncelés d'or
se
complaisent
désirs,
et
comme
d'argent,
et
dans l'amour des choses
des
femmes,
des
des chevaux de
qui
sont
des talens
enfans,
grand prix.
JlU. quoique singulier est cons
truit comme le seroit un pluriel irrégulier, confonnément à ce
qui a déjà été observé (n.° 320).
Dans
cet
exemple, le
mot
,
,
dr.?' d^'j
qui arrivaient en foule, les
*fr /«/ /tfr escadrons
// tfvo//
/?r^r
provisions qui afiluoient abondamment les armées destructrices les
guerriers dévorans, les glaives qui pourfendent les cohortes et les
drapeaux les lions noirs les légions qui rompent ( les obstacles),
et les étendards
qui brillent comme la foudre.
,
,
,
,
,
Des jardins
sous
lesquels coulent des fleuves
Nous leur avons dit,
de
et
mépris);
,
leur sont destinés..
Soye% changés en singes (pour être des objets
rendu ces singes un exemple pour leur sikh
et nous avons
pour les siècles suivans.
■$
•
-$-«,*
iSj^sAi
.5 Val
Un grand nombre d' enfans.
369*
pronom
Cette concordance
a
rarement
raisonnables; mais,
lieu
dans
irrégulière
quand
ce
le
cas-là
l'adjectif que du
signifie des créatures
tant
nom
de
même, ejle n'est pas
sans
DE
exemple,
On
en
pourvu que le
trouve un
SYNTAXE;
LA
nom
exemple
dans le
Depuis
le siècle d'Ad, c'a
vers
Uf
UJLio^ L-^JUsj djllU Jfm\
les rois dans les fers , de les
soit -pas
ne
été
un
pluriel régulier.
suivant
UjJjU
toujours
tuer , et
213
,
:
qç* ilé o^â ^«
notre coutume
de mettre]
de les combattre.
concorder les noms masculins pluriels
n'expriment pas des êtres raisonnables
avec des adjectifs pluriels féminins. Ainsi Fon dit : oIjjU» >j^\
des lions dévorans oUJj ^JUa. des montagnes solidement affermies,
o&^cjjiv* des glaives affilés, ofS/o^ Iv.T des jours comptés.
370. Cette même concordance irrégulière, qui est la plus
ordinaire, n'exclut pas cependant la concordance régulière qui
peut aussi avoir lieu soit que l'on emploie les pluriels réguliers
ou les
pluriels irréguliers des adjectifs ; mais avec cette restric
tion que le pluriel régulier des adjectifs masculins et les pronoms
pluriels masculins ne peuvent être employés que quand le nom
ayquel ils se rapportent signifie des êtres raisonnables ou des
êtres que par une figure poétique on assimile à des êtres rai
sonnables. Exemples :
On peut aussi faire
pourvu toutefois qu'ils
,
,
,
,
,
,
,
,
,
alous .ksi©
jlJ^^â
UXU
o^LicfJ j!UJf l»)y3 fjb
Prene^ garde d'exposer vos âmes
.
tt
les
I
le
à
Idif
\j>
feu qui dévore les hommes
confiée à des anges durs et
un
pierres et dont l'intendance est
forts, qui ne désobéissent point aux ordres que Dieu leur donne,
et
qui font tout ce qui leur est commandé.
—
,
fj-Uai"*»!
Quant
aux
iC^é Lf
^4ï^/ju {j^ASCj çj'j£ &°'p~& ^j
oiseaux de proie que
vous
aure^ instruits en fes dressant
2l4
des chiens de chasse,
comme
la science que Dieu
vous a
proie qu'ils ont prise
pour
SYNTAXE.
LA
DE
et en
donnée
,
leur
il
communiquant
vous est
vous.
»
Prends quatre oiseaux,
appelle-les
puis
ensuite
Z« ^/7f «Vka*
portion
elles accourront
/# /w^,
rt
bitent, célèbrent ses
approche- ks
mets- en une
et
,
de
sur
vers
# Aw/wr
ot
chacune des montagnes;
toi.
les créatures
Fourmis, entre^ dans
.,
Jl
—
*»
et
oô.f
oj[3 <>j
je les
la lune;
écraseront
demeures,
vos
et
D'autres compagnons me
société; un loup endurci à la
hyène
l'épaisse
•
vus
qui
Uûf (j
et ses
point.
\\** -\tA*'*-9jcj «r**> -^jlî
^fr.„
de voir trahir
ai
alors Salomon
$!--*»
fj**-*
fs
-
.-U,
-»
1-
ey
jfif j£
de la perte de votre
,
ces
"M
Oj**' j**-^5
£$& v
dédommageront
un
course
léopard
crinière. Avec
secret; le
-
<**--«
J34 > u autf^ ^.jj y jpf
à
les ha
qui
**£Lj o^ft* f^*^£ *? f&J=X^A f^Sf JuSJf
ne vous
*>*-
louanges.
J'ai vu dou^e étoiles, le soleil
m'adoroient.
■*$
**îj
il^JxJ, (2&otj î^îf V
toi (et coupe-les en plu
^jj^U ti'^13 >£^j (j^}j U^s »jiî>
tnupes
partie de
libre de manger de la
ijf^. ^jiM jUa» <)> ji j«My ^^i^j^ ->y*M
sieurs parties) ;
une
camarades-là ,
au
poil
on ne
ras, une
craint point
coupable avec eux n'appréhende point
d'être abandonné pour une faute qu'il a commise.
Dans le troisième exemple, J& est en concordance avec des
pronoms féminins pluriels, par la raison que l'on a dite ailleurs,
comme dans l'exemple ^JU*- If^-H (n.°
320}.
Dans le quatrième le pluriel irrégulier ofJôJ est en concordance
son
,
DE
21
SYNTAXE.
LA
5
dans
l'exemple
pluriel régulier féminin ^-J>
rapporté ci-devant (n.° 310), ijffôà tëàj *-l* Jjjf
Dans le cinquième exemple et les suivans, les pronoms sont
du pluriel masculin parce que le loup, le léopard et Y hyène, ainsi
sont
que les astres et les fourmis, auxquels ils se rapportent
des
raisonnables
êtres
considérés comme
susceptibles d'adorer,
ou doués de la parole.
avec
ïe
comme
,
.
,
,
,,
371
II faut
.
observer, par rapport
encore
à la concordance
du nombre , que les noms d'une signification.collective , quoique
de forme singulière , se joignent bien à des adjectifs pluriels
l&jïy^ t$\ J*. lij^l Secours- nous contre
(n.° 320). Exemple:
les gens incrédules.
Par la même raison, j-j^=>
en
concordance
avec un
suivans
exemples
nom
étant
,
pluriel,
n'y
m
grand nombre
et
de femmes.
Il
a
de
myriades
fait sortir de
Le
372.
:
ces:
qui
*
deux personnes
se trouve en
^-Jj4. °& Hj'k^é.
auront
dans les deux
O? Q4*
avec
lesquels
ont
été tués
ce
un
grand nombre d'hommes
casVj*?
comme un nom
^quiconque, celui qui, est aussi employé comme
collectif, et
Exemple
ceux
mat
est souvent
d1 hommes/
regarder, dans
apposition (n.os 387 et suiv.)..
un nom
comme
.»
J*£ OjOO ***° Ôï? iSr*
a-t-il pas de prophètes
On peut aussi
en
singulier,
:
j
Combien
au
suivi
ma
concordance
oj»
>& (j\û4>
avec
des
pluriels;
^ mais pouf
direction^, ils n'auront aucun sujet de
*-o
ils
n'éprouveront aucune affliction^
un nom
qui est au duel ou au pluriel, et qui exprima
3 73
par conséquent plusieurs individus, on veut joindre des adjectifs
crainte,
,
et
•
Si à
04
21
6
qui ne
rapportent qu'à
se
corder
adjectifs
ces
soit
seul des individus , il faut faire
un
genre
doit les
mais
on
au
duel
ou au
J'avois deux amis,
d'un
cette
nom
C'«st
sensé
,
et
(l'autre)
se
le
imbécille.
vizirs, (l'un) généreux (un autre)
,
(le troisième) prodigue.
et
Dans
con
ils
nom
,
(l'un)
Un certain roi avoit trois
avare,
le
auquel
mettre au singulier
quoique
:
Exemples
pluriel.
et en cas avec
;
rapportent
nom
en
SYNTAXE.
LA
DE
dont les
comme
adjectifs
si l'on disoit
y a réellement ellipse
les attributs ou les qualificatifs.
s'exprimer, il
manière de
:
sont
J^U.^i.Yfj J>'U.
X^f
qU^U» J $
j'avois deux amis l'un étoit sensé et l'autre étoit imbécille; ou bien
JjfeU. c_>o.U>j J£lé <_>».U> qUaL^ J ô^1 j'avois deux amis un ami
,
,
,
sensé,
Si
374.
noms
ami imbécille.
et un
un
même attribut
singuliers,
et
que
tous
est commun
ces noms
à deux
soient
au
ou
plusieurs
même
cas et
du même genre , il faut mettre l'attribut au duel ou au pluriel,
suivant le nombre des personnes auxquelles il se rapporte, et,
du
reste
,
le faire concorder
Exemple : ^yÀM\ fjJj
et
j'ai écrit
Si les
o—
à Zéid, les deux
noms
n'étoient
en cas et
en^ genre
avec ces noms.
'4&J Xîfi o^ j'ai parlé
à Amrou,
poètes.
point
au
même
cas
,
l'adjectif ne
con
genre , et on le mettroit , soit au nominatif, soit
à l'accusatif. Ainsi l'on diroit, (jfJcUif
c^'j JLf o-^' Yfé c>-A
corderait
ou
^jjJjtUJî
sens
et
qu'en
seroit
cela
,
.
Dans le
ils
premier
sont tous
on
L£, et le
second, J^f >
sous-entendroit
poètes ; et dans le
je veux dire les deux poètes.
deux
à la lettre
cas,
signifteroit
yj^> Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la concordance
,
DE
217
SYNTAXE.
LA
des pronoms avec les noms, ne s'applique qu'aux
pronoms de la troisième personne. Les pronoms de la première
et de la seconde personne sont toujours , et sans exception , en
irrégulière
concordance de nombre
se
de genre
et
ïes
avec
noms
auxquels
ils
rapportent.
adjectifs verbaux des formes Jj»3
J^»5 JUa» J&u et J^aÀ« exige quelques observations par
ticulières (n.os 673 et 680, 1" p.).
Ces adjectifs sont du genre commun ; et si quelquefois ils
prennent la terminaison ï', c'est comme forme énergique
(n.os 623 et 625, i.re p.). Ainsi l'on dit également *-JjX« J^J
un homme
dédaigneux, et «Jj-U "**>°i unwfemme dédaigneuse ;
on dit aussi *-ïf Jju
JaJ zm homme brave à l'excès ***b J ?J
i//z homme très -fin.
Quelques-uns des adjectifs de ces formes ont cependant ïes
deux genres, et suivent les règles ordinaires de concordance.
féminin i-iUL»,
Tels sont t>»j^ féminin *iu>k joli ; olîy»
376.
La concordance des
-
-
-
—
,
féminin
crédule; o^-^î
>
ennemi;
féminin
a».J
adjectifs
Les
,
iû^C^,
*-4N*J
de la forme
,
culine
,
Hors de
avec
des
ce
cas-là
noms
Convertisse^- vous
lg£jf CS*Î*J
C/n
quelles
arc
il
long
est
et
cX*
,
jtvé
pauvre;
Jjls
féminin
ojoJî
,
des deux genres.
à Dieu par
une
,
sous
la forme
Exemples
mas
:
pénitence sincère.
W^J^Î t>3^* cM*^* *[jÀo
robuste, sonore, que décorent les courroies
suspendu.
,
aussi les deux genres , et
quand ils ont la signification
ont
ils concordent
**y>*»\
,
clément.
suivent la concordance ordinaire
passive.
,
,
>
aux
2.1
8
LA
DE
SYNTAXE.
Elle dit: Comment aurois-je
et
je n'ai point
C'est
la
une
un
fils ! aucun
homme
ne
m'a
touchée,
ni à
labourer
été coupable- d'union illicite.
'vache
n'est point accoutumée
qui
au
joug,
terre.
adjectifs de la forme Ja*>, ayant le sens passif, et étant
joints au nom cjuils qualifient, concordent indifféremment avec
des noms masculins ou féminins. Exemples :
Les
J'ai
J'^i
Si le
nom est
nairement à
Z>jr
corne
,
mais
tuée.
jeune fille blessée.
sous-
entendu,
terminaison féminine.
l'adjectif la
vous
sont
on
donne ordi
Exemples:
interdits.
(bête) qui
Ces mêmes
trouve
été
a
adjectifs
naison féminine ,
et
,
mangée par les animaux féroces.
ayant le
sens
actif,
suivent la concordance
cependant
signification active
JguiiJf VJJf êlJJû. uLl;f
la
d'une
^jj/ près
féminin,
femme
iîiJïljtj />3j[j *^-tf <*^-^ Ovoja
charognes, le sang, et toute (bête) qui â été frappée de h
Za
On
une
vu
,
et
des
adjectifs de
qui
sont
admettent la termi
régulière.
J*»> qui ont
commun. Exemple :
la forme
du genre
envoyé contre eux le vent des
tructeur. On en trouve pareillement qui prennent la terminaison
féminine, quoiqu'ils aient la signification passive, et que le
«okj
ûvonr
DE
2 LO>
SYNTAXE.
LA
féminin
qu'ils qualifient soit exprimé. Ainsi l'on dit
i^ô, *l«î» une qualité digne-de blâme et tW* digne de louange.
377. Nous avons parlé fort au long, dans un des chapitres
précédens, des cas où un adjectif semble qualifier en même
temps deux noms, quoique, dans la vérité, l'adjectif ne forme
alors avec le nom qui le suit et qui est dans sa dépendance
qu'une qualification complexe du nom qui le précède ; et nous
avons fait voir que dans cette expression un enfant roux de che
c'est l'expression complexe roux de cheveux toute entière,
veux
et non le seul adjectif roux, qui est le qualificatif du mot enfant ;
le sens étant, un enfant dont les cheveux sont roux (n.° 266). L'ad
jectif, dans ce cas est donc qualificatif par rapport au nom qui
le précède, et attribut par rapport à celui qui le suit.
Nous avons aussi fait connoître les diverses manières d'indiquer
en arabe le double
rapport de cet adjectif: nous devons ajouter
ici ce qui concerne la concordance des adjectifs dans ce cas.
378. La première chose à observer, c'est que l'adjectif, dans
ïe cas dont il s'agit, doit concorder, par rapport à la qualité de
nom
,
,
,
,
,
,
,
défini
dire,
ou
d'indéfini ,
^Q-Vl^HÂ^Lj
Zéid le beau de
le
avec
un
nom
qui le précède. Ainsi
homme beau de
visage,
et
l'on doit
i^.'J\ ^Icd oJj
visage.
379* En second lieu si l'adjectif gouverne son complément
au
génitif, il doit concorder en genre, en nombre et en cas
avec le nom
qui ïe précède comme il concorderoit s'il étoit en
rapport logique et grammatical avec ce nom c'est-à-dire s'il le
qualifioit purement et simplement. II faudra donc dire:
,
,
,
,
,
«-â.^ f ^â. J—aJj ojl>» j'aipassé près d'un homme beau de visage;
«-a.JJf ici-*. ïs£\ o-Jtf} j'ai une femme belle de visage;
vu
*^yl
L-LL».
*-*j" ô'•^,
&3b.j ^«U.
il m' est venu deux hommes beaux de
visage;
"f-j^o^ii j'ai vu des hommes beaux
de
visage*
II
SYNTAXE.
LA
DE
220
seroit de même si le
en
l'accusatif sous forme de
qui suit l'adjectif
nom
complément circonstanciel,
étoit mis
comme
a
dans
exemple : ljâ.j o-*^ cfe* <^>JJ* j'ai passé près d'un homme
beau de visage.
mis au nominatif,
3 80. Mais si ïe nom qui suit l'adjectif est
alors l'adjectif concorde quant au cas avec ïe nom qui le pré
cède; et quant au genre et au nombre, avec le nom qui le suit
en observant
cependant que la concordance de l'adjectif en genre
et en nombre avec ïe nom qui le suit, est sujette aux mêmes
irrégularités que celles qui ont lieu dans la concordance du
verbe avec son sujet, quand le verbe précède le sujet (n,oi 309
et
suiv.). On dira donc :
cet
,
,
,
,
k
gyl Q-li. J-4*jj oj j* j'ai passéprès d'un homme beau de visage;
LjLglj i^yLL o%y»ii ojj-» j'ai passé près
d'une
femme
belle de
visage;
ajLLj iûjLÂ JLâjj ojj* j 'ai passé près de quelques hommes beaux
de visage ;
UJJajU ^â. *j-^? Zijj» j'ai passéprès de plusieurs femmes belles
d
*_;Ué
IL-é-?^ "Aaj
oj
fj, I j'ai
i_$UU ^ jLj ^S\j
Donnons
\
vu un
quelques exemples
On peut même
,
si le
nom'
homme dont les serviteurs sont
malades
Fais-nous sortir de cette ville
(a)
aspect;
,
qui
de
(a).
cette
construction
:
dont les habitans sont méchant,
suit
l'adjectif est au pluriel
,
mettra
l'ad
'on
dire, xiL^ê ^jyÂJJÂ J-»jj ojj-»»
pluriel régulier,
admet, pour le verbe précédant son sujet, la syntaxe connue sous la formula
jectif
au
i-sç.fjJf<^jJU=»f
s'
et
(n.° }i.4),page
ipi ,
note.
DE
<f ;
Malheur (aux
.
.j
.
j
v.
dont le
hommes)
22 1
SYNTAXE.
LA
,-..*,. $,.--.
_
cœur est
trop dur pour
se sou
venir de Dieu!
/)/>« rendra les
ceux
dans le
dont les
suggestions
cœur
desquels il y
cœurs sont
de Satan
a une
un
sujet
maladie,
de scandale pour
et pour
(les hommes)
endurcis.
Dans le second
le troisième
et
exemple,
il faut sous-entendre
io^liff
Les adjectifs, quoique destinera se joindre à des
381.
noms
s'emploient fréquemment seuls parce qu'on fait ellipse
du nom. Cet usage de l'adjectif est sur- tout très fréquent en
le
(_^bJf
mot
les hommes
avant
.
,
,
<-
arabe. On
le
nom
alors ordinairement le genre masculin quand
indique un être animé et le genre féminin
emploie
sous-entendu
,
Exemples : lè=ajLIl vos
quand indique
péchés ol^UJf les bonnes œuvres, <l£\l£ des merveilles, ïj ^
et au pluriel Jj^j pêc hé mortel. Le singulier masculin de l'adjectif
est aussi employé quelquefois
quoique plus rarement comme
il
une
chose inanimée.
—
,
,
nom
d'une chose inanimée
signifiant
une
bonne
II arrive
:
ainsi I
,
on
trouve
dans l'AIcoran IkU»
œuvre.
fréquemment qu'on supprime le nom,
en ne conservant
que l'adjectif ou la proposition conjonctive qui
fait la fonction d'adjectif. Exemples :
382.
Parmi elles
dire
,
au
assez
seront
(des femmes)
// lance des
le
regard
,
c'est-à-
regard modeste.
<"°
est
modestes du
plus
(flèches)
s
avec
-
c
.
les deux mains
habile à lancer des flèches.
(d'un homme) qui
DE
222
SYNTAXE.
LA
diroit que tu es (un chameau) du nombre des chameaux des
Benou-Okaïsch, entre les pieds duquel on fait ballotter avec fracas
On
une
vieille
outre
(a).
"''
Dans le
premier
4'"'
de
ces
exemples,
ïe
mot
#Uj des femmes
sous-entendu; dans le second, il faut sous-entendre
homme, complément
de
j^»;
et
daris le
Jlj
troisième, J>
«r
est
A«
f^<7-
auquel se rapporte ï'affixe de *&+£
383. Quelquefois, au lieu d'adjectif qualificatif on emploie
un nom d'action : par exemple
Jô* justice, au lieu de JiU
à
celui qu'il qualifie par rap
conforme
ce
nom
se
juste. Alors
port à la qualité de fini ou d'indéfini et par rapport au cas;
mais il conserve toujours son genre particulier et il demeure au
singulier à quelque nombre que soit le nom qualifié. Ainsi l'on
dira JJ* JLij un homme juste, Jtxé q^j deux* hommes justes,
Jôi JU-j des hommes justes. Exemple : <jf ,jCÎU>' <jf '*Sj ^
tb&zu
.
,
,
,
,
,
,
,
,
IjlC4fj caLiiJb cJCJ>y*
bien arriver, s'il
vous
c^UL^o
répudie,
<j££* fj-o. ^fjjf
que
son
seigneur
*-Jt>«H il pourra
lui donne,
en votre
place, des épouses meilleures que vous, Musulmanes, vraies croyantes,
obéissantes et vierges.
3 84* Les articles démonstratifs concordent en genre et en
nombre avec les noms auxquels ils se rapportent en observant
à cet égard, que l'on doit employer les articles démonstratifs
singuliers féminins c$i -<>>>* CÀte &c/avec les noms pluriels
irréguliers et généralement dans tous les cas où cette concor
dance irrégulière a lieu pour les adjectifs et les pronoms. Ainsi
l'on dit, _^_^l^jJf,fc5Lîï ces armées, iLlïf t>ûS ces jours-ci,
,
,
-
,
,
(a) Voyei,
sur
le
sens
de
«e vers, ma
Chrcstomathit Arabe,
t.
III
,
p.
58.
DE
u^J'lCltt éllï
^Uo>
ce
avec
si l'on
on
en
genre
adresse la
à
parle
deux hommes
un
ou
et en
parole.
£>lxpf ,jèJi.
II
en
concordance
<2Uj
est
pour dire
,
,
la personne à la
ce livre , on dira ,
;
femmes, <__>uOf UJuï
de même de
est rare
,
et
l'on
si l'on
parle
à
si l'on
parle
femmes,
plusieurs
îàk (n.° 775 //' p.). Mais
emploie plus ordinairement
et
,
;
à
,
que soient le genre
quels
sonnes auxquelles on
parle.
86.
L'adjectif conjonctif isôj\
3
et
avec
seul, cjbcOf <A$'ï
homme
à deux
nombre
Ainsi
plusieurs hommes, <L>uÇff ICIi
Si>
desquels
le pronom de la seconde personne , outre leur concordance
le nom auquel ils se rapportent , sont encore susceptibles
quelle
cette
ijj\ ci^ï t^
million de dinars.
de concorder
à
oô?
223
chevaux
ces
Les articles démonstratifs dans la formation
385*
entre
JJ*J£\
écrits,
ces
SYNTAXE.
LA
et
le nombre des per
jjJl suit les mêmes règles
de concordance que tous les autres adjectifs. Etant déterminé
de sa nature, il ne peut se joindre qu'à des noms déterminés
(n.° 361). Il concorde avec soiî antécédent en genre et en
nombre soit régulièrement soit irrégulièrement suivait les
règles que nous avons données. Exemples :
-
,
,
,
*_^J (J.C Lgfjjf (>ff *»f
Ils
ont cru aux versets
que Dieu
a
Ç)UU Là-oÎ
envoyés
à
son
prophète.
,*£-X^j' jjjf i>oîisJyf J^ »f (ji [*K^
Aye^ confiance en Dieu dans les malheurs qui vous
Celles de
d'entre
vous
femmes qui auront commis
déposent contre elles.
vos
Vos mères
qui
vous ont
un
arrivent.
adultère, que quatre
allaités.
224
L/jilS
*£=ù>»
*io.lîj(
Les deux personnes d'entre
châtie^.- les.
Je reviendrai
daais
,
SYNTAXE/
LA
DE
un
vous
(^UJ'Ij (jtjdllj
qui auront commis
chapitre séparé
la syntaxe des
sur
,
adultère,
un
conjonctifs.
XX.
CHAPITRE
Concordance des
Les
387*
des
noms
qui
ne
appositifs
réunis à
un
sont,
Appositifs.
comme
autre nom
qui
je
a
l'ai dit ailleurs
été d'abord
(n.°34),
exprimé,
et
font que présenter la même personne ou la même chose
divers points de vue , pour mieux en déterminer l'idée. Je
sous
rappellerai
Grand,
ici
j'ai déjà donné, Alexandre-lefils de Philippe, vainqueur de Darius,
expressions roi de Macédoine fils de Philippe,
l'exemple
roi de Macédoine
les
dans
que
,
lequel
vainqueur de Darius, sont les appositifs
sion Alexandre-le-Grand.
,
de la
première
expres
,
388.
Les
grammairiens Arabes comprennent les appositifs,
comme les adjectifs
dans la classe des parties du discours qu'ils
nomment
^\y (n.° 357) ; et cela avec raison, puisqu'il est
de la nature des appositifs de concorder avec le mot auquel ils
sont
apposés ojX^lif
lïs^ distinguent cinq espèces de ces mots : 1 .° les qualificatifs
ii>*xJf dont j^ai parlé dans le chapitre précédent; 2.0 les corroboratifs ù^=>^j\ qui ajoutent quelque force à l'expression,
comme le mot tous dans ces
phrases ils sont venus tous4 jt
,
,
,
,
,
,
les ai
tous vus
,
ou
eux-mêmes; 3.0
Omar dans
le
les
cette
mot
eux-mêmes dans celle-ci
,
ils
sont venus
conjonctifs explicatifs oUiJf (jiLl comme
expression, Abou- Djafar Omar; 4.° les
conjonctifs
,
'
DE
conjonctifs d'ordre ^IàII <jJ^ c'-est à
joints à d'autres par des conjonctions
-
dire
-
,
et,
tn
mais,
ou
,
vuis
et
remplacement J5J
Zéid
est venu me
tible de
aussi ,' même
plusieurs
ïes
non-, &c. ;
,
ces
sous-divisions. La
une nuance
,
mots
cette
les
5.0
phrase,
divisions
cinq
cinquième
peu sensible. La
ne
sont
qui
des adverbes
ou
Zéid dans
comme
,
voir. Chacune de
troisième que par
à
,
22$
SYNTAXE.
LA
comme
,
mis
mots
ton
frère
est
suscep
diffère de la
quatrième n'ap
que j'appelle appositifs.
On peut donner pour règle générale, que les apposi
tifs concordent en cas, et, autant que leur nature le permet,
en
genre et en nombre, avec le nom avec lequel ils sont en
partient point
ce
389.
1
apport
d'apposition ;
nom, déterminés
En
cette
ou
année,
le
plus
souvent
indéterminés.
mourut.
aussi ils
sont
,
comme
ce
Exemples:
Abou'ihosa'in Ahmed
fils
de Moham-
*
med
Kodouri,
de la
La lumière de
d'Abou-Hanifa.
secte
cette
lampe
est entretenue
(du produit) d'un arbre
béni d'un olivier.
X
-
II
Dans le
avec
jjf
ojJ£
; et
,
39O.
,
ou
abreuvé d'eau, de pus.
dans le
comme
apposirif*
dans le
troisième, o^u-i
11
•"••-'
•
premier exemple, oJL*\
en est
mine l'étendue du
tion
sera
-
de même
JJ*\
sont en
concordance
second, ijyôj concorde
un
mangé
II.9 PARTIE.
avec
*U, par la même raison.
l'apposidf restreint ou déter
avec
quand
lequel il est en rapport d'apposi
point de vue particulier. Exemples :
mot avec
ie réduit à
J'ai
:
et
le
pain,
la moitié de lui,
P
LA
DE
22CJ
,,
...
SYNTAXE."
s,..
,
.
'*.
ZA/, /<z beauté de lui, m'a plu.
£jUÎ *{±=>j*à cfjUè f 4
y^i *for camarades,
■/Vzi
vu un
homme,
autres
autre
que
que
vous
vous,
,
qui
entrer
me sont
chers.
dans la maison,
d'appositif nommé JôS mots mis en remplace'
grammairiens Arabes rapportent un exemple que
et dont j'ai offert une autre analyse
(n.° $1),
ils
au'
JUs» *fjif.j^Jf ,j iAjjLJÏJ
t'interrogeront sujet du mois
C'est à
ce
genre
ment, que les
j'ai dé)k cité ,
*a9
sacré, de l'action de combattre
en ce
mois.
exemples que je viens de donner en dernier lieu, n'appar
qu'improprement à la classe des appositifs. A plus forte
raison ne peut-on, pas regarder comme appositif une expression
que l'on substitue à une autre qui étoit échappée par une
erreur involontaire, comme si l'on disoit
j'ai vu Ibrahim, et que,
Les
tiennent
se
reprenant ,
on
ajoutât
tout
de suite Isaac ; c'est-à-dire
,
je me
n'est point Ibrahim que j'ai vu, mais Isaac. Les gram
trompe,
mairiens Arabes font de ce cas une des sous-divisions des mots
ce
mis
en
remplacement JàS
Au reste, dans
corde
en cas avec
ce
.
cas-là
celle à
même, l'expression substituée
laquelle
on
con
la substitue.
On peut avec plus de raison
39
rapporter aux appositifs
une
partie des expressions nommées corroboration ou corrobo1
.
ratifs o-*J=3>jS par les grammairiens Arabes. Celles dont je
parle ici se subdivisent en deux espèces dont la première répond
au mot françois même, ou au
latip ipse, et la seconde rem
place l'adjectif tout, qui n'a point d'équivalent exact en arabe,
et répond au mot françois la totalité.
392. La première espèce renferme les mots j*Jo ame tt
,
DE
SYNTAXE.
LA
227
Amrou,
l>£ orflj,
arabe, j'ai
lui-même
vu
Amrou
pour dire, j'ai
(a).
Ces mots ne sont jamais en apposition qu'avec des noms déter
minés soit par l'article, soit autrement, ou avec des pronoms : ils
œil. On dit
J&
sçn
ou
œil *~iSS
concordent
cas
avec
le
observant que l'on
aucune autre forme de
avec ce
même
ne
pluriel
que
{jJù\
le pronom avec lequel ces mots
est au duel , 011 doit employer ïe
doivent être
*làs
en
et
sont
(
^
n.°
201
rapport d'annexion
et
en
rapport
nombre,
acception
nom en
peut employer dans
'
position
des appositifs jj-àj
ils
lequel
nom avec
ils concordent aussi
en
nom ou
son ame
vu
,
en
d'apposition;
en
cette
o^f
pluriel
). Enfin
,
que, si le
et
,
sont en
rapport
et non
d'ap
le duel
appositifs
ces
des pronoms affixes
nombre avec le mot dont
avec
qui concordent en genre et en
jJo et (JS sont les appositifs. Exemples:
q'
^
-°i
Ifr
L&Làjf
^
Zeïd lui-même
o^j'slÂ
o^jJ 0*1»?*
est venu;
Zeïnab elle-même
tf.j-tM\ o-jfj j'ai
vu
est venue ;
les deux émirs eux-mêmes ;
LvUiu f <#£>-! l> ojj/» je passai près des deux Maries elles-mêmes;
*t
--'''I
"q
j«Juf *jl~^j
Si
nom
ces
J>X)ïy\
affixe
,
Cà^sÇi élÇf
(n)
iS»Jô
//
Les
J5&
les
vizirs
*xfô"
ses
femmes
appositifs
on
pronom affixe
ou
î-J&
et
sont en
peut
ou
ame),
,*wiù
d'apposition
un
avec un
pronom isolé
On peut donc dire:
enfin éUiû ô-jf
osbcjfj je
pro
ïe
entre
éUiucéUjIj
t'ai
vu
toi-
pas^toujours appositifs ainsi, si l'on di
J&j&i sLâ. U est venu en personne (à la lettre:
n'est. point appositif.
mots
fZJù et (j^a ne
il s'est tué lui-même,
est venu avec son
elles-mêmes l'ont tué.
rapport
interposer
l'appositif.
cslXjfj
eux-mêmes l'ont tué;
sont
:
P
x
228
même
DE
CA»*&i
(a);
SYNTAXE.
LA
<A? ojj»
ou
ciUii
oJ f
<Aj
j'ai passée auprès
izïjj*
de toi-même.
Si l'on
vant de
à
sujet
le verbe
le verbe
IClijf
veut
,
donner
un
un
verbe^
interposer
sans
I'appositif.
et
fJy
appositif de
ce
genre à
mettre
on ne
peut pas
réellement ie pronom
Ainsi l'on
ne
i?
tu
o—
pronom
ser
I'appositif après
personnel entre
peut pas dire
mais il faut dire cîU&i dsif
:
un
csliàjô^ni
t'es levé toi-,
même ;
,*C«jùI jSj! \yj> leve^-vous vous-mêmes.
303. La deuxième espèce de corroboratifs
renferme les
et
mots
JE"
universalité ,
autres de la même
quelques
Leur concordance
avec
le
^-^ totalité,
signification.
nom avec
I
lequel
(L
fr
ils
dont
je parle,
*JiU
généralité,
sont en
rapport
U
„
la même que celle de j-^U et ^ , si ce n'est
d'apposition ,
même de leur signification, ils demeurent
que, par la nature
est
toujours
singulier. Exemples
au
W
Jf
J:é^.\
l'armée toute entière
tU.
la tribu
L>-^^l-Xv*iJf tpslâ.
)£
A.
f^ÂJ^
*l
iyU-.f o-jfj /"#*
llfL
:
c/> j* /"^i
vu
toute
entière
toi/s ces
l'armée entière
est venue;
gens- là;
auprès
/7<z.tjt
est venue ;
de
toutes ces
femmes.
est venue.
(a) Suivant quelques grammairiens, si, dans ce cas, on emploie le pronom
qui représente l'accusatif (n.° 813 i.re p.), comme (J/\>\* M tamis en
isolé
,
$\
remplacement JJo
il
est
..
'
■
'
corroboratïf
;
si l'on
&£—,+*
emploie
•
•
ie pronom isolé
nominatif,
comme
-
*1
o-» 1
.
surplus, il est nécessaire d'observer qu'on ne peut faire usage des pronolM
isofé*. composés de Ljf que dans le cas où le, pronom affixe qui précède repré
sente un accusatif, comme cela a lieu dans A\j\
ciUjfj
Au
.
DE
394*
d'autre
Avec
mot
22<?
SYNTAXE.
LA
pronom affixe duel , on ne peut pas employer
que 3f pour le masculin ] et Q^ pour le féminin
un
(n.°2io); au génitif et à l'accusatif on dit '<^( et^Jf Exemples :
L_^»5k* J—^j yy^-f- *^- Amrou et Omar sont venus tous dtux ;
.
'j-léj fj—£ o>—jfj j'ai Amrou et Omar tous
L^JÛ^ii-UUj ôÔo) *iâjj je lui ai fait épouser Ztinab
\J&Js
vu
toutes
Observez que ife*
en
et
rapport d'annexion
circonstance
,
ces
passé auprès
de
tes
deux
Fatime
déclinent que quand ils sont
pronom affixe : dans toute autre
mots sont
vw tes
et
les deux.
ne se
avec un
deux
Lîljja.f ik'o.jlj /<2/
Ud^*
les deux;
indéclinables. Ainsi l'on dira
fères
deux
,
et
eu^Lf. Ukj
<L>jj*j'ai
sœurs.
395' ^ et ^s mot^ ^e *a m^me signification s'emploient
plus ordinairement comme appositifs avec des noms déterminés ;
ils peuvent cependant servir d'appositifs à des noms indéter
minés, pourvu que ces noms expriment par eux-mêmes des
choses d'une mesure certaine. Ainsi l'on dit *JL£=> j^ un mois
tout entier, l^***^- *^« une année entière ; mais on ne pourroit pas
joindre ces appositifs à des mots qui exprimeroient une étendue
vague comme oJj temps 'io^ durée à moins que ces mêmes
mots ne fussent déterminés par l'article ou
par un complément.
306. Après I'appositif Js* on peut ajouter encore un autre
appositif qui concorde en genre en nombre et en cas avec le
même nom qui est déjà en rapport d'apposition avec Jf. Ce
nouvel appositif est, pour le singulier, au masculin *>f au
féminin "*U^- ; et pour le pluriel au masculin Ô^Crf et au féini*
nin
£<?*. Exemple : ûj*£"' °^*£j*Xif ÔJ^i tous les anges adorèrent.
On ne doit pas employer pour le duel qU^I au masculin,
,
,
,
,
,
,
,
,
ni
t)îjU!£
au
féminin.
v
'
2jO
On peut
mettre
damment de J^
SYNTAXE.
DE
LA
Jf?r\
comme
appositif, seul,
et
indépen-
.
joint quelquefois à ^_l£f d'autres, appositifs dont le sens
même, et qui suivent la même déclinaison et les mêmes
On
est
le
de concordance. Ce sont
règles
:
POUR LE. PLURIEL.
POUR LE SINGULIER.
Masculin.
Masculin.
Féminin..
:(&r
Jx4>1
■>
Féminin.
s
°
j
«
-A
"A
-
*_*«àjl
Ls
'
J
jj|a-a^a.j|
»
+à
J
J
»Lit&
Si l'on réunit
d'entre eux,
sentés ici.
on
appositifs synonymes ou plusieurs
placer suivant l'ordre où ils sont pré
tous ces
doit les
Exemple :
'
«£
<?
j
j
*
•>
•>* S*J
«_3of *-âjf jti^ssl ***•! *JS
L'armée
Quelquefois
appositifs seul,
Exemple :
,
mais
i
,
sans
qu'il
**
«J"0
est venue.
emploie
un
soit précédé de
de
Js"
ces
et
derniers
de
£\.
>«
dt^sC
l,
J^jf j*oJt K>J^ Ô^
l
Vx^-jf o*Â *UJ3Jf
Uui^f
entière
rarement , on
»-»/
'
toute
j
/jkç^f **i*
r**_y»
.
yjf
Lw^ô
<i
t^j^_*i
(>y
y
^J ^j
mamelle, porté pen
xjÂS
—
P/«r h Dieu que je fusse un enfant a la
dant une année entière entre les bras de cette belle
O
au
ne% charmant,
que, chaque fois que je pleurerais elle me donnât quatre baisers!
Ah ! s'il en àoit ainsi je passerois tout mon temps à pleurer!
et
,
,
On voit, dans ces vers, i.°
avec un nom indéterminé (n.°
»^=>f employé comme appositif
395),
et sans
être
précédé
de
23!
SYNTAXE.
LA
DE
employé aussi sans être précédé de Js*;*
3.0 I'appositif *-£l séparé de j*oJf avec lequel il est en apposition par le verbe J^ûf
nom
307. Les grammairiens Arabes comprennent sous le
de corroboratifs o*£=>y, quelques autres manières de s'exprimer
dont je parlerai en traitant du pléonasme.
$
ni de
££l
2.0
;
££f
,
.
XXI.
CHAPITRE
Concordance des Mois liés par des Particules
Les
398.
conjonctives.
n'ont pas besoin de particules con
les mots avec lesquels ils sont en
appositifs
jonctives pour se lier
rapport d'apposition : car le rapport qui est entre ïes choses
signifiées par un nom et par ses» appositifs est un rapport d'iden
tité. II n'en est pas de même quand plusieurs sujets différens
avec
,
attribut
ont un
appartiennent
un
conséquent
un
commun
à
un
,
même
commun,
ou
que
plusieurs
attributs différens
que divers antécédens
enfin que divers conséquens
sujet,
ou
ou
sujets
,
,
antécédens
nairement par des
tives. Exemples : Le ciel
Dieu
est
bon
ET
ont
divers
qui existe alors
conséquens s'indique ordiconjonctions ou d'autres particules conjonc
même antécédent. L'union
attributs
ont
juste;
ou
la
ET
Dieu
entre ces
a
,
terre sont
créé l' nomme
l'ouvrage de Dieu;
ET la femme ; tout
le ciel, dans les villes et les campagnes, nous rap
pelle q l'idée d'une Providence divine ; NI là raison NI ta religion
n'autorisent le crime; ce h** est pas Dieu MAIS l'homme, qui est
dans la
terre et
,
l'auteur du mal ; le bonheur
est
indiffèrent au
le malheur, la vie
OU
la mort,
tout
vrai stoïcien*
liés ainsi par des conjonctions doivent nécessaire
concorder entre eux en cas, si ce sont des noms, et en
Les
ment
ou
mots
P4
LA
DE
2j2
modes, si
des
ce sont
d'attribut, d'antécédent
SYNTAXE.
ou
complément,
plu lot une suite
pendance qu'une
véritable concordance
cœlum
et mare, et
à
mais
l'accusatif,
des
règles
oinnia qnœ in eis sunt,
concordant avec cœlum,
comme
sont
,
sujet,
^est commune.
de dé
je dis, Deus
si
:
de
qualité
leur
de
Leur concordance est donc
et terram
îa
verbes, parce que
n'est
ce
et
mare
cre ami
point
omn'ia
que. terram,
de complémens immé
autant
comme
diats du verbe creavit.
J'ai
309.
ceci
une
comme
dit que ïes
déjà
grammairiens
de concordance
sorte
Arabes
envisngent
l'espèce qu'ils
c'est
:
( n.° 388 ).
Ils comptent neuf particules .indéclinables, qui produisent
cette concordance; ce sont j et, o et, ~*j puis
j-â. et même
(n.° 830, i."p.) pî ou bien ,J ou jJJ mais, *$non pas ^.O mais.
L'usage de ces diverses particules peut donner lieu à plusieurs
observations ; vmais je me contente de ce que j'en ai dit dans
la première partie.
4oO. Je rappellerai seulement ici qu'if y a certains cas où
quelques-unes de ces particules ne font plus fonction de simple
conjonction; elles régissent alors le nom qui les suit tsoit.au
génitif, comme <_£-! quand il signifie jusqu'à (n^b'jo /." p.),
nomment
^iiJf
^S conjonctifs
d'ordre
,
,
,
,
,
,
et
dans les formules de serment , soit à
j
signifiant avec (n.°883 i.rt p. ).
4,0 1 Plusieurs de ces particules
l'accusatif
,
comme
j
,
.
cas
<j
une
,
-
influence
j -Jî
et
tifs d'ordre,
verbe qui les
(j^-
et
Cela
a
:
particulière
elles
cessent
leur influence
suit
au
sur
mode
ont
aussi
le verbe
qui
alors d'être de
grammaticale
Subjonctif,
si
ce
,
dans certains
les suit
; ce sont
simples conjonc
consiste à
verbe
est
'mettre
le
à l'aoriste.
été suffisamment
4-02..
Dans les
développé ci-devant (n.° 48 ).
propositions conditionnelles exprimées
au
DE
SYNTAXE.
LA
233
moyen de la conjonction <j] si, ou de quelqu'un des mots
renferment la valeur de cette conjonction, le verbe, s'il
a
doit être mis
l'aoriste,,
mode conditionnel. Il
au
qui
est
de
en est
même du verbe de la
proposition affirmative hypothétique qui
dépendance de la proposition conditionnelle^ et qui
forme' le terme conséquent du rapport dont cette proposition
conditionnelle est l'antécédent (n.°* 28 et 5 1 ).
Si, dans la proposition conditionnelle, il survient un second
ce
verbe joint avec le premier par les conjonctions c_* ou» j
est
dans la
,
second verbe peut être mis à l'aoriste condirfbnnel , comme
celui auquel il est joint par la conjonction ; on peut aussi ïe
mettre au mode subjonctif, donnant alors à la conjonction e>
s
ou
la valeur de
j
dire éutsa-f
avec
avec
que
,
en sorte
^0^3 j^iu ^1
causerai avec
moi, je
si tu viens
yf
me
que
(n.° 48 ). On, peut donc
si tu viens me
toi,
trouver, et que
bien
ou
tu
twuver, et
si tu causes^
"
i3Jc^\ ^0^.9 ^p ^f
causes
avec
moi
,
je
causerai
toi".'
Si, dans la proposition affirmative hypothétique qui forme ïe
terme
conséquent du rapport dont la proposition conditionnelle
est l'antécédent, il survient
après le verbe mis à l'aoriste condi
tionnel un nouveau verbe joint au premier par l'une des conjonc
,
,
tions
o
j,
ou
conditionnel
,
peut
mettre ce
une
conjonctif d'ordre soit à l'indicatif, comme
nouvelle proposition indépendante de la précé-
oL~dVl d**
»
,
subjonctif,
de ^f en sorte
ouau
.
tion
dans
t_?
ou
^
second verbe soit à l'aoriste
comme
appartenant à
dente
on
la valeur
*
en
donnant à la
conjonc-
que. On peut donc dire
,
l'exemple suivant, 'o JJCL.Lt oy-tj JjÇàjf J U f^cvo" Jjt.
>UJ ^ cjcyuj *^ C>4 J"?-*-?^''*v5^ Sl vol,s
manifestez^cequi est dans
vos cœurs, ou si vous le cache
7^, Dieu vous en fra rendre compte, et
il pardonnera à
qui il -voudra, et il livrera aux tourmtns qui il voudra;
234
mais
ou
DE
peut aussi,
on
bien
encore
au
lieu de
jà***
Avec l'adverbe
SYNTAXE.
LA
et
jàJyjS et Liô^j
cjôâ-j }
conjonctif
1j
,
dire J»*î?
etc-xÂ-ïuj,
(a);
et
puis,
il faudroit nécessaire
employer l'indicatif ou le mode conditionnel cet adverbe
conjonctif n'ayant jamais" la" valeur de la conjonction y]
403. Si l'on veut joindre par une conjonction le pronom
sous-entendu qui sert de "sujet à un verbe avec un autre pronom
ou ;tm nom
l'usage le plus ordinaire est d'exprimer effective
ment ïe pronom
personnel après le verbe. Exemples :
ment
,
.
,
,
Ce que
'Quand
VOUS ni vos
savie^, (ni)
pères.
jst> *-Uâ.f jCLiuUf (J.) iX*~* JL^>j \Zjà
fut arrivé à Kadésiyya, il eut besoin de vivres,
cafjs Vf J,)
*Jû» q+j
Saad
LUI et ceux
vous ne
qui
étoient
avec
lui.
Il arrive
sur-tout
cependant souvent que ce pronom reste sous-entendu,
quand il y a quelque mot interposé entre le verbe et la
pariticule conjonctive.
4o4t Si l'on veut joindre
par
d'une même
plusieurs complémens
nom
dont le premier
,
il
génitif,
est
convenable de
*-rL)r
Dieu
soit
vous
d*
i£î}
particule conjonctive
préposition ou d'un même
une
pronom affixe
un
répéter
représentant
l'antécédent.
le
Exemples :
l»g^ /*-^=a^-^T»-\^f
délivrera d'elle
et DE toute
ajfliction.
j&jiiij l^J J(i'
// dit à elle
(a)
Cet
l'AIcoran
Le
se
sens est
exemple
est
partagent
et
toujours à-peu-près
terre.
, sur. 2, v.
2F/ ; et les lecteurs de
trois manières de lire les deux derniers verbes.
tiré de l'AIcoran
entre ces
À la
le même.
DE
II y
lesquels
on
//
n
,
point
Dieu
aussi-bien
Il
n'y
235
poésie
exemplesdispense de répéter l'antécédent.:
se
'a
Craigne^
vous
des
cependant
a
SYNTAXE.
LA
,
lui
cru en
,
sujet
au
et
de
(qu'au sujet)
a
(en)
qui
des
en
,
dans
mosquée Inviolable.
la
ave^ des discussions
vous
entre
parens fa).
proches
que lui
autre
personne
sur-tout
(que)
et
cheval.
son
l&jfjkSuj l^j ^mi3 ^ CAL 0^9 r^J0^ t-ïJ-^, 'j'—' b^j' "^'
Lorsqu'ils allument le feu de la guerre pour consumer leurs
ennemis malheur à quiconque vient se chauffer à lui (c'est-à-dire,
ace
feu) et (à) sa flamme ardente!
,
CHAPITRE
des Verbes
Syntaxe particulière
sujet
4o?.
XXII.
qui
ont
pour complément un
attribut.
et un
(n.° 1 1 4) de diverses espèces
complément un sujet et un
auxquels
attribut qui constituent une proposition complémentaire. Ceux
d'entre ces verbes qui signifient croire juger penser imaginer,
J'ai
ailleurs
déjà parlé
de verbes
on
donne pour
,
(a) C'est
*lâjVflj
ici
un
fjLif
ment
du verbe
il y
a
des lecteurs
un
sujet
en est
passage de
l'AIcoran,
d'autres lisent à l'accusatif
qui
,
et
lisent
dont l'attribut
est
le
au
est
sens
sur.
sous
de même de vos parens. Beïdhawi
,
Plusieurs lecteurs y lisent
comme
nouveau
un
alors, respecte^ aussi
nominatif
(jlfja
v. 1.
4,
lia.» Vfj
,
vos
*lâjVf2 regardant
•
-entendu
préfère
la
;
en sorte
parens. Enfin
ce mot comme
que le
première leçon.
complé
sens
est, il
Zï6
et
qu'on
nomme, à
SYNTAXE.
LA
DE
cause
de-
cela, verbes de
cœur,
«_>AàJI
^jUifou
Jlisf exigent quelques observations particulières.
4p6. Ces verbes peuvent pelrdre leur influence sur la pro
position qui leur sert. de. complément", en deux circonstances.
La première est lorsqu'on place le verbe entre le sujet et'
l'attribut de la. proposition complémentaire ou après l'un et
l'autre. Exemples :
*ZJ&
»
,
0^*j,ojltl of
la mort doit venir,
yl—'^j.j UfôÇU L^
vous
(le)
save^;
(sont) fous deux nos maîtres, disent-ils;
uiïcMÎii juj Zéid, je crois (est) menteur.
ils
,
On peut
influence,
dans l'un
,
et
le verbe
dant ,
et
l'autre
mettrele sujet
et
cas
,
conserver au
verbe
son
l'attribut à l'accusatif
les deux
Cepen
proposition
son
influence,
de la
après
quand
complémentaire, il vaut mieux le dépouiller de
ce
qui s'appelle *UJf
407. 1,-a seconde circonstance qui peut faire perdre à ces
Verbes leur influence sUr la proposition complémentaire c'est
lorsque, ïe^verbe étant placé avant la proposition complémen
taire, il se trouve à la têre de cette proposition une particule affir
mative, interrogative négative, ou autre, qui, par sa nature,
doit occuper le commencement d'une proposition. Exemples :
est
termes
.
,
,
Ljif* iv^-f o-& je
sais
(que)
certainement Zéid est menteur;
/Y'^\ c*»l U o^ je pense (que) tu n'es qu'un infidèle;
jj-£ fi*?' cSrîj'
Cette
sorte
*>&. sais
tu
de construction
si Zéid
et
d'un
terme
ou
Amrou!
s'appelle ^Ui laisser en suspens.
peuvent avoir pour complément
4o8. .Ces cernes verbes
une
proposition composée d'un sujet
sujet
vient,
et
d'un verbe
circonstanciel «de temps
ou
de
,
ou
d'un
lieu, le verbe
1
DE
ou
LA
SYNTAXE.
l'attribut étant sous-entendu. Cela
taxe
,
si
le
Le
change
ne
rien à leur syn
sur le verbe ,
n'est que leur influence n'est que virtuelle
ce
circonstanciel.
Exemple
le séjour qu occupoient autrefois ceux qui
t'inspire, je crois, de la tristesse.
ou sur
237
terme
mot
^_?j
complémentaire
dire ici
*_jj
termes
de la
A$S* (joUJ
au
est
à
l'accusatif,
comme'
:
^xcUaif^-jj \£\
ont
quitté
sujet
leur demeure,
de la
le verbe Li
nominatif,
est
,
proposition complémentaire. Exemple
certes
,
tu
sais
proposition
On peut aussi
le
verbe
entre les deux
est
parce que
dont l'attribut
Ici le verbe n'a
dl-ç
(que)
ton
trépas
influence
:
i-Ls^Lc. oJii
arrivera assurément.
la
proposition complé
mentaire Aj*S* ô^'u à cause de l'interposition de l'adverbe J
4op. Lorsque les verbes qui ont pour complément un sujet
et un attribut, et dont il vient d'être
question, sont employés
à la voix objective le nom qui servoit de sujet à la proposi
tion complémentaire, devient le sujet grammatical du verbe,
et le mot qui formoit l'attribut de la proposition complémen
taire, demeure à l'accusatif f n.° 1 84 ) ; mais il faut alors envisager
ce mot comme un terme circonstanciel déterminatif
(n.° 116).
:
L'is
Zéid
est
menteur,
réputé
Exemple
i>jj ,jlaj
Les
et
les
noms
d'action
4lO.
adjectifs verbaux formés des
verbes dont il est ici question exercent la même influence
que ces verbes^et sont sujets aux mêmes exceptions. Ex. :
%àlsvé f c\jj qU? o»Jsf
Crois-tu (que) Zéid (est) raisonnable !
aucune
sur
.
,
,
,
v
'
i»
J'ai
passé près
r-«-
■> ■>
s
\
.
->\.'
d'un homme dont le
Je suis charmé que
tu
\J-
■*»»••
père (est) réputé philosophe.
croies Zéid
généreux.
238
DE
SYNTAXE.
LA
XXIII.
CHAPITRE
Syntaxe particulière
Le verbe
4.11.
j^Y être,
des Verbes- abstraits.
et
les
Verbes
autres
ferment que la valeur <$u verbe abstrait unie à
qui
une
ne ren
circonstance
à joindre
qui, par conséquent,
un
sujet à un attribut exprimé indépendamment du verbe,
exigent que le sujet soit au nominatif, et l'attribut à l'accusatif
(n.os 86 et 88).
412. Si ces verbes sont employés comme verbes attributifs,
de temps
de
ou
durée,
servent
et
~
c'est-à-dire
renfermant
,
d'influence que
413.
traits
,
L'attribut
4l4*
le
,
eux-mêmes
sujet, qui
l'attribut, ils n'exercent
doit être
mis à l'accusatif
peut être considéré
,(n.°i27).
ployé,
le
sur
en
comme terme
au
nominatif (n.°
87).
ïes verbes abs
après
circonstanciel adverbial
.
L®
d'action du verbe
nom
comme
le verbe
étant mis
lui-même,
q\s*
est
avec un
très-souvent
sujet
et un
em
attribut,
forme de
complément d'un
rapport d'annexion et l'attribut à l'accusatif. L'adjectif verbal
l^y étant met aussi l'attribut qui le suit à l'accusatif. Exemples :
k***^ &y>? 0^5 ^j* ^ijQ
sujet
au
génitif,
sous
,
Parce que
,
tu es
osw \'3 #Utf
Mahomet, qui
encore
que de la
4l5ou
au
fort
Nous
prétérit
étoit
et
£#J
que les
son%foibles.
l3fj Lyo ^jl^lff fc£
déjà prophète,
terre et
autres
lors même
qu'Adam
n'étoit
de l'eau.
observé que le verbe &&, joint à l'aoriste
d'un autre verbe, donne au premier de ces
avons
temps la valeur de
l'imparfait (n.os 34$
et
340,
//' p.) ,et au
DE
second la valeur du
Le
nom
manière.
SYNTAXE.
LA
plusqueparfait (n.oî 328 et 330, t." p.).
($ peut être employé de la même
d'action du verbe
Exemples
:
^jJLff Ji U<34j
Parce
qu'il
^k'//j
'&*
Vavoit trouvée
*îy\y.
le chemin.
sur
Ujf
ôyjAJ V °&y
savoient pas qui de nous
Ils*
/Vw*
239
ne
Jii
t)*
avoit fait cela
(a).
quelquefois que le verbe <jl^ est employé
d'une manière pléonastique, et qu'il perd toute influence gram
maticale en sorte que les mots qui semblent devoir former son
sujet et son attribut ne forment plus qu'une proposition nomi
nale. Cela n'a lieu qu'au prétérit, et le verbe peut se placer
entre les deux termes de la
proposition nominale, ou avant la
toute entière. Exemples :
proposition
4l6.
II arrive
,
,
*
Mdise
est- il
donc
prophète!
un
grammairiens Arabes envisagent dans le cas dont il s'agit le verbe
prétérit ou à l'aoriste, comme l'attribut du verbe qç" et ils n'ont
point imaginé de regarder cela comme des temps composés d'un, verbe auxi
(a)
mis
Les
,
,
au
,
liaire. Ainsi, si l'on dit
eût dit
*-ji. ^IkjUJf
Jlo \«'la»j&> (jUâJUJf
à-dire, étoit
qo
qb
,
le
le sultan
sens est
a
le même que si l'on
été sortant auparavant, c'est-
Jjtkjf \~û& JL* 8JC!j <^f qIt» le
père
JJJJf ft& js* f*j» &\ (jo
sorti. Si l'on dit
même que si l'on eût dit
sens est
'
mon
de
a
le
été désap
part. Dans
ces
( c'est-à-dire désapprouvoit) cette manière d'agir'
d'un
exemples, Xjî. et eljCj sont des propositions verbales composées
verbe et d'un agent. ou pronom caché (n.° 148)» et ces propositions forment
l'attribut du verbe ^M* et sont par conséquent virtuellement à l'accusatif
prouvant
,
ma
,
JjtfJf
çjj-uÀ/»
olkLjf
; et
.
Le
sujet du verbe
dans la seconde,
^f
.
q£* est,
dans la
première proposition,
2-4o
DE
LA
SYNTAXE.
i^XitjôJb J?i» jà[^ o<-*Ui; '0«&** (j*Wf (jo o-« fif
Quand je serai mort, voici ce qui arrivera : les hommes (seront
divisés en) deux partis (à mon égard) ; l'un qui censurera, Vautre
qui louera ce que je faisais (-pendant ma vie) (a),
«
^ J, f
-
CHAPITRE
Syntaxe particulière
exprimer
le
XXIV.
Adjectifs verbaux qui servent
Comparatif et le Superlatif.
des
à
adjectifs verbaux qui servent à exprimer le com
paratif et le superlatif > et qui sont toujours ccrmme il a été dit
ailleurs (nf" 62.6 //' p.) de la forme JJ*à\ étant sujets à quel
par rapport tant à la
ques règles de syntaxe particulières
nous
croyons nécessaire* d'en
dépendance qu'à la concordance,
traiter ici d'une manière spéciale (b).
4 1 8 Les adjectifs verbaux d'une signification comparative ou
superlative peuvent être employés, ou en rapport d'annexion
Les
417.
,
,
,
,
.
/
■■
(a)- Cette observation pourroit à la rigueur justifieivies deux exemples que
j'ai rapportés ailleurs ( n.° 87, note) d'une construction vicieuse du verbe
^jéf avec un attribut au nominatif; je persiste cependant à croire que ce sont
des fautes parce que l'usage pléonastique da. ce verbe usage dont il est ici
question, est très-rare, et n'appartient guère qu'au sryle poétique.
,
,
,
,
(b) J'ai envisagé ces adjectifs comme dérivés des adjectifs verbaux d'une
signification positive.: les grammairiens Arabes les envisagent comme dérives
immédiatement des verbes. Suivant les mêmes grammairiens, on ne peut point
former d'adjectif verbal comparatif, i.° des racines qui ne sont point verbes;
2.0 des verbes, soit primitifs, soit dérivés, qui ont plus de trois lettres; 3.0 des
verbes dont l'adjectif verbal est lui-même de la forme A^$ f comme 1*. f avetigle;
4.°de la voix objective; 5.0 des verbes qui n'ont point Une conjugaison com
plète, comme ^jli // peut se faire que; 6° de ceux dont la signification
n'est susceptible ni de plus ni de moins, comme (^{S» mourir. Quoique ces
,
avec
DE
avec un nom
déterminatif,
et sans
article.
.
Etant
4i()'
invariablement
ou
d'une manière absolue
enfin hors de
ou
rapport d'annexion
en
tout
,
avec
rapport d'annexion
ils doivent demeurer
singulier si leur complément
est indéterminé. Ainsi il faut dire \*y.\ J{f^\ '& cest une femme
excellente comme on dit JLa.j J^ïif j* c'est un homme excellent;
JU.J llîtf V5 ce sont deux très-grands hommes.
420. Si le complément du rapport d'annexion est déterminé
l'adjectif comparatif peut demeurer invariablement au singulier
et au masculin de quelque genre et de quelque nombre que soit
le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Exemples :
au
masculin
^4l
SYNTAXE.
adjectif,
ou un
l'article
LA
et aU
,
,
,
,
*UIff
Elle
est
la
Vous deux êtes les
observations soient
justes
,
elles
^}\ plus
verbe; (JLc\ P^s
point de
.-^>f abrégeant davantage]
adjectifs
ne
puissent
m\Ç=>\ honorer,
sot,
s'ont
j-j^f
des hommes
cependant sujettes
à
LJ voleur, quoique
enclin à
tirer leur
j^3J(a\
j^
plus véridiques
voleur ; de
Ainsi l'on dit
Jtiif
plus. excellente des femmes.
donner,
qui
a
un
véridiques.
quelques exceptions.
cette
racine n'offre
*jjÉ=»f plus disposé
à honorer,
plus grand besoin, quoique ces
J^cf donner
origine que des verbes dérivés
abréger,
^-Lâ-f
-quoique l'adjectif verbal positif
,
avoir besoin. On dit auss1
dérivé du verbe L.J* être
*-j*f
sot
plus
soit lui-
plus occupé, ^cf plus enclin à s'occuper de quelque chose,
adjectifs appartiennent nécessairement par leurs significations, à la
quoique
voix objective, Jjçi être occupé, '^c être appliqué à quelque chose.
Au reste ces exceptions sont rares et l'on peut les regarder comme de§,
licences ; il faut seulement observer que les verbes de la quatrième forme Jii (
donnent assez fréquemment naissance à des adjectifs verbaux comparatifs.
même
i."ybf ; JiUif
ces
,
,
U.' PARTIE.
,
Q
2^2
DE
I-Âjjjf
Tu les
entre tous
trouveras
SYNTAXE.
LA
ëjA^f <J* (jt^'
assurément les
contre
Elle
sont tous
On
le lion, c'est celui
qui l'a
souvent.
II peut aussi concorder en genre
auquel il se rapporte. Exemples :
Ils
de la vie présente,
r^>*"^ tx^Vl J* /j»UJf *^>f
Le plus h-ardi d'entre les hommes
le plus
plus avides
les hommes.
*~î-±)
vu
ifU^' &-JO*du
est
la
plus
et en
nombre
avec
le
nom
excellente des femmes.
deux les deux plus excellens hommes de
ce
peuple.
deux différentes manières de
s'exprimer réunies
dans l'exemple suivant : jJ,^£ j?* ICjjsifj £jf >£<Âtj
f^-î^f ^
U'3lî.f iCXwiif *iUiff ijj ne faut-il pas que je vous apprenne quels
sont ceux d'entre vous que j'aime le plus! ceux d'entre vous
qui seront
le plus près de moi par (les) places (qu^ils occuperont) au jour de la
trouve ces
résurrection
42
,
ce sont ceux
qui
se
distinguent par le meilleur caractère.
Employé d'une manière absolue avec l'article déter
minatif, Fadjectif verbal comparatif doit ^concorder en genre et
en nombre avec le nom ou le
pronom auquel il se rapporte.
:
Exemples
(jYtXcVf \I&
Ils sont les deux, hommes les plus justes.
1
.
Elles
Ils
sont
sont
les
les deux
plus
femmes
excellens
les
plus petites.
entre
les hommes.
DE
»
M3
SYNTAXE.
LA
.«0
UUif c£r i»I
*^i=j JJûJl fjjîi ^»<3Jf *^f J*a»
7/ d ra?//tf /tf parole ( c'est-à-dire , /# puissance ) <& £■«/# ^h / on? ///
incrédules , la plus basse, et la parole de Dieu a été la plus haute.
On peut employer au pluriel .masculin la forme régulière
£)^liif , ou la forme irrégulière Jet>f Au féminin , on peut de
.
même
se
servir du
lier de la forme
pluriel régulier t^JSSks
,
ou
du
pluriel irrégu
J*3
42 2. Employé hors de tout rapport d'annexion, et sans
article, l'adjectif verbal comparatif n'éprouve aucune variation
de genre et de nombre ; il est invariablement du singulier mas
culin ; il doit toujours être suivi de la préposition <j« qui gou
verne le mot qui exprime le terme de
comparaison avec infériorité
Si quelquefois cette préposition et son
relative *Xlé Jflî-^
ne sont point exprimés, c'est une
ellipse. Exemples :
régime
.
,
•
La sédition
est
A\JLL
*àa
Nous
avons
n'y
a
hommes, que
au
au
cette
maudite
m
Leurs maris
ont
i
-
royaume que lui.
nuisible
plus
plante.
W
meurtre.
.puJf ÉWaJ Ju«if »'^ Uj
Ù* ^d
monde de
rien
le
(jâ.f i^i.
de droit
plus
iÂ^vA^f oliuf
//
pire que
,
X
Z
J
J~\
plus de^droit
au
tempérament
des
JJ
à les
reprendre,
icf À»f
Dieu
Dans
est
deux derniers
plus, savant.
exemples il y a ellipse de ^ et de
son
complément. II faut suppléer, dans le premier, XÂi ^o que
tout autre; et dans le second U*
que nous ou ojÂl ^ que tout autre.
ces
,
,
LA
DE
2^4
SYNTAXE.
fréquente quand l'adjectif comparatif
dans les exemples précédens -.elle
fait fonction d'attribut
ou quand il sert de terme,
a rarement lieu quand il est qualificatif,
circOnstancieL Exemple : x^î &\ fo^\ &,fj> le sens est g-fji
0l5Cdff^ & %J c&à Ô*f j*-'^ &*" è}s va-t-en, et retire-toi
ellipse
Cette
est assez
,
,
comme
>
lieu plus propre que celui-ci pour y faire la méridienne.
en
423. Quand l'adjectif comparatif est employé rapport d'an
dans
un
nexion,
suivi de
suivi de
ou
bien
l'article
avec
déterminatif,
il
ne
doit
point être
^ ; et si quelquefois dans le second cas on le trouve
^» et d'un complément ce complément n'exprime pas
,
,
,
de
comparaison.
.424. L'adjectif de la forme Jiif employé en rapport dîannexion, ou avec l'article exprime le superlatif, et répond à l'ex
pression françoise le plus, comme on le voit dans ces exemples :
un
terme
,
Dieu
est LE PLUS
miséricordieux de
(tous)
les miséricordieux,
-S£=)l\ J» À»f
Dieu
^
grand.
d'un
complément il n'exprime qu'un
comparatif, répond simplement au mot françois plus. Exemple:
<&* 3à~~°\ °^ Ahmed est PLUS véridique que toi.
426. Quand l'adjectif comparatif est en rapport d'annexion
comme dans cet exemple
avec un complément indéterminé
^'j J^iif j* le sens est le même -que si l'on disoit SL'j J-iit y*
il est très-bon, en tant qu'un homme. Aussi le complément doit-
i^l1).
Suivi de
est LE PLUS
et
,
et
'
,
,
,
il être du même genre
pronom qui
eux
deux
sert
sont
sont deux
de
et
sujet
excellens,
en
du même nombre
que le
à la proposition. Ex. :
nom ou
le
(jS^j jUil tf
tant
hommes excellens.
que deux
hommes; c'est-à-dire,
et
DE
LA
2.^<y
SYNTAXE.
complément fait ici fonction de terme circonstanciel spéci
1
20) ; cela est si vrai qu'il faut le mettre à l'accusatif,
si l'adjectif est déterminé par un autre complément en rapport
d'annexion. Exemple : JLij <jA-Lff JLlif j_* il est le meilleur
des hommes en tant qu'un homme. Cette façon de s'exprimer
revient à celle qui a lieu avec les verbes de louange et de blâme
(n.ot 304 et 305).
427. L'objet de comparaison et la préposition ^» à laquelle
il sert de complément doivent être placés après l'adjectif compa
ratif. L'inversion cependant doit avoir lieu quand la phrase est
interrogative. Exemple : JSàj\ ôJjf &} Ô-* lequel d'entre eux sur"
Ce
ficatif ( n.°
,
,
,
,
en
passes-tu
Dans
une
licence ,
Elle
nous
manger les
a
excellence!
tout autre cas
dit,
fruits
présenté quelque
On
est
ne
pressé
des
si l'on
dans les
comme
a
,
Soye^
permet
exemples
les bienvenus,
palmiers ;
et non
chose de meilleur
saurait y trouver
,
se
et que rien
ne
aucun
défaut,
en
inversion
suivans
et
elle
contente
encore
les surpasse
cette
que
si
ce
,
c'est
:
nous
a
offert
de cela , elle
ces
h
nous
fruits.
n'est que leur
trot
paresse.
428.
Le rapport qui est entre l'adjectif comparatif et l'objet
comparé, peut être assimilé à celui qui est entre l'antécédent
complément des rapports d'annexion : aussi ne doit-on
interposer entre l'adjectif et l'objet de comparaison aucun terme
étranger. On peut cependant y interposer des complémens
circonstanciels qui modifient le sens de l'adjectif comparatif
'«?
(ii.° 216 ). Exemples :
et
le
246
DE
Zéid
est
plus
riche
^J^
7«
es
420.
plus agréable À
Nous
avons
SYNTAXE.
LA
Oi
qu'Amrou.
EN ARGENT
c5^* cs^** cjk-jI
mes
yeux
dit ailleurs
,
que
(n.os 240
tout autre
et
243 ) que les adjec
tifs verbaux peuvent imiter la syntaxe du verbe ,
sur le sujet et sur les
même influence que le verbe
Cette influence
verbaux
de
cela,
les verbes
sur
dire
ijA
beau
est
le
la même influence que
sujet.
ne
Ha
dont le
père
(n.° 267).
en est
ï'adjectif verbal
*Js\
complémens.
adjectifssuperlatif; et à cause
,^i. j£jj ojj^ j'ai passé près d'un homme
La raison
à
beaucoup
ïe comparatif et
peuvent guère exercer
le
la
doit pas dire sy f *1* (j*^-f cj^S? ojj^» j'ai passé
d'un homme dont le père est plus beau que lui ; comme l'on peut
Ainsi l'on
près
ne
et exercer
moins forte dans ïes
est
qui expriment
ils
que toi.
;
*+î£ »jjf
et
l'on
,
qu'ici
l'on
car on ne
exprimeroit
^Ljî. ^ji ojj-»
>
ce
pourroit pas substituer le verbe
pourroit pas dire ~[^4. J?jj çJfp
ne
un
sens
différent si l'on disoit
qui signifieroit seulement^"*?/ /wr*
père est beau comme lui. Pour rendre le
même sens en employant le verbe il faudroit ajouter quelque
chose qui exprimât l'idée de comparaison et de supériorité rela
tive et dire par exemple *_1* /-^=*' *j^ o^ i]*Ji ojj^
Si donc on veut mettre au nominatif ïe nom qui forme ïe sujet
de l'adjectif comparatif, il faut le placer avant l'adjectif com
paratif, et dire *-J.« (j^s-} «jjf ô^-Ji ^îv* ^ ^a lettre, j'ai passé
près d'un homme, son père, (est) plus beau que lui ; et alors tjjS
sera au nominatif, non pas comme agent de l'adjectif verbal,
mais comme sujet d'une proposition nominale ou inchoatif.
près
d'un homnie dont le
,
,
,
,
•>
,
DE
43O.
Il y
le
nom
ratif,
mis
a
cependant
qui
tel
lui
sert
*{j
SYNTAXJE.
LA
un
de
où, après l'adjectif compa
cas
sujet
considéré
est
nominatif : c'est
comme
agent»
la
lorsque proposition qui
et précédée d'une pro
comparaison
ïe
mot
fait
fonction d'agent est
qui
position négative que
tout-à-fait étranger au nom qualifié par l'adjectif comparatif,
et exprime le terme comparé avec infériorité relative et enfin
comme dans
que la comparaison se compose de deux idées
ces exemples :
et
comme
au
renferme ïa
est
affirmative
,
,
,
•
•-
-
Je n'ai
point
-
vu
->
•
"rfYT
•'-
■
d'homme dans l'œil
-
'"** £\J
duquel
dans celui de Zéid.
beau que
1
le
■*
•?-
1-
collyre
soit
plus
*
.
K-Iisf (_ji jÂé (j
'
lÂ/J Àuf
fcjf oÂ.f AVjf y* U
f>^aJ]
// n'y a point de jours dans lesquels le jeûne soit plus agréable
Dieu que dans le dixième jour du mois de dhou'thiddja (a).
OJ.A
a
La raison pour laquelle cette manière de s'exprimer est per
en ce cas, c'est qu'en substituant la préposition cil comme
mise
a
^
,
effet,
on
on
pourroit aussi substituer le verbe à l'adjectif verbal. En
exprimeroit, quoique avec quelque légère différence
,
ces deux
exemples la forme de la phrase est négative, je n"ai point
proposition qui renferme la comparaison est affirmative, le collyre est
plus beau dans son œil b"c. ; le mot qui fait fonction d'agent, le collyre, est
étranger au nom qualifié homme, car on ne dit pointée» collyre ; le mot collyre
est ici le terme
comparé avec infériorité relative car c'est le collyre dans l'œil de
tout autre homme
qui est moins agréabfe que le collyre dans l'œil de Zéid : enfin
cet
objet comparé et qui est envisagé comme relativement inférieur n'est pas
îbcomplexc H est complexe et formé de la réunion de deux idées ; ce n'est pas
le collyre seul c'est le collyre dans l'œil d'un homme autre
que Zeïd.
Il seroit trop long de développer les raisons en vertu desquelles toutes ces
conditions sont requises, pour que cette manière de s'exprimer puisse être
(a)
vu;
Dans
,
la
,
,
,
admise.
Q4
2.48
DE
la même idée de
l'on disoit
aussi
J7
O^ cî.
point
agréable
n'y
a
comparaison
et
de
^i-***
$£^\ *-i^ cî o^- ^^"J ^^L)
d'homme dans l'œil
vu
(a)
,
si
duquel
le
*"•
collyre
soit
que dans celui de Zéid.
point
de jours dans
le jeûne soit aussi
lesquels
à Dieu que dans le dixième jour du mois de
43 I-
relative
supériorité
:
*H)
Je n'ai
SYNTAXE.
LA
agréable
dhoulhïddja(b).
Les
adjectifs verbaux comparatifs ne prennent point
de complément immédiat à l'accusatif, lors même qu'ils sont
dérivés de verbes transitifs ; et s'il y a quelques exemples du
contraire c'est l'effet d'une ellipse.
Si l'adjectif verbal» comparatif dérive d'un verbe qui exprime
Yamour ou la haine il se joint par la préposition J au complé,
,
si
(aj La construction permise dans les exemples
l'expression n'avoit pas la forme négative ainsi
:
çôj
t£P
*^f J^-Jf
tJ,
•-<•-•
ù^tj cJS*1 cl
l'œil duquel le
■>
•
*-**
•'
*ÀÂé
l'on
$4\) o^fj
^ <j<waJ
-»-«*f i»f»Vf •J-'
5-^ 3 \JMA' J^-J f *■*»•)
collyre
donnés
•
-
"
A-
seroit mauvaije,
ne
pourroit pas
dire
wris i' faudroit dire
>
.,
o-Jh 7
.
l
1
<" y» «8
homme dans
plus agréable que dans celui de Zéid. On ne doit pas non
plus,
négative, dire i£\ * £* iV^-f ^»j o4|j ^
^V w^i point vu un homme dont le père soit plus beau que cet homme lui-même parce
qu'il manque une des ^conditions exigées le terme de comparaison ne se
même
avec
est
la forme
,
,
composant pas ici de deux idées.
Au reste, il y a diverses opinions
sur cette
matière
parmi
les
grammairien!
Arabeç.
Voyelle Man. Ar.
Man. Ar. de S. G. n.°
de la Bibl.
465
,
f.
1
30
imp.
et
n.°
1234,
f.79
verso, et
(b) On voit par cet exemple que l'adjectif verbal comparatif
passif (n.° 417 note). Il peut aussi avoir le sens actif.
sens
,
80
recto f et
le
suiv.
£>i.f
a
ici le
qui indique l'objet
complément qui indique
ment
par la préposition
du verbe. Exemples :
du verbe
le
sujet
«.
•
*
6-aC
Z* vra/ croyant
^
est
-o
*
j
*
x
-
r
J
plus
au
* J
que lui-même.
(_SA.f
j^>fj-If
aimé de Dieu que
plus
j]
,
(J,^
Attl
et
,
Le vrai croyant aime Dieu
■
2-4?
SYNTAXE.
DE LA
tout autre.
S'il dérive d'un verbe transitif
qui signifie science, connois
sanee, il se joint à son complément objectif par la préposition o
Exemple : !*£!£• ^L cjjcf Uf je sais mieux la vérité que vous.
S'il dérive d'un verbe transitif qui signifie toute autre chose que
cela il régit son complément objectif par la préposition J
.
.
,
Exemple
432.
:
°{SZL>
Les
intransitifs
adjectifs
se
// cherche plus que vous la vérité.
verbaux comparatifs dérivés de verbes
i*JJ oJi»f
conforment
j*
,
à cet
égard
,
aux
verbes dont ils
dérivent; c'est-à-dire qu'ils gouvernent leur complément par la
que le verbe lui-même
préposition
t>
*^r
—
i/
^& ^jâ.fj /vf ,j? t>iufj/:_^f (jf^j-^
détaché du monde ,
/?/w
plus éloigné du
&tf
433*
des
^es
adjectifs
(a)
crime,
se
«
o^jif j*
et
plus
plus
i
>oôJf
—
:
ci. t>*ji j*
prompt à embrasser le bien,
avide de
louanges (a).
règles que l'on vient de donner pour la syntaxe
de la forme ^isf ? n'ont d'application que lorsque
Cette observation
admiratifs
J;-*-!]
exigeroit. Exemple
s'applique également à la manière dont les verbes
complémens objectifs. Exemple :
comportent par rapport à leurs
î^fj 3^ «3jcf l-»j J»«f ci]
***f
^
**l
<j?S~^ S^*"^
^*
fcijÂtj /vf '^ txâof^jj^f (}\ *-é>itj ^»<yf ci ^-*3'j
combien le vrai croyant aime Dieu et est aimé de lui! combien il connaît la vérité,
il cherche la science, il est détaché du monde, il est
prompt à embrasser le bien, il
s'éloigne du mal, il est avide de louanges !
SYNTAXE.
LA
DE
250
adjectifs verbaux de cette forme sont employés avec une
comparative ou superlative. II n'est pas rare qu'ils soient
employés avec la vaïeur positive : en ce cas ils suivent les règles
ordinaires de dépendance et de concordance.- Exemples:
les
valeur
,
J?
|*£L«y!i
Dieu connoit
.'.,
-»,.?
vie
(après
qui
leur
est
qui
mort) ;
vos âmes.
'
•■>
,j,jj
j^j
et
c'est pour lui
jL/Uî l^Çj UJ
JlLtj j*f
qui a solidement posé les
les piliers sont forts et longs.
Celui
dont
f£~>j
dans
j ci
~\At i•if'-'
&&£ f tr^f cJ^VJ cJtvJi y>
tire les créatures du néant, et qui les rend h. la
f-cr* O?*'
C'est lui
ce
ic f
U
une
chose facile.
JJj ïlîûJf
deux ,
et
estai»
qui
cJtjJf ô^
a
élevé leur tente,
434* L'emploi des adjectifs comparatifs donne
à
une
manière
remarquer.
On en
voici
a
encore
Il
a
elliptique
déjà
vu
des
plus
exemples
besoin de moi que
•
ce
s'exprimer
que
nous
ci -devant
lieu
devons faire
(n.*43o)î
eïl
quelques-uns :
Et il ressemble
En
de
souvent
jour- là
,
plus
O
Us étoient
au
.£
plus
je
n'ai besoin de lui,
buffle qu'au
O
cheval.
.
voisins de l'incrédulité
qu'ils ne
l' étoient de la foi.
fO
Si
ce
n'est que les angoisses, les syncopes*? les
,,»rC*.$
serremens
de
DE
cœur, sont
LA
SYNTAXE.
Pans le premier de
que je
fcv-4
ces
exemples
n'ai besoin. Dans le second
'J> Cfr qu'il
n'est semblable. II
L'ellipse peut
lieu de dire
au
dans la
plus fréquens dans la rougeole que
que la douleur de dos au contraire
petite vérole qu'à la rougeole.
et
encore
oJj (JS
,
est
est
*J* est
en est
X
petite vérole,
plus particulière
Js?
,
25
à la
&k$=>-) j-;
*4~£j {$* ou
pour
pour
de même des autres.
poussée plus loin. Par exemple
*-*■*
J^-^ *-& à, ly^ ^j <^'j ^*
être
,
£
d'homme dans l'œil
duquel le collyre soit plus
qui est l'équivalent de
agréable
<£.j cfc* à *•***' I20, 4U'M nest agréable dans l'œil de Zéid, on
pourroit dire aussi o^j <jtp \ytaue l'wl ^e Zeïd, et même ô*j ^
que Zeïd, manières de s'exprimer où l'ellipse est plus forte.
^V n'tfi /70/nf
vu
que dans celui de Zéid ,
ce
CHAPITRE
Syntaxe particulière
des
%. I." Numératifs
4^'
être ,
en
nom
ou
XXV.
Numératifs.
cardinaux.
^ES numératifs cardinaux de la
arabe peuvent
qui régissent ïe
langue
général considérés comme des noms
l'adjectif qui exprime la chose nombrée. Les numé
ratifs simples, depuis un jusqu'à dix, ïes numératifs composés
indéclinables, depuis once jusqu'à dix-neuf et les numératifs
d'unités qui entrent dans les numératifs composés, depuis vingt-un
et au-dessus
jusques à quatre-vingt-dix-neuf, ékc.ont la distinction
,
,
du masculin
et
du féminin. Les numératifs de dixaines
-
.
,
.
vingt jusques
à
quatre-vingt-dix,
cent est un nom
sont
féminin , <jjf mille
des
,
pluriels
est un nom
,
depuis
*
f
masculins: «jU
masculin.
DE
252
Nous
avons
LA
SYNTAXE.
à considérer , par rappdrt à
ratifs cardinaux, les
de la
règles
la syntaxe des numé
dépendance,
celles de la
et
concordance.
singulier et le nombre duel des noms et
adjectifs dispensent d'exprimer les numératifs un et deux,
436.
des
Le nombre
quand le nom de la chose nombrée est lui-même exprimé et
qu'il n'y a que des unités : mais quand la chose nombrée n'est
pas exprimée, on emploie o^»\ pour le masculin, et <jùa\ pour
,
,
le féminin
,
en
rapport d'annexion
leur donnant pour com
exprime la classe d'êtres à
en
,
plément le nom ou le pronom qui
laquelle appartient la chose dont il s'agit, et faisant concorder
le numératif en genre avec ce nom. Exemples : Kyy^\ oâ\ l'un des
hommes, =elisjJf (j3J*\ l'une desfemmes, Le complément d'annexion
a ici la valeur de la préposition ,'y> : c'est comme si Ion disoit
^UJf '^e t\Â.f l'un d'entre les hommes *Ulff ^s^j^-f l'une d'entre
les femmes. Si l'on emploie le nombre un sans complément, on
,
ix^-fj pour le masculin, et de ëjo-fj pour le féminin.
Exemple \a^\} f^oJj fJU. sfjjjJf ôLV ensuite les vizirs vinrent
se
de
sert
:
un. à un.
emploie quelquefois quoique très-rarement ïe numératif
qui est ^U-Jf pour le masculin, et (jliiîj poUr le féminin,
avec le nom de la chose nombrée au duel ce
;
qui est une sorte
de pléonasme. Alors le numératif se
place comme adjectif après
On
,
,
deux ,
le
nom
cas.
Si le
de la chose nombrée
,
et
concorde
avec
lui
en
genre et en
Exemple: (jjjuf c^UJj cyjjï j'ai passé près de deux hommes.
nom de la chose nombrée n'est
pas exprimé on fait concor
,
numératif en genre avec ce nom sous-entendu. On trouve
aussi quelquefois le numératif
y Uoj deux en rapport d'annexion
der
ce
avec
^s£â
le
nom
de la chose nombrée mis
au
singulier,
corarne.
Ulïî deux
437*
grains de sénevé ; mais c'est une licence.
Depuis trois jusqu'à dix, les numératifs peuvent
être
„
J*
DE
employés
comme
ils concordent
adjectifs
en
SYNTAXE.
LA
genre
ou
et
253
comme noms.
en
cas
avec
ie
Comme
nom
adjectifs,
de la chose
Exemple : J^- c^Ujj ^Xi ^yJ *J ^'il avoit trois fis
et cinq files. Comme noms, ils précèdent le nom de la chose
nombrée qu'ils régissent sous forme d'un rapport d'annexion ;
le numératif perd son tanwin 9 le nom qui lui sert de complé
ment se met au génitif pluriel. H faut observer de ne point
employer alors ïes pluriels réguliers et de donner la préférence
aux formes de pluriels irréguliers destinées à caractériser un
petit
nombre (n.° 702, //' p.). Cette dernière règle n'est pas d'une
rigoureuse observation. Il faut aussi faire concorder le numératif
nombrée.
,
,
,
en
genre
avec
le nom de la chose nombrée. Ex.
hommes, <^Si ô«»
438.
aux
six
*j2Îj
trois
files.
depuis un jusqu'à dix se conforment
dépendance pour leurs rapports avec les
discours, c'est-à-dire, pour l'usage des cas.
ordinaires de
règles
parties
du
On dira donc
:
J-j i-jujf <>sU.
*Juj
// m'est
venu
quatre envoyés
ojj* j'ai passé auprès
*Jâf ij\yjj y^i\
439*
JU.^>
Tous les numératifs
autres
Jlâj
:
Si, après
iSïjle
JiU
// vécut
numératif,
;
de six hommes ;
cinq
mois et trois
jours.
exprime, non pas la chose
nombrée, mais un nom destiné à signifier l'espèce entière,
comme J^ô oiseau, t^&
brebis, ou un nom collectif, comme
IL*j famille, s°fi bande de chameaux, il est
plus régulier d'ex
le
entre
ïe
numératif et la chose nombrée par la
primer rapport
préposition ^. Exemples : J£]\ ^-0 «Jjl quatre d'entre les
oiseaux, i**pf &» «uLï neuf de la famille. II y a, en ce cas, ellipse
du nom qui devoit exprimer la chose nombrée ; car c'est comme
on
254
LA
DE
SYNTAXE.
si l'on eût dit,
jlwf ^5 jj^» **t>» quatre oiseaux d'entre les oiseaux
h*jïï (jî o"^ **^2 neufpersonnes de la famille,
On exprime cependant quelquefois cette idée par un simple
rapport d'annexion. Exemples :
,
"°
Il y avoit dans la ville
Il n'est
dû d'aumône pour ce
d'une bande de chameaux.
point
(individus)
d'une
neuf (hommes)
qui
est
famille (a).
au-dessous de
cinq
expressions d'une manière plau
sible il faut supposer que le nom générique ou collectif est ici
pour le nom individuel : .Lij famille, pour JoJ homme; et ^3
bande de chameaux, pour Jl£- chameau.
44o. On trouve quelquefois après les numératifs dont il
s'agit ïe nom de la chose nombrée mis à l'accusatif, sous forme
Pour rendre raison de
ces
,
,
,
de
circonstanciel, comme Ijfjj'f 1k?-,
terme
cinq habits
:
c'est
une
licence
ou une
au
lieu de <_>y f
*^,
irrégularité.
nom
qui sert de
Quoique
complément aux numératifs dont il est ici question doive être mis
au
pluriel, il faut en excepter le mot *jL cent, qui se met au singu
lier lorsqu'il sert de complément aux numératifs d'unités comme
44
!
le
•
nom
de la chose nombrée ,
,
,
je le
dirai tout-à^l'heure.
Les numératifs
442-(n.° 743
,
composés, depuis onje jusqu'à dix-neuf,
//' p> ) ; les numératifs de dixaines , depuis vingt jusqu'à
(n.° 744', 1" P>) > et les numératifs composés
quatre-vingt-dix
de dixaines
et
d'unités, depuis vingt -un jusqu'à quatre-vingt-
dix-neuf (n.° 745
(a)
Cet
,
i.Tt p.)y
régissent
exemple est pris de l'AIcoran,
sur.
tous
2j ,
v.
le
4p.
nom
de la. chose
,
DE
LA
SYNTAXE.
255
singulier et à l'accusatif, sous forme de complément
déterminatif (n.° 102). Les noms de dixaines qui ont la forme
des pluriels masculins réguliers, comme î^jj^-t vingt, n'éprouvent
aucun changement dans ce rapport (a). Excepté les numératifs
nombrée
au
de dixaines
,
qui n'admettent point les deux genres
Exemples
tous'
les
autres
genre avec le nom de la chose nombrée.
U^s j^é Sa. f onje étoiles ; <L*j ôj*-*jj
quatrebrebis.
doivent concorder
:
,
en
pHL
vingt-dix-neuf
quelquefois, après ces numératifs, ïe nom
de la chose nombrée mis au pluriel comme dans cet exemple
emprunté de l'AIcoran : UsUlf spâé. "Jjij f j^Uiîaij nous les avons
divisés en dou^e tribus, C'est une irrégularité que l'on peut jus
tifier par une ellipse en supposant que l'auteur a voulu dire
J^Uif '(Ji t—SA *p^ *&*& f^*& nous les avons divisés en douje
portions, qui sont autant de tribus. II est d'autant plus naturel
d'admettre cette analyse que LJL» tribu étant du masculin si
LLjlf étoit le régime propre du numératif, celui-ci auroit dû
être du masculin tandis qu'il est ici du féminin.
444' Le nom de la chose nombrée étant mis au singulier
après les numératifs dont il s'agit ici si on lui joint une épithète
on
peut la faire concorder en nombre grammaticalement ou logi
quement avec le nom auquel elle se rapporte. Ainsi l'on pourra
dire L>~»Ij tjUji 6j J-% en observant la concordance gram
443
Cn
•
trouve
,
,
,
,
,
,
,
,
>
«jjfli P;Uji ô^jÂ& en observant
logique vingt pièces d'or au coin de Naser.
maticale,
et
,
la concordance
,
44$'
Dans les numératifs formés de dixaines
dessus de
(a)
vingt
,
il faut
Il faut observer que, dans les numératifs
depuis vingt-un jusques
»c
toujours placer les
nomme
^^^t
ou
à
j^y
et
d'unités,
unités
avant
au-
les
composés de dixaines et d'unités
quatre-vingt-dix-neuf, qui est au-dessus des dixaines
ce
excédant.
Zf6
DE
LA
SYNTAXE.
fixâmes. Exemples: UU <^Jwj *J\^> quatre-vingt-trois ans,
fjUji é)j>içj o&f vingt- deux pièces d'or.
44&' Depuis on^e jusqu'à dix -neuf, les rmmératirs, étant
indéclinables ne sont assujettis à aucune règle de dépendance.
Depuis vingt jusques à quatre-vingt-dix-neuf, ils se conforment aux
règles ordinaires pour leurs rapports avec les diverses parties du
,
discours.
Exemples
:
Trente-quatre hommes, furent
J'ai
passé auprès
r
de
tués.
quarante-cinq femelles
de chameau.
^»^ quatre-vingts effâ brebifj
»/'##
4ÂTJ< ïpus ^es numératifs de dixaines, depuis vitigf. jusque* à
quatre-vingt-dix
d'annexion
qui
a
îa chose nombrée
Alors
on
peuvent devenir les antécédens cPun rapport
,
complément le nom du
un
pronom personnel qui
pour
,
ou
souç-entend le
nom
possesseur <$e
le représente.
de la chose nombrée ;
ce
qui
ne
peut avoir lieu que
quand cette chose est déjà connue.
s'exprimer les numératifs de dixaines^
perdent leur terminaison <j comme les pluriels masculins régu
liers (n.° 738 1." p. ) et le nom qui leur sert de complément
se met au
génitif. Exemples : c\jJ ^>^Ç les- vingt (chevaux) de
Dans
cette
manière de
,
,
,
Zeïd,
(a)
joints
x2y^i
On
,
tes trente
trouve
souvent
(esclaves) (a).
dans les écrivains des siècles inférieurs les affixet
perde pour cela sa
terminaison
£j Cela a lieu dans les dates. Ainsi après avoir rapporté plusieurs
faits avivés dans le mois de ramadhan ils diront A^ii\ (jlJ *JÇjj-iç jj
l^f ^jj o*£ b vingt de ce mois mourut le schéikh Alohammed fis d'Omar. Jo
au
numératif
ïySjXis. vingt,
sans
que
.
numératif
ce
,
,
Les
DE
Uli'f
dowre
admettent aussi
,
mairiens. Suivant d'autres
cette sorte
et
d'annexion. Dans
des gram
ils deviennent déclinables. Le premier
cas, ils demeurent indéclinables
ce
257
composés indéclinables, excepté jié Uj'I
Les numératifs
ï'jii,
SYNTAXE.
LA
,
,
suivant la
plupart
composés, prend les trois cas, et se
met au nominatif,
génitif ou à l'accusatif, selon les rapports
dans lesquels il se trouve avec les autres parties du discours ; le
second mot de leur composition jjii ou ojii se met au génitif
comme complément du premier (a)-, et ie nom ou pronom
des deux
mots
dont ils
sont
au
les suit
qui
ïjîc Exemples
ïSlf'
(JjÂâ iLZj*
ÙS ce sont ici tes
ô±
cas
,
comme
régi
par j^â
ou
:
.
lèy^s.
même
met au
se
prends
0jÂâ iulpr ,j«o Ljs. f
tes
donne
Enfin d'autres
quinze (chameaux) ;
quinze (chameaux) ;
(quelques-uns) de
tes
quinze (chameaux).
laissent la
première partie du
numératif composé indéclinable, et donnent à la seconde partie
les trois inflexions des cas : ils disent par exemple au nomi
grammairiens
,
,
natif jàé. *!&■ , au génitif j*àc iSZi- , et à l'accusatif j-ii *J^?- ,
comme si les deux mots n'en faisoient qu'un seul ; mais cette
forme
rejetée
est
du
plus grand
nombre
,
448- Le numératif Lacent est un nom féminin
(jUil*;
ce
centaines
nin
,
cette
sont
composition
point
dtux
cents.
Les
autres
:
il fait
au
duel
numératifs de
formés des numératifs d'unités du genre fémiquatre, &c, et du mot *->U cent. Dans
o^j trois,
vois
ne
On
qui exprime
mauvaise.
comme
£»jf
,
les numératifs d'unités
que les grammairiens admettent
plus loin d'autres exemples.
perdent
cette
leur tanwin ,
manière de
s'exprimer.
en trouvera
(a)
poitrail
La
1 et
première partie
la seconde,
de
j^
II.1 PARTIE.
ces
composés s'appelle xoJô partie antérieure,
partie postérieure.
R
258
-et
DE
S
LA
SYNTAXE.
s
*
.
le mot iLiU
se met au
j
.
génitif,
-
-
*jL o^->'
comme
,
ou
,
en un
seul mot, iuli'vXj' fr-o/j" f«z£r. Ces deux mots forment un rap
port d'annexion, de même que lUioij' trois femmes. On
emploie ici les numératifs d'unités du genre féminin, parce que
ibU cent,
*jU
qui est véritablement la chose nombrée, est
o^XJ signifie littéralement froÂr centaines ou plus
,
ment encore
,
7#z
gulier
c'est que *jU se
,
les numératifs d'unités le nom
trouve
pluriel
exemples
au
,
se
comme
sont
en
44q« Après
nombrée
se
met au
sin
qui exprime
pluriel (à).
régulièrement
dans
cette
composition le mot iyU
quelquefois
qu'aVec
la chose nombrée
On
littérale
Jr/tf ^ centaines.
La seule anomalie à observer ici
; tandis
féminin:
met
os-^t
au
*^>^
ou
s?
^*
—
tr0is cmts >
ma*s
^es
très-rares.
les numératifs de centaines
met au
génitif singulier
,
sous
,
le
nom
de la chose
la forme de
com-
j'ai dit sur la manière de former les numératifs de centaines,
première partie ( n.° 747 ) je dois ajouter que les auteurs des deux
commentaires sur VAlfiyya, contenus dans les Mss. Ar. n.° 1234 de la Bibl.
imp. et n.° 465 de S. G., ne laissent aucun doute sur l'opinion que j'ai adoptée.
Le premier de ces auteurs s'exprime ainsi qJo Sj liL>Lî»f3 iLJviUlf Cwf
(a)
A
ce
que
dans la
>
:
£_jLa^3
...
«-IKJf ,j»
IjJûJCâ
iuL
Le
V*jj?-
qX Qf
O^sÀjÇS.
«iiÂj *aJ f it>*Jf isLîUà
2^*"j *t?4'v^-' j-^- *^ ô» o'f ^^j ^j**^
déterminatif"de trois tt des
numératifs de la même série
toujours
collectif, il est
qui exprime l'espèce,
mis au génitif comme régi par la préposition de ; si c'est un nom autre
que ceux-là, il est mis au génitif, comme complément du numératif: alors -ce
doit être un pluriel rompu de petite pluralité .Le numératif a quelquefois
pour complément un singulier ; ce qui a lieu quand le complément est le mot
Man. Ar. de la Bibl. imp. n* 1 2 34
cent, comme dans trois cents, sept cents.
f. 129 recto. Voyei aussi le Man. n.° 465 de S. G. f. 194 verso.
«
*
»
mis
au
génitif ^ si c'est
autres
un nom
est
ou un nom
,
»
»
.
.
»
»
»
'
d'un rapport d'annexion,
plément
*5<?
SYNTAXE.
LA
DE
et
le numératif de
d'antécédent, perd son tanwin, et
minaison fc>. Exemples : Jij IjL cent hommes
qui
lui
au
sert
,
cents
ânes, oJs^ ibU
J^?- r/wy
centaine,
duel
sa ter
J& WçjL
deux
chiens.
^«;j
quelquefois employés avec le
nom de la chose nombrée mis à l'accusatif singulier sous forme de
complément déterminatif. Exemple : ûsJs UU <jooU c£jjf ^U 5J
Les numératifs de centaines
sont
,
ô*5
iUUlj ïjiltf
et
le
sont
jeunesse
le
Le numératif
a
vécu deux
qUJ f
(_»f mille
est un nom
Ç^.ùJ* ti-if
sert
à
au
,
la
joie
une
le nombre deux mille.
liuf deux mille
uiU%DÛif deux mille volumes jyji'
45 I Les autres numératifs de w///<?
,
.
<jjf
mot
de dixaines
zw///? pour
et
de
il
complément
centaines,
dans la
Exemples
li
et
se
aux
forment
:
il gou
comme
,
J4j c^f
:
Le duel de
tfz/7/e v/7/^j-.
exprimer
masculin
génitif singulier
d'annexion.
d'un rapport
.m///* hommes ,
le
cents ans
évanouis pour lui. C'est
de la chose nombrée
nom
complément
ratif
l'homme
(a).
450.
verne
de la
plaisir
cence
^«^
ce
numé-
Exemples
villages.
en
:
donnant
numératifs d'unités,
observant de le
mettre au
génitif
des numératifs
depuis
pluriel quand
il
est
dans
celle
trois jusqu'à dix; à l'accusatif singulier, quand
des numératifs depuis on^e jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf; enfin au
génitif singulier, quand il est dans celle de tous ïes autres, de
puis cent et au-dessus. Quant au nom de la chose nombrée, il est
aïors le complément du mot<^ff mille, et par conséquent il est
toujours au génitif singulier. Observez d'ailieurs que (_>Ji *»///*
,
est
dépendance
(a) Quelques grammairiens admettent aussi que le nom de la chose nom
au
pluriel après le numératif de centaines. Cela n'est fondé
411e sur un seul exemple fort équivoque de l'AIcoran. Voye^ ci-devant, 1 .re partie,
brée peut être mis
page 3 1 5
,
note.
R
2
2&0
complément
de
•
SYNTAXE.
et que les numératifs auxquels il sert
concorder
avec lui en
doivent
genre. Exemples :
du genre masculin
est
LA
DE
,
J^j c_i"^ «j^j trois mille hommes, iL-fc) U)f deux mille nuits.
JXJ (JJî (3j>*^. vingt mille livres de poids, jUjS «jJf jié ÔJLf
o«7* mille pièces d'or,
^jJtJJf ôjj^Làj iJ'^U' trente -trois mille
pièces d'argent, jUj> «_>)î iyL» o^të" ïw/j «72? mille pièces d'or,
millier de milliers) de
,Uoi <_^)f c^f tf« million (à la lettre,
w/z
^?iffw */V,
J^é- t>_JI
j/>i
U
ci— M
<-i*f
qu'on
le
de la chose nombrée
donnant le nombre
ratifs.
Exemples
et
le
cas
exprimer
veut
numératifs de différentes classes
nom
f'»^ millions de pièces
d'argent
,
H <&«# millions de chameaux.
Si le nombre
452.
*-«-?'
,
de mettre
peut
les numératifs
exigés
de
composé
tous
on
après
est
se contenter
,
en
lui
par le dernier des numé
:
^
^jfj ^V***fj cJ^f *J*llj (jliyiJf o^j v^ff oî^
l'hégire et le déluge il y a trois mille neuf cent soixante-
li5J. o**?-*}
JE/tf/r
,
ans.
quatorze
«__^j 0^1 **j' Ï-^L)^' 'jj*W t^xiu ^é
*
Â"îf
'
(j*Jj j£»Jî
'
s'
?.. -,-»,.»-
jEh/t?
l'hégire
quatre mille sept
(_>
l
if
O
«
—
wïa
et
Adam,
cent
jJ^Ij çfcà'jjM
(Ji^î»^
*_*£!•
suivant le
quarante-un
Pentateuque
e£J
*
,01.1
Hébreu , il y
a
ans.
j' i$=*\ (^ if—^[cJî^j ^^-JVf J^Uj' tJS^
—
(u)£X&
iJ^^J.\ jU|CÏ.f ^Ê
UL
(Ji^
fO'j
^^^J
i
*-**»<
cWi> j
li/zfr? /# confusion des langues et l'hégire, ily a, suivant l'opinion
des historiens, trois mille trois cent quatre ans ; mais , suivant celle
des astronomes, ilfaut ôterde ce nombre deux cent quarante-neufans.
DE
~J*^
.H*///
*■£#/
Oï**^j o*^Jl *J^ /""^j c>N WV^
»7/7/e neuf cent trente-deux cavaliers.
On peut aussi répéter ïe
chaque classe de numératifs
nombre
et
diatement.
ïe
exigés
cas
Exemples
L'évaluation du
deux millions
militaires
**^*j
cent
de la chose nombrée
nom
lui donnant
en
,
par le numératif qui le
chaque
précède
après
fois le
immé
:
de la
province de Garbiyèh est de
quarante-quatre mille quatre-vingts Aèces d'or
revenu
(a).
jp+£*
^\ iuUULVj
jUji c^î c?"^f *JsiLî
l^iU3
L' évaluation du
est
2.6 1
SYNTAXE.
LA
revenu
*->jÂç c^*^^ *^j^
*Âip'j j.U»3 ibUl^j jUji (_}Jf ôj-^J
de la
de trois millions trois cent
partie
méridionale
cinquante-cinq
(de l'Egypte)
mille huit
cent
huit
d'or.
pièces
y a des mille de mille (c'est-à-dire, des
des centaines de mille, des dixaines et des unités de
4j3* Lorsqu'il
millions),
mille , il
mille
,
est
de
d'usage
répéter
les centaines de mille ,
de mille.
ïe
et
mot
mille
les unités
après
jointes
«ujfj ciJf ij.Uj^j ci^f c?^î
LM^ ôy^} **t>li 0^^°j ^ Ôy^-'j ^ ?<?^ ^
millions
Exemple
:
cinq cent quatre-vingt-quatre
mille deux
cent
les mille de
aux
**li'
f^
dixaines
<4J i *i£
w*
neuf
soixante-quatre
pièces d'or.
45 4' S'il y
(a)
des mille de millions
Le dinar militaire avoit
courante
Le
a
:
mot
c'étoit
en
Egypte
(ou milliards), des
une
valeur différente de la
fictive.
àJ^iÂÂ fait ici fonction de pluriel (n.° 444).
une
monnoie
centaines ,
pièce
d'or
26'i
SYNTAXE.
LA
DE
des dixaines et des unités de millions
les
<>JI <JJ\
mots
mille de mille
les centaines de millions
il faut de même
million, après
ou
les unités
et
,
,
jointes
les
aux
répéter
milliards,
dixaines de
Exemple : (jJf ôj*^j *J"^jje>ff ^\ UjLj <jjf (jjf <^Jt
millions.
l^Ucji Mjstiûjj «J's^Ljj wUu^j U)f
J3'3 oJUj ti-^vj
oy*i"j
milliard deux
k«
«-"*ï*j ci*f jy^ çj'j ti-fl
cent
soixante- treize millions
quatre cent soixante- cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize
d'or, plus un demi, un tiers. et un huitième.
Nous
4$ 5-
avons
dit
plus
peuvent être employés comme
autres numératifs. exemples:
t^u*£j
*âlj wU
77 tira
haut que les numératifs simples
adjectifs; il en est de. même des,
fj^î^ ^k^?» 'i{Jû£ [£ i| ^j*' <2l «^îff ÔJÂj
.
le
terre
a
pièces
filet
,
et
il étoit
de
plein
cent
cinquante-trois
gros poissons.
forment huit mille cavaliers parmi lesquels
sont compris cinq cent soixante-quatorze tant caschefs qu'intendans
établis dans les provinces.
Zwj mamloucs
,
La concordance de genre
de la chose nombrée demande
4$6>
nom
entre
les numératifs
quelques
et
le
observations par
ticulières.
Lorsque
genre
avec
ie
nom
du genre dont
car
si
ce
dit que le numératif doit concorder en
de la chose nombrée cela doit s'entendre
nous avons
nom est
il doit être mis
,
est au
singulier
masculin
en
le
au
c^Uw*
de la chose nombrée ;
singulier
et
féminin
au
pluriel,
numératifs masculins..
ù$$ trois bains, quoique o^—*^
concordance
Ainsi l'on doit dire
nom
avec
des
DE
soit
un
féminin
pluriel
masculin. Cette
^e
457*
règle
nom
n'est
voyois sept
$«,
6
"lit
Vous ensemencerez
il viendra sept
est
singulier
généralement admise.
genre
avec ce nom.
-entendu
Exemples
,
le
i
mangeoient sept (vaches) maigres.
.fl, iJ.:
•
•-
sous
("x,
,
-
,o,,J,e,
de coutume pendant sept
années, ensuite
(années) fâcheuses.
II faut
cordance,
en
comme
Parmi eux, il y
458.
cependant pas
vaches grasses que
•,
son
*L_I?-
de la chose nombrée étant
numératif doit concorder
Je
parce que
,
2^3
SYNTAXE.
LA
on a
,.?
'x,
en a
qui
observer,
égard
en
tantôt
.*'
i'
«i°
marchent à quatre
second lieu
au
genre du
,
(pattes):
que, dans cette con
que l'on emploie ,
nom
genre de la chose désignée par ce nom; c'est-à-dire,
que la concordance est tantôt grammaticale et tantôt logique.
4^0. Si la chose nombrée est exprimée par un nom, il faut
tantôt
au
égard au genre grammatical de ce nom. Ainsi, si l'on
emploie le nom ^j^éè personne, qui est masculin, on dira au mas
culin
jAîcf &Ji trois personnes quoique l'on entende parler de
trois femmes ; et de même, si l'on emploie le nom fa* personne,
qui est féminin, on dira au féminin &f.\ £>"&$ trois personnes
quoiqu'on entende parler de trois hommes.
Mais si à ce nom qui par lui-même est d'un genre différent
de celui de la chose qu'on veut désigner
on
ajoute quelque
autre
désignation plus précise qui détermine plus spéciale
ment l'objet dont il
s'agit il faut alors préférer la concordance
logique et n'avoir point égard au genre du nom exprimé,
comme dans ces
exemples :
avoir
,
>
,
,
,
,
R4
2.64
DE
SYNTAXE.
LA
jeunes filles dont les attraits commencent
autre déjà nubile, m'ont servi de bouclier
je redoutais l'attaque.
7)w".r personnes, deux
à
se
développer,
et une
contre les ennemis dont
jjîiif l^L)Us>
^
CV/fô fri^w <& A'VVtfi'
rien de
commun avec
Dans ïe
premier
d'un
pluriel
nom
de
divisée
est
ces
j-^ û*
£$jj «î>jfj (jjJajf
en
dix
Ij^oJJ
branches;
mais tu n'as
dix branches.
exemples
ces
masculin,
est en
le
,
mot
concordance
^Jà quoique
avec
,
&)3
,
numé
ratif féminin , parce que les mots qUcV et j*磻 qui suivent,
et qui sont des épithètes particulières aux femmes, détruisent
l'équivoque
sens
du
mot
J>j£ personnes
Dans le
second,
en
parce que le
mot
ici dans le
sens
J-^ qui
de
ou
sens
le
sens
culin ,
nom
d'un
on a
quoique
trois
J^su
hommes,
l'équivalent
46
1
,
au
ame
n
de
même ,
masculin à
nom
égard
fait accorder,
avec
suit
*X#Js tribu,
4oO. Quelquefois
d'un
de
^^kjf, pluriel
concordance
pareillement
ïe
et
,
déterminent
ce mot
à
un
féminin.
,
sans
une
nom
,
fait voir que
q£S
est
employé
du genre féminin.
qui
qu'aucun autre mot détermine
est
qui exige le genre féminin
qui exige ïe genre mas
numératif avec lequel on le
idée
,
idée
une
pour le genre du
genre grammatical. Ainsi,
féminin , on peut dire jJuf «xL»
plutôt qu'au
sens
soit
JLij
masculin, est
numératif féminin j-aé
nom
féminin à
ayant
le
o-I»j,
un nom
égard qu'au
sens
du
motJUj,
qui
est ici
homme.
Si la chose nombrée n'est pas
exprimée par un nom
mais par un adjectif, ou un mot qui, adjectif dans son origine,
ne
désigne la chose que par inie qualité il ne faut point avoir
égard au genre du mot exprimé, et il faut au contraire faire
•
,
,
concorder le numératif avec le genre du
nom
sous-entendu que
DE
épithète rappelle à l'esprit. Ainsi
pression <L&j dont le singulier est iijj
cette
,
également
d'un homme
personne d'une
et
carrée ,
stature
265
SYNTAXE.
LA
,
on
féminin
mot
d'une femme
le
emploie l'ex
qui se dit
qui signifie une
si l'on
,
joindra
,
et
à
un
numératif mas
culin, quand on aura en vue des hommes, et à un numératif
féminin, quand on parlera de femmes. C'est ainsi qu'on lit dans
l'AIcoran, UJl£>f jJïé di ïS^U *^L [y> : le numératif _>*é est
féminin, quoique ^j£i soit du masculin, parce que £jl£of n'est
réellement ici qu'une épithète du nom c^llli. sous-entendu;
au
quiconque
fait
aura
une
celle
bonne chose,
recevra
dix
(bonnes choses)
équivalentes
faite.
qu'il
le
numératif
n'est point suivi du nom de la
4o2. Lorsque
chose nombrée
mais qu'il est en rapport, par la préposition
le
nom
avec
[p» de,
qui exprime la classe d'êtres à laquelle
appartient la chose nombrée il faut observer la concordance
grammaticale entre le genre du nom et celui du numératif. Ainsi
a
aura
,
,
l'on dira aà) f
|j* *iujf
trois d'entre les brebis ,
en
mettant
le numé
masculin, parce que *Àé brebis, nom d'espèce, est du
masculin; au contraire, on dira Jalff ^o^ trois d 'entre les oies
en mettant le numératif au
féminin, parce que le nom d'espèce
ratif
au
,
iû oie est du féminin. La même chose auroit lieu
après
le
quand même
ajoutëroit
épithète qui caractérisât
d'espèce
de la chose nombrée. Ainsi l'on diroit oljf k^\ [$* *-£cï
nom
le genre
trois d'entre les
et
j^=»i
Ci$J
au
Cette
jojJI
en conservant
*£Û"
o^tV trois d'entre les oies, mâles,
au
masculin
,
en conservant
féminin.
règle
le numératif le
position jj*
dire
brebis, femelles,
q*
,
une
on
iyJt j*
,
est
fondée
nom
comme
sur ce
même
dans les
que l'on doit suppléer après
sert de complément à la pré
qui
exemples donnés
-Uèl ju^lî trois brebis d'entre les
où l'on
pourroit
brebis, kjlJ o^J
,
266
4M
DE
LA
SYNTAXE.
e*0
.kJf I}.* trois oies d'entre les oies. Par la même raison
JjUïif [j* o>^'
dire
trois d'entre les
on
devra
!>UjVf ,j« iu'X'
trois d'entre les familles; parce que le sens est JuUiff 'q* J^Uai o)U
/w/j tribus d'entre les tribus, et J?UjVf j-o iufcjf iu^ trois familles.
tribus,
et
d'entre les familles.
l'épithète qui caractérise le genre étoit placée entre le numé
ratif et le nom d'espèce le numératif concorderoit avec le genre.
désigné par cette épithète. On diroit donc £iff j- oljf o&',
Si
,
CAP
trois
femelles
IfC
d'entre les brebis,. k'dl
-»
j
j
o-tjj-^^
,-
,
*J'^U /ro/r
mâles,
d'entre les oies.
463
.
au
Si le
masculin
de la chose nombrée
nom
£}lâ. état,
comme
ou
peut indifféremment
féminin.
on
au
les deux genres,
le numératif
a
mettre
4&4' Si le nom qui sert de complément au numératif. est un nom
propre, on n'a égard, pour la concordance, qu'au sexe des indivi
dus indiqués par ce nom , et non à la forme grammaticale du norn.
Ainsi l'on doit dire oUiMf ju-Mj les trois Talhas , o&y>f
gj\
les quatre Zeïnabs. Au surplus , ceci ne peut souffrir aucune diffi
culté , puisque les noms propres d'hommes sont toujours du
genre
les
propres de femmes toujours du genre fémi
nin , lors même que les premiers ont une terminaison féminine ,
comme ilÀSî Talha, et les seconds une terminaison masculine,
masculin,
et
o^îj
comme
noms
'Léinab,
46î Quand
.
les numératifs
sont
employés
comme
nombres
abstraits , ainsi que dans cet exemple , trois est la moitié de six, ils
ont toujours la forme masculine. II faut donc dire ï-L
^J-L» îM
.
466.
On peut
comprendre
choses de différens genres,
cents
ce
le même numératif des
quand
dit
j'ai quatre
j'ai quatre cents tant poules que coqs. Dans
les numératifs, depuis six jusqu'à dix, se conforment.
poules
cas,
sous
et
coqs,
ou
comme
on
.
DE
en
au
genre
qui les suit immédiatement
nom
huit
sont
genres
sont
composés
égard
placés.
Pour les êtres
avec
On dira donc
le
sans
raison
,
on
,
,
ou
les suivans, il
-,
OU^j
J'ai
quinze
»r.i
-',,.,
*9Ci
Exemples
«5Uj J4> (jvjj
J'ai
quinze
J'ai
quinze
tant
tant
Exemples
:
et
femelles.
(JÔ+C
femelles
et
sans
suit pas immédiatement le
du féminin.
(£<£*:
"
ïa chose nombrée étant des êtres
ne
*■«*?•
(Sô^z
,."
8_yic (j*?-
chameaux
«X?* (jo^,
fera concorder le numératif en
—
r?,
toujours
et
*jjU-j foy^ j«£é
fiwîj *-?.J^- j-£&
9uj "&(? j.ZÂ jû^r*
quinze chameaux mâles
J'ai
l'exprime
onze
le suit immédiatement.
qui
nom
L-
Si,
comme
,
à l'ordre dans
j'ai quinze serviteurs et servantes
j'ai quinze servantes et Serviteurs.
genre
exprimer
le masculin pour les êtres raisonnables ,
lequel les noms de différens
toujours employer
avoir
#^i à& i)>
chaque espèce séparément.
Si ïes numératifs
sans
dit donc ,
serviteurs. Au-dessous de six , il faut
servantes et
ïe nombre de
faut
;
on
oJif CjXJi J, j'ai huit serviteurs et servantes, o4^'j
ii'Jj
j'ai
267
SYNTAXE.
LA
mâles.
raison
numératif,
,
le
nom
celui-ci
qui
sera
:
U v-iili. /wif- cSiWua
chameaux mâles que chameaux femelles.
chameaux
femelles
que chameaux mâles.
46j.
Les numératifs peuvent être déterminés par l'article Jf
Cette détermination peut avoir lieu, 1 .° quand les numératifs sont
.
employés d'une manière abstraite ; exemple : «JclJf ci**-», *J^f
le (nombre) trois est la moitié du
(nombre) six;
2.*
Quand le
nom
de ïa chose nombrée
est
sous-entendu,
soit
268
été
qu'il a déjà
pléer ; exemples :
parce
Ce
est
qu'on appelle
dans
c'est-à-dire,
exprimé
la force de
état stationnaire ,
un
de
trente
Thomas, l'un des
douze
,
,
soit parce
l'âge,
ans
[jSir>
qu'il
ce sont
est
facile à sup
les années où l'homme
la trentaine
entre
à quarante
svi fif Èsu>
Pj-judS
SYNTAXE.
LA
DE
et
la
quarantaine,
;
i j£jc (j-)
n'étoit pas
ô
f i\a-f
avec eux
l^jjj
quand Jésus vint;
çû^ û?*-^ £-4j^
Les soixante-dix
(disciples)
3 .° Quand le numératif
de la chose nombrée , ce
iL^^f
^ta.jjf
les
mis
est
nom
revinrent
avec
joie ;
adjectif après le nom
déterminé ; exemples :
comme
étant
cinq hommes, jAii\ l^Ui»
numératif précède la chose
ses
dix familles;
nombrée et que
4-.° Quand le
et l'autre, ne formant qu'une seule partie du discours,
,
l'un
doivent être déterminés.
468.
jusqu'à
Dans
dix ,
on
seulement.
ce
Exemple
^^JiUif jUoJfj
de leur marmite,
siperont
dernier cas,
mon
avec
doit donner ï'article
fj-f-r^
et ces
:
ïes numératifs
au nom
depuis
trois
de ïa chose nombrée
jli'Vf ovXj ^^Jf t>«JÇ»j jpdliff j-ajj J*
^m^ les trois pierres qui formoient les soutiens
lieux inhabités,
me
rendront le salut
et
dis»
aveuglement l
On peut aussi donner l'article
au
numératif, quoique
cette
forme soit moins usitée.
Exemple : jL_I«^»uJI j^lo wCJJl les sept
préceptes fondamentaux de la loi. Quelques grammairiens per
mettent
et
de donner l'article
de dire
oyVf
au
numératif et à la chose nombrée,
i.-£&\ les cinq habits.
Avec les numératifs
depuis
onze
jusqu'à
dix -neuf,
on
donne
DE
l'article
deux
aux
composés (a)
,
ou
mots
indéclinables dont
seulement
->~tt^? **%.„,. \
£ji j^iJÏ 3ÂVf )
j
M
,*_
-
^-^^flo
VU
X
oj^wiJf
.«e^ >
les onze
les
UcÂJVr J
et
prend
s'il y
a
l'article.
des unités
et
douze femelles de
les trois
:
chameaux.
,
chacun des numératifs
et
de mille
numératif (b).
cents
numé
au
«-JUUt /^j soixante-dix-
Exemple: ^Uf y^ipJfj
j.oJf L_jl_fiOU'
j[^S
sont
Exemples
donne l'article
on
des dixaines
ou au
numératifs
pièces d'argent;
sept chameaux.
Avec les numératifs de centaines
l'article à la chose nombrée
ces
des deux.
premier
au
Avec les numératifs de dixaines ,
ratif;
269
SYNTAXE.
LA
pièces
,
donne
on
Exemples
:
d'or;
X3Jf cjifl û$o é^S*s U qu'as-tufait des trois mille pièces d'argent!
i*ji
ff u-jlif les deux
(J
Jâ
ji
ff «jJVf à*
<.>
46o. Si,
en ce
cas,
c*
cent
mille
pièces d'argent ;
million de pièces d'or.
après
ïe
nom
de la chose nombrée
,
il
sur
adjectif, il doit être déterminé (n.° 36 1) ; ex. : (j^*Âlif
^U^Jf UT^S les soixante -dix petites bondes; et je pense qu'il doit
toujours concorder en cas avec celui des deux mots, je veux
dire du numératif ou du nom de la chose nombrée, qui a
l'article. Nous avons déjà parlé de ce qui concerne la con
cordance de nombre ( n.° 444)
Quant à ïa concordance de genre il faut suivre les règles
vient
un
■
,
(n)
(b)
C'est
l'opinion
des
grammairiens
de Coufa,
et
de Hariri.
Hariri n'admet que la première de ces manières de s'exprimer. Ebn-Farhât
reconnoît l'une et l'autre. (Mss. Ar. de la Bibl. imp. n.° 1495 A f. 119 recto.)
,
DE
27O
SYNTAXE.
LA
ordinaires de la concordance des
adjectifs
les articles
,
,
&c.
,
sieurs des
exemples précédens.
(_JsJUalf JjJf
Aj'ïmf Col #Uif
l'homme
curer
qu'il
en
noms
comme on a
encore un :
l^^jo Vj^«f *J'^J
Vf
monde recherche trois choses
ce
que par le moyen de quatre
recherche ce sont ifc.
autres
qu'il
ne
plu
o^L> jj(
oiiaJ W<jJf
peut
trois
aux
quant
:
verbes, les
pu l'observer dans
En voici
ÏÂjJL
les
avec
se
pro
(choses)
,
470 Dans les dates d'années , il est d'usage d'employer les
numératifs cardinaux en rapport d'annexion avec ïe nom *JU
.
année ,
qui
sert
d'antécédent à
rapport. Ce
ce
nom est
alors déter
miné par les numératifs qui lui servent de complément : en con
séquence , il n'a point d'article. Les numératifs doivent concor
der
en
genre
ïes unités
posant la
,
avec
le
mot
L&, qui
est
féminin. On
place
d'abord
puis les dixaines les centaines et le mille en inter
conjonction j et entre.chaque numératif. Exemples:
,
"u-
■■
%\
-V--
,
•
-
-
"
J-
*
-
Ensuite commença l'année
r
-
-*-
ijpiï.
(•^é q^I jjf (jjj JùUfUj ïjJLs. ôX> ïfjJ* J»_
£jz Vannée
S'il
sfagissoit
Sij
mourut
Abou'lhasan Ali.
de dater des années d'un
règne
ou
de la vie d'un
il faudroit
employer les numératifs ordinaux. Exemple :
^U«Jci tjj^Vf
^ i^iUUf j&Uf J^ f« la sixième année du
de
règne Mélic-alaschraf Schaban.
homme
,
csUlif cAL»
4r/ I
•
Je dois
ajouter
ici
les anciens écrivains Arabes
une
observation
indiquoient
Les Arabes datent des nuits
,
et non
les
sur
la manière dont
jours des mois.
jours, parce que
pas des
leur usage civil est de commencer la durée des
après le coucher du soïeil.
vingt -quatre
heures
Ainsi, pour
dater du
commencement
du mois de
redjeb,
DE
on
dit
*£f
Lg»4-J [j»
oÂj *)*J
ou
t_sÂj y_©
On dit ensuite
étant
passée
Pour le 3/
sous
,
,
suivans
JUi (nuits)
une
nuit
,
jusqu'au
6\e
,
Pour le
7.°
,
Pour le
8.e
,
Pour le
(?.e
,
0JÏî.£_JoJ
o.c
,
yjU.
oj-&- Tyr^ji
&■
o.
—
jU. £^4-*J
^jiî. qLT^J
^
jour
n'est que le
qu'en conséquence
Ainsi l'on dit
«J six
0
Pour le onzième
quatre
le numératif
met
au
(nuits) étant passées;
étant passées ;
ij*^- cinq (nuits)
—
£)jl^
l'on
pluriel. Qn continue ainsi pour
onzième inclusivement. On dit donc :
Pour le
>
et
,
féminin
au
$.c, oj
(nuits)
étant
(nuits)
^w/7
(nuits) étant passées j
(nuits)
les suivans
étant
,
sous-entendu
le verbe
se
passées ;
étant passées ;
n.euf (nuits)
îsJ *//>
nom
passées;
sept
—
et
étant
observe ïa même
on
est
met au
passées.
*iJ
au
singulier
singulier
,
féminin.
:
Pour le n.*, ôiî.
Pour le i2.e
Pour le
.
(nuits) étant passées*
trois
Pour le
ce
ë^—à
deux nuits étant passées ;
4«c
forme , si
lieu de
au
,
Pour le
1
On peut
redjeb.
premier jour ô—Jlà. *^J
(jsXiÂJJ
-entend
le verbe
les
et
J#£î,
oj-^à- o^J
féminin ,
Pour le
dit aussi
on
$-
pour le
UUî.
et
jours
2
et
,
redjeb
:
du &c. ;
Pour le 2.0
On
première
la nouvelle lune de
a
2
employer J^o
271
nuit de
j
-
*'
"
encore
la
JjV
,
SYNTAXE.
LA
,
fjjjî fj JÂjV
onze
(nuits)
ôî». v&é t$£&\ douje (nuits)
13.', ôlî. ;«jJîfi ô^Ul treize (nuits)
Pour le i4«e
>
ôd*
étant passées ;
étant passées
étant
;
passées ;
*)-*£■ ç^jX quatorze (nuits) étant passées.
SYNTAXE.
LA
DE
2*J2
quinzième jour se nomme le milieu du mois et l'on dit
oôj ^ fj^aj) f Jj!_, ou t,>â.j <J-«^a J^ ou encore oÂj ci^jcif j
*w »i///V« /& ra^V£ ; cela vaut beaucoup mieux que de dire
de
s**j (j^ôi^sj^i J**^ ^w'n^ (nuits) étant passées redjeb, ou
de redjeb. Cette
oij ^o J^iu éjié JZ& quinze (nuits) restant
dernière formule est celle que l'on emploie pour les jours suivans.
Le
,
,
On dit donc
'
:
£_jfi quatorze (nuits) restant;
y-^ ô^ûj treize (nuits) restant;
Pour ïe i6.e
jour, ô
Pour le
,
ô
Pour le i8.e
,
«I>—^ «lié *JM^'V douze
Pour le io.e
,
Pour le
17.°
ÂiC
c>—âûj
e
«sjJîé c5Ô^.V
ft-si
,
^
Pour le 2i.c
,
ôs—^
Pour le 22.e
,
'<#
Pour le
2
3 .e
,
£&
Pour le
24-c
,
éfc
Pour le
2
5 .e
,
os
Pour le 20V
,
&-,
Pour le 27/
,
jv
Pour le 28/
,
U
Pour le 2Q.C
,
c>
20.
^HJ -«jâ©
vr-*^*-l
qLiIJ
»j
aj
H
^
30.°
(nuits)
çj
;
sj
*-«J sept
(nuits)
f^-jjV
il faut dire
(nuits)
cmq
quatre
o^*î
/ro/j"
âaj
Oi^M!
^h*
ÂHj
iL_«-UU
une
cj
restant;
(nuits)
cfe*^.
-
restant;
restant ;
restant;
restant ;
(nuits)
(nuits)
(nuits)
nuit
.
restant;
huit
^six^ (nuits)
<k
restant;
restant;
**l neuf (nuits)
fs
-
Pour le
(nuits)
<m^
<^/*'
(nuits)
restant;
restant;
restant;
restant.
%
oâj ^ ids) jàV
/*z dernière nuit de
redjeb. On peut dire aussi s>^jj !>**!> c'est-à-dire, la nuit dans
laquelle la lune est cachée ne paroit point ; au lieu de jfj—, on dit
aussi jjj-^et jj-^ Enfin, pour le dernier jour du mois, la nuit étant
passée,
,
DE
LA
271
SYNTAXE.
passé.e on se sert de ces formules : v4j IWy -&\ l* dernier jour
de redjeb; vé-j À^l et s-^j ^— **V & l* fn ^e ndjeb (a).
II est facile d'appliquer cette manière de dater aux mois qui
n'ont que vingt-neuf jours. On dira alors pour le seizième jour,
et ainsi des
^iu îjlé ô^f treize (nuits) restant du mois de.
,
.
.
,
autres.
S. II. Numératifs ordinaux.
4-72.
et
Les numératifs ordinaux
ils doivent concorder
port
à
et en
l'usage
de
avec
les
de
sont
noms
l'article, aussi-bien
qu'ils qualifient, par rap
qu'en genre, en npmbre
cas.
Les numératifs ordinaux de dixaines
et
de
véritables adjectifs,
,
et ceux
de
centaines
mille, étant les mêmes que les numératifs cardinaux,
s'emploient pour les deux genres.
déterminés par
473. Lorsque les numératifs ordinaux sont
l'article ils ne peuvent point être en rapport d'annexion : lors
être en rappprt d'annexion
qu'ils n'ont point d'article, ils peuvent
:
avec un nom ouluii pronom ajfrxe. Exemples
,
wL-UJl «Ul <£
Hakem'biamr-allah naquit la
a
nuit du
jeudi
JjVf
23 de rebi 1."
t
la neuvième heure.
Il fut salué khalife
mois de ramadhmt
Le 23 dudit
(a) Voytr,\*
(mois),
après
il
l'heure <de midi du mardi *$.' du
fut fait
Man. Ar. delà Bibl.
II.' PARTIE.
imp.
une
proclamation au Caire,
n.° 1234, f. 132
recto.
S
2y4
DE
SYNTAXE.
LA
j£^f (ji jiâ
Ensuite le sultan
s'avança
Ez^z» plaça
'cette place lé j." (jour) de dhou'lkada; la place
le u.e (jour) de dhoulhiddja.
II y
4j4-
a
et
vers
où les numératifs ordinaux
autre cas
un
camp devant
se rendit a lui
son
sont
employés
rapport d'annexion : c'est lorsqu'on leur donne pour
complément le numératif cardinal dont ils sont formés, comme
dans cet exemple, ($xj\ t>U oof tu es le second de deux; ce qui
en
seulement
signifie
s'exprimer,
on
,
tu es
doit
l'un des deux. Dans
mettre
en rapport' d'annexion ,
Ainsi l'on doit dire ojîé
et
cette
manière de
nécessairement les deux numératifs
il faut les faire concorder
j^U
en
genre.
l'un de dix, _>£* ïli;U l'une de dix,
475 On peut employer dans la même acception les numé
ratifs cardinaux depuis onze jusqu'à dix -neuf; ce qui se fait de
•
deux
façons
genres
:
on
observant toujours la concordance des
dira donc jiié ^J'K>__i£ ^L-j l'un de douze, et
,
mais
en
oj^ié '(j-*H ëj-^é £uL> l'une de douze, les quatre mots dont les
deux numératifs sont composés demeurant indéclinables; ou
bien
j*£é ^jJ'f ^lï l'un
j-îi *5Xi oJIj l'un de
douze, sjii '^pj'f iÇoLi' l'une de douze,
treize v^ ôij' *-iJL> Fune de treize')
de
,
supprimant le second mot du numératif ordinal déclinant le
premier, et laissant ïe numératif cardinal indéclinable. On peut
encore exprimer le même sens en supprimant tout -à -fait le
second terme qui est le numératif cardinal, et conservant le
,
numératif ordinal seul
'jîi& cSJu
4j6.
dans
une
y> il
est un
sous
sa
forme indéclinable.
Exemple :
treizième, c'est-à-dire, un de treize.
Les numératifs ordinaux peuvent encore être employés
autre sorte de
rapport avec le numératif cardinal immé
diatement inférieur à celui dont ils
dérivent,
comme on
ïe voit
DE
LA
SYNTAXE.
2J $
c'est-
le troisième de
deux,
exemple : (jUj'f cJU j* //• est
se
à
à-dire
joint deux pour faire trois, pour compléter le nombre
de trois. En ce sens, les numératifs ordinaux depuis trois jus
qu'à neuf (a) sont véritablement des adjectifs verbaux actifs ou
noms d'agent dérivés de verbes qui signifient élever à tel ou tel
nombre comme é>JU élever de deux au nombre de trois,
jj
dans
cet
il
,
*_-
,
nombre de quatre. Aussi ces numératifs ordinaux
peuvent -ils régir le numératif cardinal qui leur sert de complé
ment , à la manière des verbes , en le mettant à l'accusatif, ou à
élever de trois
au
rapport d'annexion en le mettant au
observant néanmoins que si ces adjectifs verbaux ont
la manière des
génitif;
en
la valeur du
noms
passé
,
en
ils
,
ne
peuvent
la seconde manière. II faut
de genre
entre
encore
régir
le
complément
que de
observer ici la concordance
les deux numératifs.
On peut donc dire l£$o
£>tj j*
bien *j'X'
ou
gfj j*
quatre le nombre de trois ; Û3Îj *»j'Ij l£.p\i bien
elle élève h quatre le nombre de trois.
a
il élève
c$$3 **jfj
J^
employer la même forme avec ïes numératifs
otdinauX composés, de ônqe à dix-neuf en déclinant le numératif
d'unité qui entre dans leur composition et laissant le numératif
de dixaine indéclinable. On dira donc ji* J3\ ji* oJIj j*
il porte a treize le nombre de douze */■*» \P*>1 °j-** **I^* l£ elle
477'
On peut
,
,
porte à treize le nombre de
478.
d'autres dixaines
-i
,
si
ce
a
n'est
lieu
avec
qu'alors
les numératifs
on
(a) Quelques grammairiens
admettent aussi
composés
retranche du numératif
__—————
—
'
1
douze (b).
La même forme
cette
forme pour le numératif
deux.
(b)
Les
rejettent
de Coufa et un grand nombre de
forme pour les numératifs de onjt à dix-neuf.
grammairiens
cette
ceux
S2
de Basra
ZJ$
DE
ordinal le
mot
<jj>-^?j
bien
de
ou
LA
qui exprime
SYNTAXE.
la dixaine.
Exemple : tii$Li %\j 'À
vingt-quatre le nombre
y. il porte à
jj>%3 '£$*> gîj
vingt-trois.
4jQ>
On
des
exemples de verbes quadrilitères formés des
depuis vingt, jusqu'à quatre-vingt-dix
ôjii porter au nombre de vingt, ^J. porter au nombre de
a
numératifs de dixaines
comme
,
,
soixante-dix. Ces verbes
à des
adjectifs
ji£
comme
neuf.
48o.
,
si
on
les admet , donnent naissance
verbaux
**^J*
qu'on peut employer dans le même sens,
{^y*** j*> il porte à vingt le nombre de dix^
De même
qu'on
dit
ôïî porter deux au
nombre de trois,
jj^> porter quatre au nombre de. cinq, on dit aussi, sous Ja forme
Jiif, avec une signification neutre, c£i\ devenir trois de deux
que l'on étoit,
J&l
devenir
cinq
de quatre que l'on étoit,
jusqu'à dix.
ne parlerai point ici des
de quantités qui ont quelque
ainsi
et
des autres
48
poids et
1
ratifs
,
.
Je
,
ni de la manière dont
plémens; j'en
ai donné les
ces
CHAPITRE
mesures
avec
joignent à
(n.os 101
ailleurs
,
de
les numé
leurs
et,
com
102).
XXVI.
de l'Article
482. QUOIQUE j'aie parlé
de
rapport
noms se
règles
Syntaxe particulière
noms
déterminatif.
ailleurs
( n.os 770 et suiv.
/." p. ) des divers usages de l'article déterminatif, j'ajouterai
encore ici quelques observations à ce sujet.
On emploie quelquefois l'article déterminatif, 1° pour remplacer un complément d'un rapport d'annexion «Jf t^i£l\ l^Ao}
.
Exemple : Jfj oy^ à
Jïitïïj^j)} cJJ^Q
tu
m'as troublé par
DE
SYNTAXE.
LA
^77
éloignement et dans le trouble (que cela m'a causé) la raison
Ji*Jf la raison est ici pour (JÀb ma raison.
ton
,
s'est évanouie.
,
2.0 Par antonomase iÂJUU
Ainsi l'on
.
ditoUOf /* livre, pour
<>Uf le prophète, pour Mahomet.
/Wr indiquer une qualité dominante
l'AIcoran;
3.0
SJuâJf JJU
lieu de
,
en sorte
nom
que
:
propre
cette
qualité
c?est donc
devient
une
sorte
dans
un
une
personne
sobriquet et tient
d'antonomase. Ex.
:
rébarbatif, t^lûsâjf le rieur.
pléonastique 'tSufj; et dans ce cas, il est
c'est-à-dire qujsn ne peut pas l'omettre
ou inséparable &jé
comme dans l'adjectif conjonctif (joJl
qui; ou susceptible d'être
omis ïijV jlc comme dans le mot composé JJjVf cy& des truffes,
au lieu duquel on peut dire, sans article,
jjjf <^>Uj.
483. L'article déterminatif, considéré sous ïe point de vue
des règles de dépendance donne lieu aux observations sui
jiUsJf
le
4-° D'une manière
,
,
,
,
vantes :
1
.°
Lorsqu'il
d'annexion
,
se
trouve
dans le second
il détermine l'antécédent
doit
,
article. Cette
terme
qui
,
en
d'un
rapport
conséquence
,
point prendre
règle
exceptions
et suiv., 26*9 et
106
et
été
2^.6
suiv.,
déjà
exposées (n.os
270).
2.0 II fait éprouver quelques changemens à la déclinaison des
noms, ainsi que je l'ai dit ailleurs (n.° 737 et suiv. //'/?,).
ne
cet
et ses
ont
484* Quant à la concordance, la seule chose à observer,
c'est que l'adjectif qui se rapporte à un nom déterminé soit
,
par l'article
,
par l'article
(n.° 361 ).
soit
autrement
,
doit être lui-même déterminé
S}
278
LA
DE
SYNTAXE."
XXVII.
CHAPITRE
Syntaxe particulière de l'Adjectif conjonctif,
conjonctifs et interrogatifs.
et
des Noms
conjonctif <j Ù \ qui, lequel, et les noms
conjonctifs ^ celui qui, \S'ce que, l$\ '*->}' quoi, qui servent
aussi à interroger donnent lieu à quelques règles particulières
de concordance et de dépendance.
4-86. L'adjectif conjonctif (jôJ\ se conforme, pour ce qui est
de la concordance en genre et en nombre avec le nom auquel il
se
rapporte aux règles ordinaires de la concordance des adjectifs
(n.os 368 et suiv.) : il ne peut, comme nous l'avons déjà observé,
servir à qualifier qu'un nom déterminé soit par l'article soit
autrement, parce qu'il est lui-même déterminé de sa nature,
renfermant toujours l'article déterminatif jf (a).
II concorde également avec le verbe ou l'attribut auquel il
sert de sujet dans la
proposition conjonctive *JU / conformément
aux
règles exposées précédemment concernant la concordance
du verbe avec le sujet qui ïe précède ( n.°* 3051 3 1 1 ) et celte
du sujet avec l'attribut (n.os 350- 355).
L'adjectif conjonctif n'a point de cas si ce n'est au duel ; à
ce nombre, il suit les
règles ordinaires de dépendance.
487. L'adjectif conjonctif dans plusieurs langues,, a deux
fonctions à remplir dans le discours (b) : il sert d'abord, à
48^
L'ADJECTIF
-
,
,
,
,
,
-
,
,
,
(a) Cet article est ici selon
indispensable Ifi (n.°482).
,
(b) Voyej^, sur
grammaire générale
,
la
nature
z.c
de
les
grammairiens
l'adjectif
édition, p. 105
et
et
suiv.
sur
Arabes
son
,
usage,
explétif o^\\
mes
,
«t
Principes d*
DE
LA
SYNTAXE.
2J?
exprimer ïa relation qui est entre une proposition conjonctive et
nom qui est qualifié
par cette proposition ; et à raison de cela,
il doit être placé au commencement de la proposition conjonc
tive : il remplit en second lieu la fonction de sujet ou de
complément dans la proposition conjonctive elle-même ; et par
le
,
raison
cette
duel
il
,
,
prend
les divers
cas.
n'en ait pas
En arabe même
,
il
a
des
nombres,
Lorsque
quoiqu'il
en même
fait
mortuus est,,
rex
temps ïa
qui
qui
je
et
de
du
verbe
mortuus
celle
est.
fonction de conjonctif,
sujet
Si je dis homo cujus filius œgrotat miles quem occidi, les conjonc
tifs cujus et quem outre l'idée conjonctive qu'ils expriment
indiquent encore l'un le complément du nom filius l'autre
;|e complément du verbe occidi. II en est de même des con
jonctifs qui, duquel, que, dans ces expressions françoises, le roi
QUI est mort, l'homme DUQUEL le fils est malade, te soldat QUE
cas au
dis
en
,
latin
aux autres
,
,
,
,
,
j'ai tué.
488. Chez les Arabes, l'adjectif conjonctif n'admettant point,
quelques exceptions près la variation des cas et ne pouvant
ni être déplacé du commencement de la proposition conjonc
tive ni être dans la dépendance d'un antécédent qui est réel
lement placé après lui, toutes les fois' que le conjonctif doit,
dans la proposition conjonctive exprimer le complément d'un
verbe d'un nom ou d'une préposition on supplée au défaut
d'indication de cette dépendance dans l'adjecrif conjonctif, par
un
pronom personnel que l'on donne pour complément au verbe,
au nom ou à la
préposition. Ce pronom concorde en genre
et en nombre
suivant les règles ordinaires avec le nom auquel
se
rapporte l'adjectif conjonctif.
Si l'attribut de la proposition conjonctive n'est point un
verbe mais un adjectif, un nom ou un pronom et que le nom
auquel se rapporte l'adjectif conjonctif en soit le sujet logique,.
à
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
S4
,
2$ô
ce
D"E LA
SYNTAXE,
nprtî doit è*tré aussi représenté par
Exemples*
Lé voleur LEQUEL
fils
a
un
pronom
Jjersormef (a).
:
fils
mon
a
tué LUI, c'est-k-dire , que mûri
tué.
Le médecin LEQUEL le fils de LUI
dont le fils
est
chez
est
chez moi, c'est-à-dire,
moi.
Lé marchand lequel cette
c'est-k-diré ,
chez lequel
Le schéikk LEQUEL
se
jeune fille se trouve chez
trouve cette jeûne fille.
malade , c'est-à-dire,
LUI
est
qui
LUîi
malade.
personnel se nomme ojU retournant parce qu'il
l'adjectif conjonctif.
reporte
IIarrivé
néanmoins fréquemment que Pan supprime
480f.
ce prô'rïorrî personnel.
Lorsqu'il est destiné à r-éjyrésenter le sujet on peut le sup
primer, pourvu qtté la proposition conjonctive soit d'une
certaine longueur. Exemples :
Ce pronom
,
éur
se
,
'
'■
j
ai
«
*
~"°
ty* (JJ Jjtë ^jjJL lîf U
je
né suis pas
un
homme
té dise du mal.
qui
(a) Si l'attribut est exprime par un verbe il n'y a point lieu à cela, parce
que la terminaison mèrrie du verbe qui èoncorde en genre et en nombre avec
l'adjectif conjonctif, fait la fonction, du pronom personnel- Ainsi, dans
,
'
Fdfetf rvjjJ»
nel
qui
(1?
dis à
concorde
disent les
Arabes;
avec
ceux
le
qui ont cru
,
la terminaison
conjonctif AjjJf
JA^. lit f
,.
et se
<JÎ jjUJf ^Àé-iJf
,
F» est
reporte
le pronom person
sur
lui,
ou, comme
DE
C'est lui
qui
LA
Dieu dans le ciel
est
281
SYNTAXE.
Dieu
et
C'est la même chose que si l'on eût dit
Jf LôsJf j y» ^jjJf
conformément à la
,
sur*
la
terre.
^Sli '£ ijùlU
et
règle.
très-courte, on ne doit pas
proposition conjonctive
faire l'ellipse du pronom personnel. Il y en a cependant des
exemples, mais ils sont rares. En voici un : (f&L*. *^ o^L? J** [f>
«Jû. U ^wé quiconque recherche la louange ne prononce point, des
Si
la
est
,
auroit dû dire *jJL y> li
Si l'attribut étoit sous-entendu et
paroles
400.
sottes ; on
.
exprimé seulement
par un terme circonstanciel, on ne pourroit point faire l'ellipse du
pronom personnel. On ne pourroit pas dire jfoJf j «jtXJf o^fj
il faut nécessairement dire jfoJf j/y> (jôJ\ oôfj j'ai vu celui qui
>
LUI
dans la maison
,
c'est-à-dire , celui
qui
4e) l Lorsque ïe pronom personnel
•
ie complément objectif
verbal, et
souvent
,
par
d'un verbe
conséquent
sur-tout
dans le
UuuJùî
doit être à
est
est
dans la maison.
destiné à
représenter
transitif, ou d'un adjectif
l'accusatif, on le retranche
premier cas.
J&Jï-i (£éJi\ JCil
Les richesses que
nos âmes
désirent.
fjjàj J<Wùf (Adjï tsdJt ùf)}^
La subsistance que Dieu t'accorde,
On auroit dû dire
*>&£
et
isCJy
,
est une
mais
on
du pronom
grâce.
a
fait
l'ellipse
personnel.
4o2. Lorsque le pronom personnel forme le complément
d'un rapport d'annexion ou d'une préposition et est par con
séquent au génitff ] on peut quelquefois en faire l'ellipse.
Cette ellipse a lieu quand l'antécédent du rapport d'annexion
,
282
DE
LA
SYNTAXE.
adjectif verbal exprimant ïa
exemples :
est un
ces
ô_"jf
j&U'
Fais
u)U> o>^»
Je
quand
Ici
ne
fais
ma
j»U'
Elle
ce
que
tu
valeur du verbe
de
main peut saisir
est
pour
f~?li>
,
comme
dans
^tyfjaj'f
juges
a
propos de faire.
<j(pf c^lfJjSL» Js*£ ô^Ajf
aucun cas
,
fif (jï'ki js*é ^
richesses
J*"**-*}
les
je
épargne point,
cherchois.
je
'l'objet que
mes
et
et
ne
UJU? pour «XilU
.
pareillement lieu pour le pronom personnel servant
de complément à une
préposition et même pour la préposi
tion quand ïe conjonctif est lui-même régi par la. même pré
position. Exemple : Q^éX^ V—* (jà-^^ t~0>* j'ai passé près de
l'homme près duquel a passé Soléiman. On voit qu'il y a ellipse
a
,
,
de
*j
après j^
.
préposition, étant la même, n'exprimoit pas le même
ne faudroit point se
permettre cette ellipse. Ainsi il ne
seroit pas convenable de dire éj^ê-j <jô—^ ci, cyiN-ij» mais il
faudroit dire sans ellipse *-ô ^Âi.^ iS^ j^c^ô^j je me suis abstenu
de ce que tu as recherché. Si en pareil cas l'ellipse a lieu quelque
fois, c'est une licence.
493 L'adjectif conjonctif ,jàS\ renferme quelquefois la valeur,
d'un antécédent et signifie celui qui celui que ce qui ce que.
Exemple : <_fc£lUf «Jj4»J (S^j .d~*Jà. y> *** cyô^ijf <joif ce que
je méprisais m'a sauvé, et ce en quoi je mettois mon espérance m'a
perdu. Cela a lieu sur- tout dans une sorte de construction pardans laquelle l'adjectif conjonctif ^oJf
ou
ticulière
plutôt
toute ïa proposition conjonctive devient ïe sujet, et le nom
ou le
pronom qui est le véritable sujet qualifié par cette pro
position devient l'attribut , comme lorsque l'on dit celui que j'ai
Si la
sens
,
il
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,
DE
battu
Zéid
Zéid
est
,
ou
celui
LA
qui
été battu par moi,
283
SYNTAXE.
battu Zéid, c'est moi,
a
battu Zéid. On
au
lieu de
bien
qu'en
s'exprimant sous cette forme on a pour but de donner plus
d'énergie à son expression de réveiller davantage l'attention de
ceux qui écoutent, ou de confirmer ce
qu'on avoit déjà dit,
et de dissiper les doutes
qui pouvoient rester dans l'esprit des
auditeurs. C'est ainsi qu'au lieu de dire en françois Dieu a
créé le monde je suis venu hier, on s'exprime d'une manière plus
affirmative et plus énergique en disant : c'est Dieu qui a créé
a
ou
j'ai
sent
,
,
,
,
,
,
le monde
,
c'est moi
En arabe
la chose
sur
dans
,
qui
cette
laquelle
hier , c'est hier que je suis venu.
manière de s'exprimer, ïa personne ou
suis
venu
tombe l'affirmation
,
et
qui
devient l'attribut
grammatical ^..Âî. quoique dans ïa réalité elle soit le sujet
logique, se nomme <j jJL *!* Jâ^JI la chose dont on énonce une
qualité par le moyen de l'adjectif conjonctif et la formule ellemême s'appelle <jô){j $]ji JjijUîLVf énoncer une
qualité d'une
chose par le moyen de l'adjectif conjonctif.
L'adjectif conjonctifdoit être alors placé au commencement de
la proposition et le nom qualifié par cet adjectif doit être mis
à la fin. Le surplus de la
proposition conjonctive se place entre
les deux et doit renfermer suivant ce qui a été dit un pro
nom
personnel qui représente la chose ou ïa personne dont on
affirme la qualité. Ce pronom personnel doit concorder en genre
et en nombre avec le
conjonctif, et être au même cas où l'on
,
,
,
,
auroit mis le
exprimé
On
nom
de la chose
de la manière la
concorder
,
,
en
nombre
ou
de la personne
plus simple.
et en
Enfin le
avec
genre
ïe
,
si l'on
se
fût
conjonctif doit
nom
qu'il qualifie.
mieux ceci par un exemple. Supposons qu'au
les deux poètes ont envoyé une lettre aux vi-rirs fambo
comprendra
lieu de dire ,
poetœ miserunt epistolam ad v'ï7iros ] on veuille employer la for
mule énergique dont il s'agit ; on variera l'expression selon que
,
2%4
DE
LA
SYNTAXE.
l'on voudra faire tomber la valeur
les deux
poètes,
ou sur
Pans le
ïes
de l'affirmation
énergique
sur
yiz}rs ou sur la lettre. On dira,
qui ont envoyé une lettre aux vizirs,
,
premier
poètes (jfj^Làlf lull, *\jjj\ ^ oîûJJf ;
Dans le second cas : ceux à qui les deux poètes ont fait par
venir une lettre, ce sont les vizirs >[}jy f *J^j of>eLîJf &>& ^.^f ;
Dans ïe troisième cas : ce que les deux poètes ont envoyé aux
fU> %^'fj^ ^fj^UJf tgîA? JjJf
vizirs, est une lettre
Dans le premier exemple, le conjonctif est au duel masculin,
parce qu'il se rapporte au nom yfjcuJf les deux poètes ; et le pro-
ce sont
cas :
ceux
les deux
*
.
nom
renfermé dans le verbe UAJ e%t aussi
qu'il
concorde
avec
le
conjonctif qÎoJUJ
au
duel
^es
masculin^parce
(deux) qui.
Ce pro
quoique non exprimé, est virtuellement au nominatif,
puisqu'il est l'agent du verbe UÛ ; et effectivement si l'on se
fût exprimé simplement en disant les deux poètes ont apporté une
lettre aux vizirs !ô\J»j *\j'j^\ ^fjçuuf UÏJ, le mot les deux poètes
nom,
,
"
auroit été
au
r*
-
nominatif
Dans le second
culin,
,
-"O
comme
exemple
,
met
-;
le
C
sujet.
conjonctif
qu'il se rapporte aux vizirs
affixe l& concorde en genre et
parce
est
au
»J33y'
pluriel
mas
', le pronom
nombre avec ie
personnel
conjonctif; et il est à l'accusatif, comme, dans l'expression simple,
le mot les vizirs qu'il représente seroit à l'accusatif »\j)J\
Enfin dans ïe troisième exemple h? conjonctif est au sin
gulier féminin, parce qu'il se rapporte à une lettre *Jllj; le
pronom personnel affixe U concorde en genre et en nombre
avec ïe conjonctif; et il est à l'accusatif, comme, dans l'expresn
sion simple, le mot une lettre qu'il représente seroit effectivement
à l'accusatif, *JL^
Observez néanmoins que si le nom auquel se rapporte le
conjonctif est un pluriel irrégulier le conjonctif et le pronom
en
,
,
,
.
,
.
DE
LA
285
SYNTAXE.
pemint être mis au singulier féminin ( n.° 368).
Si le mot sur lequel on fait tomber l'affirmation éner
personnel
4p4«
gique
,
n'étoit , dans
ciel de temps
il faudroit
ou
l'expression simple qu'un
terme
,
de lieu mis à l'accusatif
dans la formule
sous
circonstan
forme adverbiale ,
énergique l'exprimer sous forme
Ainsi au lieu de dire
de complément avec ïa préposition j
le
du
L-àiU-\ £—î oto j'ai jeûné jour
vendredi, il faudroit dire
*£^f fjj juJo-iU <jix-lf celui LEQUEL j'ai jeûné DANS LUI
est le jour du vendredi.
4*)*)' ^» c*ans ï'exPressi°n «impie, c'étoit un terme cir
constanciel de motif, d'intention mis pareillement à l'accusatif
il faudroit dans la formule énergique
sous forme adverbiale
l'exprimer sous forme de complément avec la préposition J.
,
,
.
,
,
,
,
Au lieu de dire csUs
iS&j o«Xa. je
il faudroit dire cîLs
iZlj
,
suis
*_J ola.
venu
c$<>
ff
—
(par) l'envie de te
CE
QUE
je
suis
voir ,
venu
(c'est-à-dire, ce pourquoi je suis venu) est l'envie de te
voir (a). Cet exemplefait voir que quand le nom n'exprime pas un
féminin réel le conjonctif et le pronom qui précèdent ce nom
auquel ils se rapportent peuvent être mis au masculin ; la raison
POUR LUI
,
,
,
que le véritable antécédent est ici le
sous-entendu.
en est
4o6.
dans la
II y
encore
une
proposition simple
(a) La raison
on
a
de cela
,
substitue les pronoms
dit
aux
un
,
nom
*^ilf
la chose,
observation essentielle à faire. Si
que l'on convertit
commentateur
noms,
il faut
de
en
cette
,
formule
VAlfiwa c'«*t que, quand
l'expression à sa forme
,
ramener
primitive, parce que les pronoms n'ont pas la même force que
qu'on ne peut pas leur donner toute la signification qu'on peut
donner au nom ; c'est-à-dire qu'en employant les noms on peut se permettre
des ellipses de prépositions, qui ne peuvent avoir lieu quand on emploie
les pronoms. (Mss. Ar. de S. G. n.° 465, f. 19a recto.)
naturelle
et
les
,
noms
et
,
286
DE
conjonctive énergique
il
,
SYNTAXE.
LA
n'y
si la
l'attribut, c'est-à-dire,
point de verbe qui lie le sujet à
proposition simple est nominale,
a
'
ooj Zéid (est) ton père , IjIs jj^ Amrou
il faut nécessairement employer ïe conjonctif <joJ\ ,
comme
djjf
(est) debout,
et
exprimer
le pronom personnel qui se rapporte au conjonctif.
Dans ces propositions, le sujet ou l'attribut peuvent devenir
proposition conjonctive énergique. Si l'on veut
faire tomber l'affirmation énergique sur l'attribut on dira celui
qui est son père, c'est Zéid; celui qui se tient debout c'est Amrou
uô) <jj>\ 'J> <_ejjf et jjé f?ls y> (jôJ\ : mais si l'on veut ïa faire
l'attribut d'une
,
,
,
'
tomber
sur
le
sujet,
on
dira, celui qui est Zéid c'est ton père; celui
,
qui est Amrou, se fient debout <djs\
Sjj j* cJ^'
et
*/U" jf& y>
^ jjf
,
exemples, y> est le pronom qui se rapporte au conjonctif tijJf et qui représente le nom sous-entendu J^jJf
l'homme : ce nom est le véritable antécédent auquel le conjonc
Dans
ces
,
tif se rapporte.
497* Si la proposition
simple que l'on convertit en une for
conjonctive énergique, est composée d'un verbe et d'un
agent, c'est-à-dire, est une proposition verbale, on peutemployer,
pour conjonctif, l'adjectif ^ix—ff ou l'article déterminatif Jf fai
sant fonction de conjonctif
(n.° 703 //' p.).
Dans ces
le sujet du verbe ou son complément
propositions
peuvent devenir l'attribut d'une proposition conjonctive éner-1
gique; il faut seulement pour employer le conjonctif Jf que
l'on puisse substituer au verbe un adjectif verbal actif ou passif.
Ainsi, au n'eu de J-^)\ àof Jj Dieu garantit l'homme brave, on
peut dire wf JLkJI jjjjf celui qui garantit l'homme brave, c'est Dieu,
mule
,
,
,
et\JJa^f«»f *$^\
On
pourroit,
nom.
dans
,
celui que Dieu
cette
dernière
garantit,
formule,
c'est l'homme brave.
faire
l'ellipse du pro
DE
LA
287
SYNTAXE.
Remarquez encore que si dans cette fonnuïe prove
nant d'une proposition verbale, le conjonctif Jf se rapporte à la
même personne que le pronom personnel il ne faut pas expri
le pronom se rapporte à autre
mer le pronom. Sï, au contraire
chose il faut l'exprimer.
Supposons que l'expression simple soit, j'ai apporté une lettre
de la part des deux Zéids aux Alusulmans <if ^jJôJJJf ^» &JX?
«JU> ^J^i\ on en pourra former ces quatre formules conjonc
4^8.
,
,
,
,
,
tives
énergiques :
Celui
qui
Musulmans
Les deux
aux
a
,
apporté
une
lettre de la part des deux Zéids
de la part desquelles j'ai
sont les deux Zéids.
(personnes)
Musulmans
,
ce
Qi(>jjJf ILfL)j çj^U^tf ^f t^L
Ceux auxquels j'ai
et sont
aux
c'est moi.
apporté une lettre de
Uf
apporté une
lettre
>I^Ltf
la part des deux Zéids,
les Musulmans.
M^«lif «ju»j "fCJ] ^osi}jf [j;
«f >L*-U
La chose que j'ai apportée de la part des deux Zéids
mans, est une lettre.
ïiUj ^IXX\ J,\ ^t>Jjif [y*
Uf
aux
Musul
Igàillif
premier exemple on n'a pas dit 'J> ^Uf ; mais on
supprimé le pronom parce qu'il se rapporte au même sujet
que le conjonctif.
La raison en est que si l'on eût employé le verbe au lieu
de l'adjectif verbal et (jôîf au lieu de Jf, le pronom auroit
été dans la première formule sous-entendu, ou, comme disent les
Dans le
,
a
,
,
Arabes
renfermé dans le verbe ,
que dans les trois autres il
auroit été distinct du verbe. On eût dit dans cette supposition :
,
et
^88
DE
Dans le
i
.?r
ex.
SYNTAXE.
^Ui ^jJf
£
lieu de
au
fcif
£
\&*Ï>Û ^\'J\
L_&.
d^If
^«pf
kJJJ
LU
Dans ïe z.e
ex.
Dans ïe 3.e
ex.
p
Dans le 4-'
ex.
U
Dans
LA
îfc
£iUJ
l
jjf
l'exemple précédent,
le
conjonctif
g£|f
j
l'adjectif
représentent un verbe à la première personne; on observe*
roit les mêmes
règles s'ils représentoient un verbe à la troisième
si l'on vouloit changer cette proposition
personne. Ainsi
***J^ C*y° t>jj 7-éid a frappé sa servante en une proposition
conjonctive énergique il faudroit dire y> IJo^U. cjJjUlJJ <*JC
Zéid, celui qui a frappé sa servante, c'est lui c'est-à-dire, celui qui
nom
et
verbal
,
,
,
,
,
frappé servante c'est Zéid, si l'on vouloit faire tomber l'affir
énergique sur lé sujet du verbe CSf* ; si, au contraire,
on vouloit faire tomber cette affirmation sur le
complément
du verbe qui est la servante, il faudroit dire
~J> l^jUJf jjj
a
celle
c'est
sa
Zéid,
servante,
qu'il frappée
c'est-à-dire,
joJ^U
celle que Zéid a frappée c'est sa servante (a).
Dans la première forme on ne djt pas
y> iojU. y, ojllJf cuj ;
mais on supprime le pronom personnel qui devroit se
reporter
a
sa
,
mation
,
,
,
sur
le
conjonctif,
porteraient
parce que
ce
pronom
et
le
conjonctif se rap
à la même personne.
(a) II faut se souvenir que la proposition £jo»Lâ. <Vv^ ^rfj cst une
proposition composée ou à deuxfaets { n.p 1 48 ) et que relativement à l'inver
sion dont il s'agit ici
on ne considère
que les deux mot? *jçï jU. ùj^r
,
,
,
qui forment une proposition verbale, dont Je sujet est Je pronom '£ il, caché
dans la forme du ve*be
CSf*> Aussi, malgré l'invergiojj énergique dont il
le
mot
reste
s'agit,
toujours à sa place, comme inchoatif pfjix» d'une
&Jj
proposition composée, dont la proposition conjonctive 'J, iïSXsi <^)jLlff
quoique renfermant elle-même un sujet et un attribut, ne forme cependant
•
,
que
l'attribuç.
Dans
DE
Dans la deuxième
forme,
exprime ïe pronom y> qui se
conjonctif Jf qui est pour jJI
on
rapporte à Zeïd, parce que le
se rapporte à ïa servante.
Je n'entrerai
^8p
SYNTAXE.
LA
,
,
plus grands détails sur cette ma
tière, ni sur les circonstances qui permettent ou interdisent
l'usage de ces formules conjonctives énergiques. Ce que j'en ai
dit suffit pour en faire bien concevoir l'analyse.
4oO. Les noms conjonctifs ^* celui qui, celui que, et U ce qui
en ce
ce
qu'ils ren
que, diffèrent de l'adjectif conjonctif <jô)\
point
dans de
,
,
ferment toujours la valeur d'un antécédent, celui,
chose, et celle du conjonctif qui ou que.
ce,
l'homme, la
n'emploie proprement le conjonctif ^ qu'en parlant
des êtres raisonnables, et le conjonctif U, qu'en parlant des êtres
sans raison. Quelquefois cependant
[y» s'applique à des êtres
sans raison, par une sorte de trope qui les assimile à des êtres
raisonnables ou parce qu'on comprend sous une même expres
fOO. On
,
,
sion des êtres raisonnables
des êtres
et
sans
conjonctif U s'applique parfois
Exemples:
ïe
motif,
nables.
Ceux
qui
sont
dans le ciel
(j* (j^C- q-o À\*j £Àiu ^jd, (jjïtf.
Z)/ik
a
formé
tous
ÂÀ^
#U
q*
les animaux de l'eau
qui marchent sur leur ventre ; d'autres qui
et d'autres
qui vont a quatre pattes.
jiyJ f Jf_
Ce
qui
JO I
nables ,
est
dans le ciel
Uj ofjojf J^
et ce
qui
à des êtres raison
la terre, adorent Dieu.
et sur
qa
raison. Parle même
U
:
JÙ 1 3
il y
JET ji—Jlà.
en
a
AMI
parmi
eux
marchent à deux pieds,
tvsû À»
est sur
la terre, adore Dieu.
employer U en parlant des êtres raison
lorsque l'on veut indiquer une certaine classe de ces êtres
.
On peut aussi
//.' PARTIE.
T
,
DE
2pO
distinguée des
autres
SYNTAXE.
LA
par
considération relative à la
une
à la
qualité
J5J& *UIif [$* 'JCi tl>l£ U
quantité. Exemple
fj^pû*
ce
bon
semblera
de
vous
que
femmes, une
&Ujj ô^Jj épousez
couple, ou trois, ou quatre.
?02. Les noms conjonctif^ [^ et Lô ne sont susceptibles
ou
:
d'aucune variation de genre
masculins et singulier?.
,
de nombre
,
ni de
cas ;
ils
sont
cependant avoir égard pour leur concordance avec
les autres parties du discours au genre et au nombre du nom
qu'ils représentent. C'est alors une concordance logique. Mais
la concordance grammaticale est la plus usitée.Voici des
exemples
On peut
,
,
de Fune
de l'autre
et
:
Parmi eux, il y
Celles d'entre
son
vous
en
(ô femmes) qui
Il y
en a
,
J rt
parmi
.
•
„
Dis-moi
O
loup,
tu es
ne
point
me
porté a
tromper,
lui.
soumettent
à Dieu
et
à
J'ai donné ailleurs
le
nom
JO3.
nous
perfidie ;
t'obéissent.
J[Ji»
étoit
nous serons
*Je
ta
mère.
néanmoins , si
ensemble
comme
tu me
promets
deux hommes
amis.
sont
avec
la
quelle
,
qui
eux
cîUf «Ix-Jlr^Ô
qui
se
en
prophète.
Teï.
de
croient
qui
a
conjonctif U
II faut
avons
exemple d'une concordance logique
(n.° 332).
appliquer aux noms conjonctifs [^ et U ce que
de la signification et de l'emploi de l'adjectif
un
dit
,
DE
SYNTAXE.
LA
2p
I
conjonctif ^^ et de la nécessité de placer dans la proposi
tion conjonctive un pronom personnel qui rappelle ïa valeur
du conjonctif ( n.os 488 et suiv.) ainsi que des exceptions aux
,
,
quelles cette règle
Les
^o4la
est
mots
sujette.
^î
et
conjonction (jf si.
Je ne répéterai point
U
expriment
souvent
l'équivalent
de
j'ai dit ailleurs de l'influence
de ly> et de U sur les verbes quand ces deux noms expriment
la valeur d'une condition ( n.° 51).
ÇOJ. Les mots [f» et U" servent encore à interroger (n.° 704,
t.re p.) ; et dans ce cas ils peuvent aussi observer, avec ïes verbes
auxquels ils servent de sujet, la concordance logique ou la
concordance grammaticale (n.° 502).
ici
ce
que
,
J'ai dit ailleurs que ^i devient quelquefois déclinable
les nombres , les genres et les cas (n.°</f)6, i.rt p.)
506.
et
prend
tous
,
:
cela n'a lieu que dans une seule circonstance ; c'est lorsqu'une per
sonne ayant fait , dans ie discours , mention de quelqu'un , non
pas par son
indéterminé
gnée
par
,
on
ce nom
et
propre , mais en
veut s'informer
employant un /nom appellatif
quelle est la personne dési
Alors
on
emploie le mot ^i, c'estappellatif.
lui donnant le même genre, le même
le même cas que la personne qui parle a donné au
à-dire, qui
nombre
nom
est-ce!
en
appellatif dont elle s'est servie.
Ainsi si quelqu'un dit f)Lj <>sU. un homme est venu me trou
ver, on lui demandera jU quel est cet homme! S'il dit "&Lj oJfô
j'ai tué un homme, on lui demandera Ui quel homme!
nom
-
,
Pour faire usage de cette forme, il faut ne rien ajouter de
plus après le mot ^ : car si l'on disoit , quel homme as-tu tué! ou
[y* ne devroit plus être décliné, et il
faudroit dire simplement ôJfâ' ^ et &* ^» ly>
On trouve cependant quelquefois ^i décliné de la sorte,
quel homme,
Monsieur!
-
T2
DE
2^2
le
SYNTAXE.
des circonstances
qui déterminent régulière»,
ment l'usage de cette forme. Exemple : 'Kif £)jU oJis j^U
Çi'f
U^fë \£f oJl* ^4\ tyU* ils se sont approchés de mon feu hospitalier.
Je leur ai dit: Qui êtes-vous! Nous sommes les génies, m'ont-ils
répondu. Que les génies leur ai-je dit, soient aveuglés et plongés
sans
'
LA
concours
,
dans les ténèbres.
%OJ. Quelques Arabes
nommé
un
homme par
son
j 'ai passé près de Ze'id, on
Ifi
indéclinable
est
que lui
t>ÔJ çfcslÂ.
;
Ze'id
mais
est venu me
manière de
s'exprimer
quel est ce Zéid! En ce cas
lui demande
on
donne
donné celui que l'on
a
une
lorsque la personne qui parle ayant
nom
propre , ayant dit , par exemple,
semblable à celle-ci ,
assez
admettent
trouver,
au nom
Zéid le même
Selon
,
cas
qu'il dit,
interroge.
bien lo^J oj|3 j'eii vu Zéid,
a
ou
ùîji ^jj* ïai pa^é près de Ze'id; on lui dira en finoj} q* ou fuûj o* ou enfin oôj ^ quel est ce
terrogeant
Zéid (a) !
L'usage le plus général cependant parmi les Arabes, en ce
ou
enfin
,
(a) II faut observer que l'on ne doit point dans tous ces cas faire entendre
voyelle nasale, parce qu'il y a pause {^-31 (n.os 71 et 696, i.re p.).
Quelques grammairiens Arabes poussent plus loin l'usage de cette conformité
entre la question et le nom qui a donné lieu à cette
question conformité qu'on
désigne par le mot jylSG. ; et ils permettent de dire joj *»Xb ^ quel page
,
,
la
,
,
de Zeïd!
«Jufl
f^F {$*
quel
Amrou
et son
fils!
\*f£\ jJj
lîlè \j» quel page
^Jj o^\ q* quel Zeïd, fils d'Amrou ! interro
dit
personne, qui
geant
jôj f ^ ^>^ J'a* ^ Ie Paëe ^e %éid,
fils, fl£j t^J f^s o4ji> j'ai frappe
i-Ajfj f^P oJ.fj/^' Amrou
le page de Zeïd et Amrou,
^Jf ^ jjijj OjJ* /<"' passé près de Zéid, fils
de Zeîd
et
(quel) Amrou '. *j^
une
a
en
,
et son
vu
d'Amrou.
Voyej\z Man. Ar. de S.C
n.°
465, fol.
199
et a 00.
DE
cas
,
est
de dire
j^j [f*
attribut d'une
comme
J08.
gatif et
Jjf,
avec
COO. II
nom
au
proposition nominale dont \y»
aussi
2pJ
nominatif,
est
le
sujet.
intesro*.
comme
ïa valeur conditionnelle , ainsi que [y et U
décline régulièrement avec toute la variété des
.
se
des genres
l'on décline ^i ( n.°
et
des cas, dans les mêmes circonstances où
506 )
dit
seule
différence, qu'il
plus après ls\. Si donc
avec cette
,
n'est pas nécessaire de rien
demander
toujours o^
mettant
,
conjonctif, s'emploie
nombres,
quelqu'un
SYNTAXE.
LA
ajouter
^ *^£ j'ai
vtt
de
deux hommes ,
(jre-^ ^ OS^t quels deux hommes,
's ?
mon
on
peut lui
ami!
'
?IO. Hors
ce
cas,
indifféremment pour
on
Jjf
n'a ni
ni
duel,
ïes nombres
tous
j^jjli
Je
Amène-moi
quiconque
ceux
qui
s'emploie
pour ïes deux genres .;
«JJf Exemples :
.
uf Jûxaf
me
se sont
!j\à ôJU' ^L ^Sja\
il
pluriel;
et
peut cependant dire pour ïe féminin,
tuerai
<
ou
fera
la guerre.
révoltés
toi
contre
moi,
oJli' £>Ij Jt-JjÂi
Apprends-moi quelle (femme)
a
dit cela.
s*
d>\
du nombre des
qui supposent toujours
l'emploie fréquemment sans
complément est sous-entendu (n.°202).
ainsi
12.
Ce
mot,
que les autres conjonctifs, exige après
£
lui un pronom personnel (n.°488), dont néanmoins on fait
fréquemment l'ellipse. Exemples :
5'
'•
est
rapport d'annexion ;
complément, c'est que ïe
un
et
si
noms
on
s
J ««jf^Ê jjjLj t£yCh
Amène-moi celui (d'entre eux) qui est plus excellent.
—
T
?
2C)4
DE
SYNTAXE*
LA
,*x l2*x ,,',
Ji
ju2>jJ
Prends pour toi celui
.
J
Gl ciU j^à-
(d'entre eux)
que
tu
voudras.
p^. II y a une circonstance où le nom l$\ devient toutà-fait indéclinable : c'est lorsqu'il est en rapport d'annexion'
complément exprimé et non sous-entendu et qu'il est
suivi d'une proposition nominale ( n.° 1 44 ) dont ïe sujet est
le pronom personnel qui se rapporte à (j\, mais sous-entendu.
avec un
,
>
La raison
en est
twCc
Ensuite
auront
devient le
sujet
de la proposition. Ex.
:
jjH^yf J* ôJïf'^f ii^J^^ ô*J^ f
retirerons de chacune de
nous
été les
jjf
que
plus
ces
obstinés dans leur révolte
ceux
troupes
qui
le Dieu misé
contre
ricordieux.
jS
•£
j
Ut
-
Si
est
le
tu rencontres
plus
Vous
droit
les
-
enfans
.
..
ils <Jfc
J^lsf'^jf j*
&
ô*a) U
«
bj
de Malec , salue celui d'entre
savez
point qui
plus prochain
à
de
profiter
vos
de
pères
vos
ou
de
vos
eut
,
-
JLâif <jf Je
et
enfans
aura un
biens.
exprimé le pronom personnel ou
complément de ijf, il auroit fallu décliner ce
oJsï jS&°jkJ
J^î J*'(&J<j* et 4î>^ j**(&îU ou
fait
ellipse du
nom, et
dire
bien oà\ uf
-
c^jSf Uf.
de construction peut être assimilée à celle qui
lieu quelquefois dans l'emploi du verbe
penser , et qu'on
Cette
a
qui
excellent.
ne
Si l'on
eux
sorte
^t'
dire laisser
suspens ( n.° 407 )•
appelle &&>' ; qui
Quelques grammairiens déclinent ls\ dans toutes les circonsveut
ce
en
tances.
514. 51
et
*j1
,
étan* joints à ï'affixe U
,
s'emploient
aussi
DE
comme
On dit
LA
SYNTAXE.
2^5
destinées à caractériser le vocatif
particules
donc l^f et U&jf
(n.° 136).
/
.
pour exprimer
des autres choses
distinguer
quelque
de même nature; c'est ce que les grammairiens Arabes appellent
iLkxkf indication Spéciale. En voici des exemples ;
C I
5
.
On
sert
se
chose de
aussi de
spécial qu'on
deux
ces
mots
veut
Ï^UjriJîf Uî>f fît
O
mon
Dieu J
,
pardonne-nous,
spéciale!
à
..-.Vf \-A »- >-1-*<&• lài J*â*
l»yuf
iVbi/j
agissons ainsi
qui
nous
,
sommes
une
troupe
•»•«•
^
nous autres.
ji}lf l£Î tji-jiîl fcl
J'agis
ainsi, moi
en
particulier.
qui suit L^.f et que l'on nomme lJ>yLàîJ\ indiqué
spécialement, doit être mis à l'accusatif. S'il est suivi d'un adjectif
ou d'un
appositif, celui-ci doit être mis au nominatif, commer
attribut d'un sujet sous entendu qui est 'J> (n.° 151).
J 1 6. On peut exprimer la même idée en supprimant L^» f
pourvu que le nom sur lequel tombe la désignation spéciale,
soit déterminé par l'article Jf, ou par un complément déter
miné lui-même par cet article. Exemples :
Le
nom
,
,
Nous autres, Arabes,
nous
les
sommes
plus hospitaliers
d'entre
les hommes.
Nous autres, société des
droits à
nos
prophètes
,
nous
ne
laissons pas
héritiers.
T4
nos
2$6
DE
LA
SYNTAXE.
n'a
lieu
qu'après un pro
soit pluriel, et on
nom de la première personne soit singulier
peut la considérer. comme une sorte de vocatif ou compellatif.
On s'en sert quelquefois après un pronom de ïa seconde
w>f S* c'est de
personne, comme dans cet exemple : Jw^iif jaj
les
toi, de Dieu (veux-je dire), que nous espérons
bienfaits. Si l'on
considéroit Dieu comme vocatif, il auroit fallu direlwf (n.° 1 32).
Cette manière de
s'exprimer
guère
,
Le
J 17.
il
mot
Jf
sert
aussi à
exprimer l'admiration,
toujours pour complément un nom indéterminé.
S'il est précédé d'un nom indéterminé il le qualifie
et
alors
a
,
suit les
de
à la
ma
règles
qu'il
dance des adjectifs avec ïes noms. Exemple : J-a.3 c$î c^j^ tfc^
tu m'as amené un homme; quel homme!
S'il est précédé d'un nom déterminé, il se met à l'accusatif;
comme terme circonstanciel. Exemple :
J^Lj (j\ o^j cpU. Zéid
est venu me trouver; quel homme (c'est que Zéid) !
La raison de cette dernière règle c'est que le mot Jf étant
du nombre des mots qui restent indéterminés, lors même qu'ils
sont en rapport d'annexion avec un complément (n.° 205), ne
peut jamais être en concordance avec un nom détermine.
518. Le nom sur lequel tombe ïe sentiment d'admiration
exprimé par Jf peut être sous-entendu, ou compris virtuellement
nière des
adjectifs
,
c'est-à-dire
concor-
,
,
,
,
dans
un
verbe. Alors
Jf
se met au
même
cas
où l'on auroit du
SlCj Jf J^Cxi!
exprimé. Ex. :
ils, furent vexés ; de quelle vexation! Jf est à l'accusatif, parce
StXlj Jf HjIxj \y^*j\ ils furent
que l'expression pleine seroit
mettre ce nom,
s'il eût été
«
*
vexés d'une vexation;
quelle
—
vexation!
DE
LA
SYNTAXE.
CHAPITRE
zp7
XXVIII.
des Pronoms.
Syntaxe
plus d'une fois occasion de mettre sous
les yeux les principales règles de syntaxe qui concernent les pro
soit en indiquant l'usage des pronoms isolés qui repré
noms
sentent le nominatif (n.° 802, //'
p.) des pronoms afïîxes
(n.os 8o4 et 806, //' p.) et des pronoms isolés qui représentent
l'accusatif ( n.° 813, //' p.) ; soit en traitant de l'usage des pro
noms affixes avec les
particules indéclinables (n.os 894 et suiv.),
et des pronoms servant de complément aux adjectifs verbaux
(n.os 156, 157 et 158). J'ajouterai encore ici quelques obser
vations qui auront pour principal objet d'indiquer ïes circons
tances où l'on doit
emplqyer, au lieu des affixes, les pronoms
isolés qui représentent l'accusatif.
^20. Mais auparavant je dois remarquer qu'en général, toutes
les fois que l'on veut donner de l'énergie à un pronom exprimé
sous la forme d'affixe
en ïe
répétant ce qui appartient au
genre d'appositif nommé corroboratif o^=>p ( n.° 391), on
doit faire usage des pronoms isolés qui représentent le nomtT
natif; cela a lieu également soit que le pronom affixe repré
sente ïe
génitif ou l'accusatif (a). Exemples :
^IO.
J'ai
déjà
eu
,
,
,
,
,
,
(a)
Ebn-Malec donne
J
—
ce
précepte
.«J'f rfjfo J$**-* <>-%=> fj-éi^f OJ
Tout pronom isolé
(Mss.
très-positivement
nominatif
Ar. de la Bibl.
imp.
dans
,
fol.
22
Alfiyya
:
i5ù$\ £7-^^ y—t'^-y
doit, servir à corroborer
n.° 1291
son
verso.)
tout
pronom
affixe.
2p8
DE
VU cAk
tëJjj
Si
tu
yois
me
SYNTAXE.
LA
moi, moins
,
JJ>'f-
Uf
^ Q
que toi
favorisé
en
richesses
et en
enfans.
Qu'est-ce qui
A qui
Tu
empêchés,
vous a
est-ce ce
livre!
a
l'enverras, lui
<£j
vous
nous
et ses
Uf
Car je suis, moi,
,
deux, de cela!
nous autres.
partisans.
$\0
ton
seigneur.
çfcCnt l3ÎJL<fe)f
Malheur h moi, moi , pauvre misérable
(a) !
personnels isolés qui représentent le no
minatif, ne sont employés avec les verbes que pour corroborer
l'expression. Exemple : l "j\ ola» o^a. <jf si tu viens, je vien^21.
Les pronoms
—
drai , moi. Ils doivent concorder
nombre
et en
Le verbe
être
en
personne ^
au
pluriel,
et
avoir pour
de diverses personnes,
plusieurs
pronoms singuliers
l'ai dit ailleurs (n.° 335).
du
ïe verbe
en
genre.
cependant peut
<2 2. II y
avec
sujet
je
comme
où le verbe doit être à la troisième personne
quoique le sujet soit un pronom de ïa première
a un cas
singulier,
(a) Cet exemple est tiré de la seconde des
après lui Golius ont écrit {j<XLltf ; mais
concorder avec l' affixe du mot A
,
.
fables de Lokman.
c'est
une
faute
:
Erpénius,
ce
mot
et
doit
DE
SYNTAXE.
LA
de la deuxième personne , soit du
nombre : c'est lorsque le pronom qui
ou
2pp
singulier
exprime
,
le
treint par la
est
une
particule L>f, qui, comme on l'a
particule de restriction. Exemples :
//
C'est moi
qui fournis
de leurs droits; il
'puissions
sujet
autre
est res
dit ailleurs
(a),
*
r
s'est levé que moi.
f
ne
tjLjf Uf *M«oJ qs. çjfj^
seur
soit d'un
U" \j
_;UXff j»l^f o4fJlf
à leur subsistance ,
n'y
a
repousser les attaques
que
moi
faites
ou
et
qui
mes
U
suis le
défen
semblables
qui
h leur honneur.
l'usage des pronoms isolés com
523.
posés de Uf et des affixes qui représentent l'accusatif.
La règle générale est que l'on ne doit jamais avoir recours à
ces
pronoms isolés quand on peut employer les affixes ; et si
l'on prend quelquefois une licence contraire à cette règle, ce
n'est qu'en poésie pour ïa mesure.
^24. Les causes qui autorisent l'emploi des pronoms isolés
au lieu des affixes sont
comme je l'ai dèjh dit
( n.° 813,
/
p.), 1° l'inversion qui place le pronom qui doit servir de
complément avant son antécédent; 2.0 l'ellipse de l'antécé
dent; 3.0 la rencontre de deux pronoms qui servent tous deux
de complémens à un même antécédent. Ce dernier cas exige
quelques déveïoppemens.
525" Pour l'intelligence de ce que nous avons à dire ici il
Je viens maintenant à
,
,
,
,
"
,
faut d'abord savoir que les pronoms des différentes personnes
observent entre eux une sorte de gradation ou de rang , qui les
approche plus
grammairiens
(a) Voyer,
moins de la personne qui
Arabes expriment par le mot
ou
les Additions à la
première partie.
parle
; ce
que les
JiaiU plus spécial.
DE
3OO
LA
SYNTAXE.
Le pronom de la première personne a ïa préférence sur tous ïes
autres , et ïe pronom de la seconde
personne a la préférence!
sur
celui de la troisième.
J 26.
De là il résulte que
pour que l'on
,
sieurs pronoms affixes à un même verbe,
d'action , ou adjectif verbal ( les seuls mots
complémens )
,
il faut que
puisse
attacher
à
même
ou
un
plu
nom
susceptibles de deux
pronoms puissent être disposés sui
ces
leurs rangs respectifs. II faut aussi que les deux pronoms
soient pas de la même personne. Cependant, s'ils sont tous
deux de la troisième personne , pourvu qu'ils diffèrent entre eux
vant
ne
de nombre
affixes à
un
de genre , on peut les
seul antécédent.
ou
joindre
tous
deux
comme
règles, on ne peut pas dire ci^ulîcf
je t'ai donné a lui, jXl^à^sl je t'ai fait me prendre; il faut dire
cîllJf «jc^lîcf et Juf d£âJà\, en employant les pronoms isolés,
On ne peut pas dire non plus cslCjuxk j'ai cru que tu étois
toi-même, J-sxiaÂià tu as cru que j'étois moi, Utgslk j'ai cru
JÇjf jsi&kquelle étoit elle ; iï faudra dire <JQ<Aj5&
les
avec
isolés.
Ul^rigioLU
pronoms
Mais on pourra dire, en joignant deux affixes à un même
antécédent, l^oJLC demande-moi la, 'ACxÂJicf je te les ai donnés,
»j*Joûiu,f je vous l'ai fait boire "^Jé$*&\ je les leur ai fait
manger, UU*^u,f je la leur ai fait boire à eux deux.
La même chose doit s'observer avec les adjectifs verbaux
(n.° 249) et avec les noms d'action. Exemples:
En
conséquence
de
ces
-
,
■*
.*
,
J'ai
vu
Prince, de qui
avec
plaisir
que
daigne le ciel
tu
lui
as
fait
un
don.
écarter toute malédiction,
ne
conçois
DE
le désir de
point
ce
que
tu
posséder
t'en empares
Avec les
de
J iy.
complément,
,
ne
LA
SYNTAXE.
cette
beauté
seroit-ce pas
:
car
une
301
des obstacles à
mettre
chose
impossible!
adjectifs verbaux, ïe pronom affixe qui leur sert
ou le
premier des affixes, lorsqu'il y en a
deux, peut être considéré
comme
génitif,
accusatif
ou comme
(n.°248).
528.
Avec les
quand il y
génitif, soit
d'un verbe
en
noms
d'action, Paffixe
deux, doit toujours
a
ou
le
premier affixe,
être considéré
comme
qu'il exprime le sujet du verbe ou le complément
transitif, ou le premier complément d'un verbe dou
,
blement transitif.
^20. Lorsqu'il y a deux pronoms affixes pour complément
adjectif verbal ou d'un même nom d'action le second
d'un même
doit
,
toujours
être considéré
Dans les
comme un
où l'on peut
accusatif.
ïes deux pronoms
affixes à un même antécédent, on peut aussi employer, au lieu
du second affixe, les pronoms isolés composés du mot Lil Avec
C30,.
cas
joindre
.
les
verbes,
il
plus élégant d'employer
est
les deux
affixes;
avec
adjectifs verbaux et les noms d'action il vaut mieux détacher
complément.
^31. Quand les pronoms servent d'attribut au verbe ^
être et aux autres verbes qui ont comme lui la signification du
verbe abstrait, et qui sont- sujets aux mêmes règles de syn
taxe, iïs sont nécessairement mis à l'accusatif (n.° 86). Dans ce
cas, l'on doit employer, de préférence, les affixes. Exemples :
les
,
le second
«JvàX-9
Pour
ce
qui
est
du
(VjJuJaJ!
juste,
Uf
c'est moi
qui
le suis.
*
Si c'est lui,
pas lui,
tu ne
tu
n'auras
point l'avantage
gagneras rien à le tuer.
sur
lui;
et
si
ce
n'est
DE
302
C'est ainsi que l'on dit
SYNTAXE.
LA
J^Ul ou ^JJ ce n'est pas
moi
(n.° 897,
emploie quelquefois dans ce cas en poésie ïes pro
au lieu des affixes ; mais c'est
noms isolés composés de LS f
une licence
qu'il ne faut pas imiter dans la prose, si ce n'est
quand le verbe négatif J*3 est Pris dans le sens de excepté.
Exemple: dLifJJJ à,p\ ils sont venus me trouver excepté toi.
On
,
,
,
,
tàiy ôyO.
Qn peut dire dans le même sens,
dernier cas, on fait usage des affixes , c'est
fjZJ *fjXl)f
cepté
*yÏJ v^i
if
lorsque
une
^-
Si,
licence.
les hommes s'en
sont
dans
ce
Exemple ;
allés,
ex
moi.
La même chose doit s'observer
avec
Vf,
sinon
du nombre de
,,
excepté.
qui ont
pour
532. Lorsqu'un verbe,
de
deux
est
suivi
1
1
4)
complément un sujet et un attribut ( n.°
dont
l'un
fait
de
fonction
sujet et l'autre d'attribut,
pronoms
on
peut joindre les deux complémens à l'antécédent sous forme
de pronoms affixes ou en détacher celui qui fait fonction d'attri
ceux
,
,
étois lui,
«ul csUÇ*^» j'ai
que tu
êtois cela. II n'est fias besoin d'observer que,
but. On peut donc dire
tS^L^.
ou
cru
que tu
dont
pour joindre les deux pronoms à l'antécédent , dans le cas
il s'agit, il faut que les conditions exigées ci-dessus (n.° 526) se
ou
'
rencontrent.
occasion, que ïe pronom,
troisième personne singulier masculin s'emploie souvent
^33de la
dans le
ïï fam remarquer, à
de cela,
cette
représentant non pas un nom,
mais une proposition toute entière, ou un adjectif servant d'attri
but. Exemples :
sens
et comme
Ne mangez pas leur bien
très-grave.
avec
le
vôtre,
car cela
est une
faute
DE
LA
SYNTAXE.
.7* n'étois pas sage,
On
346
et
et vous
déjà vu divers exemples
531).
a
de
des
Syntaxe
m'avez
cette
CHAPITRE
303
cru
tel.
signification (n.°5 34 J
»
XXIX.
Propositions qui font fonction
de Termes
circonstanciels d'état.
534*
En traitant de
j'ai parlé des termes
qui forment des
j*r*-t
expressions adverbiales et qui exigent l'emploi de l'accusatif
(n.os 1 1 1 et suiv.). II est inutile de revenir sur cet objet.
Mais je dois observer ici que la valeur d'un terme circons
tanciel d'état peut être exprimée par une proposition soit ver
bale soit nominale de même que l'on peut employer au lieu
d'un adjectif, une proposition que j'ai nommée, à cause de cela,
adjective ou qualificative (n.° 362). On peut appeler celle dont il
s'agit ici, proposition circonstancielle d'état; ce que les grammairiens
Arabes expriment par la dénomination de 4!^- *&
J35* ^es propositions de ce genre peuvent être verbales ou
nominales et n'ont rien de particulier dans leur syntaxe si ce
circonstanciels d'état
l'emploi
des cas,
de situation
ou
,
,
,
,
,
•
,
,
n'est par rapport à la manière dont on indique leur connexion
le nom de la chose ou de la personne dont elles déter
avec
minent la situation.
536. Cette connexion s'indique
la
proposition
nombre
tancielle
avec
,
ou
circonstancielle
le
,
ou
qui
lequel tombe cette proposition circons
conjonction j ou par ces deux caractères
,
et
nom sur
par la
par un pronom placé dans
concorde en genre et en
,
3o4
DE
LA
SYNTAXE.
circonstancielle
réunis. Souvent ,
quand
bale
devant le verbe l'adverbe ôà
,
ajoute
on
la
proposition
.
est ver
Quelquefois
manquent, le pronom étant
,
cependant,
signes
:
Exemple f\û^ JaÀs ji> ojj* j'ai passé près de froment,
tous ces
sous-*
entendu.
un
boisseau pour
oJaàs un boisseau
pièce d'argent.
une
pièce d'argent: J^
de
lui, c'est-à-dire, dont
boisseau,
un
ici pour
est
boisseau valoit
un
une
357. Quoique l'on puisse en général indiquer la connexion
de la proposition circonstancielle d'état avec le nom de la per
,
,
de la chose dont elle détermine la situation
sonne ou
par
,
un
pronom seulement , ou par la seule conjonction j , ou par ces
deux signes réunis , il y a cependant certains cas où l'usage de
l'un de
ces
moyens
lue nécessité.
J3 8. Quand
affirmative
exclusivement à
proposition
,
circonstancielle d'état
circonstanciel que par le pronom
conjonction
j
.
Exemples
Zéid
*,.
«Jt\J
est. venu,
Dans le
jonction
^4°«
.
verbale,
,.,
est venu en
sans
riant.
•"i--îî°,,i'J
^/vj UJU4I iUU
premier exemple,
est
On diroit,
Si la
seulement,
i*
-
•'•
-
JJ-P ftS*
des chevaux de main étant conduits devant lui.
Si le verbe
j
est
:
ïe pronom
est
verbe osUâJ ; dans le second, c'est f affixe du
539*
d'une abso
est
,
que le verbe est à l'aoriste sans être précédé de
elle ne doit être liée avec la proposition dont elle
,
est un terme
Amrou
tout autre
et
l'adverbe âS
la
ïa
,
précédé
en ce cas
de
,
Ôi
csUsû
,
on
renfermé dans le
mot
doit
JjJ
mettre
o£j et ooU^f
.
la
3 lia*
con
Jàj.
proposition circonstancielle d'état étant verbale,
et
DE
et le
verbe
suivi de
diquer
jf
au
ou
prétérit
n*
ce
,
bien, il faut
la connexion.
/ft/r v«w/£ /w/;»
verbe
se
h
est
de
Vf
sinon ,
ou
du pronom pour in
:
ty fr" y[ i)jtj
d'envoyé de
305
précédé
contenter
Exemples
h^Sè^i.
//
SYNTAXE.
LA
oz
l*
"jfeé'Vi
Dieu dont ils
ne se
moquassent.
îLi y 5vâ>
*^lé -pÀJ" Vj Vjki jf jlâ. {^-^*J JiA^t c)^*
Secours
qu'il ait agi injustement ou justement
envers toi, et ne sois point avare à son
égard, soit qu'il ait usé envers
toi de générosité ou d'une avare parcimonie.
ami , soit
ton
54 Ik
Si la
proposition circonstancielle est une proposition
nominale,
emploie ordinairement la conjonction J avec ou
sans le pronom; quelquefois on se contente du pronom.
Si cependant cette proposition ne faisoit que la fonction d*
corroboratif, c'est-à-dire, si elle n'exprimoit que l'équivalent de
la proposition même à laquelle elle sert de terme circonstanciel,
il faudroit se contenter du pronom pour indiquer la connexion.
Exemple ; *J %L* Y jâd y> cela est la vérité, en quoi il n'y a point
on
d'erreur.
^42.
On seroit
peut-être
tions circonstancielles d*état
tenté de confondre
avec
les
proposi
propositions qualificatives
ces
(n.° 362 ) ; mais, pour les distinguer, il suffit de faire attention
que les propositions qualificatives sont toujours indéterminées ?
et ne
peuvent qualifier que des noms indéterminés, au lieu que
les propositions circonstancielles d'état, quoiqu'indéterminées
,
sont
<i3»ô
en
oôj
riant, o4>
Ainsi l'on dit
rapport avec des noms déterminés.
*^* , comme l'on dit lio^U» d45 «U- *Léid
étant déterminé
circonstanciel oî&J
jectif eUU>
étoit
ou
L£kU> indéterminé
employé
/// PARTIE.
comme
nom
comme
est venu
et
le
e$
terme
propre ,
; tandis que , si l'ad-
qualificatif
,
il faudroit dire ,
V
306
DE
l'article, ciU-LDl ;
v.erbe, il faudroit dire,
avec
S&S lscJI
,
en
L.A
SYNTAXE.
que, si l'on vouloit lui substituer le
sous forme de proposition conjonctive,
et
exprimant l'adjectif conjonctif.
XXX.
CHAPITRE
Syntaxe
543'
des Particules indéclinables,
LES détails dans
mière
lesquels je
traitant des diverses
suis entré, soit dans îa pre
sortes de particules indé
partie,
(chap. VII du liv.II), soit dans cette seconde partie,
quand j'ai exposé ce qui concerne l'usage des temps et des modes,
•et l'emploi des cas, particulièrement celui du génitif (Iiv. III,
chap. V, §. h) et quant! j'ai traité (liv. III, chap. X) des noms
qui ne sont jamais employés hors d'un rapport d'annexion
(n.os 2o4 et suiv.), me dispensent de m'étendre ici sur l'in
fluence grammaticale de ces particules. Je me contenterai donc
de présenter quelques développemëns qui n'ont pas pu trouver
place dans les endroits cités.
en
clinables
,
$. I.cr
1
4:4'
Syntaxe
Les verbes que
Prépositions.
des
j'ai appelés intransitifs,
et
même les
verbes neutres, peuvent être relatifs ; et alors ils s'unissent aux
complémens avec lesquels ils sont en rapport, par des prépo
qui deviennent les exposans
175), et qui modifient souvent
sitions
et
tante
fa
de
ces
d'une manière
du verbe.
signification
fréquemment, cependant, qu'après
;**'îl arrive
sitif de
(n.°5 1 66*
très-impor
rapports
sa
d'exposant
supprime
rapport qui est
nature on
au
la
un
préposition qui
entre le verbe
verbe intran
devroit servir
et son
complet
DE
inent
,
et
on
met
le
545*
l'accusatif ,
à
complément
verbe étoit transitif de
,
comme
si le
sa nature.
Quan(ï Ie verbe intransitif
proposition
3°7
SYNTAXEé
LA
soit verbale , soit
a
nominale,
complément
une
commençant par la
con*
pour
//' p.), on peut toujours
Jonction yf
supprimer la préposition qui devroit lier le verbe intransitif à
son complément. Ainsi Ton peut bien dire cstf > JiiJ
ô^j^^'f
au lieu de oslli Jiiu qT Jl-c j-aJu'L // 77e put pas faire cela;
&y csDf o^* au lieu deuis cfljf^ o4^ 7V m'étonne que tu
ou
qÎ que (n.° 880,
^é
sois menteur ;
je m'étonne qu'il se
Cette
ne
doit
règle
jamais
est
*■>&.
^f o^£
révolte
contre
lieu de
au
moi
(a).
sujette cependant
omettre
la
^.j^T q! ^-« «y^
"J^
à
une
exception
il
préposition quand
On
en
et
,
l'on
peut résul
ne
peut pas dire par exemple
amphibologie.
(21) i J*iu Jjl o4«j pour cA)i J*àj (^I j ^Jijje désire que tu fasses
cela; car s'il y avoit ellipse de la préposition on pourroit
ter une
,
,
,
,
/
|
^
(a)
Les
grammairiens
Arabes
censé être à l'accusatif
mettent en
question si
question
,
dans
cç cas
,
le verbe
n'est pas aussi frivole
Cette
génitif.
paroît au premier abord ; car on trouve quelquefois un nom formant
jin nouveau complément, qui est joint par une conjonction avec la proposition
complémentaire, et par conséquent ce nom doit concorder en cas avec le cas
que la proposition complémentaire représente. Voici un vers qui offre un exemple
de cela, et où le nom est mis au génitif:
est
qu'elle
ou au
le
,-s
Je n'ai point. rendu visite à
J
-„-
Leila,(à cause) que je l'aime,
%
ni
-
.
(à cause) de quelque
dette que j'aie à réclamer d'elle.
préposition sous-entendue est ^.é Je pense que le poëte auroit pu dire
également Uui Dans le premier cas, il y a ellipse totale delà préposition,
son
complément demeurant au génitif, comme on en verra bientôt un exemple
(n.° 547); dans le second, il y a substitution du cas adverbial (n.° 83) à une
préposition et au cas comp^4r^^altai3nB(n.<,. 66)., ccquixi'cst point une ellipse.
•La
.
■
Va
3û3
DE
supposer que ïe
sens
STNTAXE,
LA
seroit <îUi
Jiïi £>l ^ o^*3 je n'ai pas envie
fasses cela:
c4&- Lorsque les verbes intransitifs ©ni simplement pour
complément un nom, on peut aussi supprimer l'exposant du
rapport-, c'est-à-dire la préposition et mettre le complément
à l'accusatif, comme si le verbe étoic transitif. Mais ,à cet égarai,
H y a des verbes avec lesquels cette liberté de changer le com
plément médiat*en un complément immédiat ne souffre aucune
restriction ; il y en a d'autres à -l'égard desquels l'on «e peut en
4iser qu'en, poésie, dans le cas de nécessité.
Ce que nous disons ici des verbes intransitifs, par rapporta
leur complément, s'applique également aux verbes transitifs,
par rapport à ceux de leurs complémens qui ne sont pas immé
diats. Exemples :
que
tu
,
,
«jjx-i pour
*J
ç^jk^i
•Je lui ai rendu
iissJ pour
Jle lui ai donné
t*Lî)f o4^3
*J
un
grâces*
oôsâi
bon avis*
*pJ1 <J[ o^^a
allé en Syrie.
pour
Je suis
*jCï *^J3j ««oUu» IcNjj o-ç pour *jVo «j o>jj *J»Uua> o^jl o^
,/W mesuré à Ze'id son blé, et je lui ai pesé son argent.
»
<j *ii=>lj ô^£ a-rLI JÂjJf .^(jaH v^i o*)l
»/'#/ ^tf// serment de manger toujours les baies de l'Irak,
.
^j^Jf *jjiut
les
qui
cependant
est mon habitation).
(où
ce sont
vers
fc_*U£)f
consomment ces
£jyi3\ if^.
Comme Je renard
court
baies dans le
UT
dans le chemin.
et
villogt
DE
LA
Dans tes deux derniers
des grains,
et
&>jâ.l\
SYNTAXE*
u>â.
exemples,
jj^JiJf
pour
est
$0$
pour Z>â
</dWj /* chemin
J
Ji.
(a).
au
sujet
Ce
sont
des licences
poétiques (n.° i 10, note-).
quelquefois, mais très-rarement, qu'en sup
^47primant k préposition l'on conserve cependant son complé
ment au génitif; c'est alors une véritable ellipse. Exemple :
«jL>Yf t3-£=>yU s>^<^jj^f jcUa9 j_yi ^t^fl Jf <J-<£ )>J quand on
demande quelle est entre les hommes une méchante race les
M arrive
,
,
,
doigts des mains s'étendent d'eux-mêmes pour montrer celle de Cola'ib-.
*+Jf est pour o** Jf
.
i. II. Syntaxe
des
Expressions
ELLIPTIQUES APPELÉES NOMS
adverbiales
VERBES.
DE
j4& J'^i parlé, dans la première partie, des expressions ellip
de verbes, parce que , sous une forme
elles, reaferment réellement la valeur d'un verbe.
tiques appelées
adverbiale
Tels
sont
,
les
noms
mots
o^--*i>
-
yUi
<jt*>-
-
Puisque
.
ces
mots
équivalent à des verbes, ils peuvent avoir un sujet et des com
plémens; il ne s'agit donc que dhppliquer à ces expressions ellip
tiques les règles ordinaires de la syntaxe des verbes, et des noms
qui leur servent de* sujet et de complémens c'est-à-dire', de-mettre
le sujet au nominatif etrles complémens à l'accusatif. On peut en
voir des exemples dans la première partie (n.° 874.).
,
i. III. Observations
«^ai
549-
eu
Conditionnelles
(a) C'est
£jJLjtf
droite.
ainsi
pour
Voyez
souvent
exprimées
qu'on
AJU.!*_tl
sur
la
occasion de
par la
le commentaire
\j-~o J?
s-ur
sttr-.
je leur
VAlfyya,
parier
des
t,
v-
16,
ou
par
cîLUljrf.'Al'ôjJjtf V
'
teitdrai des emlmchts doits
man.
-
propositions
conjonction- Ifj si,
lis- dans PAIcoraT*.
<3jo
Conjonction <J
de S. G. ru?
4/65 ,.foL.<îd
ta
et
voie
.67.
DE
£16
quelqu'un des
mots
LA
SYNTAXE.
qui renferment la
valeur de cette' conjonction,
d'observer que ces propositions sont toujours les antécédens
d'un rapport dont le terme conséquent est une proposition affir
et
mative hypothétique
sur
rapport
(a);
et
j'ai développé l'influence de ce
propositions (n.° 51). J'ai aussi
les verbes des deux
observé que la conjonction <_j se met souvent à la tête de la
proposition affirmative hypothétique, et sert à distinguer les
(n.° 881, //' p., et n.° 5 i,2,'p).
Cet usage de la conjonction ô est assujetti à certaines règles
que je dois développer ici.
55O. Observons d'abord que des deux propositions corré
latives dont il s'agit la première est toujours une proposition
vestale (n.0 i44)> ïa seconde est tantôt verbale, tantôt nomi
nale [ibid.)
Pour* savoir si l'on doit mettre la conjonction o au corn»
ou
si l'on doit
mencement de cette seconde proposition
l'omettre il faut avoir égard aux conditions suivantes.
Ç
I
On omet la conjonction ci lorsque la seconde propo
y
sition est une proposition verbale si le verbe est au prétérit, que
ce soit un verbe
susceptible d'une conjugaison parfaite, et qu'il
ne soit
point précédé de l'adverbe ôi' Exemples :
deux
propositions
corrélatives
,
,
,
.
,
,
;
JU
Si
^_4^ càJS dJUî i£
je fais cela, je perdrai
mon
bien.
(a) Pour obvier à tout mal-entendu j'observe que dans un rapport de ce
l'anté
genre, dans celui-ci, par exemple, si vous faites le bien vous sere^ heureux
cédent logique est vous sere^ heureux; le second terme du rapport est la propo
,
,
,
plutôt vous fertile bien, et la conjonction si est l'exposant:
général par-tout où j'ai parlé de ces propositions corrélatives
eu
n'ai
çgard qu'à leur disposition grammaticale et j'ai appelé antécédent la
je
proposition qui renferme la condition et conséquent celle qui exprime une affir
mation hypothétique.
sition
vous
mais ici
,
faites
et
,
en
ou
,
,
,
,
5
*
Quiconque
SYNTAXE»
LA
DE
\j#
cache
iXt
son
J
I f
iSS> i*+
o-m
secret,
parvient à
But*
son
^52. On l'omet pareillement quand le verbe est à l'aoriste,
pourvu qu'il ne soit point précédé des adverbes J^. Cfy» et
autres semblables (n.° 848
//' p.) si la proposition est affir
si la proposition est négative que la négation
mative ; et
soit exprimée par les adverbes négatifs Sf ou "Jl Exemple :
'Sj-?\fi, 1CLIU |j.^pj £)) s'îls vous vainquent ils vous lapideront.
553* Dans tous ces cas néanmoins on met quelquefois la
conjonction ci au commencement de la seconde pi ©position;
-
,
,
,
,
.
,
,
et
alors
si le verbe
,
indicatif.
Exemples
est
cette
sa
robe
femme
Ceux
qui
a
(la
à l'aoriste
,
il doit être mis
mode
au
:
i^OiN-aS
Si
,
JUS ^
robe de
0x3
Joseph)
*-*e-v«? (J©
est
Q^
fendue
,;
par devant
-
,
alors
dit vrai.
auront
fait
te mal , leurs
visages seront précipités
dans
le feu.
Quiconque croira
mage
ni perte.
en
son
Seigneur,
celui-là
ne
craindra ni dom
\v
Je pense que , dans ces circonstances , il faut supposer une
ellipse. Ainsi, devant le prétérit, on peut supposer i'ellipse de
l'adverbe ÔJs ; et effectivement l'usage de la conjonction ci »
en
ce
passé
de
cas
,
ou
n'est autorisé que quand le prétérit a le sens du
peut du moins être ramené à ce sens par une sorte
,
prosopopée.
Dans le premier exemple, le verbe ^àS*
a
une
signification
V4
passée
nace
de Dieu
On
article
'fëy+j
second, le verbe ^14» exprimant
dans le
;
SYNTAXE.
LA
DE
312
cette menace est
,
assimilée à
une
chose
une
me
passée (a).
d'un
pronom ou d'un
l'ellipse
démonstratif qui rendroit la proposition nominale. Ainsi
c4^* sera ici pour 'f*j*-j c4* ^Xjk et de même
peut aussi
supposer
»
c>lûi s^U
554-
sera
Si,
c^UÉ^Jé* (b).
pour
contraire, la seconde proposition
au
sition nominale si c'est
une
,
demande
,
un vœu
commandement ,
un
,
J$
verbe défectif ,
comme
des adverbes
^ <j£<" Iw»
[J
proposition
-
^
-
,
&c.
verbale
ou
,
propo»
qui exprime une
dont le verbe soit
ou un
&c. soit des
-
est une
verbe
un
précédé soit
négatifs U
adverbes
placer la conjonc
tion ci au commencement de cette proposition. H en est de
même dans les propositions circonstancielles (n.° 1 4-5 ) qui ne
dans le fait que des propositions nominales dans les
sont
quelles il y a une ellipse. Exemples :
ou
,
dans
tous ces cas
il faut nécessairement
,
,
,
^i==>L&L».
Si
qui
vous
LjU
êtes dans le doute
vous avons
ç>AÂjf
au
(j'pSs <jf
Q* <-x?j
sujet de la résurrection i c'est
nous
créés.
Si
vous
aime^ DieuK suive^-mol.
(a) Cette sorte de figure est très-fréquente dans l'AIcoran lorsqu'il est
question des peines de l'enfer ou des récompenses du paradis. Voye^ le conv
memaire d'Aschmouni sur XAlfiyya, (M$s. Ar. de la Bibl. imp. n.° 1234»
,
fol,
lit
(bj
verso).
On peut
affirmative
tionnel
relie
j'ai
encore
JUjiJÎ *fjÂ.
»
et
que la
proposition indépendante
résolu ailleurs
cette
qu'il y a, ellipse totale de 1% proposition
devoit former le second terme du rapport condi
supposer
hypothétique qui
proposition qui
de
ce
rapport
difficulté (ri.° 51 )%
commence
•
•■*
par ^j
est une nou-
-
cjU*<û¥f fXâ
.
C'est ainsi que.
DE
CkxL
Si
vois bien
moins
a
frère qui
un
déjà
a
ij^a^Sâ j)aàj\ *£-*\ O^i
J/
Quiconque
vous
demandes
pardon
pour eux, Dieu
/u
ce
ne
o^
richesses
me
donne
avant
et en
quelque
lui.
<£*
mois ,
d'entre
verra
en
volé
Uf <)>»'
Jsï
seigneur
mon
,
S'il vole, il
que toi
partagé
il pourra bien arriver que
chose de meilleur que ton jardin.
enfans
VU csU.
[y» \££ iàë'}?. Sj JSs foLjjj
tu me
3l3
SYNTAXE.
LA
qu'il
leur
le
jeûne.
pardonnera
pas.
f>.\ I^a 'JZJ!i\J» O *j&)y o^j
Si
vous
tourne^ le
*5Ï
tu
Jï le verbe
dos ,
dis cela,
est
je
tu
joint à
ne vous
es
cette
ai
point
demandé de salaire.
du nombre des incrédules.
particule (cela)
,
est
contraire
a
la
règle primitive.
Dans
est
ce
dernier
exemple,
Jû^f ci^ ci* ^^
»
il y
ams*
a
4ue
ellipse de êtfi, et le sens
Ie l'a* exprimé dans la tra
duction.
quelques exemples où la conjonction ci est
omise contre la règle précédente ; mais ce sont des licences.
la proposition est nominale on peut substituer
})). Quand
l'adverse f if signifiant voici (n.° 276) à la conjonction ci Ex£)Jjii£ *J*Til A^f cImÔJ1 U ï ZI'éC^aj y s'il leur survient quel
On
trouve
,
,
,
,
que adversité à
désespèrent.
cause
du mal
qu'ils
ont
fait auparavant,
•
alors ils
se
j 14
Ç Ç
sur
ti
DE
6*
1-A
syntaxe;
Si Ton fait attention à tout
les circonstances dans
devant la
lesquelles
proposition qui forme
que nous venons de dire
doit placer la conjonction
ce
on
le second
terme
des rapports
conditionnels , et sur celles dans lesquelles on ne doit pas en
faire usage, on en comprendra facilement la raison.
L'influence des rapports conditionnels sur cette seconde pro
position est de mettre le verbe à l'aoriste conditionnel , ou au
du futur. Toutes les fois que cet effet ne peut
pas avoir lieu , soit parce qu'il n'y a point de verbe dans cette pro
position , soit parce que le verbe employé n'a point d'aoriste,
prétérit
avec
soit parce
le
sens
qu'il
est sous
l'influence immédiate de
antécédent soit parce qu'il doit
,
être
pris
dans
quelque
un sens
autre
passé, soit
souhait, on
qu'il exprimé un ordre une défense
conjonction ci pour suppléer à ce signe du rap
port conditionnel et indiquer la dépendance qui est entre les
deux propositions corrélatives.
On doit donc employer la conjonction ci quand la propo
sition est nominale, parce qu'il n'y a point de verbe, ou que le
verbe y est sous l'influence immédiate de son sujet placé' avant
lui; dans les propositions circonstancielles, parce qu'il n'y a point
de verbe; dans les propositions impératives
parce que le verbe
n'est ni au prétérit ni à l'aoriste, ou que, s'il est à ce dernier
temps, il est régi à l'aoriste conditionnel par la particule J.T et
non
par l'effet du rapport conditionnel ; dans les propositions
où le verbe est précédé de oS parce que cet adverbe le
enfin parce
a recours
,
,
un
à la
,
,
,
détermine
au
sens
point exprimé,
passé,
ie verbe
dans celles où il
aussi dans celles où, îw n'étant
cependant la signification passée;
et
a
précédé
des adverbes
Ji ci**» et autres
semblables, parce que ces adverbes n'admettent point après
eux l'aoriste conditionnel ; enfin dans les
propositions négatives
et
U
les
adverbes
^j, parce que ie premier exige
exprimées par
est
-
DE
après
lui le
exige
l'aoriste du mode
prétérit avec
3 15
SYNTAXE.
LA
la
et que le second
signification passée
subjonctif. Si la négation
,
est
exprimée
par les adverbes V et li , il est plus ordinaire de ne point faire
usage de la conjonction , parce que l'on peut, après V mettre
,
que , avec ÏJ ,
non
conditionnel
s'exerce
,
pas , il est vrai sur le verbe
rapport
qui est mis à l'aoriste conditionnel par l'influence immédiate de
cet adverbe négatif, mais sur l'adverbe lui-même , qui , de sa
le verbe à l'aoriste conditionnel
,
l'influence du
et
,
ne
nature,
nie que le
port conditionnel
Dans
tionnel
,
tout autre
ou au
,
exerce son
négation
une
cas
et
,
devient
ici, par l'effet
du rap
du futur.
le verbe étant mis à l'aoriste condi
prétérit avec le sens futur,
influence naturelle
rapport par la
conjonction ci
$. IV. Syntaxe
ET
passé,
AUTRES
des
,
ïe rapport conditionnel
il est inutile d'indiquer ce
et
.
Particules d'exception
MOTS
SERVENT
QUI
AU
M'ÈME
USAGE.
employés par les Arabes à exprimer une ex
partièule7 composée de la conjonction ^f
si, et de l'adverbe négatif V non; y*f.-ify„-<jjl et »\'f^, qui sont
proprement des noms qui signifient différence; UU. Ù&. et foi
excepté, mots considérés comme prépositions mais qui sont pri
mitivement des verbes ; enfin lïy- V expression composée dont
j'ai expliqué l'origine ailleurs {n.° 863 //' p.) et qui signifie
<j în.
ception,
Les
sont
mots
Vf sinon,
-
,
,
,
,
,
sur-tout.
%%o.
«n
L'exception *&^«J
rapport
«xceptée
de
ne
peut avoir lieu
deux
quantités dont l'une
l'autre. Quand je dis je n'ai vu
entre
,
qu'il
sans
est
y ait
extraite
aucun
cheval,
ou
si
$l6
DE
LA
SYNTAXE.
j&ucépkale, j'affirme d'abord que je n'ai vu aucun être
l'espèce entière des chevaux, et ensuite j'excepte ou je re
tire de l'espèce entière le seul individu Bucéphale, parce que
je l'ai vu, et que, par conséquent, ma première proposition
ce
n'est
de
seroit fausse par rapport à lui.
La chose exceptée se nomme
de
laquelle
«L»
nomme
on
retire
et
sépare
arabe
en
cette
JX*l_iî et la masse
l'exception se
,
chose par
,
<}JûLJf
proposition générale
.
que l'on restreint par une
JîO.
exception peut être affirmative ou négative. Elle est affirmative
dans cet exemple
tous les arbres ont été
gelés excepté les
La
,
,
,
pommiers; négative
excepté les fguiers. Si
l'exception
au
renferme
contraire,
une
dans
arbre n'a été
gelëk
l'idée générale est exprimée négativement,
une
cet
autre,
aucun
véritable affirmation
négation, quand
l'idée
:
elle
générale
renferme,
est
énoncée
affirmativement.
exprimer ïa chose exceptée,, sans exprimer l'idée
générale de l'espèce de laquelle on excepte cette chose. Ainsi
quand on dit, je n'ai vu que Louis il y a ellipse, et ie sens est,
je n'ai vu aucun homme excepté Louis.
J6 O. Le nom qui exprime îa chose exceptée se met en
arabe tantôt au nominatif, tantôt à l'accusatif ou au génitif,
suivant certaines règles que je vais exposer. Je commence par
indiquer celles de ces règles que l'on doit suivre lorsqu'on faii
usage de la particule d'exception Vf sinon.
<y 6 1 L'idée générale de laquelle on fait l'exception étant exprpniée, si fa proposition est négative, on mettra le nom qui exprime
la chose exceptée à l'accusatif, ou bien on le fera concorder avee
le nom qui exprime l'idée générale ; cette dernière construction
est même préférable : si la proposition est affirmative, ce même
nom devra être mis à l'accusatif. Exemples de la proposition
On peut
,
,
,
,
.
,
DE
3 17
SYNTAXE.
LA
négative : îo^j ^' **»■' jsi/'Li ou jûj Vf personne ne m'a parlé,
j/'rtcw Z«W; *-?jy*M V^^^iCJIu t^JLyf U ou ^.y^ /"' nai Point aP~
porté les livres excepté le Pentateuque. Exemple de la proposition
affirmative : fô^3 Vf ^UJî à*^- l*s hommes sont venus me trouver, ex
cepté Zéid. Si cependant on construisoit les propositions négatives
de manière que l'idée particulière de la chose exceptée précédât
l'idée générale le nom qui suit VJ devroit nécessairement être
mis à l'accusatif. En ce cas il faudroit dire, jô.f Ijj) Vf>cj^i U,
et non
pas i>4j *\ et de même, çjsaJOIj **jjfi\ ¥' c>â^ ^* et non
,
,
»
>
^
pas
Z
rV
*jj^Jf Vj ^,
562. Si l'idée générale de laquelle
entendue
le
,
auroit dû être mis le
sition
principale
Vf
fjiu«£
Le
Vf
nom
nom
ô^Jâl'l je
dans ïe second
VJ
fait
l'exception est sousmême
au
sous-entendu. Dans
U // n'est
oji* U/V
t-iââ.
on
doit être mis
ce
cas
où
cas, la propo
toujours négative. Exemples :
est
%—***■ Vj ^Aâ.
j— stkk
suit
qui
nom
est
n'ai
n'ai
passé qu'auprès
frappé
dans le
génitif,
au
à moi que
venu
que
Djafar;
de
Djafar;
Djafar,
premier exemple
au
dans ie troisième à
et
parce que dans le premier on sous-entend i>Âf
tjL%L, et dans le troisième fj^f
,
nominatif,
l'accusatif,
dans le second
.
(a) 11 y a cependant des exemples du contraire quand la proposition est
négative; mais Ebn-Malec dit positivement qu'il est préférable de mettre, en
ce cas, le nom de la chose
exceptée à l'accusatif:
,
hs
»
»
Le
il /■**■ '
***"
<^5 <?^
**
^'
<4
o^ V^ /**i
de la chose
exceptée étant mis le premier dans une proposition
négative on ie trouve quelquefois à un autre cas qu'à l'accusatif; mais si
l'occasion se présente préfère toujours l'accusatif.
«
nom
,
,
,
»
JI 8
Si le
^63.
cette
tive
au
,
qui précède ^J est un sujet, et celui qui suit
attribut, la propositron, sous une forme néga
mot
particule
exprimant
un
(à
la
véritable affirmation
une
oil^Vt li>Ââ.
nominatif. Ex.
menteur
lettre,
les deux
,
mots seront
U
Djafar n'est autre chose qu'un
Djafarus nisi mendax); î^j»^\ t>f
non
Vf les incrédules
l)J>j*&
SYNTAXE.
LA
DE
ne sont
que maudits c'est-à-dire,
,
sont
certainement maudits.
S
qui
se
64.
Si la chose
sont
comprises
dans l'idée
nécessairement à
met
n'est
exceptée
de la
point
générale
ïe
,
nature
dé celles
suit Vf
cjui
nom
l'accusatif, Ex. ULji VI o^\
^îU.
U
qu'un cheval.
comprendre parmi les propositions négatives
^65.
celles qui le sont par le sens quoiqu'elles ne le soient pas par
la forme; telles sont les propositions prohibitives et les proposi
tions interrogatives qui expriment une négation, comme ; Quel-'
il n'est
à moi personne
venu
H faut
,
,
qu'un entrera-t-il dans le Paradis excepté les vrais croyans!
servent à former
5 66. Les noms %& A^L j^ et <s'y» qui
des exceptions gouvernent le nom de la chose exceptée qui leur
et ils se mettent euxsert de complément, au génitif ( n.° 66 )
,
-
-
»
,
,
mêmes,
devroit
dans toutes les
mettre
Vf
la
le
particule
oÔj jXè personne
ïSfïù f
ou
.
mieux
nom
circonstances,
de la chose
Ainsi l'on
aux
exceptée
dira, &ïj f*?
mêmes
,
cxÂf
où l'on
cas
si l'on
J^j^U
employoit
ou
mieux
parlé, excepté Zéid ; '_#?< u^luo^'^
'ùfy} f J^- jen 'ai point apporté les livres, excepte le
ne
m'a
Pentateuque; o>£ 3^c
jLliJf ^ïU»
les hommes
sont venus me trou
excepté Z"id; j**4- jJU à^ ^° M n'est venu me trouver que
Djafar ; y**- fSj élfjf* (-• je n'ai passé qu'auprès de Djafar;
ver,
_j.ÂsCâ. J^c
c-y^f p je n'ai frappé que Djafar; ^j-y 'j*?-
personne n'est
Les deux
venu
noms
me
trouver,
«^
et
excepté
Ur"
un
^ant ^
o^\
çi*^
**
cheval.
ceux
W* .ont *ei t*0**
DE
3 Ip
SYNTAXE;
LA
(n.° 731 //' p.), ce n'est que virtuellement
qu'ils éprouvent l'application des règles que l'on vient de
semblables
cas
,
'
donner.
Après les mots Lîlâ. $1. et lô* on met le nom de la
chose exceptée au génitif ou à l'accusatif; on peut même le mettre
au nominatif, comme qSj UU.
f^jU ils sont morts excepté Zéid:
%&J.
-
,
,
mais
si l'on
,
mettre
le
568.
se sert
iU. U
de
de la chose
nom
l'égard duquel
cordance des appositifs.
560. Après Vf-J^è
-
entière, composée
toute
Vf n'a
aucune
que l'on
influence
0J0,
la conjonction yf
met
.
Je n'ai
beau
il faut nécessairement
aucune
influence
observe seulement les
Cw il peut
d'un
sujet
sous
Exemples
sur
le
nom
règles de
se trouver une
et
,
et
qui
con
proposition
d'un attribut. Dans
proposition
sur cette
à l'accusatif
*^A
plus
on
,
à l'accusatif.
exceptée
La formule UiL, V n'a
la suit, à
fé^ U
et
ce cas
après JÂé
forme adverbiale,
on
,
et
ajoute
:
(j^wAl cVJJ Vf
1)0*
L> Oj>°
vu
d'aucune personne, que Zéid ne m'ait paru
passé auprès
qu'elle.
x-'a* Vf oJ*.\
(JS&a U
jamais adressé la parole,
*—
Personne
m'a
ne
que
je
n'aie conçu
pour lui du respect.
Quelquefois
la
,
conjonction j
tion.
vous
Exemple
:
dans
cette sorte
entre
Vf
et
Q^-^'ivJ^
la
de construction
proposition qui
Vf
"^i^é
S
ne
,
on
interpose
i'excep-
renferme
moure^ pas,
sans
que
soyez devenus Alusulmans.
t)IVJ q( J^c et y, ôSxJ si ce n'est que, doivent souvent
iULIlj jJâi ^* ^it uf
rendre par mais. Exemple ^fp & ç)J
o^û, Jo & £jJ*^ù\j je suis (disoit Mahomet) celui qui prononce le
570.
se
-
:
o~>
DE
320
LA
SYNTAXE.
mieux la lettre dhad ; mais je suis de la famille de
Koréîsch, et j'ai été
allaité parmi les enfans de Saad. C'est comme s'il eût dit , mais cela
n'est pas surprenant, car je suis de la famille de Koréîsch &c.
j>7 I II peut arriver que l'on répète plusieurs fois ; et alors
,
VJ
.
il faut considérer si
tiné à donner de
cette
répétition
l'énergie
si elle forme
au
n'est
discours
qu'un pléonasme
sans
former
une
des
nouvelle
exception. Dans ïa pre
suit la seconde particule d'ex
nouvelle
exception
supposition le nom qui
ception se met au même cas que le précédent sans que la répé
tition de la particule ait aucune influence soit qu'il y ait ou qu'il
n'y ait pas de conjonction devant la seconde particule. Exemples:
,
ou
mière
une
,
,
,
l^U^y j£ù\ £jJL£ Vlj &jlgjj
La succession des siècles est-elle
la suit !
jour qui
son
«JUJ Vf ^-sbôJF
autre
(est-elle autre chose)
chose
J*
qu'une
nuit et le
que le lever du soleil
et
puis
coucher!
frère que Zéid.
Dans la seconde supposition quand la répétition de la par
ticule Vf forme autant de nouvelles exceptions, il faut encore
faire une distinction. Si l'idée générale est sous-entendue, il faut
mettre le nom qui exprime la première chose exceptée au cas qui
lui convient, suivant la règle donnée précédemment (n.° 566),
et mettre à l'accusatif les noms
qui expriment les autres excep
tions. Exemple: \oX£ ^[fo**!, V^j.**^- VJ il* U // ne s'est levé
(personne) sinon Djafar, sinon Sa'id sinon Mohammed.
Si l'idée générale est exprimée, et que la proposition soit affir
mative il faut mettre à l'accusatif tous les mots qui expriment
les exceptions. Exemple : Fj& V[l.> VH54) ^'
î»^' J*5' tout le
monde fut tué excepté Ze'id excepté Omar excepté Amrou.
Si l'idée générale est exprimée, que la proposition soit négative,
// n'est
venu me
trouver
que
ton
,
,
,
,
,
,
,
,
et
,
DE
et
cru'ii y ait inversion ,
LA
on
SYNTAXE.
mettra
aussi
tous
3
ïes
noms
VrUt U /'/
Exemple o^f ^ VJ ô^f VJ \yJLL
excepté Djafar, excepté Ahmed, excepté Omar,
:
2 I
à l'accusatif.
s'est sauvé,
ne
aucune
personne.
pas d'inversion , on mettra l'un des noms au même
cas où l'on mettroit le nom
qui suit Vf , s'il n'y avoit qu'une seule
S'il
n'y
a
exception
,
et tous
les
autres
à l'accusatif.
E-taiV} fj-^Vf
Il
ne
Exemples
^\IC\J£>;'\
:
'
s'est sauvé personne, sinon Zéid, sinon Amrou, sinon
Djafar.
On diroit
^
également \yJÂ
!>~£
"^V^i>
^
^—^'
fti'|»
•
L^U V î ÏJà\ \Jô. p
Ils n'ont pas tenu parole sinon Amraa, sinon Ali (a).
J 72 Pour exprimer l'exception on emploie quelquefois le
verbe négatif J^J ou ^j£j V Dans ce cas le nom de ïa chose
exceptée se met à l'accusatif. Exemple : f jJj Qj&- [P^ ou
foûij i^S. ils ont été tués excepté (à la lettre, ce n'est pas ) Zéid.
et le sens est
II y a alors ellipse du sujet du verbe
Vj \jkà
,
.
,
.
,
°
,
,
fôûj^-â*! qj£j
Us
ont
été tués
,
mais
aucun
d'eux n'est Zéid.
précédemment (n.° 531) que, dans le
cas dont il
s'agit si la chose exceptée est exprimée par un pro
et
nom on doit employer les pronoms isolés composés de GJ
573.
Nous
avons vu
,
,
,
non
les affixes.
De même
est
exprimé
après Vf, quand
par
un
pronom
,
le
il
nom
ne
de la chose
exceptée
faut pas faire usage des
(a) Dans cet exemple, l'idée générale n'est pas sous-entendue, comme on
pourrait le croire; elle est comprise dans le verbe, et, suivant les grammairiens
Arabes, c'est le waw de LcJ qui fait la fonction de pronom j**** (n-° 814»
i.»p.).
II.' PARTIE.
X
DE
322
affixes
:
LA
SYNTAXE.
si l'on trouve
tilVf pour
<iiÇj] Vf
i. V. Syntaxe
quelques exemples
excepté toi, ce sont des
du contraire
licences
,
comme
poétiques.
Particule suppositive
de
la
et
négative
VJÎ.
particule suppositive et négative V£f si ce n'étoit,
n'a aucune influence grammaticale sur le sujet de la proposition
qui la suit. Cette proposition devroit être composée d'un sujet et
d'un attribut, mais le plus souyent l'attribut est sous-entendu :
il est même de règle de le sous-entendre toutes les fois qu'il
peut facilement être deviné (a). Ainsi l'on dit cfbjjJ Sîj XI
sinon Zéid, je te visiterois; c'est-à-dire, >y>y» o^'j Vif si Zéidn'existoit pas ou «_)U «>j; Vp si Zéid n'y étoit un obstacle. Exemples:
<f7 4' La
,
fjffjVI oo>-*»jJ j**u'Àî«j (j*^' j*^ f^i *^y
Si Dieu n'avait pas opposé les hommes les
terre auroit été dévastée.
uns aux autres ,
la
%£*. £jyi "iwf £)[j ^-^"JJ *jfe^* ^ J-**-* XP
JV
(ils
f£
«V«r <fo' la bonté de Dieu pour eux et sa miséricorde
exterminés) ; mais Dieu est indulgent et sage.
auroient été
575' Quoique fe particule VJi n'ait aucune
sujet
,
ni
sur
l'attribut de la
proposition quand
influence , ni sur le
il
est
exprimé (b)
.
(a) Hariri, dans son commentaire sur le Molhat alirab dit, sans restriction,
qu'après Vif on ne doit pas exprimer l'attribut ; mais les exemples que je donne
et l'autorité des commentateurs de XAlfiyya prouvent
que cette ellipse ne doit
avoir lieu que quand elle ne nuit pas à la clarté du discours.
(b) Hariri, parlant des différentes particules qui peuvent être placées avant
,
,
,
sujet et un attribut, les divise, par rapport à leur influence grammaticale
la proposition qui les suit en quatre classes. La quatrième classe comprend
celles qui n'ont aucune influence grammaticale sur le sujet ni sur l'attribut, et
parmi celles-ci il compte Vif {Molhat alirab man, de M. Marcel, f. 47).
un
sur
,
,
DE
si le
cependant
emploie les
,
Si
ce
sujet
LA
de
SYNTAXE.
cette
proposition
pronoms affixes (n.° 899, //'
n'étoit lui, le monde
LJ^j tSy&t*
323
ne
est un
pronom
p.). Exemples
,
on
:.
seroit pas sorti du néant.
*}j c*-** c& JxLcJi fjJ\ ~<jf3
*iilii
A0j ^l/Tofjîl &
ôJZ-> ô^ c^'-^'i
ISyQ.'j UVjJj l^UV
particule \S), c'est celui ou on l'apptlle
dominante : on la nomme ainsi quand elle s'ajoute aux particules
CvLâ. et >J qui deviennent par-là susceptibles d'agir comme parti
cules de compensation ; si ce n'étoit la particule L*, elles ne seroient
point du nombre des particules qu'on appelle instrumens de con
dition et de compensation (n.° 51).
Avec le pronom de ïa première personne on dit Is^y* si ce
Le
la
quatrième usage (de
,
n'étoit moi ,
et non
<>Vp (a).
grammairiens Arabes n'ont pas manqué de remarquer cettty syntaxe
particulière de la particule Vif qui ne régit l'accusatif que quand le mot qui
la suit est un pronom. Les uns ont regardé en ce cas cette particule comme une
préposition ; c'est le sentiment de Seibwaïh suivi par Ebn-Farhât les autres,
comme Ahfasch,.ont dit
que la particule n'a aucune influence, et que le pronom
Les
(a)
,
:
,
affixe tient lieu du nominatif ; enfin d'autres,
cette manière de
s'exprimer et ont soutenu
,
l'usage
des Arabes. Aschmouni
contraire.
fol. 131
Voyelles
son
Mobarred,
n'étoit
commentaire
imp.
n.°
sur
condamné
ont
point autorisée par
VAlfiyj/a prouve le
1234, fol. 59
,
recto, et 1295
A,
je soupçonne que quand VlJ gouverne son complément à l'accusatif,
négatif Y y «t considéré comme niant l'existence (n.° 93 ),
Vif signifie alors i^-'J» f jui> Vl) si une telle chose n'existoit pas, ou
que l'adverbe
en sorte
que
*^$£Jf fo^> ÎJ**)ljl
cette
particule
n'a
si
ce
une
lorsqu'au contraire
négatif n'y est considéré
Vil signifie alors ijU foi Vil
n'étoit l'existence d'une telle chose;
point d'influence, c'est que l'adverbe
que comme niant l'attribut
si
dans
qu'elle
recto.
Pour moi
cest
,
Mss. Ar.de la Bibl.
comme
(n.° 96), en sorte que
telle chose n'y mettait obstacle.
Xz
DE LA SYNTAXE;
3^4
^76. Cependant trouve aussi ce
on
qui représente le nominatif.
sonnel isolé
si
n'étoit
ce
en
vous
,
nous
cas
le pronom per
Ex. (j£»y>
vlO'&fVlf
aurions été vrais croyans.
577* .Quoique l'attribut de la proposition suppositive qui
soit le plus ordinairement souscommence par la particule VJJ
entendu, on peut cependant l'exprimer, quand l'ellipse ren
droit le discours obscur. Exemple : [jL^icsU o—Â/^ui.. ^£ V^j
si Omar n'eût pas été injuste envers moi, je me serois réfugié (sous
f
sa
protection).
578.
Le verbe de la
proposition suppositive qui commence
par la particule Vy quand il est exprimé doit être au prétérit ;
et celui de la
proposition affirmative hypothétique doit aussi être
au
prétérit comme on le voit dans l'exemple précédent : si cette
dernière est négative on peut mettre le verbe au prétérit avec
la négation Li ou k l'aoriste conditionnel avec la négation
p
On met ordinairement au commencement de la propo
57p.
sition affirmative hypothétique l'adverbe J sur-tout quand elle
exprime une affirmation. Quand elle exprime une négation, on
met rarement cet adverbe ; j'en ai donné des exemples ailleurs
(n.os 3 12. et suivans, 330 et 8A9, i.re p.).
5 80. On fait quelquefois ellipse de la proposition affirmative
hypothétique; on en a vu un exemple un peu plus haut (n.° 574),
,
,
,
,
,
,
CHAPITRE
XXXI.
De la Construction -proprement dite*
<> 8
1
•
La construction
la
(n.° )
,
cours.
C'est
1
truction;
est
et
,
comme
disposition respective
en ce sens
l'objet
que
propre que
je
me
je
l'ai dit
des diverses
je prends
propose dans
ce
précédemment
parties du dis
ici le
mot cons
chapitre,
est
de
DE
faire connoître
minent
cours
de
en
LA
SYNTAXE.
325
spécialement les principales règles qui déter
cette disposition
respective quoique dans le
arabe
en
,
dépendance j'aie
eu
,
observations
sur
,
,
de la syntaxe
exposant les règles de concordance et
plus d'une fois occasion de faire des
sujet.
ce
On peut considérer séparément, i.° la disposition
respective du sujet, du verbe et de l'attribut; 2.0 celle du verbe
^82.
complémens médiats ou immédiats ; 3 .° celle du nom
et
complémens ; 4«° celle de la proposition réduite à
ses termes essentiels et des parties accessoires qui sont les termes
circonstanciels ; 5 .° celle des prépositions relativement à leurs
antécédens et à leurs complémens.
j 83. Dans l'exposition des règles de la construction, je
m'arrêterai seulement à ce qui est d'un usage commun et ordi
naire ; je n'entrerai point dans la discussion minutieuse de toutes
ïes inversions que l'on se permet dans le style poétique.
et
de
ses
de
ses
,
,
$. I.cr Construction
du
Sujet,
du
Verbe
et de
l1 Attribut.
J 84«
entendu
Le
:
sujet de toute proposition est ou exprimé ou sousquand il est sous-entendu il est compris dans le verbe,
,
,
dont ïes diverses inflexions
genre
il
et
est ou
*»f
fj£=>
abstrait,
indiquent
de
nombre , de
quel
quelle personne est ce sujet. Quant à l'attribut,
exprimé sans aucun verbe qui le lie au sujet comme
Dieu (est) libéral; ou lié avec le sujet par un verbe
quel
de
,
comme
fS*u *»\
uj&
Dieu
sera
témoin,
lûf^f9iC^>f
&-*f» 0J0 JU tant que je serai malade ; ou
enfin compris dans ïe verbe ce qui a lieu avec tous les verbes
attributifs, comme (j^[ JU le diable a dit, expression qui équi
vous
êtes devenus frères
,
,
vaut a
celle-ci X>të
q^ il a
été disant.
326
585.
LA
DE
SYNTAXE.
L'attribut peut aussi être sous-entendu
seulement par
Zéid dans la
un
terme
circonstanciel,
mosquée c'est-à-dire, o^uf
,
&
indiqué
et
comme
tvâûlf j
v£^*H)
Zéid est dans
0Ô3
la
mosquée.
f 86. Pour simplifier la considération de l'objet qui nous
occupe je diviserai toutes ïes propositions' en propositions ver
bales et en propositions nominales. J'appellerai verbales, celles qui
renferment un verbe, soit attributif, soit abstrait, à un temps
personnel; et nominales, celles où il ne s'en trouve aucun (a).
Ç
87- Dans les propositions verbales on peut placer le sujet
avant ou après le verbe : l'usage le plus ordinaire est de mettre
ïe verbe avant ïe sujet ; mais il faut avoir égard aux circons
,
,
tances
suivantes.
^ 88. Si la proposition
particules indécïinables £)£ car, <jf que, <jb comme si, ^Çf mais, J*J peut-être que
ôif plût h Dieu que et que ïe nom sur lequel ces particules
exercent leur influence (n.°
90) soit lui-même le sujet de la
proposition, ce sujet doit être nécessairement placé avant I«
verbe. Exemples :
commence
par les
,
,
,
s
Mais la
plupart
d'entre
eux
j
j8ç.
Si ïe
sujet
vous
est un mot
pas.
»
*£-«w
\$fjè=>i&S
Peut-être que
ne savent
y
fere^ réflexion.
interrojgatif,
comme
^i quel
(a) Je ne prends pas ici ces dénominations , proposition verbale
sition nominale, dans le sens que leur donnent les grammairiens Arabes
pour eux comme je l'ai dit plus d'une fois , de proposition verbale, que
.
verbe
est
exprimé
et
précède son sujet.
et
:
propo
il
n'y
quand
a
le
DE
LA
SYNTAXE.
327
ls\ lequel! U quelle chose! 'Jf combien! &¥ combien! ou
bien un adjectif con jonctif ou un nom conjonctif, comme tcoyl
celui qui, \yi quiconque U quelque chose qui, <jf lequel &c. ce sujet
doit nécessairement précéder ïe verbe. La même chose a lieu quand
homme!
,
,
ces
mots cessent
d'une
d'être
interrogation,
interrogatifs
dans
comme
,
mais renferment la valeur
,
cet
exemple: lus» [^ ^jSl V
je ne sais pas qui est-ce qui l'a tué.
ÇÇO. Le sujet doit au contraire être placé après ïe verbe,
si ïe verbe est précédé de la conjonction suppositive y si, de
ïa conjonction conditionnelle lj\si, ou de l'un des mots qui
comme
renferment ïa valeur de cette conjonction
^f-c^i.
par-tout où, &c. (n.° 343, J-re P-) ; de l'adverbe conjonctif Cl
lorsque; des adverbes négatifs U-V ^f-*l et \.1Xnon, ne ; des
,
,
,
-
interrogatifs J* f est-ce que! et
interrogative ou conjonctive employée non
adverbes
complément
composés ;
comme
et
-
;
de leurs
des
conjonctions q\
prépositions J
des
gouvernant le mode
de
toute
comme
expression
sujet mais
,
et
[j^>
et
j^. signifiant que,
que, pour que,
de l'ellipse
subjonctif,
de la conjonctio/i <yî (n.° 830, //' p.) ; des conjonctions ci
j
et
jf prises dans un sens qui exige l'emploi du même mode
(n.° 48) ; de la préposition J indiquant le commandement et
régissant le mode conditionnel (n.° 5 1) ; de l'adverbe ^if en ce
cas, cela étant
régissant le subjonctif (n.° 48); de l'adverbe V
une
exprimant
prohibition et régissant le mode conditionnel
(n.° 5 1 ) ; de la conjonction £)f et du mot conjonctif U, donnant
à l'aoriste et au prétérit la valeur du nom d'action (n.os
889 et
//'
des
adverbes
et
oà
890
p. ) ;
qui
ciJ-« ci-- ïf
y»
modifient la valeur du prétérit ou de l'aoriste, &c.
J 9 1 Cependant il y a plusieurs de ces particules avec les
quelles on peut placer le sujet avant le verbe, de manière
pour que,
et
en vertu
-
,
,
,
,
-
-
-
,
>
.
X4
328
DE
LA
SYNTAXE.
toutefois que la particule ne soit point séparée du verbe par
ïe sujet. Exemple : *j^Jjb»f cjS>L>\ ^f oJlj si Zéid m'honore,
je
si
honore
Zéid,
moi,
lettre,
j'honorerai lui):
(à
(il)
peut alors considérer ce sujet comme un mot placé hors
l'honorerai
On
la
de la
proposition comme un nominatif absolu ; ce qui se rap
proche de la manière dont les grammairiens Arabes analysent
toutes ïes
propositions où le sujet précède le verbe (n.Q i48).
5»Q2. Lorsqu'il survient ainsi au commencement d'une pro
position un terme qui n'est pas le sujet du verbe soit que ce
,
,
terme
soit
un
nominatif absolu , soit que ,
fluence de la
se trouvant sous
l'in
conjonction £jf
particules qui
pareille à celle de cette conjonction il soit mis à
l'accusatif, le sujet de la proposition doit être placé après le
verbe. Ainsi il faut dire îfi\ ôU 0Ô3 et if*\ t^U IjJj £>f le
père
une
,
ou
des
autres
exercent
influence
de Zéid
,
mort, et
est
Si l'on
J03.
ïe sujet doit
«JXàJf aUc
non
place
<£>U
le
ej_>f
et
ooj
complément
encore en ce cas se mettre
ôU
«jjf fou) ô^ (a^
du verbe avant le
après
le verbe.
verbe,
Exemple :
^â. ULyij"A\>f fjâJ> Lju^i
dirigé une partie
d'entre eux et l'égarement a été prédestiné pour une autre
partie.
Dans les propositions nominales la place naturelle du
594
sujet en ne considérant que l'analogie des idées est avant
Dieu
a
,
.
,
,
,
ï'attribut
:
cependant
la chose n'a pas
donner pour règles générales ,
i.° Que l'on doit
placer le
fois que l'inversion
(a)
jetteroit
L'auteur du commentaire
cette
construction
sujet
son
père Zéid est mort,
;
ce
qu'on
et
de
avant
du louche dans
\Alfiyya (Mss.
,
et
ï'attribut,
l'on peut
toutes
les
l'expression ;
de S. G. n.°
465, £32 recto)
cependant le double incon
amphibologique, puisque cela pourroit signifier,
placer le pronom affixe avant le nom auquel il se
sur
oJj vfj\ oU-
permet
vénient de rendre la proposition
rapporte
toujours
lieu
évite ordinairement.
Elle
a
DE
2*
Qu'il faut,
quand
de la
proposition
naturel
contraire, placer
3 2p
l'attribut
avant
le
sujet,
inversion contribue à mieux déterminer le
cette
3.0 Que,
au
SYNTAXE.
LA
dans
sens
;
tout autre
cas,
on est
maître de suivre l'ordre
l'ordre inverse.
ou
qui distingue le plus ordinairement le sujet de l'attri
but c'est que le sujet est déterminé, et l'attribut indéterminé,
comme
fj£=> ^f Dieu (est) libéral: quelquefois, sans être rigou
reusement déterminé, le sujet est cependant tiré du vague d'un
nom indéterminé, ce
que l'on nomme ^yJ^è particularisé (n.° 1 60,
595*
Ce
,
note)
,
soit par
croyant; soit par
ce
qui
est
épithète,
une
juste,
comme
^y
o-ûî
serviteur vrai
un
complément comme cijj*< j»\ ordonner
Ji^f une œuvre de piété, JU-_>N \y. A'jh> des
un
jj
,
gens généreux d'entre les hommes.
Ç 06. Si
miné
,
donc ïe
l'inversion
sujet
est
est
déterminé,
et
l'attribut indéter-
permise. Exemple : Uf "j^ér je (suis)
un
homme de la tribu de Témim.
597'
mination
Elle l'est aussi si le
sujet a un
commencement
de déter
l'attribut étant absolument indéterminé.
Exemple :
pfjXUf ^« j^j lJôlfi che^ nous (sont) des gens généreux d'entre tes
hommes, c'est-à-dire, quelques hommes généreux.
598.
l'autre
,
Si le
ont
d'être dit
,
un
sujet
et
l'attribut
commencement
sont
déterminés
de détermination ,
,
le
si l'un
comme
il faut observer la construction naturelle
alors que l'ordre des
ou
et
il vient
, parce qu'il
de l'attribut.
qui distingue sujet
(est) notre seigneur, sans se per
mettre d'inversion parce qu'il n'y a ici que l'ordre des mots qui
indique que le sens est c'est Dieu qui est notre seigneur, et non
pas c'est notre seigneur qui est Dieu. On devra dire de même, sans
se
permettre d'inversion eU* J*àif j^ J-îif un (homme) meilleur
n'y
a
Ainsi il faudra dire
mots
\£>j "aaf Dieu
,
,
,
,
DE
330
que moi
LA
SYNTAXE.
meilleur que toi, chacun des deux
de détermination imparfaite.
(est)
égal degré
termes
ayant
un
Mais , s'il y avoit dans l'expression même quelque chose
faciliter ïa distinction du sujet et de l'attribut , fin version
590.
qui pût
seroit permise. Ex. cvetjVf Jl^f *Qf ^yJl^UjjUjUjf fyJ UyJ
les enfans de nos fis sont nos enfans; mais pour nos files, leurs
enfans sont les enfans d'hommes tout- à-fait étrangers pour nous.
II y a ici dans ïe texte une inversion ; et si l'on n'y avoit point
égard, on traduiroit, nos enfans sont les enfans de nos fis: mais
le poète a pu se permettre cette amphibologie grammaticale,
parce qu'il n'y a réellement point d'amphibologie logique (a),
60O. Dans l'exemple suivant l'inversion est nécessaire pour
déterminer ïe sens: c^olc j&ji peut signifier une pièce d'argent
(est) a moi, c'est-à-dire, j'ai une pièce d'argent, fjï étant le
sujet, et <joIc l'attribut, par ellipse du mot Iftâ étant ; mais il
peut aussi signifier une pièce d'argent qui est à moi «^ji étant un
nom
qualifié par la proposition qualificative <jt£&, au moyen de
l'ellipse du verbe q^JCj est (n.° 362 ). Pour éviter l'amphibo
logie, il faudra dire tfiji c5<>^ che^moi (est) une pièce d'argent.
6oi. Si le sujet étoit déterminé, ou du moins- qualifié, ce
qui opère un commencement de détermination l'inversion ne
seroit point nécessaire. Ainsi l'on pourroit dire (jôS* o^j
,
,
,
ou
o-jj
cSf^,
Zéid
(est) che^
moi;
j\oJ\ J ^J^j^j
^iji fyLj un homme de la nation des Francs est à
602. II en seroit de même si la proposition
ou
interrogative
(a)
auroit
,
parce que
cette
discours.
jftvî j.
la maison.
étoit
négative
proposition ne laisse
je disois en latin salus hominis fuit crux Christi, il y
amphibologie grammaticale sans qu'elle préjudiciât à la clarté du
C'est ainsi que si
une
forme de
ou
,
DE
&*■! \
—•
ou
33
I
Ainsi l'on pourra dire indifféremment
point d'amphibologie.
jCU'^Lé JL5> ou llU
*jj—£ff JL
SYNTAXE.
LA
iXo
*v»f
Ji (est- il)
*-Jj^f J
un
savant
^» -aucun homme
vous!
parmi
ne
(se trouve)
dans le villave.
o
603» Quelques
autres
circonstances
exigent
encore
l'inver
sion.
1
.° Elle doit avoir lieu
renferme la valeur d'une
es-*tu!
c>jf
loi U qu'est-ce que
[y jj^f
2.0 II
un
^
je
est
en
ne
,
sais pas
de même
pronom affixe
lorsque l'atfribut est interrogatif ou
interrogation. Exemples : ojf ly> qui
cela! tîlfU. ^fS comment (va) tasanter
qui
se
qui tu
quand il
es.
y a dans le sujet complexe
rapporte à l'attribut. Exemples :
"°
"
l§la.U>^fôJf j*,
Dans la maison
le maître d'elle.
(est)
fo«jj LjgAx« i)J&\ i^é.
Pour les dattes leur égalité en beurre, c'est-à-dire
valent un volume de beurre égal a leur volume.
•
Je
te
-
^-
$
J
les dattes
s
-
faire honneur, car
satisfait.
te
respecte, uniquement pour
«
,
tu ne
peux
rien contre moi ; mais celle que l'œil aime , le
Dans
s
jit
sujet
trois
ces
avant
ïe
étant
exemples,
sujet
;
car ces
déterminé,
et
on ne
deux
peut douter que l'attribut
termes sont
o^^jsXâ
(et
,
ne
le
l'attribut indéterminé*
3 .° L'inversion a encore lieu quand le sujet
par Llj f seulement, ou VI sinon. Exemples :
C'est Zéid
bien distincts
non
pas
un
est
restreint
L^rf
autre) qui
est
po'éte.
\jy°^
LA
DE
33^
jJ Vf î—cLî u
point d'autre poëte que Zéid.'
o-
Il
Si ,
n'y
contraire
au
,
a
SYNTAXE.
on
-
vouloit restreindre le
il faudroit mettre le
attribut,
3—cU
sujet
avant
sujet à un certain
ï'attribut, et dire:
Ze'id
o^J ^l c'est poète, qu'est
(et non pas peintre ou toute
autre
chose) ; j*Lâ V| o4) ^ Zéid (est) pas autre chose que poêle.
On dira de même cj^VJ ÔJf 0] #/ n'es qu'un menteur.
On peut cependant intervertir quelquefois cet ordre, quand
,
n
on se
sert
premier
C'est
cas
ce
Vf pour exprimer la restriction
de
,
Jclâ o4j ^i
voit dans
qu'on
^
>
et
dans le second
ce vers :
et
,
,
dire
,
dans le
o^} j^^' ^
**•
<
Jjiltf ci*J£ V| Jij *fuh Jl£. ^ilîf c3L VJ J* d3 ^
O
par
et
moK
ton
secours!
peut-on
mettre son
victoire
appui
sur
sur
eux
quelque
autrement
autre
que
que toi!
Si l'on y fait bien attention , on reconnoîtra que , dans l'une
l'autre formule de restriction , il y a Une ellipse.
Quand
est
Z)m/, peut-on espérer la
on
dit
oûj V| JcLs
au
contraire ,
et
ïe
sens
est
0^3 ^l 5-e^
oô»f U
aucun
U
,
il y
ellipse du sujet
,
et
homme n'est poète
que Zéid.
j.£^ Vj o4j ^
J_çU Vf ^^ o—j) ^
on
dit
a
>
il Y
a
ellipse
Z«V «Vf*
le
sens
Quand,
de ï'attribut ,
aucune autre
chose
que poète.
604.
un
mot
L'inversion ne peut pas avoir lieu , 1 .° quand le sujet est
interrogatif ou renfermant ïa valeur d'une interrogation,
<2ô3& {y qui (est-ce qui est) che% toi! <3ô$>£ ly c$p' ^
je ne sais pas qui est-ce qui est che^ toi;
2.0 Quand le sujet est précédé de l'adverbe afflrmatif J.
comme
Exemple : oik"ôoV certes tu es menteur.
OÇ>5' Dans les propositions composées d'un sujet et d'un
attribut liés par le verbe <jk% ou Par un autre verbe abstrait,
DE
LA
SYNTAXE.
333
la
place naturelle de l'attribut est après le verbe et son sujet. Ce
pendant on peut toujours le placer entre le verbe et le sujet. Ex.
4^-j
Si
et
fj* *!r" <y^Jfi*-j k* tr^N owL$â. oieP
'en es pas instruite,
interroge les hommes sur le compte d'eux
de nous ; car celui qui sait et celui qui ignore ne sont pas égaux.
//
tu
n
ff&'j(~>j~*i
n'y a aucune
j*r
•
«jfoJ
On peut aussi
oûj yf QU
point
lieu
ovofî Lé
douceur dans la vie,
troublés par le souvenir de la
606.
iùâ*À*
mort et
mettre
Ze'id étoit savant,
tant
de la
l'attribut
et
^j^jJJ
que
i_w?
ses
V
plaisirs
sont
décrépitude.
avant
le
verbe,
jj£ Jjj °l Qy^
et
dire
Amrou n'a
généreux. Cette inversion ne peut point avoir
2\> U tant qu'il sera. Avec j4^ elle est d'un usage très-
cessé d'être
avec
rare et
même contesté.
point non plus mettre ï'attribut avant ïe
verbe, si ïe verbe est précédé soit des particules of ou U, donnant
à l'aoriste ou au
prétérit la valeur du nom d'action (n.°* 885;
et
890 i.re p.) soit de quelqu'un des mots qui veulent être
suivis immédiatement du verbe, et que nous avons indiqués
en
parlant de la construction du verbe et du sujet (n.° 590).
Exemple : Uu^o ôj^->' o^ <Hj^ )e veux ûue tu S01S vrai croyant.
00 8. Si le verbe abstrait est précédé de la négation U
on ne peut
point placer l'attribut avant la négation ; mais on
peut le mettre entre la négation et le verbe. Exemple: êUjo^i U
ojj J fj Zéid ne cesse pas d'être ton ami.
609. Si la proposition est interrogative et a pour attribut
un mot
interrogatif, il faut nécessairement mettre l'attribut avant
le verbe et son sujet. Exemples : c^J^U (^[y> qui est-ce qui a
été ton aide! (Â^Vy* qJ^S U quelle sera ta réponse! ly et Li font
007.
,
On
ne
doit
,
,
,
ici fonction d'attribut.
334
DE
6 1 0.
En
général
SYNTAXE.
il faut
,
dit de l'inversion du
LA
sujet
ici
appliquer
de ï'attribut
et
ce
que
nous avons
(n.° 5p4)> s'interdire
quand elle peut altérer le sens de la proposition ou
la rendre amphibologique , et au contraire la regarder comme
l'inversion
nécessaire
le
quand
reçoit plus
sens en
Ainsi il faudra dire
inversion
sans
de clarté.
lè^iy* ^y» îf&
Moïse étoit
parce que, le sujet et l'attribut étant déterminés ,
l'inflexion des cas étant insensible dans l'un et dans l'autre
affranchi
ton
et
,
que leur disposition respective
II faudra dire aussi l^~a.U> jfôJf j L&jsu» 1b
nom
il
,
n'y
a
la même chose
maison
son
maître
demeurera)
précède pas le
y
t^sa-U. jfôJf j
,
,
(c'est-à-dire
avec
nom
faire l'inversion
inversion,
il
auquel
b U
qui ïes distingue.
U, ou, ce qui est
que demeurera dans la
maître de la maison
le
tant que
,
pour que le pronom affixe U ne
se
*
tant
rapporte. Si l'on ne vouloit pas
l^s jtjjf o^A^» *b U tant que
il faudroit dire
,
demeurera le maître de la maison dans elle.
o^j VI fJ-cU qU» U // n'y avoit
(a).
point
Si l'on dit jîoJf j Vf o^J ife^i cela signifie Zéid n'étoit point
ailleurs qu'q. la maison; et au contraire, si l'on dit jfôJ f j o°^
o4j Vf le sens est il n'y avoit pas h la maison d'autre personne que
On dira aussi
inversion
avec
de poète, si
ce
n'est Zeïd
,
ZéiiLCes deux constructions
61
I
.
tout ce
On
conçoit
nous
,
sans
fa)
C'est
cette
cité ailleurs:
j'ai
est
employés
comme
p
qu'il
soit besoin d'en avertir
,
que
,
cesse
d'avoir lieu
quand
ces
verbes
verbes attributifs.
construction
qu'on remarque dans un texte de l'AIcoran que
Vf K»y> Çi\y>. ^\ji{n.° 87 note).
fyÛ ^f Vf
f^fU ^f
fçjjà
la même chose que
mot
doivent donc pas être confondues.
venons de dire de la construction des verbes
que
abstraits avec leur attribut
sont
ne
"ni- sous-entendu,
Vf ;
mais le véritable
sujet
du verbe
est
alors le
DE
LA
SYNTAXE.
335
Observons,
passant, que lorsque l'attribut du verbe
verbal
^b"
adjectif
qui a lui-même un complément objec
tif ou un complément circonstanciel on place assez souvent
ce complément immédiatement
après ïe verbe abstrait avant
le sujet et l'attribut. Exemples :
012.
en
est un
,
,
U-jU» ô^j ***^f
U
$,
/y. [fe
Zéid jeûnoit le vendredi;
éfj îàj,-à>\ tAiJ '£*>\
—
%»f
oj>j éUUJs
ton
ôU
frère
Zeïd
a
désira ;
te
passé la
nuit
a
manger
tes
vivres.
Ce genre de construction est rare avec un complément
objectif immédiat, comme dans le dernier exemple.
613.
verbes
\£>
J'ai
qui
parlé
ont
ailleurs
pour
penser. Le sujet
(n,os
complément
et
nominale
proposition
,
1 1
4
un
sujet
?
115,
1
et un
84
et
346)
attribut ,
comme
l'attribut forment réellement alors
dont les deux
termes
peuvent
,
des
une
ainsi que
dispositions respectives. Je ne répé
ai
dit
terai pas ici ce que j'en
précédemment.
61 4- Dans les propositions nominales qui entrent dans la
composition du discours, comme termes circonstanciels, sous
forme d'expressions adverbiales l'attribut doit être nécessaire
cette disposition étant un des signes
ment placé avant le sujet
qui caractérisent ces sortes de propositions (n.° 122).
le verbe
,
admettre diverses
,
,
S. II. Construction
mens
615.
Les
du
Verbe
OBJECTIFS MÉDIATS
complémens objectifs
et
ET
de ses
Complé
IMMÉDIATS.
du verbe
(a) doivent naturel-
joins ici une observation que j'ai oublié de faire lorsque j'ai parlé
complémens des verbes : c'est que ces complémens sont appelés en
général jdLl$ et au pluriel ^a>Xîj par les grammairiens Arabes ; nom qui
(a)
Je
des divers
,
»
DE
33^
SYNTAXE.
LA
placés après le verbe et le sujet : cependant il arrive
très-fréquemment que ïe complément objectif se met entre le
lement être
verbe
6 1 6.
sion
sujet,
et son
est
En
ou
général
permise
même
avant
le verbe.
peut établir pour règle que cette inver
les fois qu'il n'en résulte aucune équi
on
,
toutes
voque dans le .-sens, et qu'au contraire il faut s'astreindre à
l'ordre naturel quand l'inversion peut rendre le discours ambigu.
d'inversion
Exemples
:
C'est toi que
adorons ,
nous
cîlljfl
iuu
(jv.»
O^aJ
é$\j>\
c'est de toi que
et
nous
réclamons h
secours.
OU
jj-f \0-?j i-ij^
.
renferme aussi divers
Amrou
termes
a
jj&
frappé
circonstanciels,
CJ>i> IOtîJ
Zeïd.
comme
le
terme
circonstanciel d'état
et celui de
spécification ^yy^Jf Le mot xJLlà signifiant proprement
superflu, ce qui est au-delà du nécessaire, je pense que ce nom a été donné à
ces
parties accessoires de la proposition, parce qu'elles sont comme surabon
dantes à la constitution de la proposition qui consiste essentiellement dans
i'union d'un sujet et d'un attribut. Et en effet le complément complexe des
verbes de cœur et autres du même genre (n.° 1 4) qui est formé réelle
^JL^f
.
le
,
,
1
,
ment
d'un
Voyelles
sujet
dont le
»
»
»
d'un attribut, n'est
commentaires de
XAlfiyya sur
point compris
ce vers
yU^ (jy? ^•CJO**-
J*a-&- y
5»
et
sens est
«
qu'il
doit être
de
dénomination.
d'Ebn-Malec,
^'fri"h
permis
»
sous cette
O'
J^f
supprimer
le
*■***■*
CJÔ^J
complément objectif
d'un verbe, pourvu que cela ne nuise point à la clarté du discours auquel cas
on ne doit
point le supprimer : par exemple , on ne peut pas le supprimer en
,
question qui a pour objet ce complément, comme si l'on
qui avrçvous frappé ! On neîe peut pas non plus quand onresl'action du sujet à un certain complément, en disant : Je n'ai frappé que
répondant
vous
à
une
demandoit
v
treint
»
Zeïd.
»
Voyelles
Mss. Ar. de S. G. n.° 465
,
fol.
6y
verso,
96
verso
,
&c.
DE
Wy.
ilké
LA
SYNTAXE.
3}J
>U| (jl^li "AïjJj S'y» ôy^y>
oJ^'
Z)^j
porc-épics accouroient en troupe autour de leurs tentes pour
(recevoir la nourriture à) laquelle Atiyya les avoit accoutumés.
Si
interprète^
vous
£6^
—
y
£(f>'j6" (A&
Dieu peut
6 1 7* Si
cette
vision.
*»f
tout.
l'action
exprimée par le verbe est restreinte au com
plément du verbe par les particules L^l seulement ou V^ sinon,
le complément doit nécessairement être placé après le sujet. Si,
au contraire, la restriction tombe sur le
sujet, l'inversion est né
cessaire. Exemples du premier cas :
o^.j £Sy°
Vf
o«jJ éSy°
Exemples
i>
U"f
C'est Amrou que Zéid
Lo Zeïd n'a frappé
du deuxième
^3 ^ ^r>y°
—
^3 VHj.^ C/y»
frappé ;
qu'Amrou.
cas :
^ î C'est Zéid qui
o—
a
U Ce n'est
a
frappé Amrou;
aucun autre
que Zeïd qui
a
frappé
Amrou.
On peut
le sens n'en
cependant avec Vf s'écarter de cette règle, parce que
reçoit aucune ambiguïté.
6 1 8. Quand le complément est en rapport d'annexion avec
un
pronom affixe qui se rapporte au sujet l'inversion est per
mise et d'un usage très commun. Exemple : o*£ %j <jU.
Mohammed a craint son seigneur [reveritus est dominum suum
Mohammedes ]'.
,
-
6 1 0. Quand le sujet
nom
affixe
qui
se
est en
rapporte
/// PARTIE.
au
rapport d'annexion
complément
,
le
avec un
complément
Y
pro
doit
338
DE
précéder
ïe
c'est
licence.
une
sujet;
si l'on
et
Exemples
se
permet
une
autre
construction,
:
o'jfc^IcWî ^L
*
Lorsqu' Abraham
SYNTAXE.
LA
fut éprouvé par
suusj.
son
seigneur [quando
tentavit
Abrahamum dominus
Zw
actions
enfans
de
et
d'Aboul
ses
-
récompensé de ses grandes
Sinmar fut récompensé de ses
Gaïlan l'ont
bienfaits,
comme
travaux.
620. Lorsqu'un même verbe a deux complémens objectifs
le premier de ces deux complémens, exprime, du moins le plus
souvent, une personne ou une chose qui agit sur la personne ou
la chose qui forme le second complément. Ceci a été développé
précédemment (n.os 181 et 182). La construction indiquée
,
par l'ordre des idées est de mettre le complément
qui exprime la personne ou la chose qui agit, avant celui qui
exprime la personne ou la chose qui est l'objet de l'action.
en
ce
cas
621.
On doit observer
sion rendroit le
est
restreint par L* ^
est un
cette
louche,
sens
ou
pronom affixe.
V£
,
quand l'inver
quand
complément
le
quand
premier complément
construction,
2.0
3 .°
Exemples
1
.°
le second
:
foôj -oXtcf j'ai donné a Zeïd Amrou;
l^Ji V^ fooj o^licf U je n'ai donné a Zeïd qu'une pièce d'argent;
\\ i ix&s. f je lui ai donné une pièce d'or.
fjl
°£
fj
622. On doit
inverse ,
ou
et
quand
quand le second complément est un pronom affixe,
premier un nom ; 3 .° quand le premier complément est en
Vf;
ie
.°
contraire faire usage de la construction
le premier complément est restreint par 15 f
au
1
2.0
DE
rapport d'annexion
second. Exemples :
Iojj
Vf
10^3
*
UA—jIj
pronom affixe
avec un
U
C^ji K^asA
4*"^
SYNTAXE.
LA
je
qui
rapporte
au
n'ai
point donné une pièce d'argent
d'autre qu'a Zeïd;
quant a la
a Zéid;
fj^
339
se
l'ai donnée
pièce d'argent, je
j\ô3\ o^l*f j'ai fait habiter
a
la maison par celui
qui
l'a bâtie.
complément qui fût en rapport d'an
pronom affixe qui se rapportât au premier on
Si c'étoit le second
nexion
avec un
pourroit user
de
donc aussi bien
Zéid
son
l'inversion,
ou
suivre l'ordre naturel. On diroit
*JU olLcf
fô^J
*JU ù+j o»1Lc[
ou
j'ai
donné
a
argent.
Hors les
623.
ment
,
ïes
cas
complémens
indiqués,
à
on
peut construire
respective
volonté. Ainsi l'on peut dire:
^ÔJ\^j J^sfj [ylyJ f ) je revêtirai de tissus du
voir ;
\ù>j fj [y lyï) f ^jy f ( viendront
Yémen
ceux
qui
vous
V
$>j\ Ls>3 o^cf /
—
'
"
Io
§.
j
,
jj
.
,
s
>
^*ji o^i»cf ]
j'ai
donné
Construction
III.
une
du
pièce d'argent
Nom
a
Zeïd.
de
et
ses
Complémens.
624.
observer par rapport a la construc
forment les deux termes d'un rapport d'an
La seule chose
a
tion des
noms
nexion
c'est que l'on ne peut s'y permettre aucune inversion ,
ne doit interposer aucun terme
étranger entre le consé
et
,
qu'on
quent
et
exposées
qui
l'antécédent. Cette
ci-devant
règle et ses exceptions
(n.os 216, 236, 252).
ont
Y
2
déjà
été
}40
BE
SYNTAXE.
LA
$. IV. Construction
des
Termes circonstanciels.
02.5. On peut en général appliquer aux différentes sortes de
complémens des verbes dont nous avons parlé ailleurs (n.° 1 70),
ce
que nous venons de dire des complémens objectifs : leur
place naturelle est après le verbe ïe sujet et les complémens
objectifs ; ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse intervertir quel
quefois cet ordre, pourvu qu'il n'en résulte aucune équivoque.
Ces divers complémens circonstanciels n'observent point non
plus entre eux un ordre fixe et déterminé.
626. Nous nous contenterons de faire ici quelques observa
tions sur la construction des termes circonstanciels qui indiquent
la manière d'être l'état ^t^f et qui font, à l'égard de la per
,
,
,
,
sonne ou
,
de la chose dont ils déterminent
l'état,
la fonction d'un
lorsqu'on dit U%>fj j>£ sU. [à la lettre, venit Amrus
equitantem ] c'est comme si l'on disoit &£=*\j J*j jfé ^ Amrou
est venu et il étoit a cheval [venit Amrus et
ipse equitans].
attribut
:
,
,
,
627. De même donc que, dans la construction
sujet doit précéder l'attribut , de même aussi le nom
la personne
ou
tancielle d'état
tanciel. Mais
la chose
Jl
sujet
de
est
s^^3
cette
l'attribut,
l'objet
qui exprime
de la détermination circons-
doit
précéder ce terme
précédemment (n.° 504)
>
le
circons
que l'on
règle par rapport à la construction du
et employer une construction inverse:
nous avons vu
peut s'écarter de
et
^f
—
qui
naturelle,
ïa même inversion peut avoir lieu dans le
Ainsi l'on peut dire également
Zeïd est venu en se hâtant.
lcj-li o^J
*U.
cas
ou
dont il
ou)
s'agit.
UjuU si*
II faut pour cela qu'il n'en puisse résulter aucune équivoque.
Ainsi, si l'on veut dire Zeïd rencontra Omar qui étoit a cheval , il fau
dra nécessairement dire
l*U=? [3 j£ o^J $'>
et
l'on
ne
pourra pas
DE
341
SYNTAXE.
LA
direJZé lÇ%»îj où) JjJ
, parce que le terme circonstanciel paroîtroit alors déterminer l'état de Zeïd, et non celui d'Omar.
628. L'inversion ne peut pas avoir lieu, i.° quand le terme
de Vf
circonstanciel
est
tUU VI
U Zéid n'est pas venu autrement
le
oûjïU.
précédé
de la personne
nom
terminée par le
ou
dans
comme
,
exemple
qu'a pied ; 2.0 quand
cet
,
de ïa chose dont la situation
circonstanciel
est
dé
forme le
complément d'un
rapport d'annexion; exemple : *JU fj».f>$è. o*Us j'ai tué le
page de Marie tandis qu'elle dormoit; 3.0 quand le nom de ïa
terme
,
,
personne
terme
ou
de la chose dont la situation
circonstanciel ,
est
le
déterminée par le
d'une préposition. Ainsi l'on
régime
est
doit pas dire oX&i «-JU. J& Ji ; il faut dire *-JU* oIàj
O/nar a passé près de Hind , qui étoit assise (a).
ne
Dans le second
constanciel L/U
cas
entre
,
on ne
*>^U
pourroit
et
j^Ji,
peut rien interposer entre les deux
nexion (n.° 216); on ne peut pas
circonstanciel
que
,
dans
pas
parce
jJ& 3*
placer le terme cir
qu'en général on ne
d'un rapport d'an
plus mettre ïe terme
termes
non
l'antécédent du rapport d'annexion , parce
rapport d'annexion , le conséquent représente
avant
un
proposition conjonctive et l'antécédent représente l'anté
cédent d'une proposition conjonctive (b)
et que
dans ce
dernier rapport, un terme accessoire de la proposition con
jonctive ne peut pas être placé avant l'antécédent de cette pro
position.
629 L'inversion est au contraire quelquefois d'une nécessité
indispensable : par exemple, i.° quand le nom de la personne
une
,
,
,
.
ou
de la chose dont la situation
(a) En
ce
notamment
(b)
dernier
cas
7 l'inversion
est
est
déterminée par le
terme
permise par quelques grammairiens,
et
par Ebn-Malec.
Le cheval de Zéid équivaut à cette
expression , le cheval qui appartient à Zéid.
3^2.
DE
circonstanciel ,
se trouve
même valeur
exemple
à
venu
;
pied personne
rapport d'annexion
qui
fait
précédé
ou
que Zeïd; 2.°
autre
avec un
d'un
IXsU ïU. U
o^'j VJ
:
de Vf
qui a la
_>Âc
/'/ n'est
ou
quand
qui
pronom
autre mot
se
oo)
ce
nom est en
rapporte à
un nom
partie du terme circonstanciel, <f±£ jt-> <j*. U%=lj
«_jUs>f
sur son
SYNTAXE.
LA
ly o-Âf
des compagnons de Mohammed
un
âne ( c'est-à-dire
63O.
Le
terme
circonstanciel
le même antécédent qui
dont ïa situation
est
monté
l'âne de Mohammed).
sur
,
est venu
*U.
régit
le
est
toujours logiquement régi par
nom
déterminée par
de la personne ou de la chose
ce
même
circonstan*
terme
"ciel. Ainsi, lorsque je dis ^=>Yj o.jj sU. Zéid est venu a. cheval, oJj
est
régi,
agent, par le verbe sU.
comme
quement par le même verbe. Si je dis
si
tu
étois ,
affixe Ce
paraissant
en
est
le
régime
sur
de
LÇ^=>[3 est ^gi l°gijo^Jf l^iLU <A& comme
et
,
l'horizon la pleine lune le pronom
jjls et Uilt est logiquement régi
,
,
,
par la même particule.
I
Lors donc que le
63
nom de la
personne ou de la chose
déterminée par le terme circonstanciel', se
verbe ou à un adjectif verbal qui lui sert d'attribut,
.
dont la situation
rapporte à
on
peut
un
est
le
mettre
adjectif verbal.
terme
circonstanciel
avant ce
verbe
*^* ^4^
Zéid
Ainsi l'on peut dire ooj
pied ; J^yb fo^-U. il prie prosterné ; lo oôj
invoqué (Dieu) avec une pure dévotion; parce que
a
dire
su.
632.
l'attribut
ojj
et
y> j+aa
-
o*±j iW^
Cette construction n'a lieu
est
exprimé
gaison parfaite
de cette espèce
mêmes lettres ,
ou
,
,
et
et
par
un
verbe
ou cet
est venu
^\jâ Zeïd
l'on
a
pourroit
.
régulièrement que quand
susceptible d'une conju
adjectif verbal dérivé d'un verbe
qui exprime lé même sens renferme les
par
peut
un
,
,
comme
le verbe
,
admettre la différence
LA
DE
des genres
des nombres
et
(a) ;
encore
cela est-il
restrictions. Nous n'entrerons point dans
meneroient trop loin
^43
SYNTAXE.
ces
sujet à quelques
détails, qui nous
qui d'ailleurs dérivent pour la plus
grande partie
règles qui ont été données pour la construc
tion du sujet du verbe et de l'attribut. Ainsi par exemple
on ne
peut pas dire jpîf U?^ certes je frai le pèlerinage nupieds ; mais il faut dire UsU. j^arY, parce que l'adverbe d'affir
mation J veut être placé immédiatement avant ie verbe. On ne
peut pas dire non plus ~J£ U^U ^f caillé tu dois faire le péleri,
et
,
des
,
,
,
nage h
pied; il faut
jonction £)f ne peut
situation
mier
par
est
verbe
63 3
•
Les
nomment
"2"
£jf lAsSé,
parce que ïa
con
pas être séparée du verbe. Le nom dont la
déterminée par le terme circonstanciel dans ïe pre-
exemple,
ce
IX^U
dire
,
:
est
Lif
je
,
renfermé dans ïe verbe
dans le second
exemple,
c'est ôof
lfst\i
et
régi
tu.
circonstanciels que les grammairiens Arabes
spécifcatifs (n.° 120), doivent toujours être
termes
y-b-à
placés après le mot dont ils spécifient ou restreignent la signifi
cation
j^-lf Ainsi il faut dire UJé o^jj s-4-«->' Zeïd a été
trempé de sueur; LTJû o^C CJ& Zeïd a consenti de son gré (à la
lettre, a été satisfait quant à l'ame) ; <iU* l^â-j ly»^ jj& Amrou
est
cfLT^â. il te suffit pour cava
plus beau de visage que toi; HjU
lier; U»i jj'jVf ïj* plein la terre d'or.
6^4' Cependant, lorsque le mot dont la signification est
restreinte
par un terme circonstanciel spécificatif, est un verbe
susceptible d'une conjugaison parfaite on peut quelquefois
placer le terme circonstanciel avant le verbe ; ce qui ne doit
v
.
«
,
fa)
Ceci exclut les verbes admiratifs
version peut
Vqyei
et
cependant
le Commentaire
avoir lieu
sur
avec
KAlfyya,
et
ces
les
adjectifs
verbaux
superlatifs.
Lin-
derniers dans certaines circonstances.
Mss. Ar. de S. G.
n.°
465
,
fol. 90
suiv.
Y4
versa
344
LA
DE
SYNTAXE.
néanmoins être considéré que
ne
licence.
comme une
Exemples
tandis qu'il
Leïlaforcera-t-elle donc son amant à s'éloigner d'elle,
seroit pas disposé a se séparer volontairement !
f^)\ ly
ô-^ç
jmaj
(j^^Xî Pj^*J
:
J^ iMo-wj
(jr^f
peine ( à la lettre, quand je suis trop court
du bras), on ne me voit point m' abaisser h d'humbles prières ; et
de me trouver
lorsque je suis dans la détresse, je ne désespère point
un
Quand y e
suis dans la
jour dans
une
situation heureuse.
quelquefois, quand le mot
restreint par le terme circonstanciel spécificatif n'est point un
verbe d'une conjugaison parfaite comme dans ce vers :
Cette licence
635.
a
même lieu
,
On
une
voit
ne
vérité
C'est
feu semblable à notre feu; c'est-là
les familles descendues de Maad.
de
point ailleurs
reconnue
l^JbL qui
de
toutes
est
restreint par le
Ainsi la construction devroit être
qui
lui ressemble
S.
V.
en
fait
leurs
À
fjtf
circonstanciel
UU* y>
*
J
on ne
IjU
.
voit rien
feu.
Construction
RELATIVEMENT
À
de
terme
des
LEURS
Prépositions
ANTÉCÉDENS
ET
Conséquens.
l'exposant d'un rapport qui existe
entre deux termes un antécédent et un conséquent. La construc
tion naturelle exige donc que la préposition soit placée après
l'antécédent et avant le conséquent. Rien n'est plus commun
néanmoins que l'inversion qui place la préposition et son complé
636.
Toute
préposition
est
,
l'antécédent du rapport
lieu nécessairement quand le
non-seulement
ment avant
:
sion
nom
a
qui
sert
de
cette inver
complément
DE
à la
LA
SYNTAXE.
345
ûJfy '^auprès
préposition
interrogatif,
as-tu passé f
foi
éj^fù>\ fj} '+& pour combien de pièces
Cj>jJ\
d'argent as-tu acheté cet habit! ou un mot qui renferme la valeur
d'une interrogation comme ôof oiJ Hs\ [y cJj^f ^ je ne sais de
est un mot
comme
de qui
,
quel pays
de
cune
tu es ;
ces
elle
se rencontre
encore
très-souvent ,
dans le discours
circonstances,
les
et sur-tout
sans au
dans le
si communs,
exemples
qu'il est
style poétique;
inutile de s'y arrêter. Lors même qu'il n'y a point d'inversion
on n'est point astreint à placer l'antécédent immédiatement avant
la préposition. Il arrivé néanmoins fort souvent qu'une préposi
tion et son complément sont placés immédiatement après le verbe
qui leur sert d'antécédent et avant le sujet du même verbe.
Lorsqu'un même antécédent sert de premier terme à plusieurs
rapports l'ordre des diverses prépositions et de leurs complé
mens est arbitraire, ou
plutôt dépend en partie de l'harmonie,
en
partie de l'intérêt que celui qui parle attache aux différentes
parties du discours. Mais ce qu'il faut consulter avant tout c'est
la clarté de l'expression.
637 Quant au conséquent ou complément de la préposi
tion il doit régulièrement suivre immédiatement la préposition
qui le régit. On trouve cependant quelquefois le mot U explétif
placé entre la préposition et son complément. Cela n'a lieu
<°y et ly Avec les prépositions
qu'avec les prépositions
ôj et tJ le mot U> ne peut point être regardé tout- à- fait
comme explétif, parce qu'il devient leur complément et forme
de ces particules des adverbes conjonctifs. Cependant on trouve
quelquefois <L>j et es) suivis de U explétif et conservant leur
influence sur le nom qui leur sert de complément.
63 8. II nous resteroit encore beaucoup d'observations à faire
et
en
sont
,
,
,
,
.
,
c->
-
.
,
,
pour déterminer
toutes
les circonstances de la construction de ïa
langue Arabe, par rapport tant aux parties constituantes de chaque
34^
DE
LA
SYNTAXE.
proposition, qu'aux diverses sortes de propositions affirmatives,
subjonctives impéra tives optatives conditionnelles suppositives conjonctives adverbiales ou incidentes qui peuvent être
dans des rapports réciproques de dépendance les unes avec les
autres : mais il est difficile de réduire à des
règles positives l'or
donnance respective de tous ces élémens du discours ; nous
croyons d'ailleurs que ce que nous en avons dit est suffisant, et
que le surplus s'apprendra mieux par la lecture et l'observation
que par des préceptes.
Pour compléter l'enseignement de la grammaire Arabe, il ne
nous reste
plus qu'à parler de deux figures grammaticales qui
sont d'un
usage fréquent l'ellipse et le pléonasme.
,
,
,
,
,
,
,
,
CHAPITRE
De
639»
J 'A
XXXII.
l'Ellipse.
occasion de remarquer diverses ellipses
fréquent dans la langue Arabe. II en est
I eu souvent
d'un usage
qui
quelques-unes dont
sont
dois faire mention ici d'une manière
je
particulière.
64o.
On
-entend
fréquemment ïe verbe qV*, ou son
adjectif verbal *y>y formant l'attribut grammatical de la pro
position ; et l'on exprime seulement quelque terme circonstan
ciel qui fait partie de l'attribut
complexe (n.° i45 )• Exemples :
sous
,
Le sixième
(appartiendra)
*
<2lfi
La
puissance
de
faire
$
ne
mère.
trouve)
point
j
^fi. ëjôi» ^
cela
sa
a
(se
[*
en
moi.
DE
Certes, dans
cette
le sang
mort dont
•
dire,
n'y
a
le
sans
pas
rocher, (se
trouve)
de verbe
un
vengeance.
proposition nominale c'est-àexprimé (n.° i44) doit être le
d'une
sujet
point
est sous un
qui
ne restera
64 1 Lorsque
où il
vallée
347
SYNTAXE.
LA
,
,
les poètes l'omettent souvent.
pronom de ïa troisième personne ,
femelle de
C'est ainsi que Caab ben-Zoheïr, dit en parlant de la
chameau
qu'il
j.
décrit
,.
:
jT-o-
i-*.-
--'-»
\*jî\'t*\
•
***'
JJJù Aïy 1£fj U^» ^y, ^' ^j*' t-u*
Elle est comme la pointe d'un glaive ; son frère est en même temps
est aussi son
son père : elle est d'une race noble; son oncle paternel
oncle maternel; elle a la tête longue et le pas agile.
Ne crains rien;
Son nei
est
relevé
'
"
V
'i H
(nous sommes)
en
bosse
pour
quiconque s'y connoît
joues
est une
peau douce
au
,
;
deux adversaires
dans la
forme
preuve de
toucher.
une
sa
de
ses
(a).
oreilles
noblesse ;
est
,
et sur ses
dans
premier exemple o3* tient neu de Oj» û£ '»
ïe second, 0i^k tient lieu de oU-ii ^ ; dans le troisième,
tïp est pourra" j*. On voit ensuite deux exemples de l'ellipse
Dans le
,
de l'attribut.
642. Quelquefois on fait ellipse du sujet d'une proposition
mot
verbale parce qu'il se trouve dans ce quij>récède quelque
qui peut l'indiquer. Exemple : ^^Is^Ji JiiiU *4& (fjh* >}.
,
(souviens-toi)
de
ce
(a) Voyei l'AIcoran,
qui
sur.
eut
38,
v.
lieu
23.
lorsqu'on
lui
présenta
le soir les
348
DE LA
chevaux excellens
dit
33
33
La
SYNTAXE.
j'ai
détourné du souvenir de
mon
soleil)
Le
préférence
cacha
se
sous-entendu
verbe ,
qui
ïa mention
est
de leurs
terre
donnée
aux
pieds,
biens de
Seigneur, jusqu'au
les voiles (de la nuit).
ce
et
qu'il
monde m'a
moment ou
(le
eacha ,
est
33
sous
le soleil ,
jllwf
mot
la
qui frappoient
que
ce
:
du verbe
sujet
ôj'p
se
indiquée .° par le genre du
ellipse
du féminin , comme le nom sous-entendu ; 2.0 par
et cette
:
est
est
1
,
peu de mots auparavant, du soir, qui
synonyme du coucher du soleil ou du moins de son déclin.
On fait assez souvent, lorsque plusieurs noms doivent
qui
a
faite,
été
,
643*
être
en
rapport d'annexion,
l'ellipse
de
l'antécédent,
en ne con
servant que ïe conséquent. Si trois noms sont en rapport d'an
nexion , le premier avec ïe second , et le second avec le troisième,
on
supprime
aussi
Ils
ont
été imbus , dans leurs
c'est-à-dire , de l'amour du
tpÉ
est
donc pour
c
pris
est-à-dire,
pour
une
veau
J.lsJ\ <1*a
qu'ils
«
trace
J^T^î Jf\
est donc
comme
pour
du veau;
avôient fait pour l'adorer.
3
o
,.'.
de Id trace de
du cheval de
«r-
(j^
«aAc
l'envoyé;
l'envoyé. À^f)\ j-jf
est
ici
.~u>i>J JJ"S\
^jisuJ (jàJo &-++£\ Jj0~ï
-•-»
•*
Leurs yeux tournent comme celui
des approches de la mort;
c'est-à-dire,
,
.
«"Vf»
Oj-U
cœurs
£ -o.-.
poignée (de terre)
de la
premiers. Exemples :
.
Jï(f ?.f
t
Je
les deux
quelquefois
le
tournement
,jà}\ <^f
j/os*.
qui perd
■>
-
connoissanee à cause
des yeux de celui
qui
&c.
ijà)^
DE
34^
SYNTAXE.
LA
\>4A\ Quelquefois l'antécédent étant sous-entendu
demeure
plément
,
le
com
mais il faut pour cela que l'anté
génitif;
exprimé précédemment avec un autre conséquent.
J'en ai donné ailleurs des exemples ( n.os 2 1 4 et 2 1 5 ).
J'ai donné aussi des exemples de l'ellipse du conséquent dans
les rapports d'annexion (n.° 2 1 3 ).
645 ^n fa** très-ordinairement l'ellipse du nom de Dieu,
lorsque l'on rapporte quelque passage de l'AIcoran ; et l'on fait
pareillement l'ellipse du nom de Mahomet quand on cite quelque
parole ou action de ce législateur.
64®- Si le mot dont on fait l'ellipse est le sujet d'un verbe
au
cédent ait été
'
,
,
comme
dans
JU*
il
tion ,
qui
dit,
a
dans le verbe ; mais
on
on se
fait connoître si le
sujet
pronom renfermé
formule de bénédic
contente du
ajoute ensuite
une
sous-entendu
est
Dieu
ou
Ma
premier cas cette formule est (JiJJî qu'il soit
exalté, ou bien Jâ.1 ji> qu'il soit glorifié et loué; dans ïe second
cas, on emploie la formule 'ÀJLJ *JU*J«wof J^ que Dieu lui soit
propice et lui accorde le salut ou une autre analogue à celle-ci,
comme
/iLj{3 V^*^ J~*jf **J* que les faveurs les plus précieuses
et le salut le plus excellent reposent sur lui.
o4j' Si le mot dont on fait l'ellipse est le complément d'un
homet. Dans ïe
,
,
rapport d'annexion , on lui substitue le pronom affixe » ; et la
valeur de ce pronom est déterminée par la formule qui vient
immédiatement
après
,
comme
dans le
cas
précédent. Exemples :
J
3
fS
,»
S
J
j
iXljJùI j li iif 1C3
emploie ( l'adjectif verbal de ) la forme afdhal, sans
intention d'indiquer une idée superlative ; de ce genre est cette parole
de LUI, qu'il SOIT exalté! (c'est-à-dire, cette parole de
Dieu )
Votre Seigneur sait bien ce qui est dans vos âmes.
Souvent
«•
on
33
DE
350
0/z
,
trouve
SALUT!
33
33
les deux
que Dieu
*_L>oClf
C'est de
Moïse
33
,
ville.
lui soit propice et lui accorde le
(c'est-à-dire,
il pas que je
le plus! 33
vous
dans
«Ùc ^fy»
ville que Dieu
lequel puisse
a
648.
tout
sont ceux
d'entre
ce
vous
Ne
faut-
que j'aime
[yz (J,[*3 *fyo (>é UGf^
entendu
parler, lorsqu'au sujet de
reposer le salut! il dit :
ce
II
entra
dans la
a
dit
au
sujet d'Abraham.
qI^,
que pour cela l'attribut cesse d'être à l'accusatif. Cela
lieu après ïes conjonctions t)f et
^ Exemples:
a sur
On fait
assez
fréquemment l'ellipse
.
promptitude
a
sois) pied.
avec
Donne
une
Mahomet)
du verbe
Va
tu
de
33
C'est pour cela que Dieu
sans
mot
ce
apprenne quels
Jlkîj'XJf
cette
sur
l\& JÀ»f
J^ *}Js j o^y' ç&î-î «N*j
manières de s'exprimer réunies dans ce mot de
^jj z£l^.li *J=>j^.\ Vf 'L»j
lui
SYNTAXE.
LA
,
bonne
«/W«
quand
,
soit
bien même
(que tu sois)
(ce seroit)
monté
Zeïd
ou
cheval
ou
(que
Amrou;
tu
feras
a
œuvre.
J
„
«C
J^'j J4^f ^£* ^° **y4Celui qui
\£x*
j}j c& y* y>c>5\ ly^.y
commis
l'injustice ne sera jamais a l'abri de la ven
(ce seroit) un roi dont les armées seroient si
geance quand
nombreuses que les plaines et les montagnes ne pourroient les contenir.
,
a
même
Cjuîï Uj'fai uit ûi V *•** l>y£ C(p- 0-^
Toutes les branches de la tribu de Dhabba
ont eu
des sentimens
DE
de
SYNTAXE.
Les hommes
y&J. f^s^ (jfj cav*^
Et l'homme
si
si
(son
(son
sera
tué
avec
suivant leurs
du bien
«~*
I
injuste
Ô^K'A ôy.fé «jZllN
récompensés
seront
sont) bonnes, (il leur arrivera)
(H leur arrivera) du mal.
:
d'une
(ceux qui étoient) coupables
(ceux qui en étoient) les victimes.
soit
3_£s' fji ôfj j££ fjy.
tuer
35
moi , soit
pitié pour
violence,
LA
; si
(elles sont)
ô] H u^
la même
arme
œuvres :
^ uy&>
dont il
si
(elles
mauvaises,
*y^3
se sera
servi pour
été) une épée, une épée (lui donnera la mort);
été) un poignard, un poignard (lui donnera la mort).
arme a
arme a
point que plusieurs de ces exemples seroient
susceptibles d'une analyse différente, dans laquelle on suppo
serait une autre ellipse que celle du verbe y?
Dans le dernier exemple, au lieu de IJ^ q\' ££j»à Uu*L y
Je
ne
dissimulerai
.
j£à,
roit
on
pourroit dire ïj-iâ-'i fj^i. <jfj
encore
dire
fjjsiCi %££. y^
j£âj£± iy^ cj^3
offre des
cevoir,
.
Uûli
Chacune de
ellipses différentes,
Ullj IXU
«3^ ôL
ces
comme
»
et
y
est
On pour
même
manières de
il
.
££JL y
s'exprimer
aisé de s'en aper
y
ellipse du complément immédiat
d'une préposition : mais ce genre d'ellipse est très-rare ; j'en ai
donné un exemple ailleurs (n.° 826, i.re p.).
65 O. Après (X totalité et les autres mots qui doivent de leur
nature être
employés en rapport d'annexion, on fait souvent
du
l'ellipse
complément, comme je l'ai déjà observé (n.° 202 ).
65 I. Il arrive assez souvent que deux propositions condi
tionnelles étant en opposition l'une avec l'autre et devant avoir
chacune pour complément (n.° 30) une proposition indicative ou
649 Quelquefois
.
on
fait
,
DE
352
SYNTAXE.
LA
impérative, on supprime celle qui devroit servir de complé
ment à la
première proposition conditionnelle. L'opposition qui
doit être entre ces deux propositions, suffit pour indiquer cette
ellipse. Exemples :
lsiîL
.*>
oy^j csULuj oa-wJI oj*°f VL <J*Jy
jj* o-*^™
•*
Si
oo
yl
*.
fais pénitence et si tu renonces à tes discours (je te pardon
nerai), sinon je donnerai ordre à mes serviteurs de t'écorcher ; je
remplirai ta peau de paille et je te ferai pendre à la porte de
tu
,
,
Zoweïla.
£
S'il paye ce qu'il doit,
appartient
et ses
et tout ce
qui appartient
sinon tu vendras tout ce qui lui
:
à
gens, et
d'Alexandrie (a).
gens dans la
ses
forteresse
ellipse a lieu
,
652.
(laisse-le)
£
Une semblable
tu
l'enverras lui
,
après les mots qui ren
ferment la valeur de la conjonction y^, ainsi que je l'ai dit ailleurs
(n.° 343 1." p. et 5 1,2/ p.). Tel est *yi9 dans l'exemple suivant:
aussi
,
(a)
et
dans
les
On
des
trouve
l'Évangile
auteurs
Grecs
'Am'
exemples
de S. Luc
n'en citerai
je
;
Ap<JZLV%Ç
Ej
M
iiov
Azfiù
Voyei ce que j'ai
des
ellipse dans l'Exode (ch. xxxil, v. 32)
9). lis sont aussi très-communs dans
qu'un seul tiré de l'Iliade (I, 135):
cette
xm,
v.
,
fyi Aûtmxn
«
yt&iç /umyœQvjbui 'Arguo)
Qv/UOV, 07TZàÇ kvIcLfyoV iÇO-f
JbSaenv iyù H xxv cdAoç i\cùjuui\
'
H
de
(ch.
m
■.
,
YATO,
jx/n
v\
,
Aïcurloç, ia>v yt&Ç, ri 'OJbmioç
ihCCV.
dit à
ce
belles-lettres, p. py
,
sujet dans
le
tome
XLIX des Mémoires de l'Académie
note.
U
DE
£j
P
LA
SYNTAXE.
353
&*&* J-jii tgo jisJf fayétt <J>1 oJû'aJÎ ^
JjiVf j ji\j °y$ ^Jjf jlai ^tNÂil <£ (>^} fS'y^
VJj
J* ^Aj le poison passe dans les 'veines dont le
sang est fluide
le congelé ; alors les canaux de la respiration animale sont
''
iSy~£
o^>j
*
*
,
et
obstrués
,
et
le
poison
se
répand
dans
tout
le corps
,
comme
l'huile:
quiconque se dépêche en ce cas d'avoir recours aux remèdes (peut
prévenir la mort) ; sinon l'on ne peut pas empêcher l'effet du poison.
On fait aussi quelquefois, après une proposition suppositive
exprimée par ^ l'ellipse de la proposition corrélative. Ex.
,
,
Si
imaginois un signe qui pût servir aux hommes a rectifier
leur prononciation et a fixer les voyelles des inflexions grammaticales
dans l'AIcoran (tu ferais une bonne chose) (a).
tu
,
j&jykïà
l5V
au
^y
ceux
et
qui
ont
où ils
jour
dos,
ij j\JJ\ &£y>.j ^^c
où ils
ne
ne
(jyXL>
été incrédules
,
V ($a.
savaient
(le
fjjA» ly.ôJl JAj y
i)jj^>. f Vj
sort
qui
les
attend)
pourront écarter le feu de leur visage ni de leur
trouveront aucun secours,
(assurément
ils
se con
vertiraient).
Une
6jf3«
ellipse d'un autre genre est celle par laquelle on
supprime dans une proposition un verbe qui se trouve indiqué
imparfaitement par un autre verbe exprimé dans la même pro
position, c'est-à-dire que l'on donne à un même verbe deux com
plémens dont un seul lui convient réellement, et dont l'autre
ne lui convient
qu'improprement et suppose un antécédent
qui a plus ou moins d'analogie avec l'antécédent du rapport
,
,
fa)
tic la
Cette forme
Philologie
d'expression
sacrfe de
est
usitée
en
hébreu
Glassius, par Dathe,
//.' PARTIE.
1.
et en
grçc.
Vqye^ l'édition
1, p. 522.
Z
LA
DE
354
SYNTAXE.
que l'antécédent exprimé suggère l'idée de
l'antécédent sous-entendu à ceux qui entendent ou qui lisent^.
précédent
Cette
ellipse
^cu* jiuj
sorte
en
,
fréquente
est assez
fj£it^3
Ensuite il
•
•
•
l'enfance ; puis
que
.et
.
Exemples:
^-j^ !>br^^ y î^9 <v^ ly^r y ^^ i*^j4 y
sortir
fait
vous
des vieillards.
•
arabe.
en
(du
sein de
vos
dans
mères)
parveniez a l'âge fait que vous
que
atteigniez un terme fixé.
vous
,
l'âge de
devenie^
vous
ojJ=>h\ y (i)Ua^Jf Vj £owf Uj
JdtaH seul
7w /?
et
me
l'a fait oublier, que je m'en souvinsse,
«LAÀACj *£j[ P0^4 A»| QlTSljJ
/ftz«.r w/z /ta* ^h'/7 semble que Dieu lui coupe le ne^
vwtff
les yeux.
Le
est
sens
dans le
,
vous
parveniez fj*&çf
PÉCHÉ que je
J*4
est
ne
renfermé
3
J
,3
premier exemple puis
,
implicitement
Dans le troisième
Uùf
dans le
; et
m'en souvinsse
ijcî est renfermé dans
second,
oJ^=»if ^f <>*x*j.
t-f£ ;
dans
et
,
cl>f3^f f
Il
empêcha
baiser la
(a)
«J
terre
que
et il a EM-
Ainsi le verbe
de même le verbe
.
exemple,
ïe
sens
est,
et
qu'il
lui CRÈVE
le verbe lÏJû étant renfermé dans
«^c ULàjJ
Quelquefois le verbe dont on fait ^ellipse
opposé à celui qui est exprimé. Exemples :
les yeux
IL fait
^.J
1CU2V
fj^ij S£ UVJi \Jy&
y ^jXf f '&J? '£*
notre
Seigneur
les hommes de lui dire
£0s£.
directement
est
,
et
de
ne
pas
devant lui.
Cest ainsi que Moïse dit (Exod. ch. XX, v. 18) : Tout le
peuple voyoit les
les éclairs et le son de la trompette c'est-à-dire, et ENTENDOIT le son
tonnerres et
de la trompette
,
;
que S. Paul dit
,
( / Cor.
ch.
III
,
v.
z) : ydha vjuàç iin-nou,
mi *
DE
SYNTAXE.
LA
355
J*î^j jU^lf KJj^j ûjQ (jfj' J^f *yyj ly yj^\ \y+*
Il fut
défendu
servissent , pour
II faut
ù)yô\
la
JUJf
montures
devant lui
avons
Nous
ne vous
sac. t.
(a)
.
I, p.
vous
un mot autre
sur
leurs
LEUR ORDONNA
de
ta
des
ai donné à boire du
terre
lait,
ai point donné à MANGER
ne
pas baiser
se
servir,
montures
pour
,
une
voiles,
des
fait
l'ellipse
Exemple :
on
verbe.
qu'ils
le comprennent.
lui
(montagnes qui
et non une
est
,
nourriture solide
,
servent
c'est-à-dire,
nourriture solide {voy. Glassius, Philol.
630).
yx.jux.7v
sac. 1.
,
dm ^toSaf
1. p. 629
et
Hanc
&pco/ud.7fov qui empêchent
Demipho
esse
se
nescire
dit aussi, par
marier
{voyei Glassius,
Phormion
Demipho !
scire ,
qui fuerit
scire ,
?
qui fuerit!
cognatam,
.
.
.
.
et AIT se
nescire
,
tenues
;
cognatam !
esse
esse
parasite
v.
3 ) :
de s'abstenir
,
ejus patrem, qui
se.
j. )
Stilphonem ipsum quifuerit! (Phorm. act. Il,
une
Acrior,
au
hanc sibi cognatam
negât
c'est-à-dire, hanc Demipho negat
Ne
dire de même
). Térence fait
Stilphonem ipsum
fuerit! AIT etiam se
se
ORDONNENT de s'abstenir des viandes
Nequt ejus patrem
Nie
Tint. ch. IV,
(/
de
,
Negat Phanicm
Virgile
de
:
jèu>jS=>j lyJ& y fjj-ffj
second,
qu'un
cœurs
placé dans
des viandes, c'est à-dire,
Thilol.
premier exemple
C'est ainsi que S. Paul dit de certaines gens
mhvoïlûiV
qu'ils se
,
aussi l'idée du verbe dont
mis
avons
(ipa)fjut, je
et
,
d'ânes.
dans le
sens
dans le
et
;
et
des chevaux
(a).
Quelquefois
je
de mulets
ainsi le
suppléer
renfermée dans
et
,
monter
et IL LEUR FUT ENJOINT
de mulets
Nous
chrétiens de
fjftj V £>f j^Jilj et IL
*J
terre
aux
semblable
ellipse ( Ceorg.
lib. I,
v.
yt)
:
pluvier rapidive potentin solis
Borcet penetratile frigus adurat.
,
aut
Z2
35^
DE
SYNTAXE.
de) pilotis solides, (de peur) quelle ne renversât les hommes
comme
en
LA
s'ébranlant.
premier exemple, le sens est, des voiles^qui empêchent
le comprennent, l'idée du verbe gS empêcher, faire obs
Dans le
qu'ils
ne
tacle, étant renfermée dans le
nom
second, il faut sous-entendre G^à. de peur que
l'empêcher i
mais
cette
idée de
renfermée dans celle de
pilotis
des voiles. Dans le
*!%=>f
précaution
,
bien
ou
Lg*& pour
contre une secousse est
solides.
On peut expliquer de même ce passage de l'AIcorarf, qui
paroît , si l'on n'a point égard à ce qui précède , susceptible d'un
double
sens :
fjO**t£ of _>è-Vf ^Jl^ À»L ôy^J \&-ô^
tiLjiulJ V
qui croient en Dieu et au jour du jugement, ne U
demanderont point la permission, qu'ils exposent pour la cause de
k«jufj °$Djh
la
religion
point
la
ceux
leurs biens
et
leurs vies
de demeurer
permission
;
c'est-à-dire,
che^
ne
demanderont
eux, et NE REFUSERONT
d'exposer &c. (a).
point
On fait
de ïa
préposition y après
$JLï pris adverbialement et signifiant h plus forte raison
(n.° 864, r." p.)> Pour entendre ce que je veux dire ici, il faut
6j4-
Je
souvent
ellipse
mot
observer que, si le mot adverbial -Xl* , dans cette signification,
est suivi d'un nom , on interpose entre l'adverbe et ïe nom
prépositions y*
ïes
ou
y» Exemples :
.
quelques gens de prendre les personnes qui lui
sont les plus chères, et à bien plus forte raison ses richesses Une U
le refusera pas.
Si
tu
donnes ordre à
,
(a) Voyei
sant
que
Alcor.
sur.
ç
,
v.
aj.6.
On peut aussi
^iU-wf signifie également
expliquer
ce
passage,
demander la permission
et
la
en
dispense.
suppo-
DE
LA
SYNTAXE.
357
*{*> y^
^iiiif
Le sang des enfans et des petits enfans est d'une nature trèshumide en comparaison de celui des jeunes gens et, à bien plus
forte raison, en comparaison de celui des vieillards.
,
Si le
poser
mot
entre
Xé3
est
l'adverbe
conjonction y
point
a
Ztf
plupart
le verbe ïa
t)f
d'entre
rapporter, bien loin
ou
,
doit de même inter
on
préposition y.
«jj^ii
U
d'y ajouter quelque
plus forte
user a
o3*^
n'ont pas même
fait
à
l'orphelin,
bien loin d'en
o* ^Ûls
eux
,
suivie de la
:
du bien de
discrétion
*!U* ôjJj
'
et
Exemples
.
N'approche^ pas
usez
suivi d'un verbe
discrétion,
f f$>jZ£=a\
connu ce
chose
que je viens de
(a).
de la
préposition y.
comme on le voit dans l'exemple suivant
JjJL U Jf tjjJJLï V
»j>sUj ô^ ^■*<l^ otioA-tlj qUïVLJ n'approche^ point de la forni
cation en en formant le dessein ou faisant les actions qui en sont
le prélude, bien loin de la commettre effectivement.
655. II y a un assez grand nombre de mots qui sont em
Mais dans
ce cas on
souvent
ellipse
raison n'en
:
,
*
,
,
ployés adverbialement et que ïes Arabes nomment jUïVf tLU
Tels sont y5&
ô^>" <*^jj ^3* 4^J> &c- Toutes ces
expressions renferment l'ellipse d'un verbe, comme quand nous
disons vite! hardi! courage! à toi! &c. On peut revoir ce que
.
,
-
(a)
Ce passage
est
"
~
~
tiré du traité de Razi
ou
Rhajes
,
de variolis
morbillis,
et
a
imprimé ^LaJ pour «iLoi et o^jr-t
p. 14; mais l'éditeur, M. Channing,
un
en traduisant
imo plerique eorum
contre-sens
a
^ait
au lieu de
oJjJ et
non noverunt
quid per ista voluit , que distincte memoravi.
.
>
,
Z 3
DE
358
j'en
ai dit ailleurs
(n.os 762
semblable ellipse dans
une
SYNTAXE.
LA
et
suiv.
frère,
ton
frère ; car
qui
va
ton
celui
combat
au
frère
c'est -à
,
n'a
qui
874,
//' p>
).
H y
a
ce vers :
o] <3lk1 éllll
'£ v y
'J
tjL jS# ÂJ$\ d[ &?
7 on
n.°
et
dire , HONORE
-
de
point
frère,
est
MÉNAGE
ET
comme
un
homme
sans armes,
ellipse pareille que l'on dit d û^jj malheur a moi!
le mot Sjj doit être considéré comme le complément d'une
proposition sous en tendue, par exemple : DlEU a DÉCRÉTÉ
C'est par
une
-
ENVOYÉ
ou
656.
négation
malheur.
un
ellipse Bien plus remarquable est celïe de la
serment seul, suivant les
grammai
rendant la proposition négative. Exemples :
Une
autre
avec
le serment, ïe
riens Arabes
,
3 j
'.3
j
..
i
%.
-
Ils dirent
de
33
:
ce
Joseph (a),
La
(a)
négation
n'est
point exprimée
dans le
8j),
ce
,
serment
,
l'ellipse
\os\.
Ce
vers
Doreïd
,
Arab. p.
o
lai
—
***
est
la
d'Amri-afkaïs
il
;
).
Voici le
texte
Jy j^ [/"Ss
^yi f^J
p**ff
trouve
se
Agg.
de la
négation ne
qu'il n'est pas
négation.
11 compare
«
~fj\ Jûf y~^- oJji-5
J'en jure par la droite de Dieu, je
de l'édition de M.
2 1
9
—
de la
toutes les fois
,
:
J'ai dit :
ressouvenir
mais Beïdhawi observe,
texte ;
que
accompagné d'un signe précis d'affirmation emporte
cette
expression à celle d'un poëte qui a dit
"
te
?>
passage de l'AIcoran (sur. 12, v.
rend point le sens incertain
parce que le
sur
T- \J\\'-
ji=o-> V>*-> *M!9 [y^9
Par Dieu ! tu (ne) cesses (point) de
i_>***j
cesserai
cité dans les
Haitsma
glose de
(ne)
(pas)de me tenir assis.
gloses
( Poëmation Ibn
Beïdhawi
&IU fâj
du
»
poëme d'Ebn-
Doreidi
cum
scholih
:
•JJa>û3 J [jj VJ yàj" V jf
y£ o^j'V^ j**^j v tyi fo^çU ffil à\ yi
^j
<£à
i :
»/£
3'f
,.
.>£•'-.'■>"
.
cesserai d'endosser
ne
3 59
SYNTAXE.
LA
DE
*r-îS
une
.Ar.
-
?
de mailles ,
cotte
-
J\\A
jusqu'à
ce
que
je
sois caché dans les entrailles du tombeau.
Le
à
Jy'j\ équivaut
mot
Jfjl
V
parce que le poète avoit dit
de la race de Yareb (a).
,
plus haut J'en jure par les princes
657. II y a beaucoup d'autres ellipses que l'on ne peut rap
En voici une de ce genre :
porter à aucune des règles générales.
& ojoif cw|i J* £<&. IJl* //J «** présenté du lait mêlé deau,
du lait mêlé d'eau,
aveTjVous jamais vu le loup! c'est-à-dire,
,
dont la couleur,
pelle
ceux
a
demande
a
qui
d'un blanc sale
le voient l'idée du
qui
un
est
autre
:
Ave^-vous
vu
II faut donc sous-entendre ici
dit
en
le voyant
:
et
tirant
le noir, rap
que l'un d'eux
sur
loup et fait
loup!
,
le
*xJjJ ^JJ^i(du lait) tel, qu'on
Ave^-vous vu le loup !
CHAPITRE
XXXIII.
Du Pléonasme.
Ce que l'on entend par pléonasme est précisément
le contraire de l'ellipse ; et au lieu que dans celle-ci il faut ,
658.
mots
plénitude du sens, restituer un ou plusieurs
il faut pouç
qui ne sont point exprimés dans le pléonasme
ainsi dire supprimer mentalement un ou plusieurs mots qui
pour avoir la
,
,
,
n'ajoutent
rien
au
sens
,
et
dont le retranchement
pas le discours moins intelligible.
On pourroit remarquer, dans l'usage de la
(a) Voyei l'édition
v.
73 ;
et
du
poëme d'Ebn-Doreïd
celle de Scheidius , p. 6 du
texte et a
ne
rendroit
langue arabe,
de M. Haitsma, p.
5 de la traduction,
v.
64
69.
Z4
et
un
aji,
3^0
DE
l'on
nombre de diverses
grand
assez
bien saisi
a
SYNTAXE.
LA
sortes
nous avons
ce
pléonasmes ; mais, si
cette Syntaxe
on
de
dit dans
que
n'aura pas besoin que nous rappelions ici
où cette figure de grammaire a lieu.
,
toutes
les circonstances
Observons seulement que le plus souvent elle est des
tinée à donner de l'énergie ou de la clarté au discours, et
650.
pléonasme. Ainsi, dans cet exemple,
^jJLilS <jCU ^n.° 813, i.re p. ) quoique le pronom personnel
qui sert de complément au verbe soit exprimé sous deux formes
différentes d'où il résulte un pléonasme cette répétition n'est
pas cependant sans effet ; et si l'on veut lui substituer dans notre
langue un véritable équivalent, il faudra dire c'est moi que vous
deve? craindre, et non pas, craigne^- moi. De même, dans cet
exemple £Sy\'f*> Ûf, et dans tous les autres semblables, où le
pronom y> paroît superflu ( n.° 156), on doit traduire c'est
alors
n'est pas
ce
un
pur
,
,
,
,
,
moi
qui
rence
le
suis le
de
mot
Seigneur,
et non
pas ,
je
suis le
deux traductions suffit pour faire sentir
ajoute à l'expression.
ces
J>
ïa diffé
Seigneur;
l'énergie que
et
660. Je
plus véritablement un pléonasme dans
ïa répétition du pronom personnel au nominatif après le pro
nom affixe
comme dans ces
phrases (n.° 520) :
reconnois
,
^ ci
J*y î
malheur
Lèvif UX^_Ài U
*-^ <XJ»>'
ÛJ
fj^à. "y>
«sf o^cj
que
près
(a)
aure^
de Di.u
,
Cet
moi , moi !
qu'est-ce qui
-r/ tu me
vous
a
vous a
empêché,
vous
deux!
vois, moi.
»jO-i.' _>Âà. y,^ iXlJuV fjioJiJ' U les bonnes œuvres
envoyées devant vous vous les trouvère? elles au
,
comme un
exemple
est
bien
,
(a).
tiré de l'AIcoran
,
sur.
73,
v.
19.
,
DE
66 I
Je
.
que l'on fait
361
SYNTAXE.
sais si l'on doit considérer
ne
l'usage
nasme
LA
quelquefois
comme un
vrai
pléo
du pronom affixe de la
seconde personne , comme particule compellative (a) <_>lki£f (Sj=>( n.° 77 5 , i.re p.). Le pronom , dans cette circonstance , ne joue
,
rôle dans la
proposition ; il n'est ni sujet, ni complément,
compellatif (n.° 35 ) : c'est, si l'on veut, une sorte
d'interjection destinée seulement à réveiller l'attention de celui
à qui l'on parle et à l'intéresser à la chose dont on l'entretient ;
enfin c'est un hors-d'œuvre de ïa proposition.
aucun
ni même
,
,
Cet usage des pronoms affixes de la secondé personne a lieu
ordinairement avec ïes articles démonstratifs (n.os 775 et suiv.
/." p.
)
; et
ils
sont
avec ces
articles ,
quelque
sorte
tellement unis
qu'on peut
partie.
les
et
pour ainsi dire
regarder
amalgamés
faisant
comme en
en
Mais il y a des cas infiniment plus rares , où le même usage
des pronoms affixes a lieu avec d'autres mots. C'est ainsi que
l'on dit «jLî U
Le
sens est
ôûfjf
et
,
foûj d^?fjf
Zéid, dans
as-tu vu
quel
état il est!
absolument lé même que si l'on eût dit simplement
aucune fonction dans ïa
pro
le pronom affixe S n'a
position (b).
(a) Je me suis servi de ce terme, faute d'en trouver un autre. Le mot
particule compellative répond précisément aux termes arabes ^fôoJfcj\Â.
ïfSUltf éjj^- (n-0
ment
est
,
de
et
*
3° }î quant au mot ollîi^f Oj^ " veut ^'re littérale
particule qui exprime la seconde personne ou là personne à laquelle le discours
»
,
adressé.
(b)
Je tire
cette
observation
et cet
exemple
du commentaire de
Beïdhawj
expliquer le mot IXjofjf
dans
ce verset, et au v.
II
observe
se
trouve
qui
4.6.
que le ^, dans ce mot, ne
la
de
du
faire
fonction
verbe,
complément
peut pas
parce que cela supposeroit
seroit
d'avoir
le
verbe
trois
que
susceptible
,çfj
complémens, ce qui n'est
sur
l'AIcoran,
pas;
et
sur.
6,
v.
}p
;
et
il s'en
sert
que d'ailleurs il auroit fallu dire
pour
L^=>j_6v4î[jÎ.
Le
sens
est, suivant
3^2
DE
LA
SYNTAXE.
expression analogue dont on fait quel
françois dans le langage familier et qui n'a
quefois usage
d'autre effet que de donner au discours plus d'énergie de le
rendre en quelque sorte démonstratif, et d'associer ceux qui
entendent le récit d'un événement à cet événement même qui
cependant leur est totalement étranger. En voici un exemple
Je
citer
puis
une
en
,
,
,
,
:
Vous save-^, mes amis , que je passe ordinairement la soirée seul
avec mon fils, dans mon cabinet: hier, pendant que nous étions seuls,
voilà qu'il VOUS entre
que nous Usions quelques vers d'Homère,
subitement un homme mal vêtu et de mauvaise mine; il VOUS
un
et, sans dire mot, /assied auprès de nous.
et
prend siège,
662. Le mot
employé fréquemment comme
1." p.).
pléonastique et alors on le nomme -txlstj U (n.° 890,
manière
66^. Le verbe ^ est quelquefois employé d'une
U
aussi
est
,
sur ïes autres
pléonastique, sans aucune influence grammaticale
du temps
mots qui composent la proposition, ni sur ïa valeur
des verbes qui peuvent se rencontrer dans la même proposition.
On en a déjà vu un exemple dans les formules des verbes
lui,
L£y>'oS-
î] fÉiJÛS 'r^èJpy} P™el-vous (fut)
aideront, quand vous les invoquerez ! Le verbe
(n.°? 407
iCjçfrff
513 j,
et
est
et
les
complémens
la même chose que
"àJljl
,
^lii
laissé
en
Vm
suspens
sous-entendus. H suit de là que
sont
et
ici
est
^cfj
ditUX
V0S
que
\&é,
inséré dans la finale
y,
à la composition
quW sorte d'interjection compellative tout-àfait étrangère
et qui ne fait tout au plus que corroborer
de
la
et
proposition
logique grammaticale
/." p.). C'est ce
ou rendre
plus énergique le pronom afixe nominatif y (n.° 814
n'est
,
,
•
que Beïdhawi
exprime ainsi
olJ^VI y If'J-^
j,
:Ow^U^J*H'-N
V (Mss.
•
H
Ar. de la Bibl.
'
-
g.
<^=a^
imp.
-
V*^'
n.° 260, f. 188
'
je
est assurément la meilleure que l'on
qu'elle satisfasse les bons esprits
Cette
analyse
doute
cependant
éloigné de penser que
,
ce
texte
de l'AIcoran
a
puisse
et
l'on
"*
C»* <J *•£-''
faire de
ne sera
verso.
ce
)
passage:
peut-être pas
éprouvé quelque altération.
admiratifs
(n.*
503
,
DE
LA
//'
p.) ;
3^3
SYNTAXE.
c'est ainsi que l'on dit "é>\
y^Ai y 'X&
la science des anciens étoit très
~é\
signifient
ô^U
ne
mairiens Arabes. II
à
un sens
664c-
-
exacte.
($£ U
Les
mots
plus que "&\ Li, suivant les gram
semble cependant que ^Indéterminé
ici^f U
pas
passé.
Les verbes
d'une manière
^f
yï*\
et
pléonastique,
sont
comme
quelquefois employés
y?
,
dans les formules
admiratives.
665*
entre un
l'attribut.
Le verbe
sujet
yë est encore pléonastique quand il se trouve
attribut
et un
,
sans exercer aucune
Exemple: ^^^1
y? faisoit ici fonction de
phète!
Si
UL»
l'accusatif: d'ailleurs le verbe
à
sition la
du
du
Màise
est
influence
-il donc
verbe abstrait
,
on
un
sur
pro*
auroit dit
eût donné à la propo
qu'elle a la signification
yë
lieu
passé
signification
présent (a).
666. On trouve aussi ïe verbe yti* placé entre une préposition
au
,
complément circonstance où il ne peut être que pléonastique. Ex. osàuLJf fMix.il y? <j* ^Lj j£j g\ jô ïfjL* les
plus illustres des enfans d'Abou Becr, montés sur des chameaux
distingués par leur beauté et leur force, disputaient entre eux de la
gloirr. y? n'influe pas plus ici sur le sens que Li explétif, placé
entre une
préposition et son complément (n.° 890, //' p.).
C'est plus ordinairement au prétérit que le verbe y& est em
ployé d'un* manière pléonastique. On trouve cependant aussi
des exemples de ce pléonasme où ce verbe est à l'aoriste.
667- Un genre de pléonasme qu'il est essentiel de remarquer,
c'est celui qui résulte de l'emploi d'un adverbe négatif après un
verbe qui renferme déjà l'idée de ïa négation. Exemples:
et son
,
-
(a)
Je crois que
cet
exemple
est
tiré de l'AIcoran.
364
lït
SYNTAXE.
LA
DE
^i'Vf cslixi U
o
Qu'est-ce qui l'a empêché de
dire, d'adorer Adam!
NE POINT
adorer Adam , c'est-à-
js^aIS'ï y f^Us"Aiof3 '^(A*** L»
Qu'est-ce qui t'a empêché de ne me POINT suivre ^c'est^
dire, de me suivre), quand tu as vu qu'ils s'étoient égarés (a)!
.
Cette
négation pléonastique
est
omise ailleurs
&»& U
passage: <jo^j &3là>. U o^J' y
pêché d'adorer ce que fai créé de ma main !
ce
>
668.
On
trouve encore un
,
comme
qu'est-ce qui
t'a
dans
em
pléonasme de l'adverbe négatif
elliptiques dont j'ai parlé
conditionnelles
dans les
propositions
(n.° f5j i ) telles que celle-ci :\ S'il paye ce qu'il doit
(laisse-le); sinon tu vendras ce qui lui appartient, &c.
Dans ce cas , l'usage s'est introduit d'admettre dans la pre
et même
mière proposition une négation qui est superflue
ailleurs
,
,
contraire à la résolution de
cité
dans
lieu de dire ,
ellipse.' Ainsi
£à.i £)fj s'il paye, on dit ^ô-» 'J ojj
cette
au
,
l'exemple
Quelque singulière que soit cette manière
paye
ai
de s'exprimer j'en
vu beaucoup d'exemples. Je vais en citer
quelques-uns :
comme
s'il
NE
,
POINT.
,
Vl^ SçJj y Ji^. <X oô.lj't ûl^LLtf l§jf
me
venges PAS de l'affront que j'ai reçwdeton
iiL—Jf foj* ojJ-5
O roi, si
tu NE
(a) C'est ainsi qu'on lit dans l'Évangile selon S. Luc Le coq ne chantera
point aujourd'hui, que tu ne nies trois fois que tu NE me cannois PAS ; itejx « t€M
cLTtapvricy /u4 ùJiv.d/l /À ( ch. XXII v. 34) le sens est que tu ne nies trois fois que
Celui qui nie que Jésus N'EST PAS le Christ,
tu me cannois. S. Jean dit de même
i àfvéjuuivoç 071 'Iyiovvç vk eçïf 0 %ÇWÇ, pour celui qui nie que Jésus est te Christ
(/." épttre de S. Jean ch. II, v. 22); et cette manière de s*exprimer n'est point
étrangère aux meilleurs écrivains comme l'a remarqué un grammairien Grec.
Voyei la seconde édition de la traduction d'Hérodote par M. Larcher, t.lll,
:
:
,
:
,
,
note
239 p. ipi ; Glassius
,
,
Philol.
sac.
1.
1 , p. 4? }•
,
DE
LA
365
SYNTAXE.
fis ; sinon j'avalerai ce poison. Le sens est : Si tu me venges de
l'affront que j'ai ieçu de ton fils, (a la bonne heure); sinon &c. (a).
yùu]\
y? (£-$]
Hosa'in
,
jjkik y
pacha
o-àU
de la
Mecque
des mains de Dhaher les
nement
»
de la
Syrie ;
restitues PAS
ces
îsc* uu
^f sfjf^
y^JvèûyLa.j
vint ensuite ,
,
il voulut retirer
et
que Dhaher avoit pris du gouver
il menaça donc Dhaher; et lui dit :
Si tu NE
cantons; sinon, a mon retour du pèlerinage il
cantons
ce
,
n'y pas de doute que je ne te fasse mourir. 33 Le
restitues ces cantons , (a la bonne heure) ; sinon &c.
a
33
^jj^.i\j tsy vfj o*LLf[
Si le maître de la maison
curées)
exclusif du
NE consent PAS
droit
mier le laisse
consent
a
donner
va.
Le
u
(dont
donner
curement et
s'en
et
a
t_>jj»
vidange
sinon, le fermier le laisse
et
Si le
sens est :
s'en
va
tu
ont
besoin d'être
que demande le fermier (du
des latrines) ; sinon, le fer
que demande le fermier
ce
Si
jjÀitf i-ijyy. *i y*
les latrines
ce
sens est :
,
maître
(h
de la maison
la bonne
heure) ;
(b).
Vfj VL libj-sj'l» y ^ ^j^w cJ"°^,5 ?^^ S^Lh^ f^r^ /£-*■?. «Jwâ.f ^
Ensuite il lui fit réponse en lui reprochant la dépopulation de- ses
états
lui ordonna de les faire
refleurir, ajoutant que s'il NE les
Le sens est, ajoutant que s'il
rétablissait POINT, sinon sinon
les rétablissait, (on lui pardonneroit ses fautes passées) ; sinon, un
le traiterait de telle et telle manière (c).
,
et
...
(a)
Cet
exemple
Oriental Collections
,
est
tiré de la
tome
cinquième des
Mille
et une
Nuits.
( Voyez
I.er, p. 248. )
L'exemple suivant est pris d'une Histoire manuscrite du
(b) Voyei ma Chrestomathie Arabe, tome II, p. 464..
(c) Voye^ ma Chrestomathie Arabe, tome l.'r p. z^x
,
scheïkh Dhaher.
/
the
$66
LA
DE
SYNTAXE.
phrase offre un exemple de réticence ou
figure qui appartient plutôt à la rhétorique qu'à la
aposiopèse
i
La fin de cette
,
grammaire.
669.
On peut
des mots
regarder
comme
sorte
une
de
pléonasme
<jU çeil, qu'ori ajoute par forme
l'emploi
jjJ
d'appositifs aux pronoms personnels exprimés pu sous-entendus,
et
qui répondent
ame et
au
latin
670. C'est encore
mot I)? tout, universalité,
ipse (n.° 392).
pléonasme lorsqu'après le
on
ajoute quelque autre mot qui signifie
véritable
un
,
précisément la même chose, comme ^Z- ^irH £»î> &c.
(n.os ^93 et suiv.)
6j I Ces deux sortes d'expressions pléonastiques font partie,
de ce que les grammairiens Arabes
comme je l'ai dit (n.° 39 1 )
nomment o^=»y corroboratif; et ils les distinguent particuliè
rement sous la dénomination de l$y^> o*%=£> corroboratif dé sens
ou
logique, par opposition à une autre espèce de corroboratifs qu'ils appellent ^.kkJ o^%=>y corroboratif d'expression parce
qu'elle consiste dans la répétition d'un ou de plusieurs mots.
672. Cette espèce de corroboratif, que l'on peut ranger
des
parmi les pléonasmes consiste dans la répétition expresse
abso
ont
mêmes mots ou dans l'agrégation de deux mots qui
lument le même sens. Exemples :
-
-
.
,
,
,
,
^jjjf yy
Qui
est-ce
qui est-ce,
jugement !
Quand
la
terre
es
uy ^jji.i yy.
u
tiîfjM uj
t'a
,
iLô l!=>3 J.jVf ois'i fil
sera brisée et réduite en poussière
«
Tu
dtjSf
appris ce que c'est que le jour du jugement!
une
fois qui t'a appris ce que c'est que le jour du
qui
encore
u
r.
*
digne du bonheur,
...
.,ïj*
-
méritant
,
en
.^
(le bonheur).
poussière,
DE
LA
3^7
SYNTAXE.
^T^T éy*M <3lî1 dUf jjfe '!$5\&\ d, 6$
mule! ils
Où
sont
pour moi, OÙ
est
arrivés,
ARRÊTE
ILS SONT
(a)!
J'ai
673.
le moyen de
fuir avec ma
ARRIVÉS, ceux qui te poursuivent. Arrête,
EST
que, si l'on veut répéter par
personnel , il faut employer
déjà observé (n.° 520)
forme de
pléonasme un pronom
les pronoms personnels isolés qui représentent le nominatif
soit un affixe.
comme bf je, ÔjÏ tu quoique celui qui précède
comme
j^i J^f
674. Les adverbes affirmatifs ou négatifs
de pléo
forme
J^.- ji oui, H non, peuvent se répéter par
V
non. On peut aussi employer
nasme
p jUJ oui oui; H non
oui.
deux adverbes affirmatifs différens comme ^ J*î oui,
si l'on
67 5 Quant aux prépositions et aux conjonctions
il faut aussi répéter leur complément ou du
veut les répéter
l'on
moins lui substituer un pronom qui le représente. Ainsi
,
,
-
-
,
,
,
,
,
,
.
,
,
J*lâ. to^j o] ^3 oj car Zéid, carZéid est un insensé, on
J*U. «I foûj oj car Zéid, car lui, c'est un insensé.
peut dire
bien
On dira de même
dans la maison,
ou
^ j}&\ j Jo3\ j Zéid
bien £>3 W
tk j}^ à,
est
maison, dans elle. Voici
M.0JU. l«*î >
un
*"'*?S ji
dans la maison,
Z«V/
est
dans la
genre de pléonasme:
i/r demeureront dans la miséricorde de
exemple
de
ce
Dieu éternellement , dans elle.
676. Quand
il
ïes
particules
sont
formées de
ordinaire de les
plusieurs par
répéter sans répéter
plus
avoir lieu sans ré
complément. Le pléonasme peut aussi
deux particules différentes
péter le complément en employant
:
quoique d'une même signification. Exemples
ticules réunies
,
est
leur
,
(a)
Sur le
mot
fcîlyLOIff
,
voyez, ci-devant, n.°
%t
,
3^8
DE
SYNTAXE.
LA
yy* of'^ôwÂ* i^Ucf y^j y&j uîJj y».
En
te sembloient
que tu les voy ois , et qu'elles
leurs cous eussent été liés par une courroie.
sorte
COMME SI
if
uj^j
(jyçji y& j
Le lendemain
le moyen
pour
en
6jJ.
trouve
II
matin elles
,
sans son
:
678.
de pléonasme,
haut des airs,
ou
rare
*ljS toô| >
UJ
S£ £
U &*
^^
de remèdes ni pour la maladie dont je suis,
ni POUR POUR celle dont ils
L'adverbe
(ji^w>u
le questionnèrent pas TO U CHANT
,
l'exemple suivant
trouvera
12 ^ *ji^j v
si
qu'une simple particule se
complément comme la préposition ^
extrêmement
est
on ne
ne
f?
employé pour s'élever au
avoit
répétée
l'est dans
jamais
au
qu'il
descendre (a).
SUR
<>iu>f
comme
négatif V
et sans
avoir
affligés.
quelquefois employé par forme
sont
est
aucune
influence
sur
le sens, dans
Exemple : rûkf "£jj *^îJf ^?fp, p'f ^ls
%-k& je NE jure POINT (c'est-à-dire je jure) par le lieu où se
couchent les astres; car c'est-là un grand serment (b).
les formules de
serment.
,
Il faut observer que la
(a)
dans
ce
vers
,
et
que
<_j est
«_>-%-».]=> ^Uiôjf *U^l-> _j<y*à>
,
m'interroge-^ Ail
vous
femmes
préposition
je
suis
SUJET
un
des
médecin
femmes
(propre
ici dans le
(joli
sens
de la
deux
comme
«
,
,
exemple offre
pléonasme des prépo
répété pourvu qu'on em
cet
porte que le
,
sitions peut avoir lieu
ploie
,
sachez que Ie connois les maladies des
à les traiter ) et dans un passage de
règle précédente qui
sans que le
complément
prépositions différentes.
application
y,
=eUJjlj <^ JUJ (jvi
l'AIcoran; dont j'ai fait usage ci-devant (n.° 404). Ainsi
une
de
soit
,
(b) Cet exemple est pris de l'AIcoran sur. j6 v. yj. On trouve deux
exemples pareils sur. jf v. 1. Je doute cependant très -fort qu'on puisse
admettre un pareil idiotisme. Peut-être devroit -on interpréter ces phrases et
autres semblables par forme d'interrogation.
,
,
,
,
679.
>
DE
679.
On peut
LA
SYNTAXE.
6ç
y
de
pléo
l'emploi
préposition y» lorsqu'avec le nom qui lui
sert de complément
elle remplace
ou un sujet
qui devroit
au
être
nominatif, ou un complément immédiat d'un verbe qui
devroit être à l'accusatif. Exemples :
considérer
encore
de la
nasme
comme une sorte
,
,
,
,
//
leur arrivoit
ne
seigneur, qu'ils
point DE
PRODIGE
d'entre les prodiges de leur
n'en détournassent leur attention.
y)yyx\ *iy y
<Jî\â
o-ïîj
*»f ow^j o^y* y
personne qui puisse changer les paroles de Dieu ; et déjà
il t'est venu ( c'est-à-dire , il t'a déjà été révélé ) DE L' HISTOIRE
Il
des
ses
n'y a
envoyés (de Dieu, qui
Il n'est point
DE
deux ailes,
qui
n'avons point oublié
Dans
jjliij
tous ces
BÊTE
ne
la terre,
sur
DE CHOSE
exemples,
l'histoire ,
contraire, s'y
y,
dans le livre
«-5IÎ
de chose
remplacent
aucune
remplace
aucune
bien attention à
le
nous
(des décrets éternels).
of y de prodige, *U>
j*S&j
^«our n'avons oublié)
Si l'on fait
*dP 0"^tri'^v-'f
ni d'oiseau volant avec
soient des nations semblables à vous;
wfî y de bête ni d'oiseau,
prodige, *L3
LJ*i
t'ont précédé).
bête
y
de l'histoire,
sujets *jf
les
et aucun
un
oiseau. Au
immédiat
complément
chose.
l'analyse de
ces
formules
,
on verra
qu'elles renferment en même temps du moins pour ïa plupart
une
ellipse et un pléonasme. Je dis qu'elles renferment une
ellipse ce qui ne peut souffrir aucun doute ; car toute prépo
sition n'étant que l'exposant du rapport qui existe entre un anté
cédent et un conséquent ^n.° 821, //' p.) il est certain que, dans
,
,
,
,
,
U,' PARTIE.
Aa
DE
37O
LA
SYNTAXE.
exemples, il y a ellipse d'un antécédent qui peut être r*y
chose, ou iajû partie. Ainsi lorsqu'on lit dans le premier exemple
ces
,
r-*
<—
*,
^ ne ^eur arriv0lt Pomt DE PRojVo <=>^ï Iùî *rfï £>*"&*
DIGE &c. le sens est oUf y, *-j.Î
{j^ '^ù'Ij' U il ne leur arrivoh
point UNE PORTION DE PRODIGE, c'est-à-dire aucun prodige;
à
et le
genre féminin du verbe c|jj' ne s'oppose point cette ana
lyse grammaticale car c'est ici la concordance logique dont j'ai
parlé ailleurs (n.° 3 3 2). Cette ellipse a lieu en françois quand on
,
,
,
dit
:
pour
Je n'ai jamais
des
vu
crimes
d'HOMME sage
de
cette nature.
qui
.
.
n'eût
.Des
DE
L'HORREUR
voleurs
m'ont
attaqué (a). J'ajoute que dans ces formules il y a en même temps
pléonasme; ce qui est vrai, puisqu'au lieu de of y de prodige
[de prodigio] expression abrégée pour of y ^y une chose de
,
prodige [aliquid de prodigio] ou substituée à f jo*j une portion
de prodige [aliquid prodigii] on auroit pu exprimer le même
sens, en disant simplement *jf'&uL» U il ne leur arrivait (aucun)
prodige [non veniebat ad eos prodigiumj.
Je ne dissimule point cependant que cette manière de s'ex
primer n'est pas toujours purement pléonastique qu'elle ajoute
sur tout dans les propositions négatives
souvent à l'énergie
et
et que quelquefois même elle ne renferme qu'une ellipse
nullement un pléonasme. C'est ce qui a lieu dans le second
des exemples que j'ai rapportés ^JL^lif^Uï y t-sUU. om :car,
si l'on eût dit ySfJfX\ #Uj le sens auroit été, l'histoire des envoyés
(précédens t'a été révélée) ; au lieu que l'auteur a voulu dire
yX^yil *Ui y.* ,y ou, en d'autres termes, yXLjJ»\ *Li J***
une
partie de l'histoire des envoyés (précédens t'a été révélée).
*j
,
,
,
-
,
,
,
,
,
(a) Voyez mes Principes de
Grammaire générale
2.
c
édition, p. 4.0,
note.
DE
SYNTAXE.
LA
37I
680. On peut aussi regarder comme pléonastique ^ Pus 'ge
de la préposition o quand elle sert à exprimer l'attribut d'une
proposition, ou qu'elle suit l'adverbe fy (n.os 824, 1." p. et
,
77,2'P-)
CHAPITRE
XXXIV.
Des Licences
081. Les poètes
poétiques.
fréquemment des licences
qui s'éloignent des'règles ordinaires de la grammaire. Je ne parle
point des licences qui consistent dans certaines constructions
peu usitées dans des inversions contraires aux règles ordinaires
des ellipses ou des pléonasmes ; j'en ai fait observer plusieurs à
mesure que l'occasion s'en est présentée. Celles dont je veux
parler ici n'affectent que la forme des mots ou les règles ordi
se
permettent
,
,
,
,
naires de la
dépendance
et
de la concordance. Les
tiennent donc à la seconde
de la
partie
pensé qu'il ne
unes
appar
les
autres
grammaire
à la troisième. J'ai
seroit pas déplacé de réunir
ici toutes celles qui sont d'un usage plus fréquent.
682. Les poètes substituent quelquefois un élif d'union à
un
élif de séparation, et réciproquement un élif de séparation à
un
élif d'union (n.° 1 27 /." p.). Exemple :
,
et
,
cJ-é bfj L/lâi
\ji ]jû«âjf Lj\y qL
Çà donc, va porter à Hatem
Dhabai a pris la fuite.
iijf
avec un
(a) Voyez^a.
f.
1
53
^///"d'union
et
ibl Vf
Abou-Ali la nouvelle
tient ici la
place
de
Grammaire d'Ebn-Farhât, man. Ar. de la Bibl.
qu'Owana
^Jbf
.
imp.
n.°
Aa
2
recto.
1
195 A
,
DE
372
LA
Us font masculin
683*
masculin.
Exemples
SYNTAXE.
féminin,
un nom
et
féminin
un
nom
:
LgJ&f Jîlt jt>y VJ
Aucune nuée n'a versé ses
IgsSj ôj'SJ
eaux
aucune terre
,
ïjj* Sj
n'a produit ses herbes
potagères.
*•
Lorsque
Médine)
,
3.
j**°
«_Jii^î
<"°
'"*>
JU^L fljoUf
.
,
c
m
•
,
,
nom
est
parvenue
(a
'°%
jy»
,
,
dans le
féminin;
rapporte à
se
-S ."-
\° J
de la ville s'est abaissé humblement , ainsi
que
saisies d'un saint respect.
premier exemple, JJi/f
j»jf
,
.
mur
■
Dans le
féminin
-
la nouvelle de l'aventure de Zobe'ir
le
les montagnes
porte à
,
0***<bLj' wôjJf J*À <^f U
jyj.
nom
verbe
au
masculin,
se
rap-
seconrj, ojU>[^j verbe au
,
masculin.
684«
point
Us redoublent par un teschdid une lettre qui ne doit
être doublée , et ils suppriment le teschdid d'une lettre qui
doit être doublée.
Exemples :
y^jaH\ yûè.\ Zj^-l. y&>
Un gros homme
qui
aime
ceux
qui
ont une
grosse taille.
<Jt* o^ d* olÂy^Jf £^|j ci *=£f oJ^>J Ulc ex—l»
J'di to/ Ilbaa, et Hind (a) Djamali et les fils de Sauhan,
pour défendre la religion d'Ali.
—
-
,
On voit
pour ^^ f
68 J
icij«i?Vf
et
l^é
pour
j*s? Vf
,
et au
contraire
Ji^f
et
J£
.
Ils
suppriment une contraction et articulent avec sa
voyelle
qui devoit en se contractant perdre cette
voyelle (n.° 300, z.n p.) : ainsi ils disent f^Jjî pour \fyb Ex. :
.
ïa
,
consonne
,
,
.
(a)
Hind
la classe des
est
ordinairement
Tabis,
nommé
un nom
Hind, fis
de
femme;
d'Amrou.
*
ici il
s'agit d'un
homme de
DE
SYNTAXE.
LA
373
^ y\
[y*
j»JyV ïyA t5j Jf^^o^J^oJ Jil*f ^4*
Soye^plus réservés, censeurs sévères ; car je me suis fait une habi
*
tude de
répandre
686.
Us
mes
bienfaits
suppriment
les
is//^ éclaire les ténèbres,
prendroit pour la
séparé du monde.
voyelles
nasales.
qui
sur
illumine la cellule
la
baissent.
en sorte
nocturne
seconde,
disent
qu'on la
d'un moine
déclinaison ïes
première
à la
me
Exemple :
quand le jour a disparu ;
lampe qui
Us déclinent
687.
même
sur ceux
noms
fj^^lji
qui
appartiennent régulièrement
j-ûlÎ3 (n.° 728 i.rt p.) : ils terminent aussi par un medda les
noms
qui se terminent par un élif'bref et par un élif bref ceux
qui ont régulièrement un medda.
688. Us déclinent régulièrement ïes noms qui devroient
perdre leur voyelle finale, parce qu'ils se terminent par un <j
( n,° 7 3 1 i.re p. ) Exemple :
et
pour
,
,
.
,
~y$
o»Um
Que Dieu
nage!
elles
689.
vf
ont
toujours quelque
Ils
grossissant)
bonne laitière des
60O.
un
(car
qui
vivent retirées dans leur mé
est
nouveau
irrégulier
à demander.
comme
d'ordinaire les nouvelles
arrivé à la
femelle
s'il étoit
vont tou
de chameau
enfans de Zéid!
Ils font
devroit avoir
ce
qui
chose de
le verbe
Ne t'a-t-il point appris
en
—
maudisse les femmes
conjuguent
régulier. Exemple :
jours
e^j *iï àf^ dj\>—î ^
y^é?. J*
quiescent à la fin d'un mot un
fatha pour voyelle. Exemples :
(j ou un j
Aa 3
qui
37^
DE
Vj *U ywf ô^
çjf
abandonné leur pasteur,
ont
^
àfi
du côté de
je fusse noble
Dieu n'a pas voulu que
celui de mon père.
Elles
SYNTAXE.
LA
Dans le
lzDZX>
69 I
voyelle
Pour
o^j
(
n-°s l99
ajoutent après
pour rendre le
,
saturation. On
73
quiescente. Exemple
y
// les
a
est un
m
-
-
lis donnent
une
>
7" Z7'
usée.
second,
)•
voyelle la lettre analogue à cette
plus plein ; ce qu'on appelle ^Uij
<j>y^
pour f^j-w*
à la fin des mots , pour ïa rime.
692.
l
conséquence
trouve en
-
tête
et
dans le
yû>f ;
pour
et
une
son
i^jfSJ^ jjiïlili
tout
est
,
Us
.
Je*
premier exemple ywf
est
vieille
comme une outre
S
ni de
ma mère
voyelle
à
dans les
poètes
^j+J*
-
j»k-iU Cela a lieu sur
.
une
lettre
devroit être
qui
:
*$&* *j
frX&j
détournant les
épargnés
dépôt qui lui appartient
en
*&*.
,
et
(j^jf
^jj *^àaî?
de dessus eux; leur
glaives
dont il leur
a
seulement prêté
l'usage.
suppriment le J du pronom 'J> et ïe J du pronom
l£ : ils suppriment aussi la voyelle de i'affixe "0 et lui substituent
un
djt^ma. Exemples :
6() 3
•
Us
,
4>
fji kSi\ jLj
—
Tandis
33
celui
qu'il
qui" a
un
vendait
y?r iy
ses
jjts jii *x».j (jy&
équipages, quelqu'un
chameau doux à monter, d'une
LçUf ^ji^y&t v j~â.s yy\ y
// n'a point hérité
aucun des
avantages
un
patrimoine
qui
j
*
de
a
race
i_ij o^j*
gloire ;
assurent aux vents
dit:
*&***
«
Quel est
choisie!
oô?
il n'est
y
33
«j
uj
distingué pur
la reconnaissance des
hommes:
car
bienfaisantes)
69^.
finale
,
ni
et
disent o-ff
•
et
69 j.
,
et
0 du
et
^oJf
pour
y
et
Au lieu de
dV.
Exemple
Je n'irai
(ô femme),
de
pluriel
£soJf
même
ofoîlt
-
la
,
adjectif,
y.o$\
(n.0 838, i.r'p.)
ils disent
^4=V,
ce
et
.
:
le trouver,
point
du midi
vent
le
la finale
foïJf
-
le
375
amène les pluies
(qui
"{éphyr (qui rafraîchit et ranime).
le [s de l'adjectif conjonctif <jô)\
comme
comme
Us retranchent
du duel
m
à boire,
il n'est ni
SYNTAXE.
LA
DE
si ton
je
ne
le
eau est
mais donne-moi toi-même
puis ;
d'une
nature
généreuse.
jîvà-jj", qui a lieu
employés comme
quand
régulièrement
compellatifs (n.° 138), et le pratiquent lorsque les noms ne
sont pas pris en ce sens. Exemple :
696.
Us imitent le retranchement nommé
dans les
noms
ils
,
y«>£\\ p,f£\ itixi ju y c*->.y<3
*y
—
j
sont
*y°
ci' iy&5 s^* &*^
Tarif ben-^
homme illustre par sa générosité que
Certes c'est
Malec : c'est à la lueur de ses feux hospitaliers que les
un
(voyageurs)
rassemblent pour prendre leur repas, dans une nuit où ils
la rigueur de la faim et du froid.
se
On voit ici
JU y C*?.j&
Pour
<$" 0^ <-*0^
éprouvent
•
Les poètes- emploient aussi le mode subjonctif de l'ao
riste après la conjonction ci , sans que cette conjonction soit
697.
prise dans
un sens
J'abandonnerai
dans l'Irak,
(a)
\jLyL\
et
est
là
qui exige l'usage
ma
demeure
aux
de
ce
enfans
mode
de
(n.° 48j.
Ex.
Témim; je m'en irai
je goûterai le repos (a).
pour
'<cyj\
(n.° 691).
On
:
pourroit
supposer, quoi que
A
a
4
376
LA
DE
SYNTAXE.
suppriment quelquefois la conjonction 0 lors
séparation entre une proposition con
qu'elle
ditionnelle et la proposition corrélative ( n.os 549 et suiv.).
Exemple : UJJCî^j «of olL'icd Jkiû y Quiconque fera le. bien, Dieu
lui en témoignera sa gratitude. On auroit dû dire UjXLi amLj (a).
699. Us mettent quelquefois le verbe ou l'attribut au sin
gulier, lorsque le sujet est un duel qui exprime deux choses
inséparables l'une de l'autre, comme dans cet exemple: y&ù\
Ifëj les deux yeux fondent (à la lettre fond) en larmes.
700. Quelquefois, lorsque deux mots sont liés par une con
jonction les poètes intervertissent l'ordre naturel et placent la
conjonction et le mot qui la suit avant celui qui dans le
sens
précède la conjonction. Ex. /»^lUf À»f d^f^ csuU h la
Us
698.
,
devroit former la
,
,
,
,
,
,
lettre,
sur
toi
,
I 1JCX&
A»f
£^jl (Bs^uJ
posent) sur toi !
que
le salut
le contraire de la
Arrête-rtoi, Dhabaa
ment
où
tu
t'arrêteras
La construction
,
avant
ne
soit
sujet
nom
règle
au
ordinaire
au
y*
ne
soit
point
dire, n'attends pas l'instant
le
(re
un nom
qui est
(n.° 155). Ex.:
;
ce
séparation;
que lemo~
l'instant des adieux.
régulière auroit été t^U* ^fy» f^y}
l'instant des adieux
lieu de
yysLxj\ JUs ^
l'instant de la
point
verbe
déterminé
L£u^> U
UfyJf cilL» c_9$Lô (Aj Vi
le salut,
la miséricorde de Dieu
et
Ils peuvent donner pour
indéterminé , et pour attribut un
701.
précisément
Dieu,
la miséricorde de
et
moment
où
tu
csI-j V que
t'arrêteras ; c'est-à-
des ad'nux pour t 'arrêter
auprès de moi.
\,
dise Hariri de
qui ceci est tiré, que <__j signifieroit
particule exigerait le subjonctif (n.° 48).
,
cas, cette
(a)
Cette seconde
proposition qui forme
la
ici
en sorte
que; et,
en ce
proposition se nomme #f_jj^f <_!> U?» c'est-à-dire,
réponse d'une phrase exprimant compensation.
»
m
DE
LA
377
SYNTAXE.
702. Ils emploient la forme du pluriel irrégulier 3*fy pour
le pluriel masculin des adjectifs verbaux de la forme J^L^
quoique cette forme de pluriel ne convienne régulièrement
qu'aux féminins de ces mêmes adjectifs verbaux ( n.° 700
ir p., page 267).
de l'aoriste,
703. Enfin ils emploient le mode énergique
même
ils
donnent
et
avoir
ne
devroit pas
lieu",
quand ce mode
quelquefois la forme énergique au prétérit et à l'adjectif verbal,
ainsi qu'à des verbes d'admiration. Exemples :
,
,
'
i^£ 0^3 ôL <4ù>sJ» y\>
Puisse ton bonheur être durable, (femme),
malheureux que l'amour a rendu captif!
\iy&\
xj
c^sxâ
si tu
as.
pitié
d'un
y o^ijf
Ajf (J***îj sjUâJ*
\')jj
liJj___iJf J-f-âJ (^î«lf
(son jeune amant) avec cette taille délicate cette
chevelure crépue, ces habits d'étoffe rayée penses-tu que (le père de
Faites venir les témoins (pour dresser l'acte
cette amante) dise
\
de leur mariage) !
704- Plusieurs des licences poétiques indiquées dans ce cha
pitre ont aussi lieu dans la prose rimée.
Si elle amène
,
,
:
33
«-
33
QUATRIÈME.
LIVRE
DE LA
CONSIDÉRÉE
DES
SYNTAXE
SUIVANT LE
GRAMMAIRIENS ARABES
CHAPITRE
De la
Proposition
705 ^ E qu'on appelle discours
gation de deux mots au moins
'
but
et
comme
le
sujet
appartenant à
est
un
nommé ibJ-f
en
ou
,
attribut
SYSTÈME
I.er
général.
phrase 13?
,
est une
aggré-
dont la réunion énonce
sujet. Ce rapport
,
(a).
ce
entre
un
l'attri
que l'on peut rendre par
attribution.
(a)
J'ai suivi
principalement, dans
quatrième partie de ma Grammaire,
lingua Arab'ca, ; mais je. l'ai beau
coup abrégée, parce que le but que je me suis proposé n'est que d'offrir un
moyen de parvenir à l'intelligence des grammairiens et des scoliastes Arabes
et que d'ailleurs les détails dans
lesquels je suis entré dans la troisième partie,
me
permettoient d'être plus court ici.
Les dénominations techniques ne sont pas les mêmes chez tous les Grammai
riens Arabes: en conséquence, on trouvera
quelquefois ici des dénominations
différentes de celles que j'ai indiquées dans les trois premières
parties. J'ai laissé
subsister exprès ces différences, afin de donner la connoissanee d'un
plus grand
nombre de termes techniques. U en est de même de
l'analyse d'une proposition;
la même proposition est souvent analysée de diverses manières
par différens
grammairiens quelquefois par le même grammairien.
On trouvera ici des
développemens d'analyse grammaticale que l'on a déjà
celle de
Martellotto, .intitulée
,
cette
Institutiones
,
,
DE
Le
LA
l'attribut
qui exprime
mot
SYNTAXE.
est
nommé
379
o>XU c'est-à-dire,
,
attribué. Celui
dire
,
qui exprime le sujet se nomme ^J[ oSJ^>
auquel on donne un attribut.
celui
,
c'est-à-
II n'est pas absolument nécessaire que le sujet et
l'attribut soient exprimés par deux mots distincts : quand le
706.
pronom , et l'attribut un verbe , le sujet se trouve
réuni dans un seul mot avec l'attribut ; mais on considère alors
sujet
est un
forment ïes personnes des verbes comme des
distincts du verbe (n.° 8 14, //' p-)> Ainsi, dans oJLjî. , ïa
ïes inflexions
mots
qui
première partie du mot ~jj* forme l'attribut ; la deuxième
partie, o forme le sujet.
707. Si la proposition forme un sens complet elle se nomme
indifféremment 18? phrase ou *X£ proposition. Si la proposition
est de nature à exiger, pour la plénitude du sens, une autre
proposition on la nomme seulement aJÙ^ proposition.
Ainsi HU. oôj Zéid (est) savant est en même temps Idfc*
phrase, et *ii* proposition. Dans t£y° y>y° y quiconque me
$
frappera je le frapperai il y a deux propositions *Sir et une
seule phrase ISf
,
,
,
,
,
,
,
-„
j
,
,
,
.
précédemment; je n'ai pu éviter ces répétitions : autrement cette quatrième
partie eût manqué d'ensemble.
Au surplus
elle n'est point faite pour les commençans ; elle ne pourroit
qu'embrouiller leurs idées. Elle est faite pour les personnes déjà avancées, et
doit leur servir de préparation à la lecture des scoliastes. Il est fâcheux que
tout ce qui a été imprimé de scolies
jusqu'à présent du moins la plus grande
partie, soit défiguré par des fautes innombrables. Telles sont celles qui accom
vus
,
,
pagnent le poëme de Caab ben-Zoheïr
Lette, le poëme
thologie
de
5sjy«Jutf
sentences
Arabes
la Moallaka d'Amri-alkaïs
«jfJLft ^JLSÇjf
A. Schultens. On fera mieux d'étudier
l'AIcoran par Beïdhawi.
et
,
donnés par
et l'An
d'Ebn-Doreïd de l'édition de Haitsma,
de Zamakhschâri,
quelques chapitres
publiée
par
du Commentaire de
380
DE
LA
SYNTAXE.
CHAPITRE
IL
De la Nature des diverses
708
Le discours
Propositions.
la
phrase est simple ou composée :
simple quand elle ne contient qu'une seule proposition ; com
posée, quand elle en contient davantage.
700. La phrase simple est ou une proposition nominale
.
ou
,
juao»I *JL^
,
ou une
proposition verbale «-^5
^w*-
.
La
proposition nominale est celle dans laquelle l'attribut
adjectif ou un nom soit que ce nom soit
seul ou qu'il soit joint à un adjectif, ou qu'il ait un complément.
Exemples : fUi ou) Zéid (est) savant; *tU JJl^j *o*j Zéid (est)
un homme savant ; uhri\ *$&
o*jJ Ze'id (est) le domestique de ton
oJuLtf
est ou un
,
,
père ; c^f o4j Zéid (est) ton père.
La proposition verbale est celle dont l'attribut est exprimé
par un verbe. Exemple : ouj ôU Zéid est mort.
7 10. II y a deux autres sortes de propositions elliptiques qui
semblent n'être ni nominales ni
rapporter
l'ellipse
à l'une
par
un
ou
verbe
à l'autre
ou
par
verbales, mais que l'on peut
espèce suivant que l'on supplée à
,
un nom.
Câyô ï&r proposition circonstancielle
,
La
première
parce qu'elle
pour attribut une circonstance de lieu sorte de
tanciel que l'on nomme (Sj& vase. Ex.
,
est
semble avoir
terme
So^f 0J3
che^
o^sUf j_ oj) Zéid
toi ;
nommée
(est)
dans la
mosquée.
ï*?J*j\ yf£ jU» c'est-à-dire, formée à
proposition
,
circonstancielle. Dans celle-ci
,
nommée
circons
Zéid
(est)
La seconde
est
la manière de la
l'attribut ,
au
lieu d'être
simplement, devient le' complément d'une préposition.
Exemple : çj}JouJf y Uf je (suis) du nombre des véridiques.
Si l'on suppose qu'il y a dans ces propositions ellipse d'un
énoncé
DE
verbe
,
y?
qu'il y
comme
l'on suppose
étant, ou d'un nom,
nominales
elles
,
a
381
SYNTAXE.
LA
ellipse
comme
d'un nom verbal
un,
joju
verbales. Si
propositions
des
sont
,
^jk"
comme
portion,
une
elles
sont
(a).
phrase composée est 1 .° celle qui contient deux
propositions qui dépendent tellement l'une de l'autre, que le
sens de la première resteroit suspendu si l'on n'ajoutoit pas
la seconde. Exemples :
La
711.
,
j.
j
Quiconque
me
.
s
frappera je
me
,
33c.
S'il
•
—
,,
,
.-,
le frapperai.
«î
-
le frapperois.
frappoit, je
i$>&? JLP çKj
^
fut de retour, il logea che^ moi.
2.0 Celle dans laquelle une des parties intégrantes de
:
position forme elle-même une proposition. Exemples
Quand
il
33? ,,- S
8»Jl
o*°
Zéid,
(a)
<* jJà
Le
son
père est mort;
terme
vase;
circonstanciel
.r
0>3j
c'est-à-dire , le père de Zéid
est,
mais il faut ici faire
une
la pro
comme
nous venons
est mort.
de le dire, nommé
distinction. Si le verbe
qui
doit être
sous-
signification très-vague et qui
entendu pour remplir l'ellipse,
la préposition et de son complé
réunion
la
soit suffisamment indiquée par
je
donné
j, O^) ^ M dans la maison
ment, comme dans l'exemple
est un
verbe d'une
jp\
dans
lequel
il faut sous-entendre le verbe
.
yfp être,
ou
j^.
se
trouver, le
terme
exprimé ou si
et dont l'idée
le verbe sous-entendu est un verbe d'une signification plus précise
cet exemple,
dans
comme
n'est point renfermée dans ie terme circonstanciel
circonstanciel
se
nomme
j_ï*£ £,>£
verbe
; mais si le
est
,
,
&Jj\'j
nomme
ô&
*6
tsJ cij-»
.
Zeifi
est mon
dans U chmin' Ie
termC
circonsUnciel
&c
382
DE
SYNTAXE.
LA
*~Ki)
ifwA
Zéid,
On
son
fils
nomme cette
sition à deux
7
12. La
0»JJ
beau; c'est-à-dire, le fils de Zéid est beau.
est
sorte
de
proposition os^yf ot3 ïXz- propo
faces.
verbale peut être ou énonciative «jjUlf
ou conditionnelle *Xk>£
proposition
<CLiUjf
,
productive
première énonce un attribut comme appartenant au sujet;
la seconde exprime un commandement une défense un souhait,
une
prière, &c. ; la troisième énonce l'attribut comme apparou
,
.
La
,
sujet
tanant au
sous une
certaine condition.
CHAPITRE
Des Parties
qui
les
ïe
adjectifs
tanciels
,
parties
sujet et l'attribut
,
les
appositifs
,
essentielles d'une
prennent différens
noms
,
elles
et
noms
*fÔJC{-if
j
—
l'^f
3
e
J
à raison de la
des
dépendance auxquelles
7 14- A raison de ces différences,
quatre
proposition
,
les
parties accessoires , telles que
les complémens et les termes circons
et
,
occupent dans la proposition
de
III.
essentielles qu'accessoires des Propositions,
Les différentes
713.
sont
tant
,
sont
règles
place qu'elles
de concordance
ou
soumises.
le
sujet et l'attribut prennent
différens :
V inchoatif,
l'énonciatif,
•'f
àtâJf le verbe,
—
JUtUff l'agent.
De
une
ces
quatre
proposition.
parties
,
il y
en a
toujours
au
moins deux dans
DE
7
tifs
,
1
Les
parties accessoires du discours , telles que les
J
ïes complémens , les termes circonstanciels , sont
.
ïe
comprises
tingue six espèces :
sous
3
oUÎi&LU dépendances;
de
nom
—
le patient
ou
la situation
spécificatif
jjjJiâJf
le
complément
y&Ll\
la chose
«—jlyjf
les
716.
toutes
en
dis
circonstanciel d'état,
terme
ou
le
—
l'on
objet de l'action,
jw^Jf
•
et
adjec
.&
«
Jji*-ltf
y jd
d'un
383
SYNTAXE.
LA
,
mis
exceptée
au
génitif,
,
appositifs.
Chacune de
ces
parties
de la
proposition fera
le
sujet
chapitre particulier.
IV.
CHAPITRE
De
717.
qui n'est
L'inchoatif
l'inchoatif.
est un
nom,
ou
l'équivalent d'un
nom,
d'aucun antécédent. C'est ordinai
dans la
dépendance
proposition, rarement l'attribut; et, sauf
tient la première place dans la
l'inchoatif
quelques exceptions
proposition ce qui est indiqué par le nom même qu'iï porte.
rement
le
sujet
de la
,
,
Exemple
:
1JU
oûj
Zéid
718. Quelquefois
(est)
savant.
l'inchoatif
est
Zéid
est
ici l'inchoatif.
placé après
l'attribut
ou
qui a lieu quand l'énonciatif doit être précédé
d'une particule négative ou interrogative, et que l'attribut et l'in
choatif, qui est le sujet, concordent en genre et en nombre.
Exemples : i£j*fë ^ ^e^ nest Pas ^0llti O^J^ O^*}*
énonciatif;
ces
ce
deux hommes
ne
sont pas
debout.
384
DE
SYNTAXE.
LA
7 I O. Lorsque l'attribut, précédé
duel
particule négative ou
concorde pas en genre et en nombre avec le
pluriel , le sujet ne peut plus être inchoatif, parce
interrogative
sujet
d'une
ne
,
ou
alors
étant
la
dépendance de
l'attribut : c'est en ce cas l'attribut qui est l'inchoatif; et le sujet
est considéré comme
agent, ainsi qu'on le verra ci-après. Ex.
qu'il
est
envisagé
yàuyjl Yb
U
est-ce
hommes
ces
que
comme
deux hommes
ces
sont
ne sont
sous
pas debout;
JLaJJfylj'f
debout!
720. J'ai dit que l'inchoatif doit être
véritable
(ce
qui comprend aussi les pronoms) \y° îwj ou l'équivalent d'un
nom c'est-à-dire une manière de s'exprimer qui puisse se résoudre en
un nom
fjjj~* f*i Ainsi un verbe précédé d'une des conjonc
,
ou un
,
,
,
,
,
•
tions nommées
parce qu'elles donnent aux temps du
d'action (n.oï'88o. et 890-, i.re p.), peut
ùfo^oJ»
,
verbe la valeur du
nom
servir d'inchoatif.
Exemple
est
bon pour
vous ;
:
iCf
c'est-à-dire,
j*S. \j*yaî y que
le jeûne
l^JJf
L'inchoatif ne doit être dans la
y 21.
antécédent.
J—«U
nom
J'appelle
antécédent
ce
est
jeûnie^
vous
bon pour
dépendance
que les Arabes
vous.
d'aucun
nomment
pluriel J*f^é ; ce qui revient aux mots gouverner tl
régir, employés par nos grammairiens. Les Arabes distinguent
,
et au
des antécédens
exprimés ou grammaticaux JLlkàJ Jl»fe
,
et des
anté-
logiques *jyÂi Jufj* II n'est question ici
premiers dans la dépendance desquels l'inchoatif ne
cêdens sous-entendus
que des
sauroit jamais
antécédent
cédent
,
logique
,
est un
interrogative
nombre
,
il
est
dans la
dépendance
ïes Arabes considérant l'absence de
comme un
L'inchoatif doit
l'inchoatif
et en
.
trouver ; car
se
grammatical
722.
ou
attribut
tout
d'un
anté
véritable antécédent
toujours
précédé
être
logique.
Quand
particule négative ou
au
d'une
nominatif.
qu'il ne concorde pas avec le sujet en genre
(n.° 7 1 o) il régit le sujet qui est alors considéré
et
,
,
comme
comme
agent
,
et
il le
385
SYNTAXE.
LA
DE
met au
nominatif,
exemples, Q^U^ffyU' U ces deux hommes
jUJif V,Ut est-ce que ces hommes sont debout!
les
ne sont
'
"°
3
&
*
Ta
comme on
dans
vu
pas debout ;
'
-*
V.
CHAPITRE
De
ÏEnonciatif.
ce soit un nom ou un adjec
723. L'ÉNONCIATIF, soit que
tif remplit toujours la fonction d'attribut dans la proposition.
,
Exemples :.Î)U 0Ô3
un
vieillard. Les
Zéid
mots
(est)
HU
savant;
savant et
'& .$*
mon
mari
(est)
UJi vieillard,
sont
déterminé ,
l'énonciatif
ici les
énonciatifs.
En
général
,
l'inchoatif est
un nom
et
adjectif indéterminé.
Suivant quelques grammairiens l'énonciatif n'est régi, comme
un nom ou un
,
l'inchoatif, que par l'absence de tout antécédent grammatical
(n.° 72 1 ) ; suivant d'autres , il est régi par l'inchoatif, et ne peut
l'être par
aucun autre
antécédent
grammatical.
724. L'énonciatif doit toujours être
régulièrement après l'inchoatif.
Nous
avons
vu, ci-devant
(n.° 718)
au
,
nominatif; il
un
cas
se
place
où l'énonciatif
précède régulièrement l'inchoatif , sans que l'un et l'autre de
ces deux termes changent pour cela de nature. II y a quelques
d'inversions de ces deux termes ; mais plusieurs
autres
exemples
grammairiens ne
rendre raison
,
à
les admettent pas
analyse.
(n.os 760 et
une autre
ques-uns dans la suite
/// PARTIE.
,
et ont
Nous
suiv.
en
recours
,
pour
en
indiquerons quel
).
Bb
386
DE
SYNTAXE.
LA
CHAPITRE
VI.
Du Verbe.
qu'il y ait à observer ici relativement au
verbe c'est que les grammairiens comprennent sous ce nom
par rapport aux règles de la syntaxe les adjectifs verbaux ou
"noms d'agent et de patient et ceux qu'ils nomment J&Jf ol^û
assimilés au verbe (n.° 62.1 i.re p.). Ainsi dans cette propo
sition £^U ly o4j Zéid, son esclave (est) beau, pour l'esclave
de Zéid (est) beau, o^J Zéid est l'inchoatif, et les deux autres
mots forment une proposition verbale qui tient lieu d'énonciatif
et qui est composée d'un verbe et d'un agent, ^ô. beau, adjec
72 <
La seule chose
.
,
,
,
,
,
,
,
tif verbal, étant considéré
726.
Les verbes
j£*Jï qui
,
première
,
primitives,
lettre
ajoutée
LX^
est
aux
indiquée
jjé
il
par
quelque
mots
o^ j'ai
su,
ajoutée
De
n'y
a aucune
jjûl*
oJȎ
qui précède
qualité signifiée
ce nom
nom
exprime
par le verbe.
ou
tu as su,
~^\
VII.
l'Agent,
727. On appelle agent le
:
aux
est
le pronom est apparent, c'est o-ô
le
su,
pronom est caché (n.° 8 i4, 1>l P-)>
CHAPITRE
le
lettre
avons su,
a
un
pronom
signification à la
le pronom est jJS apparent. S'il
lettres primitives , le pronom
caché. Ainsi, dans les
nous
censés contenir
leur agent et qui détermine leur
seconde ou troisième personne.
lettres
dans
toujours
verbe.
est
Si la personne
y&JL»
sont
comme un
le
auquel se rapporte le verbe
sujet qui a pour attribut la
DE
LA
387
SYNTAXE.
l'ad
placé après le verbe,
jectif verbal qui fait la fonction de verbe. Exemples : y* ôU
Omar est mort; ifj\ <L>U Jj£ Omar, son père est mort, c'est-à-dire
le père d'Omar^ est mort. Les mots f£ Omar, dans la première
phrase et *j4f son père, dans la seconde sont les agens du verbe
L'agent
doit donc
toujours
être
ou
,
,
,
ôl*
est mort,
728. L'agent,
expression équivalente
une
dit
en
que
à
de l'inchoatif.
parlant
plaisir
ta
lieu d'être
au
tu es
sorti;
ce
un
un nom
vrai
^y>
nom
ôjy%\
Exemple ô*J£. y
l'équivalent
est
,
peut être
comme on
■>
:
qui
n»\
l'a
déjà
y&\ il m'afait
de
cîUjjà yZ£\
sortie m'a fait plaisir.
n'est pas alors
a son
agent en lui-même. La
agent, mais inchoatif, et le verbe
en ce cas n'est plus simple ; elle est composée , ayant
Si le verbe
précédé
est
d'un
nom
,
ce
nom
proposition
pour attribut
une
proposition complète (n.°7i 1).
<I^U "f?
Ainsi
Omar est mort, est la même chose que y> ôU jj> Omar, est mort
lui; et cette proposition est absolument semblable à celle-ci,
tL\ ôU
verbe
,
o4; Zéid,
et
porte
mort son
est
père ; Jf£
lui-même
en
son
est
inchoatif, ôU
De même
agent.
,
est
dans
Uf je,
est
J|-aiûi yj^» pronom séparé,
qui
inchoatif; le verbe est Iff* ; le %*& jJ£ pronom affixe
est en même temps
jjî apparent {n.° y 26), est l'agent du verbe.
le
aù'y> bf j'ai frappé,
o
,
adjectifs verbaux. Toutes les
fois que le nom ou pronom auquel ils se rapportent les suit
on le nomme agent. Ainsi, dans ces exemples
o^JJf yfé U
720. II
en
est
de même des
,
,
n'est
pas
debout
sont pas
debout;
à-dire,
est-ce
est
inchoatif,
deux hommes, c'est-à-dire
ces
cfe-ji^ VJ^'t
ces
hommes
que
les mots
La même chose
a
est-ce
o^-j
lieu dans
qu'est
sont
et
debout
tl^>
ces
.
debout
deux hommes
ces
ne
hommes! c'est-
(n.° 719)!
sont
phrases
ces
le
mot
agens.
:
Bb
2
/U"
388
DE
cs>j Zéid, le serviteur de lui
le serviteur de Zéid frappe.
£>yà>
ïw^lc.
dire ,
l^^U
teur
SYNTAXE.
LA
Jyû£\ y±j ^îU«
de lui , c'est-à-dire
,
H
(est)frappant
,
c'est-à-
à moi Zéid, le bead le servi
est venu
dont le serviteur
est
beau.
exemples, Iô^U le serviteur de lui, est agent par
rapport à â>Jà> frappant et à y^\ le beau.
730. Tout ce que l'on dit ici de l'agent a aussi lieu par
rapport au nom Ou au pronom qui sert de sujet au verbe passif,
et que l'on nomme £Lli
fi.'\ cS^Î Jy*-M l'objet d'une action
Dans
ces
J
_
»«C
,,
3,0
"«O
l'agent n'est pas nommé: ce sujet est considéré comme agent,
on le nomme JcUJf lui Vis
remplaçant l'agent, quand il est
dont
et
après
ïe verbe ; s'il
verbe porte
en
est avant
lui-même
ïe verbe , il devient
son
inchoatif,
et
le
agent.
CHAPITRE
VIII.
Du Patient.
plutôt dCobjet de l'action
Jjjtïlif sont compris cinq termes complémentaires ou circons
tanciels qui peuvent trouver place dans la proposition (n.° 170).
Je traduirai le mot Jj*à* par celui de complément pour simpli
fier l'expression.
732. Le premier, nommé ^JUaLtf J^lallf complément absolu,
73
Sous le
I-
nom
de
patient,
ou
,
,
est
le
nom
d'action du verbe
,
ajouté
verbe d'une
au
verbe lui-même
ou
à
un
signification équivalente ; ce qui se fait dans plu
sieurs vues: i .° o^%3uJJ pour donner de l'énergie, ex. ITJi o-J}-*
j'ai frappé rudement ; 2° ifô—«jjf pour énumératïon, exemples,
f..jyi> c^?3^ j'ai frappé un coup (j^>y> ^y° j'ai frappé deux
coups ; c'est le nom d'unité (n.° 577); 3.0 çy& pour spécifier,
exemple «J^a Zi'iy* j'ai frappé d'une certaine manière ; c'est le
,
,
nom
389
DE
LA
SYNTAXE.
579
)
fo^oJî IjJ-Î> o4j^» j'ai frappé d'une
spécificatif ( n.°
; et
percussion forte.
Le second
nommé
simplement Jy^àUf ou *j jy^ûll
celui sur qui se passe l'action ou qui en est l'objet c'est le complé
ment objectif des verbes. Exemples: louj oj>^ j'ai
frappé Zéid ;
'y£ oôlj j'ai vu Omar.
7^4- Le troisième nommé ju^ Jfj*^lf ce dans quoi l'action
est faite, indique ie temps ou le lieu dans lequel se fait l'action.
Exemples : ^Uîf l^Jf ôU il est mort le deuxième jour ; elîlî. stâ.
73 3.
est
:
Je
.-O
,
il
derrière toi.
est venu
735*
Le
de l'action
:
quatrième
ce
sont
l'es
est
tJ
appelé
noms
Jy«iû£f
d'action
qui
«J
ou
tXsS le
servent
à cet
motif
usage.
Zeïd pour le
^-^?^ Î*H) ^Ay^ j'ai frappé
corriger.
*ii
nommé
celui
avec
cinquième,
qui a été
Jj*ï^f
736.
faite l'action indique celui qui a coopéré à l'action avec
l'agent; on le joint à l'agent par la conjonction J. Exemple :
jkL^fl ^UxJUJf sli. le sultan est venu avec l'armée.
Exemple:
Le
,
,
737.
Dans
plément Jjialïf
tous ces cas,
le
nom
qui
fait la fonction de
com
doit être mis à l'accusatif.
CHAPITRE
IX.
Du Terme circonstanciel d'état*
3
738.
Ce
.*>
qu'on appelle Jl^f
état,
est un
nom
destiné à
expliquer une circonstance relative à l'état dans lequel se trouve
l'agent ou le patient ou même quelque autre personne qui entre
dans la proposition comme complément de l'une de ses parties
,
essentielles
,
et
à modifier ainsi l'idée de cette personne.
emploie régulièrement pour cela ïe nom d'agent ou adjec
tif verbal. Exemples : LJL£=»fj ù—^j «U. Zéid est venu à cheval;
lâj^ yyà\ o4^=>3 ïai monte l* cheval (qui étoit) sellé.
On
Bb 3
DE
3p0
730. Quelquefois
porter^ également
à
SYNTAXE.
LA
le
terme
l'agent
ou
circonstanciel d'état peut se rapau
patient. Ex. oLçls lô^j oJ>î
j'ai frappé Zéid qui étoit assis ou pendant que j'étois assis. On
peut cependant disposer les mots de manière à éviter cette amphi
bologie (n.° 627).
^4-0
Le même
.
en
rapporter
terme
circonstanciel étant mis
même temps à
ys*=,\~j foJJ3 jj£ [^ Amrou
l'agent
et
rencontré Zéid,
a
duel peut se
au
patient. Exemple:
au
tous
deux étant à
cheval.
7'4 f
H Peut aussi
quelque terme circonstanciel
quelque complément
proposition. Exemple : ôJs'oXà'
L^U jJJ^j'ai tué le chien d' Amrou tandis qu'il (Amrou) dormoit.
ou
•
se
rapporter
à
de la
à
742.
Le
terme
circonstanciel d'état
est
CHAPITRE
Du Terme
Comme
743*
le
terme
terme
X.
circonstanciel d'état
spécificatif
sembloit dit du
à l'accusatif.
spécificatif.
certaine manière d'être d'une chose
de même le
toujours
spécifie
précédemment
-ZCS restreint à
dans
une
une
nommée
,
d'un
partie
Exemple
:
qui
^j(? ^V? ^ J\>J^ la rose est agréable par l'odeur et la couleur. Ici
le terme spécificatif restreint la
proposition elitière.
y 44' Quelquefois ie terme spécificatif ne restreint qu'un nom
applicable à une multitude de choses et devient alors un vrai
complément logique. Cela a lieu après certains numératifs et
après les noms de mesure de poids de quantité. Exemples :
tout
ce
tout
son
entier.
•
,
,
,
^3 OjJ-^ vingt hommes;
L***- J-kj une livre de pain';
7 41)
•
Le
terme
spécificatif
,
Xy£^ Jf$? un boisseau d'orge;
>5U3 li" combien d'hommes!
est
toujours
mis à
l'accusatif.
DE
LA
SYNTAXE.
CHAPITRE
Du
n4^'
Le
"y± qui
parce
est
qu'il
comme
mot
le
Complément
arabe jjj£
mis
génitif et indique
de complément à
,
,
au
i
à
747'
La
jùJ\ <Jliltf
une
ou
s'exprime par
les
jjj^j 3
à
au
un
génitif,
adjectif
■
de la maison.
<"°
qui reçoit une annexe.
mis
nommé
visage;
préposition j^I o_j*
—
ce
au cas
beau de
première sorte de rapport se nomme
îltf l'annexe ; et
se nomme <Jl
-
l'antécédent
mis
un nom
nom
**y\ J^-
de
qui
complément
:
Exemple jlôJf y o4»3* Ie SUIS sortl
sert
nom
génitif.
un nom
.°
un
oj) f ^ l'esclave de Zéid,
2.0 Un
XI.
signifie
sert
3pl
La seconde
*jU>J
le
annexion;
conséquent
,
espèce de rapport
préposition et son régime.
74$' Ces sortes de circonstances exprimées par une pré
position et le nom qui lui sert de complément se nomment
jj-jj^j j^c J^iiû complément objectif impropre, soit que l'action
mots
•
une
,
w
laquelle ils appartiennent soit exprimée par un verbe tran
sitif ou qu'elle le soit par un verbe neutre. Dans cet exemple
UuJIj foûj ^'y0 j'ai frappé Zeïd avec le bâton, fo^—{j Zeïd est un
complément objectif proprement dit z.j^> JyÀ» du verbe i^y^
j'ai frappé; et L^kJL avec, le bâton, est un complément objectif
impropre ^~>.j<* j^ H Jj-*~** du même verbe.
Dans cet autre exemple, **#Jt y* ^^î. nous sommes sortis
de l'église, UÂji. nous sommes sortis est un verbe intransitif; mais
û1 a un complément objectif impropre c'est ï^Jl y de l'église.
à
.
*j
,
Bb4
DE
392
LA
SYNTAXE.
CHAPITRE
XII.
».
De là Chose
exceptée.
appelle yl£*> chose exceptée, un terme circonstan
ciel qui fait exception d'une partie sur une masse précédemment
exprimée. Exemples Yo^'j ^ fyuf ù*^ ces gens sont venus me
j4Q-
excepté Zéid.
trouver,
On
On
lière des
ailleurs
(n.os 845
particules d'exception.
trouvera
suiv.)
et
7^0.
Sous le
c'est-à-dire, qui
donnant à
cette
nom
se
particu
XIII.
CHAPITRE
Des
la syntaxe
Appositifs.
ç-^y qui signifie
mots
,
conforment,
dénomination
et
un
qui
suivent,
que je rends par appositifs en
sens plus étendu que celui que
lui ai
assigné précédemment (n.° 34 ) on comprend quatre
parties accessoires de la proposition : o^%>Uf f ou o*%»*j-tf ,le corroboratif, o-*Uf ou *JuLf f le qualificatif, Jo^Jf le mot mis en remplacement ou permutatif, et <jJâiJf le conjonctif (n.° 388).
751. Le corroboratif est ou ~<jpsâ c'est-à-dire, réel consis
tant dans l'expression, quand on répète deux fois de suite une
proposition toute entière ou quelqu'une de ses parties sorte
d'expression énergique et confirmative qui n'a guère lieu que
dans la conversation; ou «j^** logique consistant dans le sens,
quand après avoir employé le nom d'une chose on ajoute l'un
de ces mots (ja» y& qui répondent à notre mot même ou de
je
,
,
,
,
,
,
,
,
-
même,
f£ &
versalité.
-
-
UÏ( Jjf\ £$
Exemples :
-
-
-
£B=>1 ^î totalité,
-
uni
DE
LA
3
SYNTAXE.
3% $
Zeïd lui-même
,"3
Ces gens
Ces deux hommes
.,
,
Le
7<2.
il
s'emploie
r^
sont tous venus vers
sont
qualificatif
moi.
est venu vers
_.,*
venus vers
J'ai acheté la maison
l'attribut de la
}9$
r,
est un
proposition
,
moi,
toute
moi.
tous
les deux.
entière.
adjectif qui ne forme point ici
qui sert à qualifier un nom ;
mais
de deux manières.
il
qualifie réellement le nom qui le
exemples suivans fy^. ^JuJ à^=fprécède comme
bel
un bel homme est venu vers moi; Uui
2k.J ooîj j'ai vu
homme ; et alors le nom est ^j^>y ou c^*^ qualifié,
Dans le
premier
cas
,
dans les
,
:
un
Dans le second cas,
l'adjectif est placé entre deux noms, et,
rapporter à celui qui le précède il qualifie
quoiqu'il
véritablement celui qui le suit. Exemple : i^. f \y^>. £)Xj à^
dont le frère est beau. Alors le nom
un homme est venu vers moi
$
qui précède l'adjectif est nommé oj~=j* qualifié, et l'adjectif luimême s'appelle 44-«* ou C$4-* motivé par une cause étrangère et
le nom qui suit l'adjectif est appelé 4*4-"' cause ; ou bien ïe pre
mier nom est appelé IjpaJ Ljj^y qualifié quant à la forme de
semble
se
,
,
Je
,
le second
qualifié quant au sens.
Dans l'un et dans l'autre cas, l'adjectif est J-â-fff 4-4: assimilé
au verbe, et est censé contenir un agent pronominal. Ainsi quand
on dit
,jiô. Jaj èî*W H m'est venu un bel homme, Ldo^ %!iU.J ovjtj
j'ai vu un bel homme, c'est la même chose que si l'on eût dit
l'expression
,
et
Isy**
ej^j*
,
3^4
y> y^s» l)4-j QÀ4-
LA
DE
il m'est
SYNTAXE.
venu un
homme , beau lui ,
ÏàLj ouf3'
y ICwi j'ai vu un homme beau lui ; ce qui est considéré comme
l'équivalent de y> y^.4 li4-j ùs^4- H m'est venu un homme, est
beau lui;'jo ,.yZL 2i=». j ojK j'ai vu un homme, est beau lui.
7^3 Le permu.tatif est de quatre sortes : i ,° Jklff y Jslff JôJ
^w tout pour le tout, quand, après avoir exprimé un être par son
nom
on
ajoute encore un autre nom qui exprime de même cet
être tout entier mais sous un autre point de vue. Exemples :
,
•
,
,
îàj*\y# é±yL
Omar
Le
de la
peuple
ton
,
frère
est venu
vers
moi,
"^L^^j'ikjfj.A.i *Xjpuf j>y c^£^
ville, les grands et les petits, sont venus vers moi,
!
2.°
avoir
en
à
(jCj\ y
exprimé
entier
,
on
jjo*Â.Jf JôJ
chose par
une
y
ajoute
en
partie. Exemple
une
ment, sont
venus vers
3.0 JLfUVf ^JJJ
partie
un
pour le tout,
nom
un autre
qui
j£l*J l^Sjf £?^
:
quand après
qui signifie
cette
restreint ïa
ces
gens,
chose
signification
une
partie seule
ou
réciproque
moi.
du
Ex. *.^y oj)
ment.
d'une
contenu
é^L»
pour le contenant,
Zeïd
a
été dérobé ,
(du moins)
4.° ixUit JôJ d'erreur quand après avoir dit un
,
,
son
mot
habit.
pour
un
reprend. Exemple : ^y i_d4 ^fy j'ai passé près
(je veux dire) d'un cheval.
Le conjonctif est de deux espèces: 1 .° ulÇÇjf ^é.
J^4conjonctif explicatif quand après un nom moins connu on en
ajoute un autre plus connu afin d'être mieux compris ou pour
lever quelque amphibologie. Exemple : ojj tîlyJ à}^r ton frère
Zeïd est venu vers moi. Le nom propre sert à distinguer Zéid des
autres frères de celui à qui l'on
parle*. Ceci diffère peu de la
première sorte de permutatif.
autre
,
on se
d'un chien,
,
,
,
DE
LA
SYNTAXE.
395
2,0
c>j>^f L*&é conjonctifformé par une particule. Exemple
jffj ojJ c)*^ // £f£ vf«« ^<?£ moi Zéid et Amrou.
Des deux
dernière
/*
parties
du discours
,
•CHAPITRE
Observations
sur
les
et
conjonction la
première *Ué c!?^**
par
la
<J^.k*i conjoint
/^w^/ porte celui qui est conjoint.
se nomme
wflf jt/t*
jointes
:
une
,
XIV.
Chapitres précédens.
quelqu'une des parties essentielles
proposition est remplacée par une propo
sition complète. On a déjà vu une proposition tenir la place de
l'inchoatif dans l'exemple l£U j^ \y^Lj y il vous est bon de
jeûner (n.° 720) et celle de l'agent dans celui-ci ô-â-jp- y (f*&l
votre sortie m'a fait plaisir ( n.° 728 ). On peut mettre de même
une
proposition à la place du complément objectif. Exemple :
'JyL y oojf je veux que tu sortes, ce qui équivaut à <Aâ.jjà o«jjt
je veux ta sortie.
7î6. Le plus ordinairement c'est l'énonciatif (n.° 723 ) ou
qualificatif (n.°75 2) ou le terme circonstanciel d'état (n.°738)
qui sont remplacés par des propositions; et dans tous ces cas,
ïa proposition qui remplace ces termes doit contenir un pronom
qui se rapporte à l'inchoatif si elle tient lieu d'énonciatif, au nom
qualifié si elle tient lieu de qualificatif, ou au nom modifié si elle
tient lieu de terme circonstanciel d'état. On comprendra mieux
ceci par les exemples suivans :
yli' ijj\ o.*j3 ou 8j-*Î A* ^j Zeïd son père est debout; ùSj est
l'inchoatif; la proposition nominale Ai o,jI ou la proposition
verbale ifjl fë remplacent l'énonciatif.
7< t
ou
.
Il arrive souvent que
accessoires d'une
,
,
,
,
396
yli' o^jf *îfLj à^
DE
LA
ou
ojif
SYNTAXE.
*U*
# ,«* venu vers moi
dont le père est debout;
^Lj c^,1^
père est debout, c'est-à-dire
les propositions Vja Sjjfet ©jif lU" tiennent
un
homme,
son
,
et se
rapportent
-,Jf 1**1"
ojjl
wb
de Zéid ,
■*
VtS"
oyfj
•--
ojjj ojj*
son
qualifié Jb.j
au nom
"'
°u
f
tiennent lieu du
qualificatif,
.
Jt- «--»•--.,.
°ji'j fHJJ cajj-» ) ai passe auprès
-*
/
debout; les propositions
étant
père
6^,1"
lieu de
terme
<>jjf
circonstanciel d'état,
et
,
L/IS'
le
et
nom
auquel elles se rapportent est Zéid.
75 7* ^e pronom qui se trouve dans la proposition énonciative qualificative ou circonstancielle d'état et qui indique son
rapport avec l'inchoatif, le nom qualifié ou modifié s'appelle
modifié
,
,
,
,
ouU retournant.
CHAPITRE
XV.
De la Construction.
7^8.
tion
,
Les différentes
doivent observer
parties qui
entre
elles
constituent
un
ordre
qui
proposi
assujetti à
une
est
règles. Nous allons les exposer ici en suivant l'ordre
dans lequel nous avons traité de ces différentes parties.
7Jp. L'inchoatif et l'énonciatif constituant une proposition,
là première place appartient naturellement à l'inchoatif; cette
règle cependant est sujette à quelques exceptions.
760. Quand l'énonciatif est simple ou est un terme cir
certaines
,
constanciel de lieu
,
on
peut le
C
placer
avant
OfC
l'inchoatif. Ainsi
0-0
l'on peut dire
également, qI^â. ^UuVf ou Jyi2i\ £jKIâ. f homme
est un animal,
yôJ) j o^.j ou o-j) jfôJf j Zeïd est à la maison.
Dans ce cas l'inchoatif, quoique déplacé est toujours virtuel
lement fjJOJti* la première partie de la proposition. Aussi, s'il
doit y avoir dans l'énonciatif un pronom afïixe
qui se rapporte
,
,
DE
à
l'inchoatif,
dans
sa
sition
comme
maison , le
n'apporte
du pronom
rapporte. On peut
(est)
dans
397
SYNTAXE.
cet
exemple «jfî j o4}
,
Zéid
(est)
parties de la propo
à cela , quoiqu'il soit de ïa
des deux
déplacement
changement
affixe d'être précédé
aucun
nature
maison
LA
donc,
si l'on veut,
par le
auquel
nom
dire, ojJ
il
dans
ïj^'* à
se
sa
Zeïd.
l'énonciatif, quoique placé ïe premier est tou
jours virtuellement la seconde partie de la proposition. Ainsi
quoiqu'en plaçant l'inchoatif après l'énonciatif on puisse lui ad
joindre un pronom affixe qui se rapporte à l'énonciatif, comme
l#*U jîjJI j dans la maison est le propriétaire d'elle, on ne
pourroit pas conserver la même forme d'expression en plaçant
l'inchoatif avant l'énonciatif. On ne pourroit pas dire, j l'ee-^0
Au contraire ,
,
,
,
jfojf le propriétaire d'elle (est)
dans la maison; il faudroit
dire,
propriétaire de la maison (est) dans elle.
761. Dans les propositions interrogatives, l'inchoatif doit
être placé après l'énonciatif. Exemples : ôM y qui (es) tu! foi U
qu'est (~ ce que) cela!
d'un
762. Dans une proposition composée d'un inchoatif et
verbe pourvu que ïe verbe n'ait point d'autre agent que le
on
peut
pronom compris dans le verbe lui-même y^A (n.° 728)
il
alors
mais
le
verbe
mettre
;
après
déplacer l'inchoatif et le
véri
cesse d'être inchoatif, et devient agent. Ce n'est donc pas
[#j jtjjf o^^"
Ie
,
,
tablement ici
Ainsi l'on peut
et
une
inversion de l'inchoatif
et
de l'énonciatif.
dire, û>y> o*j Zéid a frappé [Zéidus verberavit]
ujL*\ <&J=*\ ô'
^3 si Zeïd m' honore, je l'honorerai [si
,
Zéidus
eum], auquel cas cy) Zéid est inchoatif;
ou bien,
o4j ô>* a fraPPé Zeïd [verberavit Zéidus] Jsô^î ô]
HjéJ 0Ô3 si m'honore Zeïd, je l'honorerai [si honoraverit me
Zeïd devient agent.
Zéidus, honorabo eum], et, dans ce cas, *£
honoraveritme, honorabo
,
35)8
DE
Dans CSy<>
où)
,
le
SYNTAXE.
LA
o-?j est
728) forme
nom
inchoatif, le verbe CSy>
avec son
proposition qui sert d'énon
ôj-^ *M) est composée (n.°7ii),
^e
verbe
Dans o^>3 VJ^
oj*^ est verbe et le nom o~?3 agent :
la proposition est simple et verbale ; il n'y a ni inchoatif, ni
pronom caché (n.°
ciatif: ainsi la proposition
une
,
>
énonciatif.
Si le verbe
a un
agent apparent (n.° 728)
,
l'inchoatif ne peut
exemples : ©jjf ôL-4 o-Jj
Zéid, est mort son père c'est-à-dire, le père de Zéid est mort;
fJjÂ=>\ if*\ (%y4- o^ °^3 Zéid si son père vient me voir, je l'hono
rerai, c'est-à-dire, si le père de Zéid vient me voir je l'honorerai.
763 Lorsque l'attribut, précédé d'une particule négative ou
interrogative, fait la fonction d'inchoatif comme on l'a dit pré
cédemment (n.°7io) on ne peut pas déplacer ïes deux termes
de la proposition : si on le faisoit, il faudroit faire concorder l'at
et alors le sujet reprendrait la fonction
tribut avec le sujet
pas être
déplacé
,
comme
dans
ces
,
,
,
.
,
,
,
d'inchoatif,
et
l'attribut celle d'énonciatif. Ainsi l'on
pas dire, /U" y3KL'y\ U ces deux
il faut nécessairement dire
tribut négatif y Ui U
,
et
,
hommes
M-iU-J^ ^/fi
ne se
U
l'énonciatif étant le
,
ne
tiennent pas
peut
debout;
l'inchoatif étant l'at-
sujet y$A.y f
; ou
bien
yUy o^U-jJf U, l'inchoatif étant le sujet ^«âUjJf et
l'énonciatif l'attribut y^ejà ou plutôt efc<G à cause de in
fluence de la négation U(n.° 96).
j64> Par rapport au verbe et à l'agent c'est une règle
générale que le verbe précède l'agent ; ce qui a lieu aussi pour
ïe sujet du verbe passif qui se comporte comme l'agent du
verbe actif. Si l'on déplace l'agent pour le mettre avant le verbe,
il cesse d'être agent, et devient inchoatif (n.° y 6 2).
j6$. Les cinq espèces de complémens ou termes circons
tanciels compris sous le nom de tjyétût _(n.° 731) suivent réguil faut dire
,
,
,
,
,
DE
LA
lièrement le verbe
SYNTAXE.
ils
35>p
II
auquel
complément. n'y a
règles qui déterminent leur position respective : on
point
doit à cet égard se conformer à ce qu'exige la clarté et même
l'harmonie en plaçant d'abord ceux qui sont plus courts et
réservant pour les derniers ceux qui sont plus longs. Exemple :
servent
de
de
,
,
,
,
,
*J Uolo fo^o-îi v_>^» **«j*f
frappé, conjointement
avec
»y j^Vf
Amrou
lUf
Zéid,
,
vendredi, d'une manière très-violente
foôj [>^9
o«j>*
de
j'ai
l'émir, le
que cela lui servit de
afin
,
^f
présence
en
correction.
^66. Cependant
ment
le
patient
objectif'proprement
avant
le verbe ,
Exemples
,
nommé
dit du verbe
et cette tournure
*j
Jjiàltf
complé
placé
l'énergie à la phrase.
transitif,
donne de
ou
est souvent
:
y3yi\
C'est Dieu que
nous
<j<*iuù
V o-vA/^âf
adorons
c^Sjfj
,
o-**j
et non
les idoles.
c^luf
appelons à notre aide.
Quelquefois, en ce cas, on donne à ce complément une prépo
sition et il devient le complément de ïa préposition ; mais alors
il cesse d'être Jj*.iu complément objectif immédiat du verbe et
devient jjj£ complément mis au génitif (n.°747). Exemple :
Ûfj^'^.yiiï'j&siïl si vous interprète^ cette vision. La préposi
tion sert à fortifier l'action du verbe sur son régime
cette
action étant affoiblie par le déplacement du régime.
j6j. Le complément objectif du verbe.doit être placé néces
sairement avant le verbe, quand c'est un mot interrogatif,
comme
'y et U Exemples : cxU» y qui as-tu tué ! ôiià U
qu'as-tu fait! Ces mots occupent encore la même place, quand
ils sont simplement conjonctifs, ou en même temps conjonctifs
et conditionnels. Exemples
C'est toi que
adorons ,
nous
c'est toi que
nous
,
,
,
.
:
4oO
DE
SYNTAXE.
LA
ciu^u J&*
JV
sais pas
w£
5Î
..
Instruis- moi
Je
ne
d'eux
qui
plémens objectifs
Je
ne
uj
sais pas de
'
Je frapperai
II
et
de lieu
,
en
nommés
Par-tout
o^
qui
Le
lièrement
*/j
ou vous
quand
le
i.rt p,).
terme
après
nom
le
m
toute
de
•
,
°
?:.
-
personne que
modifié
tu
frapperas.
circonstanciels de temps
ils sont conditionnels. Ex. :
termes
les trouvère^ ,
sortiras,
combatte-^ contre
modifie
place régu
proposition,
déterminé (n.° 508
(n.° 738)
se
à la fin de la
qu'il
«JjiU, c'est-à-dire
est
et
eux.
sortirai.
je
circonstanciel d'état
nom
t'informes.
l'ai écrit.
je
,
tu
aux com
-
nous tu
Jj*iu quand
Quand
77O.
d'or j'ai reçues.
f jjfi ^5j S f V
de même des
est
préfères.
qui j'ai passé.
W^
'
C* que j'ai écrit
760.
tu
pièces
sais pas près de
Ju*j
tîé
à
s'applique également
verbes intransitifs. Exemples :
3^
,/tf
tué.
disons ici
nous
des
a
S
.
•
o
»
sais pas combien de
Ce que
768.
,^So-»C
v*
serviteur
ton
qui
3
j
y (jy>\
Exemple': U%>J3 o^Uf y «^fô^3 <^3 à^-4-
,
Zeïd
et ses
gens
DE
LA
401
SYNTAXE.
la
sont venus de
mosquée che^ moi, à cheval. Quand le nom
o]X~> indéterminé, on place ordinairement le modifi
catif auparavant. Exemple : JJLij Cé=>Vj ^fU un homme est venu
à moi, à cheval. Le principal motif de cette .construction est de
distinguer le modificatif du qualificatif.
gens
modifié
est
Le modificatif étant toujours indéterminé, on ne peut
pas le confondre avec le qualificatif, toutes les fois que le nom
modifié est déterminé , et alors on le place toujours à la fin de la
7H I
.
proposition.
rarement,
même le
Par la même
mettre
nom
soit pas à
peut, quoique cela arrive
le modificatif à la fin de la proposition, quand
modifié
est
cas ne
on
indéterminé
le
,
pourvu que
ce nom ne
propre au modificatif; car la
permet pas alors de prendre le modificatif
l'accusatif, qui
différence des
raison,
est
cas
adjectif qualificatif. Exemple : U»Us £Jiâ.^ «sfjj ^ '«>
prièrent derrière lui en se tenant debout.
quelques
772. Si le modificatif est un mot interrogatif ou condition
nel il doit être placé avant le verbe. Exemples : o4) £^ <StJ==»
comment est venu Zéid! Jiif Jkii- <jlë=> comme tu feras je ferai.
pour
un
hommes
,
,
,
773.
Le
terme
spécificatif j^j
ou
spécifiant J^JJC
doit
tou-
spécifié j*£ (n.° 743). Ex. UviU oj>% c£^
j'ai vingt esclaves. S'il spécifie une proposition entière, il se place
à la fin de la proposition. Exemple : ITjJ Vjy\ CJ& la rose est
agréable en couleur. Quelques'grainmairiens permettent dans ce
cas de placer le spécificatif avant le verbe.
774. Le nom employé au génitif, comme complément d'un
suit immédiatement la prépo
autre nom ou d'une préposition
de
le
nom
il
ou
sert
sition
auquel
complément. Les termes
circonstanciels ou complémens indirects formés d'une prépo
n'ont point de place marquée
sition et de son complément
dans la proposition.
jours
suivre le
mot
,
,
//.' PARTIE.
.Ce
*>E
4o2
LA
SYNTAXE.
exceptée <jJx^Ji\ suit toujours immé
diatement la particule d'exception, et celle-ci suit ordinaire
ment le nom qui exprime ïa masse de laquelle on excepte. Ex.
Ijy "^ fj^' à^ ces gens sont venus a moi, excepté Zéid. Si la
phrase est négative, on peut placer Ja particule d'exception et
le nom de la chose exceptée avant celui qui exprime la masse
de laquelle on excepte et même supprimer tout-à-fait celui-ci.
o—^-f Ioj) ^J <J*l4- L»
On dit donc : \ù*j ^l oô^f à^î* U
oôj ^ à3^ ^ H nest vem personne vers moi, sinon Zéid.
776. L'appas i tif y&\ (n.° 750) suit toujours le nom avec le
quel il est en apposition pj^wif : si cependant celui-ci avoit un com
plément et un appositif, il faudroit placer d'abord le complément
et ensuite I'appositif.
Exemple :'SjJ)t\ oJj i^U tyJAj'aj rencontré775
Le
.
nom
de la chose
?
-
-
l'esclave de Zeïd , le noir, c'est-à-dire, l'esclave noir de Zeïd.
CHAPITRE
XVI.
De la Concordance.
777- Les
règles
de la concordance
concordance du verbe
qualificatif
avec
le
avec
nom
son
qualifié
,
noms;
3.0
yjS.
a
trois
et
suiv.
)
l'adjectif conjonctif
ont
lieu
objets:
des pronoms avec les
antécédent.
J^lsJ^ J**Jf
la personne , le genre et le nombre.
donné les règles de cette concordance
:
; nous
entre
ferons donc seulement ici
le verbe
i.° La raison pour
et son
ïXMLa
(n.os 308
observations
quelques
envisagent les discordances qui
agent dans certains
laquelle
i.° ïa
avec son
avons
la manière dont les Arabes
sur
et
La concordance du verbe avec son agent
objets
Nous
trois
agent; 2.0 celle de l'adjectif
ce
qui renferme aussi la con
cordance des articles démonstratifs
celle de
ont
le verbe
est au
cas.
singulier quand
DE
4°3
SYNTAXE.
LA
agent qui le suit est au duel ou au pluriel c'est que les terrai*
naisons des personnes des verbes étant des pronoms qui font
son
,
fonction
est
d'agent
exprimé ^*U>
faire usage
prpnoms deviennent inutiles
ces
,
;
seroit
ce
une sorte
de
quand l'agent
pléonasme
que d'en
en cecas.
Quand le sujet du verbe précède le verbe il n'en est
plus de même: le sujet est alors inchoatif, et non agent; le verba
doit, en ce cas porter son agent en Itii-même, et cet agent
2.0
,
,
doit concorder av%c l'inchoatif.
pluriels irréguliers masculins
3 .* Avec les
indifféremment le verbe
au
genre masculin
,
on
ou
peut
employer
féminin. La r«û>
pluriels sont considérés comme des noms col
lectifs qui renferment l'ellipse du mot U\& collection : JJU.^ par
exemple est l'équivalent de JU>f I <Ul> et l'on peut faire conson en
est
que
ces
,
,
,
corder le verbe
le genre de
La concordance du
779.
ojiLtfj
avec
c>*ÂJ^ iiSjUw
cas, et la
présence
a
ou
nom
Jti;,
ou avec
qualifié
quatre objets
:
le
celui de *&Uf
le
avec
,
qualificatif
nombre, le genre, le
l'absence de l'article.
J'ai déjà dit ailleurs (n.°7$2) que l'adjectif est employé , en
arabe, en deux manières différentes : tantôt' il se rapporte à un
nom
qu'il qualifie effectivement , et alors on l'appelle <^j*£U( ^Jli
placé entrlMeux noms et
quoiqu'il semble se rapporter à celui qui le précède il qualifie véri
tablement celui qui le suit et on le nomme t^jLyi\i ^JJU.'Ût £)ta.
(état) de la chose qui est accessoire h la chose qualifiée.
J'ai exposé ailleurs (n.OÎ 3 58 et suiv.) ïes règles de la concor
dance du nom avec l'adjectif dans l'un et dans l'autre cas,
780. La concordance de l'adjectif conjonctif avec son antécédent
ÛJ\ i^y^ii^y*\ fcîjlii est la même que celle du nom et de
état de la chose
qualifiée ; tantôt
il
est
,
,
,
,
Fadjectif cpialificatif,
CC2
4o4
SYNTAXE.
LA
»E
CHAPITRE
Des
781.
certaines
Ce que
nous
distinguer
espèce d'influence
est
cette
influence
exercée,
par
JjpU
:
Dépendance
exercent
complémens
sur
général,
l'influence que
est
les autres,
et
qui
de leurs antécédens* Cette
^ opération ;tle mot qui exerce
J*U et celui sur lequel elle est
nommée
nomme
se
en
appelons dépendance
du discours
parties
les
à
sert
de la
Règles
XVIL
,
je traduirai le premier par régissant,
et
le second
régi.
appelés régissans sont divisés en deux
classes *lJaJïJ exprimés ou grammaticaux et *-jy.*U non expri
més ou logiques.
Les régissans grammaticaux sont subdivisés en «^?L3 fondés
et *ÂcLsw
fur l'analogie ou réguliers
fondés sur l'usage. De ces
deux subdivisions la première se partage encore en sept classes,
782.
Tous les
mots
,
,
,
,
et
la seconde
783
.
tion de
en
treize classes.
Le verbe , le
nom
Le verbe
régissans.
et
particule peuvent faire la fonc
la
et
le
nom
CHAPITRE
De
7o4«
Le verbe
78J.
Les verbes
l'Influence
seul peuvent être
XVIII.
du Verhe,
général (jJLkif J«ft.,,Jf
régissans grammaticaux réguliers.
en
que deux cas, le
7o6. Tous les verbes
est
le
premier
que des noms. Ils ne
et X
,
accusatif o-ôlff
régissent
nominatif J^y\
ne
régis.
régissent le
des
régissent
.
nominatif; les verbes actif*
DE
mettent tous
au
nominatif,
agent. Cet agent
le verbe
:
il
est
virtuellement, leur
l'a déjà dit (n.° 727) suit toujours
réellement,
comme on
,
,
ou
^*L£
ou
apparent, lorsque c'est
c'est
,
seul
le verbe
mot avec
ou
,
^li pronominal (a) lorsque
un
4°5
SYNTAXE.
LA
; et
un
celui-ci
leur
le
sujet appelé
d'agent, JeÛÎ ^
patient
ou
nom
,
ou
pronom renfermé dans
est
,
ou
jj^ sensible,
ou
2.'
72e,
p.).
jl&Ï caché (n.° 8i4,
de
même
verbes
Les
passifs régissent
787.
1" p; et n.°
un
au
nominatif
l'objet de l'action, faisant la fonction
U;/£li}f Jj£&\
( n.° 730).
II y en a de plusieurs espèces.
L'un est particulier aux verbes transitifs ; on le nomme
tt'JJ&XÏ ; c'est V objet ou le complément objectif du verbe actif,
devenu le sujet du verbe passif ( n.° 1 78 ) : il est de même que
l'agent, ou ^*lk' apparent, ou lyX* pronominal.
Les autres sont communs à tous les verbes. Le premier est
jJ^'lT^lVlT le complément absolu; c'est le nom d'action même
du verbe. Exemple : ou.tv*i Jy» y>» une marche forte a été mar,
chée
(n.°
i*7).'
complément qui indique le lieu ou
le temps de l'action. Exemples : j^ 3**ï un m0is a ^ marché,
iuîà *)£of y*» trois milles ont été marchés^ (n.° 188).
Le -troisième est ^lif^ «/Jyiit le complément objectif
Le second
est *<£
Cls*^
^
dans la pensée, dans
(a) Le mot \^£» signifie proprement ce qui est renfermé
une autre langue, si je dis Petrus
dans
un
exemple
l'esprit. Ainsi, pour prendre
le sujet m
dormit, le sujet Petrus est apparent; mais si je dis dormis ou dormit,
ou ille est renfermé dans la pensée.
Je me sers du mot pronominal, pour simplifier l'expression ; mais il faut obser
du verbe, que
ver
que si le pronom personnel étoit exprimé indépendamment
Tondît, par exemple, Ll oii" dixi ego. l'agent seroit apparent. Cependant,
en
suivant
système, des Arabes, la finale 0 àe c>X9
Cl seroit un appositif corroboratif à£py çiy
rigoureusement
l'agent pronominal
,
et
le
.
CQ3
seroie
$o6
DE
improprement dit; c'est
mile le
arabe
SYNTAXE.
LA
un
sujet vague
et
latin dans
indéterminé
qui assi
,
expressions ventuni
passif
esf, dicitur, itur, &c. et qui fait "le m|me effet que notre sujet
indéterminé on. Exemples :
passif
au
ces
,
,
Cad
//
a
été
sorji, c'est -à-dire
J
,
on est
sorti de la
mosquée,
i
jUjji (JfjssXAf
II
a
été besoin
On s*est mis
On
a
On. a
78 B.
il y
a
sont
en
d'argent.
colère
'passé près
eu
contre
lui.
de Zeïd.
peur des
volejirs.
régissent pareillement l'accusatif; mais
différentes espèces de régimes placés à l'accusatif; Les uns
>U
Tous les verhes
communs
à tous ïes verbes
liers à certaines
,
ïes
J»la. particu
de verbes.
espèces
l'accusatif, qui
régimes
Les
autres sont
mis à
ïes
sont communs à tous
^Xkli) Jyùltf ou jlvXtf le complément absolu ou
nom d'action; <*s
tlj*£tf le complément qui indique le temps ou h
lieu de l'action;
JyXtt le complément qui indique ceux qui ont
concouru à l'action,; *J
jJJ*sl~-1\ le complément qui exprime le motif
verbes,
sdnt
***
de l'action;
jL^l
le
terme,
circonstanciel d'état
(n.° 170).
»
Ceux
*ià
qui sont particuliers à certains verbes sont "l}y&A
le
.«.jJLfl
complément objectif proprement dit (n.* 84) particulier
aux verbes transitifs ;
J.~SJf le spécificatif (n.* 120) qui ne
fcj
,
,
,
LA
DE
4°7
SYNTAXE.
convient
qu'aux verbes dont l'action a besoin d'être restreinte ;
o^-aÂlll _/^f l'énonciatif mis h l'accusatif', particulier aux verbes
nommés
on
o^JLiif Jliif
parlera
Les verbes
780.
i.re p.)
:
comme
quelques
dont
autres
triplement
actifs
intransitifs (n.° 224,
simplement ou doublement
sont ou
ou
transitifs.
verbes transitifs
__Les
cœur, et à
transitifs
sont ou
les verbes transitifs
même
ou
w^j de
dans la suite.
ou comme
in transitifs peuvent être employés
passifs ; mais il faut observer que , les
ou
employés à la voix objective on ne doit
jamais exprimer l'agent par forme de terme circonstanciel au
moyen d'une préposition à laquelle l'agent serve de complément,
comme on peut dire en latin et en françois : Nero occidit Briverbes arabes» étant
,
,
tannicum, Néron
Britannicus ;
tua
ou
Britannicus occisus
est a
Nerone, Britannicus fut tué par Néron.
7OO. La plus grande partie des verbes transitifs outre leur
complément objectif direct ont des conséquens ou complé
mens indirects
auxquels ils se joignent par l'intermédiaire d'une
<i* ""G* ^c' ^es
préposition comme cj J ô* t*'
verbes intransitifs prennent toujours leurs complémens au
moyen d'une préposition. Mais la connoissanee des prépositions
qui conviennent à chaque verbe est plutôt du ressort du dic
tionnaire que de celui de la grammaire (a).
Tout cela ayant été expliqué ailleurs je ne m'y arrêterai pas.
,
,
-
-
-
~
,
,
,
emploient la dénomination de
(n.° 22$, //'/'.), c'est-àqui
transitifs oSÎJ> pour
leurs
des
soit
dire qui ont
complémens immédiate
qu'ils gouvernent
complémens
comme
ou médiatement
ment comme f tj^p JÛùà il a tue' Amrou
j>_#j j*
(a) Observez
que les
grammairiens
tous
les verbes
relatifs
passéprès
plément
,
,
,
a
sont
,
,
il
Arabes
au
d' Amrou. Dans le dernrtr
moytn de telle
ou
telle
cas
,
ils disent que le verbe passe à
préposition j»aL <_jj-^
son com
*-lj*** d>\9<S <>-**£
Cet
•
4o8
SYNTAXE.
LA
DE
701. Les verbes simplement transitifs
les verbes doublement
plément à l'accusatif:
sitifs gouvernent
à l'accusatif.
régissent
pareillement
leurs deux
s'ils
simplement
sont
s'ils
sont
devient
sujet
objectif:
mens
transitifs
,
,
peut indifféremment
et
le second
prendre
triplement tran
trois complémens
à la voix
objective,
complément
plus
un de leurs
complé
mais
on
complément ;
de
ils n'ont
doublement transitifs
pour
reste
com
et
ou
702. Quand les verbes transitifs passent
leur
,
sujet l'un
ou
l'autre des deux
complémens, et l'on peut dire: l^}? o^J ck^ ou J«H> fj\ îk*i
une
pièce d'argent a été donnée à Zéid, ou Zeïd a été gratifié d'une
pièce d'argent; *Ia» c>*?'j y^=> ou tow->3 **~-^ o^£=» Zeïd a été
revêtu d'un habit,
ou un
habit a été mis
sur
Zeïd
(a).
le
793 Quand un verbe a deux complémens celui qui est
se
le
doit
suivre immédiatement
verbe,
plus essentiel, et qui
,
•
"[Jj^f Jt\y&\\ Ie premier complément objectif,
<|v£Jt JjiiCjI le second complément objectif.
nomme
1»
^3*
j*
et
l'autre
"°
CHAPITRE
Du Nom
XIX.
d'agent.
régissans grammaticaux réguliers est
le nom d'agent Jclîlf tûj qui équivaut à-peu- près au participe
actif des Lat,ins, et qu'il ne faut pas confondre avec l'agent ou
sujet du verbe ^tUJf (n.° 727).
79 J. Le nom d'agent a les mêmes régimes que le ^jLL» ou
yç)4:'
Le second des
,
(a)
J'ai suivi ici Martellotto j mais
trictions
(n.° ib'o).
cette
règle
est
sujette
à
beaucoup
de
res
DE
aoriste , c'est-à-dire
mais
avec
que quand
future , et
qu'il
a
est
non
4°9
SYNTAXE.
les mêmes
condition
cette
il
LA
régimes que le verbe ,
à ïa manière du verbe
qu'il n'agit
employé pour signifier une action présente ou
quand on l'emploie pour exprimer une action
passée.
Le
d'agent étant assimilé au verbe, gouverne deux
régimes : l'un est l'agent qu'il met au nominatif, l'autre le patient
qu'il met à l'accusatif. Exemple : \o^ jf o^f [>-> "i»«5U cS^U» txjj
l'esclave de Zéid frappe maintenant ou frappera demain Amrou*
IvàL agent, est au nominatif, et fj-£ patient à l'accusatif,
comme étant tous deux
régis par le nom d'agent ujU
707. Si l'on se servoit du nom d'agent pour exprimer une
chose passée le nom d'agent devroit être suivi immédiatement
du complément qui exprime l'objet de l'action et il ne seroit
plus alors regardé comme nom d'agent mais comme un nom
servant d'antécédent à un autre nom qui est avec lui en rapport
d'annexion (n.°747). On diroit donc :
<^f jfé ùj^> **>&i oJj
706.
nom
,
,
,
.
,
,
,
l'esclave de Zeïd a battu hier Amrou.
Pour que le nom d'agent régisse à la manière du verbe
l'agent et le complément objectif, il ne suffit pas qu'il exprime
une action
présente ou future , il faut encore qu'il se rencontre
708.
une
des six conditions suivantes
:
précédé d'un inchoatifauquel il serve d'énonciatif
Zis* <Lj^ *&) Zeïd son
*fJjÇltf j* o^> ; exemple : ÎJLl5=
esclave (est) frappant Amrou, c'est-à-dire, l'esclave de Zéidfrappe
i.°
Qu'il
soit
*
—
,
Amrou;
précédé d'un adjectifconjonctif Jy»yX\ j* o^* ; ex.
ljL£ tjt'H» i^y^ c$oJf <^*^ est venu à moi celui que son esclave
(est) frappant Amrou c'est-à-dire, celui dont l'esclave frappe
2° Ou
.
,
Amrou,
3.0
est venu
Ou
à moi
précédé
;
d'un
nom
modifié par
un
terme
circonstanciel
4lO
DE
LA
SYNTAXE.
auquel le nom d'agent serve de' modificatif <3> (^ ùJ$*^»
Jlif ; exemple : fJJf tu* LjU oJjj ^yy j'ai passé près de Zeïd,
frappant son serviteur Amrou c'est-à-dire tandis que son serviteur
frappoit Amrou;
4.° Ou précédé d'un nom qualifié auquel il serve d'adjectifquali
ficatif cij^-tî JS. oJ&> ; exemple : fJ-£' tue «4M J^3 $/*>
est venu à moi un homme, son serviteur (est) frappant Amrou, c'està-dire, don t le serviteur frappe Amrou ;
5." Qu précédé d'une particule interrogative <jJt J— ojf**
^J^LûVf-; exemple : fJL«p îà&é. lij^>\ est-ce que ton serviteur (est)
frappant Amrou!
6.° Ou enfin précédé d'une particule négative cJj^ d* ****
Jlif ; exemple: fj-^F îèyk ojU» U #J enfans ne (sont) pas frap
d'état
et
,
,
c
pant Amrou.
application si le
nom
d'agent n'étoit pas suivi d'un agmt apparent jtXk ; il auroit
alors pour .agent Y agent pronominal ji^»", soit sensible jjî
soit caché [yd&Z [n.°y%6).
»
Toutes
ces
règles
auroient
également
leur
,
,
,
Quand
les conditions susdites
ne se
influence verbale
rencontrent
s'il
pas
le
,
nom
complément
celui-ci se met au génitif,
(n.°797).
celui
Ainsi l'on diroit: \sg £) t^J^
qui frappe Zéid, est fort;
*y*>. ojj o^U^if "le père de celui qui frappe Zéid est beau;
U
tMJ Vj^ <yjf-* j'ai passé près de celui qui frappe Zéid ; ^U
si ce n'est celui qui frappe
<H> ^P° ^ 'd** m'est venu personne
d'agent perd
son
comme
; et
a un
,
il vient d'être dit
,
,
Zéid;
0^3 £>J*°
Ij ô toi
qui frappes
d'agent quand
790. Le nom
requises pour exercer
serve cette
influence
,
son
Zeïd!
il
a
d'ailleu^
les
conditions
irifîuence à la manière du verbe,
lorsqu'il est restreint par
l'article
Jf
.
con
DE
4n
SYNTAXE.
LA
XX.
CHAPITRE
Du Nom de Patient.
800. Le troisième
des
régissans grammaticaux
naturels
est
participe passif,
complément objec
qu'il ne faut pas confondre avec le patient
tif du verbe JJJkM (n.° 731).
80 1 Le nom de patient a le même régime qu'auroit l'aoriste
du verbe passif auquel il appartient ; c'est-à-dire que sous Tes
mêmes conditions requises pour que ïe nom d'agent exerce l'in
fluence du verbe (n.os 79 5 et 798) le nom de patient à quelque
cas
qu'il soit gouverne au nominatif le complément objectifdu verbe
qui lui tient lieu d'agent JtUJf lUu^lîJf Jyeûtf Ainsi l'on dit :
ïe
de
nom
patient Jj^JCtf
fwf, qui équivaut
au
ou
et
.
,
,
,
,
.
J-f?
Ç>
8*à.l
Zeïd,
son
J'ai
frère
est
J
•
3
$
»,
OvJ^» i^Jj
frère (est) frappé, c'est-à-dire, le frère de Zeïd est frappé.
vu un
homme
(étant) frappé son frère c'est-à-dire,
,
dont le
frappé.
3
j\
J
9
,
J
ij,
e
,
.
J'ai
passé près d'un homme (étant) frappe
dire, dont le frère est frappé.
frère,
c'est-à-
dans le
chapitre
son
•
II faut
appliquer ici tout ce qui a
précédent à l'égard du nom d'agent.
été
dit,
,
802. Les verbes intransitifs n'ont point de complément ob
jectif immédiat et par conséquent ils n'ont pas de complément
objectifproprement dit %y> Jjiiû quand ils sont employés à la
voix passive : mais leur influence s'exerce virtuellement sur leur
complément objectif improprement dit +y> ^Xè Jyuu. Ainsi, dans
,
,
,
«j
,
*j
4
SYNTAXE.
LA
DE
12
*lJ} ^-Àj^ltl oJi£l\ la mosquée dans laquelle on entre,
ïa*
^jJiâJf c*U^ /<* maison de laquelle on sort, &i* QyjijtLif ^uff
les hommes contre lesquels on s'est mis en colère, les prépositions
phrases
ces
,
complémens sont considérées comme
complément objectif ou patient, ce qu'on exprime en ces termes:
AJÛé préposition avec son complément qui est au génitif i cette
préposition et son complément sont virtuellement au nominatif (ou
représentent par leur fonction dans la proposition, un nom mis au
nominatif), parce qu'ils forment un complément objectifimproprement
dit servant de sujet au nom de patient (a).
803. II y a deux autres manières d'indiquer le rapport du
nom de patient avec son complément objectif: c'est, i.° de le
mettre avec ce complément en- rapport d'annexion is\2o\t le com
J,\
-
y*
^-é
-
avec
leurs
,
,
plément objectif étant
oSâ tjjj-â* J—^j âs^
c'est-à-dire dont
alors
au
Urn'est
serviteur
génitif (n.° 747)
venu un
;
exemple:
homme frappé du serviteur,
frappé ;
2.0 De faire du complément objectif un terme circonstanciel
spécificatif j^é (n.° 743 ) en disant: fo4* MjJ^-° tfe $*^
il m'est venu un homme frappé quant a un serviteur; ce qui signifie
également, dont un serviteur est frappé.
Dans cette dernière manière de s'exprimer le vrai patient
grammatical ou sujet du verbe passifest \e pronom caché j^X» y*u
(n.°786), qui est renfermé dans le nom de patient. C'est
,
un.
est
,
,
comme
si l'on disoit: fjsLâ
8b4(a)
II
en est
Voici le
texte
de
de
'J> tSjj^-» Dij £*^
même, quand, après le
cette
analyse
Voye-r, Marteil. Inst. ling. Ar.
p. 45
:
•
nom
de
patient,
il
DE
4*3
SYNTAXE.
LA
la
la chose
laquelle
qui exprime
on dit
quand
Jyii J^J-j é^fj^j 'bipassé
d'un
homme
tué
; cela équivaut à y> JJ&» d^'jt diijj* (j'a0
auprès
tué (est) lui, ou qui étoit tué,
d'un
homme,
passé près
n'y
a aucun nom
tombe l'action
,
nersonne ou
comme
,
CHAPITRE
De
sur
XXI.
assimilé
l'Adjectif
Verbe.
au
80?. Le quatrième des régissans grammaticaux réguliers est
c'est ordinairement
Vadjectif assimilé au verbe *^Li\ *a^S\
l'adjectif dérivé des verbes intransitifs qui n'ont ni complément
direct ni complément indirect. Cet adjectif n'a proprement qu'un
régime ; c'est l'agent qu'il met au nominatif. Quelquefois il a
:
complément à l'accusatif; mais c'est
cificatif JfyXit (n.° 743). Ainsi l'on dit:
un autre
1£a.j
// m'est venu
c'est-à-dire
,
un
*-««jU
homme, beau (est)
dont le serviteur
U^i
Il m'est
qui
est
y»a> y*-j t£
venu un
est
son
beau de
u)*** u^J
un
complément spé
*»»
serviteur
quant au visage,
visage.
Qf^*
homme, beau (est lui) de visage c'est-à-dire,
,
beau de
visage.
Dans ce dernier exemple l'agent est compris dans l'adjectif.
806. Ces adjectifs peuvent encore régir leur spécrjjcatif
en le mettant
comme complément d'un rapport d'annexion
au
génitif. Dans ce cas l'adjectif ne peut jamais avoir un agent
apparent j*Uj il a seulement un agent pronominal y^u, L'ad
jectif et son complément peuvent aussi être tous deux indéter^
,
,
,
.
,
minés o>CJ.
ou
déterminés *i>*i.
4l4
*-â.j y**. J^-j à^ il m'est venu un homme
*Â.^\ y^k\ J»-jJf c3/^*- il m'est venu l'homme
On peut donc dire
beau de
SYNTAXE.
LA
DE
:
visage ou
le beau de visage, c'est-à-dire qui est beau de visage.
807. A cette classe de mots appartiennent les adjectifs super,
,
,
JU4JÙJI Jisf ; mais
ïatifs nommés
plusieurs
la syntaxe de
ces
adjectifs exige
observations.
808.
superlatifs comme des adjectifs assi
peuvent jamais régir un agent apparent
superlatifs
au nominatif,x et l'on ne
peut pas dife: vy>.\ 3y? y y**>\ ^j oJÎj
j'ai vu un homme dont le frère est plus beau qu' Amrou; 2l=Lj oôfj
*ys»\ j»wf y*2»\ j'ai vu un homme dont le frère est lé plus beau
de tous les hommes (n.° 429)809. Si l'on vouloit se servir de cette manière de s'expri
il faudroit mettre l'adjectif -superlatif au nominatif, en le
mer
regardant comme un énonciatif placé aVant son inchoatif, et dire:
milés
:
Il n'en
est
les
pas des
ne
,
Cetçe phrase
verbe
ôâij
mis à
(a)
^
doit
qui renferme
l'accusatif,
Voici le
s'analyser
texte
comme
arabe de
J- u^' JJJ^ u^^i
en
^^
^
(a)
:
même temps
son
complément objectif
/*&**■'
p.
agent;
SiLj (nom)
du verbe;
JyX\
analyse;
cette
r<y/rç Martell. /««/V. //'»£■. A<2^.
Hiversion,
ainsi
*j
V^*- J^y*
*twu
Ao^i*
455. On pourroit dire aussi,
tj-waJ ojâj (n.° 429),
*-Jy
f^j**
sans aucune
DE
mis
4r5
SYNTAXE.
LA
nominatif, comme énonciatifplacé par inversion avant son
inchoatif; y préposition ; ^ff- complément régi au génitif par la
préposition; la préposition et son complément forment une dépen
dance de Q-Isif ; le nom ji>\ est au nominatif, comme inchoatifplacé
par inversion après son énonciatif; le pronom est virtuellement au
génitif, parce qu'il est en rapport d'annexion avec l'inchoatif, il se
rapporte au nom jLj ; l'inchoatif avec son énonciatif forme une
proposition nominale qui représente un accusatif, parce qu'elle qua
lifie le nom ^UJ
8 1 0. L'adjectif superlatif doit toujours être employé de l'une
au
o
.
des trois manières suivantes
i
.° D'une manière absolue
:
avec
l'article
;
exemple : JuîiVt juj
Zéid l'excellent ;
2.° Ou d'une manière relative
ment au
sans
article,
génitif ^exemple ^U/t J*aJf o^'j
:
ayant
un
complé-
Zeïd le plus excellent
des hommes ;
3.0 Ou comme dans l'exemple précédent, mais ayant pour
conséquent la préposition y avec un complément ; exemple :
j>£ ûrîD"^ <*£> Zeïd (est) plus excellent qu Amrou.
Dans les deux premiers cas il est superlatif; dans le troisième,
,
il
comparatif.
premier cas, s'il est employé comme appositif quali
ficatif o«*î et non comme énonciatif yS. il s'accorde en genre,
en nombre et en cas
avec le nom qu'il qualifie.
est
Dans le
,
,
,
Dans le deuxième
du
cas
il
,
masculin
J*àf
singulier
nom
qu'il qualifie lorsqu'il
lificatif.
,
,
Dans le troisième
mière
ou
cas
la deuxième
8ll. Suivant
ce
,
on
sorte
qui
conserve
et
est
invariablement la forme
s'accorde
qu'en cas avec le
employé comme appositif qua
ne
peut suivre indifféremment la pre
de concordance.
vient d'être dit
,
il semble
qu'il
y ait
4l6
DE
LA
SYNTAXE.
3f .*-*
irrégularité dans ces phrases si usitées, j^=>f *wf Dieu est
le plus grand iêf âôf Dieu est le plus savant, et qu'on devroit
dire avec l'article, j^Vf'inf et icVf «if : mais il y a ici une
ellipse; et c'est comme si l'on disoit, s'Ji; jf y yj==>\ JÀ»f /)/«/
«•/ /?/#.r
^raW ^w tawtar choses.
une
,
CHAPITRE
XXII.
Du Nom d'action.
8l2.
Le
cinquième des régissans grammaticaux réguliers est
fo**^ (n.° 528, i.rt p.).
II n'est pas ici question du nom d'action lorsqu'il est em
ployé conjointement avec son verbe et nommé ^JLU^ £jjiïu
complément absolu, circonstance où il est de toute nécessité à
l'accusatif; on en a parlé ailleurs (n.° 1 87 ) : il ne s'agit, en ce
moment
que du nom d'action employé indépendamment de
et pouvant
comme tout autre nom
son verbe
être placé au
nominatif, au génitif ou à l'accusatif.
Le nom d'action équivaut alors au verbe lui-même précédé des
conjonctions y ou U et peut se comporter à la manière du
nom, en mettant son conséquent au génitif, comme second ternit
d'un rapport d'annexion *XJf oLi^ (n.° 747 )> ou a k manière du
le
nom
d'action
,
,
,
,
,
,
verbe ,
et
avoir ïes mêmes
l'agent J^Uff
au
régimes que lui c'est-à-dire gouverner
nominatif et le complément objectif fijyxll
,
,
à l'accusatif. Ces deux sortes d'influence peuvent aussi avoir lieu
concurremment.
comprendre ceci il faut d'abord observer
que l'on peut employer le nom d'action de trois façons : 1 .° avec
les voyelles nasales yy*> ; 2.0 comme antécédent d'un rapport d'annexion oLî-o ; 3.0 comme déterminé par l'article *^UL <_>>*-»
813.
Pour mieux
,
.
DE
8 4' Étant employé
1
tion
et
précède
le
avec
4*7
SYNTAXE.
les
voyelles
i'influence du verbe. II
conserve toute
natif,
LA
nasales ; ïe
met
complément objectif à l'accusatif,
suive le complément. Exemples :
ou
nom
l'agent
au
soit que
d'ac
nomi
l'agent
W?
Je serai
surpris que
Zeïd
frappe Amrou.
o>jj \j-f \*y<> o-jIj
J'ai
Je suis
vu
Zéid frapper Amrou.
surpris
que Zéid frappe
son
frère.
appartient à un verbe intransitif, il n'y a
point de complément objectif, mais la construction précédente
peut encore avoir lieu. Exemple : oûj r-^3 &?'"" ^ départ de Zeïd
m'a fait de la peine, Cependant, dans ce cas, le nom d'action
est plus ordinairement en
rapport d'annexion avec son sujet.
Le
étant employé comme antécédent
nom
d'action
8lÇ.
d'un rapport d'annexion e>Lî* conserve encore quelquefois une
partie de l'influence du verbe. II y a alors cinq manières de le
Si le
nom
d'action
,
construire
1
:
.° Avec
l'agent
Exemple Jaill
:
au
génitif et le complément à l'accusatif.
c$r££t j'ai été charmé que le, bourreau
iX£f <_>p>
ait frappé le voleur.
2.0 Avec le
complément objectif au génitif et l'agent au
nominatif. Exemple : i>&£f Jlîff tSy* yûs\ j'ai été charmé que
le voleur ait été frappé par le bourreau.
3. Avec l'agent au génitif, sans exprimer le complément
objectif. Exemple : i^f c->>«î» é^\j'ai été charmé que le bour
reau ait
frappé.
°
11.' PARTIE.
Dd
4I8
LA
DE
SYNTAXE.
objectif au génitif, sans exprimer
<Sy* J^f j'ai été charmé que le voleur
4..° Avec le complément
Pagent. Exemple : ^pf
ait été frappé.
5 .° Avec le
lieu
d'agent
,
complément objectif au nominatif,
donnant
et
comme
tenant
d'action la vaïeur d'un
au nom
nom
passif. Exemple tSUÇff &)Ù d«. oÂju*/'tfi
pris beaucoup de peine pour que ce livre fût achevé. Dans ce dernier
exemple en employant le verbe au lieu du nom d'action on
diroit à la voix objective, tl>U%Jf Zèu y ^ (n.° 226 note).
816. Le1 nom d'action, employé avec l'article déterminatif,
d'action
ou
infinitif
:
,
,
presque rien de l'influence du verbe. Aussi il est
très-rare que , dans ce cas , il gouverne ses régimes a la manière
du verbe. On peut dire cependant, !JLJ£ o-JJ c_>^-ff js££t j'ai
ne
conserve
été charmé que Zeïd ait frappé Amrou.
CHAPITRE
Du
XXIII.
Rapport d'annexion.
qui est rapport d'annexion avec complément
'817* Le
oLXtf jcwVf est le sixième des régissans grammaticaux réguliers.
un
en
nom
,
818.
Tout
dire, qui
aussi
un
nom
qui
a un
complément
annexé c>^>»> c'est-à-
sert d'antécédent à un rapport dont le
nom ,
régit le nom qui lui est annexé
conséquent
*^l t>bî-If
est
au
génitif (n.° 747)* Cette annexion est ou ïQy** logique et 4*^
réelle, ou C&sù grammaticale (a) et 'Cj^a. y? fictive.
8 ip.
La
première répond
au sens
de l'une de
ces
trois
pré
positions :
(a)
au sens.
Le
mot
Je
arabe
me sers
^àsu signifie relatif
des
mots
grammatical
aux mots ,
et
par
logique,
opposition
pour
à
^yâjireladf
simplifier l'expression*
DE
J indiquant
i.°
viteur de Zeïd
ce
faite
possession
qui équivaut
exemple :
,
équivaut
qui
ce
à Zeïd; 2.0
partient)
est
;
la
à
y indiquant
*«Ï3
J,\f
à jUâi &
4l9
SYNTAXE.
LA
une
u>^
exemple : oJCj *3te le ser
jûjJ *$>& un serviteur (qui ap
,
la matière dont
une
chose
d'argent [crater argenti]
coupe (faite) d'argent [crater ex
coupe
une
,
argento); 3.0 j indiquant la circonstance de temps ou de lieu de
l'antécédent ciLîltf (j^Jô ; exemple : *^J( *y> le jeûne d'aujour
d'hui, ce qui équivaut à »yi\ jVy* un jeûne fait dans le jour
présent.
820. Le second genre d'annexion
le
a
lieu, 1 ."quand
on annexe
qui exprime le complément objectif
c'est-à-dire, l'objet sur lequel tombe l'action. Exemple:
SKÎ m>^* Ie frappant de Zeïd, c'est-à-dire celui qui frappe
Zeïd (a). Cette annexion n'est cependant considérée comme
fictive que quand le nom d'agent est employé pour signifier une
action présente ou future : si on l'emploie pour signifier une
action passée elle est réelle. La raison en est qu'en ce cas le
nom
d'agent perd tout-à-fait suivant les grammairiens Arabrs
la nature du verbe. Cela a lieu, 2. "quand on annexe à un adjec
tif assimilé *#L£* *iu> son agent ou à un superlatif l'objet de
comparaison comme dans ces exemples *JLy\ y*Â beau de
visage (j»uff y»*>\ le plus beau des hommes; 3. "quand on annexe
à un nom de patient un complément objectif remplissant la place
d'agent JçlàJf â(JU*£U *-j tJj**«- Exemple: o^iff ùfyà* frappé
de l'esclave, c'est-à-dire, dont l'esclave est frappé.
821. Dans l'annexion logique ou réelle, l'antécédent perd
au nom
d'agent
nom
du verbe,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
fa) C'est à-peu-près ainsi que Cicéron a dit, suijuris ac diguitatis retinens ;
Tacite, avitx vobilitatis, etiam inter angustias fortune retinens.
,
Dd2
et
420
DE
nasale ,
LA
SYNTAXE.
les terminaisons q du duel et <j du
riel masculin régulier , et il ne peut jamais avoir l'article.
sa
voyelle
et
822. Dans l'annexion grammaticale il
,
en
est
de
même,
n'est que l'antécédent peut avoir ou n'avoir point
suivant que les règles de la concordance l'exigent.
ce
plu
si
l'article,
II faut seulement observer que si , l'antécédent étant au
le conséquent est un nom propre , l'antécédent ne
,
823.
singulier
prend jamais
l'article. Ainsi l'on peut dire
,
jôj f^-J^Li
et
oJj fjjjLLff ceux- qui frappent Zeïd ; mais on doit dire jjJ ^J^
et non 0^3 oj^f celui
qui frappe Zeïd. Au duel et au pluriel,
on
peut
conserver avec
plément
l'article les finales
pronom afïixe
est un
ô
,
si le
com
(n.° 24$).
CHAPITRE
Du Nom
q ou
XXIV.
parfait.
824. Le nom parfait ilï ci\ est le septième des régissans
grammaticaux réguliers.
C'est l'opposé du nom
qui régit un complément en rapport d'an
nexion
cjUi-o
nexion
jtij ;
car
c'est
un nom
qui,
étant
en
rapport d'an
logique
complément, n'est point cependant
grammaticale. Le complément du nom parfait se
nomme jXjc terme
spécificatif (n.° 744).
Le nom parfait (n.°
102) conserve sa voyelle nasale,
82^.
et ses terminaisons
au
et
duel
q
ô au pluriel masculin régulier',
et pïace son
conséquent à l'accusatif.
On
826.
compte parmi les noms parfaits les nomsde mesure
et de poids, comme £jJ{; livre, j£s boisseau, et ïes numératifs de
dixaines depuis ôjj^
vingt jusqu'à ûf^i quatre-vingt-dix.
un nom
827. Quelquefois
qui n'est pas parfait de sa nature
en
avec
un
annexion
,
,
,
»
DE
le devient par
son
42*
SYNTAXE.
LA
annexion à
un
pronom
: car
,
il ïe
génitif un second conséquent
comme terme
spécificatif. Exemple : UsO iy*
c'est-à-dire, autant d'or qu'il en peut contenir.
mettre au
,
CHAPITRE
Des Particules
pouvant
sa
plus
l'accusatif
plénitude d'or,
XXV.
qui exigent
828. La première classe
sur
l'usage JiÂcUw ilkîf jj»\'y
ne
met à
le
Génitif.
des
régissans grammaticaux fondés
les particules qui régissent
leur complément au génitif; on en compte dix -sept qui sont
y de, Jf vers, Jj-â. jusqu'à, j dans, co avec, par, dans,
,
H
à,
Je
lj>j
sur,
ce sont
quelquefois, ô et j par, dans les formules de serment,
'y. de, <$ comme, o** et <&» depuis, UL^-^U. et foi
(n.° 567 ) excepté.
820. Ces particules
sont
nommées
f4\
c>j>*
particules qui
J, lUUff
cJjj^f particules
exigent le génitif et ïj\S£\ pyLl\ p>)t\
un nom seul et le mettent au
génitif.
qui régissent
CHAPITRE
Des Particules
qui
XXVI.
Re'gimes, l'un
l'autre à l'Accusatif.
ont
deux
au
Nominatif,
sur;
particules
ticules
aux
la
verbes,
et
*l*^f J? idJS}\
entière. Elles
<_>jj^kf
exercent
par
leur
proposition
qui régissent
sur une proposition nominale (n.°70o) toute entière,
mettent l'mchoatrf à l'accusatif, et l'énonciatif au nominatif.
Dd3
influence
et
assimilées
42Z
DE
A raison de l'influence
d'inchoatif
qualité
LA
SYNTAXE.
qu'elles
le
exercent sur
qui
l'inchoatif qui
le caractérise
perd
appelle
particules ^fÔJuVf "L^y particules qui détruisent la
qualité d'inchoatif, comme on le verra ailleurs.
83 f Ççs particules sont au nombre de six : ce sont, £)J car,
y que, yf comme si, yÇi mais, ô>If plût a Dieu, JUf peut-être.
832. On nomme aussi ces particules L^'f^aJ 3 Ô^ Inna et
ses sœurs ; l'inchoatif est
appelé leur nom lg«^f et l'énonciatif
leur énonciatif UJ^.
83 3 Avec ces particules l'inchoatif doit toujours précéder
l'énonciatif, à moins que celui-ci ne soit un terme circonstanciel de
sa
et
cas
,
on
ces
encore
•
,
.
•
,
temps et de lieu
o^j jf y& cJJJ» (n.° 710).
Ainsi l'on peut dire:
jfixJf ci, u^ f&l je sais que Zeïd est h la maison.
8 3 4- Les quatre premières de ces particules peuvent perdre
'«H)
leur teschdid
allégées,
au
et
leur fatha final ,
lieu que dans le
et
alors
premier
on
cas
qu'elles sont *Iàî5
elles sont «!£& appe
dit
santies.
Sous leur
d'un
nom :
première
sous
vies d'un verbe
d'un
nom
toute
la seconde
ou
elles
forme , elles
ne
d'un
,
ne
peuvent être suivies que
elles peuvent être également sui
; mais alors , si elles sont suivies
nom
ïe mettent'
plus à l'accusatif,
elles
perdent
Exemple: ê^à-f^^p y\f oSj vi3 y (^ j'ai
Zeïd s'en est allé, et
qu'Omar est ton frère.
,
et
influence.
appris que
^35*
P°ur
distinguer qJ provenant de £>j car, de ÔJ conjonction qui signifie si on met quelquefois la particule j
devant l'énonciatif. Exemple :
^.J3 00j £>J car Zeïd est généreux.
Pour
83 6.
distinguer yf provenant de y de y conjonction
donne
au
verbe la signification subjonctive
et qu'on
qui
on
nomme
*>*«-•
mettre
ïes
le
devant
verbe
*3j
peut
particules
ôSf si le verbe est au passé tSy» ou y, s'il est à l'aoriste et V
,
,
,
»
,
,
DE
la
423
SYNTAXE.
LA
négative. Exemple : <£.\ ^js- o& y o> Vé
j_>^ Uy^JL_Lâ.jj V £)fj CjjJj cJj^ o'j /^ appris que Zeïd est
sorti et que certainement il nous rendra visite et
qu'Amrou n'entrera
si
proposition
est
,
,
pas che%
nous.
CHAPITRE
Des Particules
837*
sur
rfune
négatives
U
et
V
non.
^A troisième classe des
l'usage
838.
XXVII.
renferme les deux
Ces deux
influent sur l'inchoatifet l'énonciatif
particules
nominale
régissans grammaticaux fondés
particules négatives U et V non.
elles
le
premier au nomi
dit qu'elles sont
natif,
cas,
équivalentes du verbe N'ÊTRE PAS y^J c^i. (a). Après U au
lieu de mettre l'énonciatif à l'accusatif, on peut l'exprimer par
ïa préposition <_> avec le génitif (n.° 824, 1."'p.).
83p. Ces deux particules perdent leur influence, quand
l'énonciatif est précédé de Vf sinon, ou placé avant l'inchoatif.
Ainsi l'on dit J*U Vf oûj U Zeïd n'est qu'un ignorant, oôj J*lo» ^*
Zeïd n'est pas ignorant.
84o. La négation V perd son influence quand l'inchoatif est
un nom déterminé *3jjU La
négation U perd son influence quand
elle est suivie de ïa particule y explétive (n.° 855
i.re p.).
^
n'est
: J*U»
Z<?'/<a?
un
Exemple
i\jJ (jf
pas
ignorant.
V
aussi
!
La
être
84
employée non comme
négation peut
niant une qualité du sujet yïJ ^j^ mais comme niant l'existence
proposition
et
:
mettent
le second à l'accusatif. Dans
ce
on
,
.
,
•
,
,
{a)
Les Arabes
tous cette
,
je l'ai dit ailleurs (n.° 96 aote), n'admettent
particules négatives U et V.
comme
influence des
,
Dd4
pas
424
DE
SYNTAXE.
LA
général jJ^f gti et quelquefois- d'un seul indi
vidu ; alors elle met le nom qui la suit à l'accusatif, ce nom perd
sa
voyelle nasale et est regardé comme indéclinable jjsX* : mais
i ."
pour cela il faut
que le nom soit indéterminé ëj—Çj ;
2.0 qu'il ne soit point l'antécédent d'un rapport d'annexion ou
l'antécédent d'un rapport dont le conséquent soit régi par une
préposition ; car dans ces deux cas le nom est censé décli
d'une chose
en
,
,
,
,
,
,
nable
aucun
,
serviteur de médecin n'est
.meilleur que
Si le
vous
nom
natif. II
ïa
,
à l'accusatif. Ainsi l'on dira:
et se met
particule
Il Joie csliU
,
f^Xa.
V personne
che^ nous.
suit V
qui
en est
V
n'est
che^nous
bjJLc <_>#J£ «sMb H
déterminé ïsj**
est
de même
si le
,
nom ne
,
il
se met au
nomi
suit pas immédiatement
.
S'il y a deux négations de suite , et que ïa première soit
suivie immédiatement d'un nom indéterminé , on peut mettre
les deux
nominatif,
noms au
sans
tanwin
natif
et
,
mettre
ou
ou
les
mettre tous
l'un des deux indifféremment
l'autre à l'accusatif
sans
tanmn
CHAPITRE
Des Particules
842.
qui
deux à l'accusatif
mettent
au
nomi
(n.° q4).
XXVIII.
le Nom à
l'Accusatif.
Les
particules qui forment la quatrième classe des
régissans grammaticaux fondés sur l'usage sont nommées
ïZJXSl *yJ>\ iwVf j *LUff <Jj>^f particules qui ne
régissent qu'un
nom, et le mettent à l'accusatif.
843* Ces particules sont au nombre de sept ; ce sont j#w,
,
,
Vf sinon, lî
844cation de
La
^
-
Ijf
-
Uâ>
particule J
avec;
-
<jf
et
f ô!
n'a d'influence que
mais,
pour
qu'elle
quand elle a la signifi
exerce, cette
influence, il
DE
faut
qu'elle
soit
425
SYNTAXE.
LA
précédée d'un verbe,
ou
d'un
qui
mot
contienne
la valeur d'un verbe.
84j«
La
Vf sinon ,
particule
n'a d'influence que
excepté,
sous
certaines conditions.
Pour entendre
ce
observer que la chose
objet, il faut
exceptée jJilllf se divise'en conjointe j^»
à dire
nous avons
que
sur cet
disjointe gfsù*
On l'appelle conjointe, quand ïa chose exceptée et celle dont
sont de ïa même nature comme
se fait l'exception îS* JLixJLtf
dans cet exemple :je n'ai point vu d'UOMME, si ce n'est Omar.
L'exception conjointe est encore de deux sortes : ou la chose
et
.
,
,
exceptée précède celle dont
fjjLlf Ji^jLLf Jt-fccw^tf
la suit
et
,
oô^lif
fait l'exception
,
et
alors elle
se
exception conjointe antérieure; ou elle
chose de laquelle on excepte est exprimée
nomme
alors , si la
affirmativement
se
l'exception y*Ci\ j~^ù) jJ&Llf
exception conjointe postérieure placée après une proposition
Joû
affirmative;
,
on nomme
si la chose de
laquelle
on
excepte
1
est
exprimée néea-
tivement,
exception jiàui
j±y±\ J*?^»-Jf tj-Â^ii
exception conjointe postérieure placée après une proposition négative.
L'exception est disjointe quand la chose de laquelle on ex
comme dans cet
cepte est différente de ïa chose exceptée
exemple : je n 'ai jamais voyagé sur MER si ce n 'est sur le Gange ;
ce
qui veut dire, mais j'ai voyagé sur le Gange.
846. Si l'exception est conjointe antérieure, comme ^ïU lî
cvâ.f \ùj>j Vf [non accessit ad me, nisi Zéidus, ullus] il ne m'est
on nomme
om
,
,
,
,
venu, si ce
n'est Zeïd
cée
une
après
ad
,
aucune
personne
; ou
proposition affirmative,
me homines
nisi ZeïdusJ
[venerunt
ver, excepté Zéid ; ou disjointe,
m'est
venu
chose
exceptée
,
,
personne, si
est
ce
n'est
comme
une
conjointe postérieure pla
comme
les gens
ULJ3
jument ;
le
loj)
Vf
*yjf i>/U.
sont venus me trou
Vf oÂf
nom
^/U.
U /'/
qui exprime
nécessairement mis à l'accusatif.
ne
la
^26
DE
Si
847-
l'exception est conjointe postérieure placée après
proposition négative, le nom qui exprime la chose excep
une
tée
SYNTAXE.
LA
à l'accusatif
se met
ou
mieux
nominatif,
au
oJïU» U
comme
coj Vf oJ*.\ ou fa.jj Vf /•/ ne m'est venu personne si ce n'est Zeïd.
848* Si dans la proposition il y a ellipse du mot qui devroit
exprimer la chose de laquelle on fait l'exception *£* ytiLdl ce
que l'on appelle pjÀ*, c'est-à-dire, vide, le mot qui exprime la
chose exceptée se met au cas qu'exige le verbe précédent. Ex. :
,
,
oJj
II n'est
venu me trouver
Vf
u
^sl».
que Zeïd
accessit ad
[non
YoSj Vf o-jIj
Je n'ai
vu
que Zeïd
[non
t^3J3 Vf
qu'auprès de Zeïd [non
Si la
particule d'exception
849*
énonciatif,
un
celui -ci
se
nisi
Zéidus],
*•
vidi nisi
Zéidum],
Oj)J^> ^
Je n'ai passé
et
me
transivi nisi
secus
Zéidum],
se trouve entre un
met
au
nominatif.
inchoatif
Exemple:
ojJ U Zéid n'est rien que menteur.
850. H y a d'autres formules d'exception dont l'influence
oit" Vf
est
différente. Ainsi fàé U
n'est pas,
est
ce
le
nom
très-naturel, \'ô&
sitifs
ou
mettent
,
et
yiï
et
y?
et
«SUL U excepté
de la chose
au
génitif,
signifie
tjji^j.V
f*
exceptée à l'accusatif; ce qui
comme
^Xè yy. z\y, mettent
-
-
,
d'un rapport d'an
des noms. Les mots UiU.-
second
terme
-
851.
et
2te. étant proprement des verbes tran
des verbes abstraits qui régissent l'attribut
nexion, parce que ces mots sont
foi. $a
LçU V le mettent indifféremment
-
J«y
et
énonciatif à l'accusatif. Au contraire
nom
,
II faut observer
par rapport
proprement différence, qu'on le
,
à
a«x
jÂc qui
,
met au
trois
cas.
est un nom et
même
cas
auquel
DE
se
mettroit le
la
particule Sf
nom
de la chose
iX»l
// n'est
venu me
trouver,
Les gens
venu
<>Âf
ol}j J^jè
// wVrJ
3*..\\
I
.
sont venus me trouver ,
personne
www
**•
me
aucune
personne.
-
excepté Zeïd.
/*^
trouver, si
tX*U«
personne
*
$
•-
me
w
excepté Zeïd,
»»T
-
si l'on faisoit usage de
:
Juj _jac ç£*^
•-
Il n'est
exceptée,
Ainsi l'on dit
.
427
SYNTAXE.
LA
ce n
est une
mieux
ou
trouver, si
jument,
os*J J^
ce
n'est Zéid,
cinq autres particules de cette classe sont des par
ticules compellatives et servent toutes à appeler.
853. Si le nom qui les suit est l'antécédent d'un rapport d'an
nexion ci L^-«, ou d'un autre rapport équivalent à un rapport d'annexion <j\£l\ &jUJ on le met à l'accusatif. Ainsi l'on dira :
Les
852.
,
,
*»f ô^é
ô Abd-allah
u
(c'est-à-dire,
tjôj ô-4, Ltt* U ô (toi qui es)
ILo. U 6 toi dont le
«4»J
iU*)L
8 ?4« I"
est
la
au
U 6
liLsj
en est
indéterminé.
parole
à
un
nominatif
déterminé
En effet
ticules
Dieu)
!
meilleur que Zeïd!
visage
(toi qui es)
serviteur de
bon
&e même si ^e
est
beau!
envers tes
nom
serviteurs !
de la ehose
appelée <j5U1U
Exemple : ^Uj ^' ^ homme ! Mais si l'on adressoit
homme
sans
présent,
voyelle
le
nasale
,
mot
JUj
comme
homme
se
si c'étoit
mettroit
un
nom
simple.
,
le
nom
compellatives
déterminé
,
se met
simple ijiu *Jj*ï9 après les par
au nominatif sans voyelle nasale ;
428
il
considéré alors
est
L>
iJJ
LA
DE
0
85 5*
comme
y^y\ U 0
Zéid!
Si ïe
indéclinable
y*J». Ainsi l'on dit:
l'homme!
déterminé
simple
nom
SYNTAXE.
nominatif
est
suivi d'un
adjectif,
à l'accusatif. On peut
l'adjectif peut
dire : eM>kM <>4j U" ou <_îj>Lff csij ^ 0 Z^iV l'illustre!
8^6. SUe nom simple déterminé est suivi d'un appositif qui
soit en rapport d'annexion avec un complément cet appositif
sera nécessairement à l'accusatif. Exemple : ev»*if ô^'*"'
^.j ^
se mettre au
ou
.
,
0
Zeïd, le maître de la maison !
8^7.
Mais si
cet
appositif est
faire la distinction suivante
deux
noms
nion
et
met
au
propres
nominatif
jf£ y cnjJ Lf
ou
pas
leur
élif d'union
au
entre
ou
à
simple,
Quand le
un
ixt\
sont entre
mots
nom
ou
les
mots
y\
et
ïxt\
ne
:
homme
fils
mon
frère!
de Zeïd!
3
&) G*^ J^J ^ ^
ou
ces
ô Zéid fils de
0^3 '^yj^j. U" °
85 B.
et
il faut
propres, et alors ces mots conservent
le nom qui les précède .est nécessairement
(j") y\ £'j U
o»
,.uf
jûj] fille,
perdent leur élif d'u
qui les précède se
l'accusatif; exemple: jj-ë'y o^j U
nominatif. Ainsi l'on dit
S
mots
ou
noms
et
,
les
ô Zéid fils d' Amrou !
deux
sont
alors
et
,
ou
à l'accusatif r et le
mettent
se
:
^fils,
nom
nom
homme
fils
de la chose
servant
de
mon
appelée
d'antécédent à
frère!
est un nom
un
propre
rapport d'an
particule compellative le nom
de la chose appelée restant au nominatif ou à l'accusatif, suivant
les règles précédentes. Exemples : <^jj Joseph!
ofywJ^j-^*
nexion
,
on
peut retrancher la
,
créateur des deux !
8^9»
Enfin
lettres, qu'il
,
ne
si- le
nom
propre de plus de trois
l'antécédent d'un rapport, et ne
est mrnom
forme point
DE
soit
point précédé
LA
42<?
SYNTAXE.
de la
particule compellative on peut en
retrancher ïa dernière lettre ; ce qui s'appelle ^îU-tf &è-j-> aphérèse
du compellatif. Ainsi l'on peut dire jU. U
L«Û.f U
lié* i?
pour ojlâ. U u Harith! *Uif U o Asma! q'-Ig* U o Othman!
,
-
CHAPITRE
Des Particules qui
860.
mettent
-
XXIX.
le Verbe
au
mode
subjonctif
cinquième classe des régissans grammaticaux fon
dés sur l'usage contient les particules qui mettent l'aoriste du
verbe a l'accusatif, c'est-à-dire, au subjonctif j, *J-«UJf Cjfj^
juw»IàJ1 J*àJÏ Ces particules sont y que y non, & afin que
y if eh bien
J^. en sorte que, J pour que, j\ à moins que, J et
La
,
,
.
,
en sorte
c>
J'ai
que,
exposé
l'influence de
et
les
composés
ailleurs
,
en
de
détail
q! et de J.
( n.os 48 et suiv. ) l'usage
,
et
particules.
86l.
particule y est nommée *Jj3^» équivalente au nom
d'action parce que réunie au verbe qui la suit elle équivaut
ces
La
,
effectivement
Cette
,
,
au nom
particule
est
d'action.
toujours précédée
renferme l'idée de science , connoissanee ,
n'a
aucune
ticule
influence
y allégée,
sur
iUiJfi
le verbe
ifjf
vouloir, jôà pouvoir, j-Sf
cule
y
ïe verbe
au
,
comme
ce
verbe
"J* savoir, elle
n'est alors que la par-
(n.° 834).
Si le verbe renferme l'idée de
met
et
d'un verbe. Si
pouvoir
ou
commander > tfù
vouloir,
défendre
,
comme
la
parti
subjonctif.
Si ie verbe renferme l'idée de penser, s'imaginer, avec doute,
comme
y* "et û*^â. , on peut mettre le verbe au subjonctif où
à l'indicatif.
430
DE
SYNTAXE.
LA
particule <>» n'a d'influence que parce qu'elle supla particule y
pose l'ellipse de
863 La particule J suppose pareillement l'ellipse de j ;
on
et par cette raison
l'appelle £ *V le LA M de (la particule)
862.
La
.
.
,
,
CAÏ.
particule 'J n'a d'influence sur le verbe que parce
qu'elle équivaut à y j] : aussi dit-on qu'elle est J| J^ c'està-dire exprimant le sens de la particule ILA.
865. Les particules j et ci n'ont d'influence qu'autant que
les actions exprimées par le verbe précédent et le verbe sui
vant sont simultanées ; condition qui se nomme *Â*l^f
Outre cela il faut pour que la particule J influe sur le verbe
qui la suit que le verbe qui précède exprime ou un comman-
864*
La
,
,
.
,
,
,
dément y>\
,
ou une
rogation A^d,)
défense
j<j
désir
,
ou une
négation g*
,
ou une
inter-
offre j»3* (n.° 48).
requise pour que la particule
Cs mette le verbe au subjonctif: celle-ci diffère de la particule
en ce
qu'elle indique d'une manière plus précise que l'action
j
exprimée par le premier verbe est la cause de celle que le
second indique.
,
ou un
La même condition
est
y?
,
ou une
aussi
,
CHAPITRE
Des Particules
qui
mettent
ou
866.
sur
le Verbe
.
Ces
contient les
particules
nommé djezm
régissans grammaticaux
particules gui
nommé DJEZM ou mode conditionnel
867
au cas
mode conditionnel.
La sixième classe des
l'usage
XXX.
sont au
mettent
le verbe
fondés
au
cas
**)l^t J*àJ f g «L«UJf ù$jd\
nombre de
cinq;
ce sont
'J
.
non,
DE
lit
ne
tives. De
ces
la condition
sur
les verbes des
deux verbes
se nomme
,
i}
SYNTAXE.
J exprimant l'impératif,
pas encore,
dernière influe
LA
celui de
,
LyJ\ JJ^3
V ne,
I
y si : cette
deux propositions corréla
la proposition qui renferme
et
verbe de la condition; celui de
l'autre
proposition se nomme .L^lff *fjâ. compensation de la con
dition : car la proposition conditionnelle est nommée L^l con
dition, et la proposition affirmative hypothétique qui lui est cor
rélative, »fj rétribution ou compensation (n.° 51). La réunion des
deux propositions forme une phrase conditionnelle
*S^J^ «Iti
868. Les deux verbes peuvent être mis à l'aoriste condition
.
nel
ils peuvent aussi être
;
premier
ou
peut être mis
à l'aoriste du mode
mode conditionnel
869
La
tous
deux mis
prétérit
indicatif pyj^
au
,
fjfé e>Ll*
conjonction
et
au
prétérit ;
enfin le
alors le second
p>w*
ou
,
se met
à l'aoriste du
.
conditionnelle
y quoique
expri
lorsque
sitions corrélatives la première est impérative ou prohibitive
ou
interrogative ou optative ou exprime une offre ; en un
mot toutes les fois
qu'il y a entre deux propositions une cor
rélation qui équivaut à une condition. Exemples :
mée
,
.
exerce
influence
son
sur
l'aoriste
,
non
de deux propo
,
,
,
,
,
,
C-sUjissf <jwjf
Viens
che^
*.^f
moi ,
Jàjlj ys=â h
Ne sois pas incrédule ,
tu entreras
céljjf
Où
est ta
maison!
je t'honorerai,
cslio
(dis- le
yy\
paradis.
y\
moi) je
vu j,
dans le
,
t'irai rendre visite,
ds^j
Plût à Dieu que j'aie de l'argent! je le dépenserai.
432
î_>*-a~>'
\j*à
Si
C'est
comme
ainsi du
et
tu ne
SYNTAXE.
LA
DE
JJ-^J1 Vf
descends pas,
si l'on disoit
:
si
tu
t'en
tu
viens
Dès Noms
870.
La
qui
rusage
moi, je t'honorerai;
che^
XXXI.
le Verbe
mettent
septième
classe des
mode conditionnel.
au
fondés
régissans grammaticaux
s, t.^r.A
#lïwf
noms im
ï«>j&*
.
.
„
bien.
reste.
CHAPITRE
sur
trouveras
,
,
.
contient certains mots nommes
parfaits.
871
fluence
parce
.
Ces noms,
sur
au
nombre de
les deux verbes
qui les suivent
qu'ils renferment le sens de cette
quiconque, U quelque
temps que,
yj
chose que,
Ciuf
ou
l^i autant de fais que
<^\
,
J^
de
Les
noms
que la
particule y si,
particule; ce sont, y y
,
-
ou
U £Â
U M
-
en
quelque
Uyo. par-tout où,
XXXII.
signification
vague.
signification vague *JL» ÀjH\ forment
régissans grammaticaux fondés sur l'usage.
d'une
la huitième classe des
873* On appelle
vagues les numératifs cardinaux , depuis
quatre-vingt-dix-neuf (n.° 1 00) et les noms qui servent
jusqu'à
indiquer le
on^e
la même in
quelque
quelque manière que ( n.° 5 1 ).
Des Noms d'une
87 2«
exercent
lieu que,
en
CHAPITRE
à
neuf,
noms
,
nombre
mais^
déterminer
précisément aucun
nombre, "Jf et ^k ou °yfr combien, \ài? tant (n.° 101). Ces
derniers sont aussi appelés iïiL\jj=> expressions substituées.
,
sans
'
874
LA
DE
874*
leur
est
sert
Ces
de
875*
1
et
pour
2.0 Le
l'accusatif,
mettent à
ils
parfaite,
spécificatif _££
et
sont
terme
li
mot
sert à
des
le
,
singulier,
interroger,
comme
combien avejj vous de
et
savons
3.0
dans
régime
en conservant eux-
parfaits (n.° 8^4),
noms
nom
de la chose
d'or!
ou
son
et
gouverne
son
nom
régime
à
exemple : t^oJut \yL$
point interroga
génitif singulier ou pluriel.
lé*
cet
pièces
régime au
CèùXa JU-j ls <Ju*i
il gouverne
Ainsi l'on dit
en
leur
(n.* 744).
l'accusatif
tif,
mettent
alors des antécédens d'un rapport d'an
dont le complément est le nom de la chose
bien ils le
mêmes leur forme
ont
qui
régime
sont
818)
; ou
ce
.
.° Tous les autres numératifs cardinaux
nombrée
brée
singulier
o>%^
ici quelques observations.
; et
et au
indéterminé
lï convient de faire
nexion (n.°
qui
de la chose nombrée
nom
à l'accusatif
,
un nom
génitif,
au
le
noms mettent
régime
toujours
433
SYNTAXE.
bien il n'est
U
ou
bien
JJ.j
1s
nous ne
pas combien d'hommes il y a che^ vous.
Le mot \'àJ=» , qui tient lieu d'un nombre quelconque sans
déterminer aucun,
numération
,
met
le
à l'accusatif ou
nom
au
de la chose
qui
est
l'objet
nominatif. On dit donc
de la
cScûc
*J
bien f$>jï \ôS ijc^ A je lui dois tant de pièces d'ar
gent. On peut analyser ainsi la première de ces propositions :
proposition circonstancielle (n.° 710) dans laquelle «J faitfonction
^*j* Ioj
ou
d'énonciatif; \è>A=> est l'inchoatif transposé après l'énonciatif; ^è'j\
est le terme
spécificatif de \'ù.±=> ; enfin c5o^* est un terme circonstan
ciel de Heu, dépendant de l'adjectif verbal yy qui est sous-entendu
dans l'énonciatif: car *i tient lieu de «J yy ou *J Jf U. L'ana
lyse de la seconde proposition est la même à cela près que
fj* y fait k fonction d'appositif mis en remplacement Jôj ^Ai
.
,
(n.°75o).
//.' PARTIE.
E
e
434
SYNTAXE.
LA
DE
XXXIIL
CHAPITRE
Des Noms
qui équivalent
Verbes.
aux
»*.-?, ~>
Les
876.
noms
qui équivalent
aux
verbes
i.re p.) forment la neuvième classe des
fondés
ceptibles
ù^.jj
Je
régissans grammaticaux
On compte neuf mots de cette espèce qui sont sus
d'avoir un régime. Les six premiers le mettent à l'accu
satif ; les trois
-
(n.° 874,
l'usage.
sur
877.
s
JUiVf AJcwf
*Âj
-
autres
tiUi*
me contente
le
l*
et
mots
sont,
J^£* <l>li** O^" o**>*«
que j'en ai dit ailleurs ^n.01 762,
875, //».
cîljj^
-
-
de renvoyer à
833,84i, 874
nominatif. Ces
mettent au
~
~
-
-
ce
CHAPITRE
XXXIV.
Des Verbes abstraits.
878.
l'usage
verbes qui
est
sur
,
Ces verbes
ne
On les
matin,
sont
,
aussi
un
verbes
comme
JI3
U
toute
-
les
autres
y? être, 3^ devenir, '^>\
la nuit,
csUjf U
défectueux
et
Jl»
être
y?
U
pendant
ne
,
parce
verbes.
et ses sœurs.
être dans le milieu de la matinée,
ôl? être pendant
n'être pas t
attribut
L^f^fJ qb* Cana
Ces verbes sont,
jè\
iUijli£jU>f
nommés
contiennent pas
nomme
879*
formée du
renfermant le
de temps.
constance
qu'ils
régissans grammaticaux fondés
verbe abstrait y? être, et des autres
même sens y joignent quelque cir
La dixième classe des
c^f
tout
être
le
être
au
jour,
pas cesser, être
au
soir,
^
encore.
4j 5
080. Le sujet de ces verbes se nomme yl^^f nom du verbe
ÊTRE, et leur attribut l^y^ énonciatifdu verbe ÊTRE. Le premier
DE
régi
est
nominatif,
au
88l. On peut
et même
avant
verbe
et
le second à l'accusatif.
mettre
le verbe
celui ci
;
SYNTAXE.
LA
l'énonciatif
mais
on ne
ou
attribut
peut pas le
avant
ïe
sujet
mettre avant
U
de la
le
quand
précédé
particule négative
882. Les verbes y? et 'Jjo peuvent être employés comme
verbes attributifs renfermant l'attribut existant, c'est-à-dire,
signifiant exister: on les nomme alors *tî' fjliâ verbes parfaits;
ils suivent ,
leur agent
est
en ce cas
au
la syntaxe des autres verbes
,
loin
plus
,
on
dans la formule admirative dont
insère ïe verbe
yfr après
purement explétif o^Vj (n.° 663).
884* Quelquefois aussi Q^se trouve placé
verbe
U
on
par
mais alors ce
;
est
position
comme
parti.
et mettent
nominatif.
883. Quelquefois,
lera
,
.
nominale
d'un inchoatif
composée
y&* jûj yf
un
événement
cas, le verbe (^ n'a
nominale qui le suit , et il
Dans
ce
(a
et
été, c'est
aucune
devant
une
pro
d'un
énonciatif,
que)
Zéid
influence
sur
(est)
la pro
est censé avoir pour
position
agent
l'agent pronominal caché dans ïe verbe qui alors a la même
signification que le mot qU un événement. Le verbe y? est
donc alors un verbe parfait et ïa proposition est une propo
sition composée qui a pour énonciatif une proposition nominale.
On dit alors que le verbe est yJJ\ j*+*> t..** y£j> c'est-à-dire,
renfermant un pronom qui exprime un événement. Je reviendrai sur
ce sujet dans un des
chapitres suivans.
88 J. Quand le verbe y^J est employé pour nier l'attribut
on
sans détermination d'aucune circonstance de temps passé
peut, au lieu de mettre l'attribut à l'accusatif, le mettre au génitif
avec la préposition <_>
On dit fort bien J*li o4} û~$ Zéid
n'est pas ignorant.
,
,
,
,
.
Ee
2
43^
DE
SYNTAXE.
LA
XXXV.
CHAPITRE
Des Verbes d'approximation.
886. La
onzième classe des
régissans grammaticaux fondés
-
sur
e-^
os-
l'usage formée par les verbes d'approximation ijjlkllf ^fUif
On appelle ainsi certains verbes , au nombre de sept, qui in
est
l'existence
diquent
plus
ou
moins
prochaine
du
sujet
,
avec son
attribut.
Ces verbes sont,
887*
est
peu
telle
ou
fallu
yi
éUy éJ/"
que,
-
-
il peut arriver que, ï\f il s'en
00.
f
-
JiL jjii?' se mettre faire
a
-
telle chose.
Le
premier est employé a exprimer l'approximation de la réunion
du sujet a l'attribut, comme une chose que l'on espère jjjJ
pyy
si[Âj y&\ c'est-à-dire qu'il exprime ïa prochaine exécution
,
,
d'une chose que l'on
espère.
employé a exprimer simplement la prochaine exécution d'une chose ^oj-a-». y&\ y'o\ py^y
Les autres sont destinés a exprimer la prochaine exécution d'une
chose a laquelle on se met *Zg foJLf J^f j jj *&j*y»
Le second
est
.
.
888.
IkaJ,
Ces verbes n'influent réellement
que
seul
sur un
influent virtuellement
position
mais qui
nom
mis
verbale
,
qui
nom
qu'ils
fjjj^aj'
ne
sur
et
mettent au
l'attribut
grammaticalement
nominatif; mais ils
exprimé
par
une
pro
peut être mise réellement à l'accusatif,
occupe ^Us-. Le
verbes l^câf , et la
est
censée y être mise par la place
qu'elle
au
nominatif se
ces
nomme
le
nom
de
proposition qui sert d'attribut, leur énonciatif UJia. C'est ainsi que
l'on dit
£j^£ y ^3 c5** il peut bien arriver que Zéid sortira, Le
verbe y& se construit aussi avec la particule conjonctive y
.
,
suivie d'un verbe à l'aoriste
Exemple
:
l'agent
de
l'agent
de
ce
verbe.
bien arriver que Zéid sorte; et
il peut
o^'j '~Ji. y que Zeïd sorte, est considérée
alors toute la proposition,
comme
subjonctif, et
'Jfî. y y&
o^j
437
SYNTAXE.
LA
DE
du verbe
y*
,
car
c'et
de
l'équivalent
o^}
£jJ*
la sortie de Zeïd.
On peut dire
sortira. Dans
y^
t
cette
J*yi.
et
,
dernière construction, c^j
mot
qui
renferme
sert d'énonciatif à
minal,
889.
suivent
Le verbe il*"
cette
y* il peut
I^X c^j
encore
y*
et
un
,
faire que
Zeïd
le nom du verbe
verbe
et est
les
est
se
et son
agent prono
censé mis à l'accusatif.
verbes
autres
d'approximation
dernière construction.
ik*
890. Quelquefois le verbe
se
construit aussi
avec
la par
y que, placée soit immédiatement après iK', soit après le
nom. Exemple :
J^&ÏÏ ù>yks y 5 k" ou 4>>j y (j^f-f ^W peu
s'en fallut que le soleil ne se couchât.
801. Le verbe <îUjf prend aussi quelquefois la conjonction y
Zéid a été près de sortir,
après le nom. Exemple : ^é (jf oï.j (ÀÂj\
ticule
XXXVI.
CHAPITRE
Des Verbes de
892.
dés
sur
La douzième classe des
est
l'usage
formée des
iDfl /odf^lil qui
,
la
au
de blâme.
régissans grammaticaux fon
verbes de louange et de blâme
nombre de quatre. Ce sont, pour
sont au
'J<j
et
f^
;
de personnes ni de nombres
font
et
et sU.
pour le blâme, jZ*
Ces verbes n'ont aucune variation de modes, de temps
louange,
893.
louange
féminin ô*ju
-
**>^
-
;
*£j
J^
-
o*l«
et
*U , néanmoins
.
Ee 3
,
,
DE
premier
ou
nominatif:
appellatif déterminé, et le second est un
pronom. Le premier exprime la qualité
l'on blâme et le second la personne qui est
un
propre
qu'on loue ou que
Vobjet de la louange
dernier
,
ou
du blâme
*
JJf y
^-IsIL -jj-^Jgjf
censé être l'inchoatif
.
transposé ayant
composée du verbe et
proposition
agent. Exemple : oSà* ïîjlil «p^> c'est une belle femme
nom
est
de
son
aue
Hind.
,
verbale
pour énonciatif une
On peut dire également o^t *ïy>\
mis à l'accusatif est considéré comme
un
noms au
est un nom
nom
Ce_
SYNTAXE.
Ces trois verbes gouvernent deux
894*
le
LA
cxjo;
mais alors le
spécificatif,
et
nom
l'agent
est
pronominal.
agent
On peut dire aussi Ja-jJf
j**i le bel homme ! sans
nom
la
est
son
l'objet de la louange
personne qui
ce
qui forme alors une proposition verbale.
exprimer par
du blâme,
et
quatrième verbe \'&[*- est absolument invariable.
composé de Ç*s, et de f i ; et la manière ïa plus
naturelle d'analyser les propositions où il entre, est de regarder
li comme l'agent du verbe mis au nominatif.
Ainsi dans cette phrase ou> fo^â. que Zéid est beau! l'inchoa
tif est oâj ; il est transposé : la proposition verbale fjJ^ com
Le
89^.
Ce verbe
est
,
,
,
,
posée
II
d'un verbe
en
et
d'un agent
,
fait la fonction d'énonciatif.
de même dans celle ci
est
-
bel homme.
,
$&■} fo^a- Zeïd est
$4>j est à l'accusatif
o~>j
L'analyse est la même et
comme
complément spécificatif.
Si l'on dit i>Jj y±y\ ft>ÂÂ on analysera encore de même la
proposition et l'on dira que JLiJ/f est au nominatif comme ad
jectif, ou comme appositif mis en remplacement de fi (n.° 750).
896. Le verbe sU» s'emploie souvent comme verbe transitif
un
,
,
,
régulier.
DE
CHAPITRE
Des Verbes
jur
Verbes de
appelés
l'usage
une
,
action intellectuelle
fondés
croire,
miers
une
indiquent
,
comme
savoir, penser,
connoître.
"i& savoir,
<34-j trouver, ^\j juger voir,
JU. s'imaginer, ILj croire. Les trois pre
sont
y± penser, ô^
,
science certaine
connoissanee mêlée de doute
ces deux
régissans grammaticaux
formée de sept verbes nommés verbes de cœur
parce que l'attribut que ces verbes renferment,
Ces verbes
898.
cœur.
est
ç>yjUfjU>f
exprime
XXXVII.
La treizième classe des
897.
439
SYNTAXE.
LA
:
,
;
les trois suivans
,
le dernier tient le milieu
une
entre
classes.
tJ^'j 'Q>m\ Jl*sf verbes
de doute et de certitude, et j4^jj ^îo^Xliî J* *-4»J^ ô-*)y régissans
899.
Ces verbes
sont
aussi nommés
qui influent sur l'inchoatif et l'énonciatif.
OOO. Ils ont trois régimes : le premier est l'agent qu'ils mettent
au
nominatif; le deuxième
est
lîjVf tlj*^lM premier
<>UJf Jjiàltf second complément
nommé
com-
plément objectif, et le troisième
objectif: ces deux derniers sont mis à. l'accusatif.
90 1 Les deux derniers régimes forment véritablement une
proposition nominale composée d'un inchoatif et d'un énonciatif:
,
.
mais
comme
il
est
discours de n'être
pas ici les
ou
noms
de la
nature
régies
par
de
ces
aucun
deux
parties
antécédent ,
d'inchoatif et d'énonciatif. On
constitutives du
on ne
nomme
premier complément objectif oJuk oU j fy
nom
d'un verbe de la classe de
*£
,
et
^
,
l'inchoatif
c'est-à-dire ,
l'énonciatif ou second
plément objectif, v^JJii oÇ j j—*» énonciatif
çlctsse de
leur donne
com-
d'un verbe de la
.
Ee4
44o
002. De
ces
verbes
toujours employés
être
employés,
agent
deux
,
seulement
leurs trois
à la manière des
seul
et un
avec
SYNTAXE.
LA
DE
régimes
autres
o*^=>
;
verbes
complément objectif.
sont remarquables par
003. Ces verbes
les
et
JU.
autres
peuvent
transitifs,
deux
sont
avec un
propriétés par-
la liberté
nommée *UJVf
jYy.
défaire
ia'ôUJf
%\jJ\ Ce mot signifie JUuàVf à* yji iJjj*^
JLtLÎI
JJUj UlÎJ l^J^jiiJj' faire cesser toute dépendance entre ces verbes
et leurs deux complémens objectifs, tant grammaticalement que
ticulières. La
première
est
0
.
logiquement.
Cela
se
fait
en
mettant
nominatif
,
du verbe
mais deviennent réellement
,
en sorte
qu'ils
ne
composée d'un inchoatif et d'un
sont
ïes deux
plus
complémens
au
affectés par l'influence
une
proposition nominale
énonciatif, le verbe, de son côté,
proposition verbale qui est isolée.
Le verbe doit alors être placé après la proposition nominale, ou,
comme par parenthèse, entre l'inchoatif et l'énonciatif. Ainsi,
on
au lieu de dire 5UU. fjJj csÀ-Lk j'ai cru Zéid ignorant
peut
dire (^Sk J*U- i£j Zeïd (est) ignorant, j'ai cru, ou o^jJi oôj
formant
avec son
agent
une
,
JjèU. Zéid, j'ai cru, (est) ignorant.
904. La seconde propriété particulière à ces verbes est
nommée (y&> suspension : ce mot signifie iuJjiîlif «i'îijjf Jl£|
^JS V IkiJ l&JjâsC»j JUiVf »tx* yj faire cesser toute dépendance
entre ces verbes et leurs deux complémens objectifs,
grammaticale
ment, mais non logiquement; c'est-à-dire que les deux complémens
cessent d'être sous l'influence du verbe quant à
l'expression, et
sont mis au nominatif, mais que leur dépendance
logique est
conservée.
Cela
i.°
a
lieu
en
trois manières
Quand, après le verbe,
:
on
place la particule J
nommée
DE
*V
*fJ^oVf
l'inchoatif',
lam attache a
f-Jr** *HJ^ o^é je (le) sais, certes,
2.°
Quand il
y
a
J*U- oij
U
o^éyV (le)
comme
3.0 Quand après
,
44*
SYNTAXE.
LA
comme
Zeïd
le verbe
après
le verbe
une
exemple:
cet
généreux ;
particule négative
sais, Zeïd n' est pas
il
,
est
dans
ignorant ;
qui sert
à
trouve un mot
se
,
interroger ; exemples :
Jjlf
Sais-tu,
est-ce
\\
Zeïd qui
Sais-tu
OO
^
•
H y
a
906.
vous
dans la maison,
d'eux
est
ou
Amrou l
venu!
d'autres verbes
cœur :
tels
sont
JJ**^
rencontrer,
,
qui opèrent le même
Jââ. mettre Sy> laisser,
,
envoyer,
ys»
nommer,
Les verbes de cœur , en passant à la forme
avoir trois
/'/
est
qui
beaucoup
effet que les verbes de
y*, former, JjJ
changer, &c.
jfûJf j <>3j\ C^Ô
Jâj f
o—-
^
peuvent
,
complémens objectifs. Exemple: *.%»o. lè=Jl>f ,*Cjjj
fera
voir que
QOJ. Quand
à la voix
ces
(vos)
œuvres
verbes
,
objective l'agent
plément prend ïa place d'agent,
et
le troisième demeurent
au
nominatif le second
mauvaises.
étant à cette même forme
n'est
,
(étoient)
plus exprimé
et se met au
:
le
,
passent
premier com
nominatif;
le second
ïa forme de
complémens et à
l'accusatif. Exemple : i^Ai/À-JLff J^lUf f^jj on fera voir aux
hommes (que) leurs œuvres (sont) mauvaises.
908. On peut aussi supprimer entièrement le premier com
plément devenu agent du verbe à la voix objective et mettre
sous
,
,
complément
le troisième demeurant à l'accusatif.
leurs
œuvres seront
devenu le
Exemple :
montrées mauvaises.
du
verbe,
*-****. "àfl^f c5j-»
sujet
44*
SYNTAXE.
LA
E>E
CHAPITRE
Des
XXXVIII.
Régissans logiques.
Les
régissans logiques *ïy** JJ^y sont au nombre de
deux. Ceux-ci ne sont à proprement parler que l'absence de
tout terme antécédent
capable d'exercer quelque influence sur
ïe mot qui est envisagé comme
régime JjJU
Aussi ces antécédens logiques sont- ils nommés o^j^é et
ïy4- dépouillement ou ilkJdJÎ J*f^*Jf qS îj4- dépouillement ou
absence de tout régissant grammatical.
9IO. Cette absence des régissans grammaticaux a lieu par
909.
,
,
.
,
au
rapport
nom
et
par rapport
au
verbe ;
ce
forme deux
qui
régissans logiques.
O I I
Par rapport
.
au nom
,
c'est l'absence de
tout
antécédent qui
exiger oit que le nom fût mis au génitif jjfé ou a Vaccusatifc^f^ ;
ce
qui peut s'exprimer ainsi : jl^tj o**>Lf f ^ jJ^sj! Le nom
.
alors
est
nominatif pyy
##
Par rapport
912.
au
.
verbe , c'est l'absence de tout antécédent qui
le verbe fût mis
mode
subjonctif ojIà* ou au mode
conditionnel »jf£ ; ce qui peut s'exprimer ainsi : u^îl f y ij^ff
fj^b -^e verDe est alors nécessairement au mode indicatif ^yy
exigeroit que
au
,
.
•
II
point de dis
s'agit ici que de l'aoriste , le prétérit n'ayant
tinction de modes. Si donc on dit quelquefois que le
mis
ne
au
mode
subjonctif t->^u^
c'est seulement ÔUô
position
,
et non
a
ULiJ
,
ou
au
raison de la place
en
réalité.
prétérit est
mode conditionnel
qu'il
^fé
,
occupe dans la pra*
DE
LA
XXXIX.
CHAPITRE
De la
443
SYNTAXE.
de la forme exclamatîve
Syntaxe
ou
admiratîve des
Verbes.
913.
matif ou
quand
verbe, comme je l'ai dit^ailïeurs devient exclaadmiratif, et est nommé o**xJf J** verbe d'admiration
Le
,
il
0
,
est
construit de l'une de
ces
deux
S
manières, *JJt?f U
°J*3f Ces deux formules sont analysées différemment par
les grammairiens Arabes.
9 1 4- Dans ïa première on peut regarder U comme inchoa
tif, et Jiif comme une proposition verbale composée du verbe
et de son
agent et ayant pour complément objectif le pro
nom affixe
On peut aussi supposer qu'il y a ellipse
que
;
fc.I*if l
Ainsi
est l'inchoatif, et que l'énonciatif est *y
foJj y^-ï U Zéid est très -beau signifieroit à la lettre, ce qui a
et
iu
.
,
,
0
.
,
.
—
,
rendu Zéid
beau, c'est
une
certaine chose. Peut-être vaudroit-iï
mieux supposer pour nominatif sous-entendu À»f Dieu.
pic. Dans ïa seconde, on peut supposer que le verbe est à
l'impératif, qu'il renferme son agent, et forme avec lui une pro
tient ïa place d'un complément à
position verbale et que
l'accusatif. Suivant d'autres, le verbe est censé être au prétérit,
«-»
,
et
le
sens
de
«j
ô^*f
Pour ^caractériser
est
cette
y*L
fi
3^ il
est
dernière formule ,
devenu doué de beauté.
on
dit que la proposi
tion y passe de la forme ÉNONCIATIVE h la forme PRODUCTIVE
#tîj-V4-
(J,] jUi.Vf iU^o y.* fcJji-^; c'est-à-dire qu'au lieu
d'employer le mode indicatif, destiné à exprimer une affirma
tion
,.
*j*~?
on
se
d'exprimer
sert
une
du mode
volonté
impératif,
(n.° 712),
dont
l'usage
propre
est
444
LA
DE
SYNTAXE.
CHAPITRE XL.
Observations
quelques
sur
usages des Pronoms.
,
emploie souvent les pronoms personnels d'une
manière pléonastique dont l'objet est de séparer l'inchoatif de
l'énonciatif (n.° 1 56) ou de donner de l'énergie à l'expression
(n.os 650 et 660). Exemples :
916.
On
,
,
Zéid
(est)
le
fils
y
Dieu
de
ton
oncle
iî^lf y âwf
celui dont l'assistance
(est)
Je suis la vérité,
plutôt,
ou
c'est <moi
^UZif^udlfT^îl
C'est toi
qui
es
Dans le
paternel.
le sultan
est
implorée.
qui
suis la vérité.
Â\
auquel
on
obéit.
premier cas le pronom personnel n'est plus
considéré par les grammairiens Arabes comme un pronom mais
comme une particule, et on
l'appelle J^Jjf cJ>* particule de
séparation. En effet il sert alors à séparer l'inchoatif de l'énon
ciatif, et à empêcher qu'on ne regarde ces deux parties de la
proposition comme si elles n'en formoient qu'une seule et que
la seconde fît seulement à l'égard de la première la fonction
d'adjectif qualificatif ou d'appositif. C'est ainsi que dans les deux
premiers exemples le pronom empêche qu'on ne traduise de la
sorte : Dieu dont l'assistance est implorée
; Zeïd le fils de ton
Dans ie dernier cas, le second pronom est un
oncle paternel'.
appositif corroboratif o^y ^jIj (n.° 5 20).
917.
,
,
,
,
,
,
,
,
....
.
.
.
DE
LA
445
SYNTAXE.
Le pronom n'est alors dans
étant
en
dépendance,
quelque sorte étranger à la constitution de la proposition ; ce
qui s'exprime en arabe par ces mots : ofj-^Vf y *J Jl£ * il n'a
aucune
place dans le rapport grammatical des mots qui constituent
la proposition. Ceci sera expliqué dans un des chapitres suivans.
918. Le pronom personnel de la troisième personne soit
isolé, soit affixe, s'emploie aussi, par une sorte de pléonasme,
d'une manière vague, et qui ne donneroit aucun sens, s'il n'étoit
expliqué par une proposition suivante. C'est ainsi, à-peu-près
que nous employons le pronom de la troisième personne, en
françois, comme sujet vague et indéterminé, quand nous disons,
IL y a des
IL est des hommes qui.
(a).
gens qui
Dans ce cas, le pronom est appelé par les grammairiens
Arabes qUJ! _>#-» pronom qui exprime un fait, une aventure (b) ;
et la proposition qui le suit est nommée ^ulf j***â-f ëjlju ïX£
proposition qui interprète ce pronom.
919. Le pronom employé de cette manière peut être ou
le pronom personnel isolé représentant le nominatif (n.°8o3,
0
i.re p.) j
il, ou le pronom affixe représentant l'accusatif
(n.°8o4, r.re p.) lui, ou le pronom affixe représentant le nomi
natif, et compris dans les personnes des verbes (n.° 8 1 4, 1" p-)>
Le second cas n'a lieu qu'avec la conjonction y ou les verbes de
cœur
(n.° 897). Le troisième cas n'a lieu que quand on emploie
le verbe ^ par forme de pléonasme devant une proposition
nominale sans qu'il exerce aucune influence ni sur l'inchoa
tif, ni sur l'énonciatif de cette proposition (n.° 884). Alors le
aucune
,
,
.
.
.,
.
.
—
0
,
(a) Voye^mcs. Principes de grammaire générale
(b) Voye^h
f-97-
Grammaire d'Ebn-Farhic
,
man.
,
2.e
édition, p. 224.
Ar. de la Bibl. imp. n.° 1295 A,
446
SYNTAXE.
LA
DE
0U)f y&à> est caché dans
j.rt p.). Exemples de ces différens cas :
&
$»'
pronom nommé
i,
menteur,
"
**
J
•7'tf/
que Mahomet
J
'
est menteur.
l'
*—
envoyé
est
présent.
marchand.
qu'Amrou
*
J
3
un
JjamJ iX*-^ /LAÀiJ
Mahomet (est) envoyé de Dieu, on j'ai
cela ,
cr«
$C
J
»f
il étoit
ou
cela est,
ou
est
*ji
y$
marchand étoit,
Cela, Amrou
3
-
'-£.
y
un
yf (n.° 8 14,
-f\A iNJjjib
c'est-à-dire , cela est, que Zéid
//, Zeïd (est) présent;
Cela,
le verbe
cru
cela,
de Dieu.
*
iSr
'■
*
—
J
'
'
(S"T* t)
\?
(est) prophète ou cela a été que Moïse étoit
prophète (n.os é±\6 et 665 ).
9 20. Pour analyser ces propositions à la manière des gram
mairiens Arabes il faut dire dans le premier exemple que 3~*
est un inchoatif, qui a pour énonciatif la proposition nominale
_j^U. oôj toute entière ; dans le deuxième et le troisième
II
a
été, Moïse
,
,
,
,
que
est
0
le
nom
de la
est, pour le deuxième
et, pour le troisième
je
exemple,
la proposition
,
quatrième exemple
que son énonciatif
la proposition verbale fS£ y$* ,
conjonction £>]
,
que
0
est
le
,
et
nominale c->î©
nom
du verbe de
jf£
cœur
;
dans
c>^>
,
proposition nominale À» f J^j <>*■£>
enfin dans le cinquième exemple que c'est une proposition
verbale composée dont le verbe est && que le nom du verbe q^*
ou son
sujet est le pronom personnel caché dans ïa troisième per
et
sonne du verbe
que l'énonciatif est la proposition nominale
et
que
son
énonciatif
est
,
la
,
,
,
<>i ^y
toute entière.
DE
LA
44f
SYNTAXE.
CHAPITRE XLI.
Des Mots
app-elés abrogatifs.
Les
grammairiens Arabes appellent "L^y c'est-àdire expressions qui abrogent, les particules ou les verbes qui se
placent devant un inchoatif et un énonciatif, et en changent ou
la forme grammaticale, ou le sens (a).
Tels sont : i.° le verbe abstrait y? et ceux qui lui sont
assimilés (n.os 878 et suiv.) ;
2.0 Les verbes ik* il s'en est peu fallu que, y* il arrivera
peut-être que et autres semblables (n.os 887 et suiv.) ;
3.0 Les adverbes négatifs U et V (n.os 837 et suiv.);
4.° La conjonction y (b) et celles qui lui sont assimilées
(n.os 830 et suiv.) ;
$.° L'adverbe négatif "tf, quand il nie l'existence (n.° 84i);
6° Les verbes de cœur y& et autres (n.° 807 et suiv.).
Je ne reviendrai point sur l'influence grammaticale de tous
921.
,
,
,
.
,
,
Cela
yj£]j sfôoXif J iôo J-^lpJI
(jJw I LkÀj LJ^j^-aLàJj Le changement dans la forme grammaticale
^JijJuJl y?*s$\ lieu, par exemple, quand mot qui devroit être nomi
natif
le sujet après
met à l'accusatif,
l'attribut après 7.M1
£«f
le changement dans le
^JJuif jvyvsûf f lieu quand temps de verbe
(a)
ainsi
s'exprime
.
en
arabe
:
.
un
a
se
au
comme
sens
de
valeur,
,
,
>
•
ou
a
un
affirmation n'énonce
change
qu'une proposition qui énonçoit
plus qu'une possibilité comme cela arrive avec les verbes yé. et afc", ou que
celle qui énonçoit un jugement affirmatif n'exprime plus qu'une opinion dou
teuse
effet que produit ie verbe JJà
ou
une
,
,
,
(b)
à
.
J'ai
cause
déjà dit ailleurs (n.° 830) qu'on appelle
de leur influence
sur
l'inchoatif.
ces
particules *\ô^ Vf
«^«fji
44%
ces
DE
mots ;
elle
LA
SYNTAXE.
été suffisamment
a
expliquée,
mention ici que pour faire connoître
tendent par le mot
t^y
et
je
n'en ai fait
que les Arabes
ce
en
.
CHAPITRE
XLII.
et des
Des Adverbes de temps et de lieu
suivies de leur complément.
,
Prépositions
0,22. Tout adverbe de temps ou de lieu <j>J^-k , et toute
expression composée d'une préposition et de son complément
•
.
jjj^SjjU., dépendent nécessairement
toujours
un
verbe
ou un
Ce terme adverbial
mot
qui
d'un antécédent
qui
es.t
renferme la valeur du verbe.
dans la
dépendance s'appelle yétu
dépendant et son antécédent se nomme y**Ll\ le mot qui a un
terme adverbial dans sa dépendance.
023'. L'antécédent dont il s'agit ici est souvent le verbe
être, exister, se trouver, y? Ju«. JiuIJ et alors il est sousentendu le plus ordinairement.
qui
est
,
*j
,
-
-
,
024.
H doit même nécessairement être
ïes fois que l'adverbe
font fonction
dans la maison
ou
la
préposition
d'énonciatif y*.
de
comme
,
sous- en tendu
avec
,
toutes
complément
oôj Zeïd (est)
sori
jfôjf j
ojj*
(j<£^ j'ai passé auprès de celui qui (se trouve) cke^ toi; de
qualificatif *-ju> comme o4^Jf J| c^joc yj^Xi cl>jj* j'ai passé
près d'un chrétien (qui est) che£ toi dans l'appartement.
Dans tous ces exemples l'antécédent dans la dépendance duquel est le terme adverbial y#3*-l\ antécédent qui est le mot
ytf étant, ou J~»U. se trouvant doit nécessairement demeurer
;
proposition conjonctive «-JL5.
,
comme
<3ùjj~
,
,
u
,
,
sous-entendu.
Les
DE
LA
44j?
SYNTAXE.
Les
les
ne, là
particules ôj quelquefois, VjJ si.
prépositions employées d'une manière pléonastique (n.° 670)
n'ont point d'antécédent (a).
.
comme, et
.
,
CHAPITRE XLIII.
Observations
générales
l'Analyse grammaticale.
sur
Uanalyse grammaticale , nommée par les Arabes c-jfj* f ,
et dont j'ai donné quelques exemples dans cette quatrième partie
£2^.
de la Grammaire ,
que
joue
pour objet principal de rendre raison du rôle
dans le discours chacune des parties complexes ou in
complexes
a
dont il
se
compose
le verbe , les divers
;
d'indiquer
le
sujet l'attribut
,
,
même temps , de rendre
laquelle les mots se pré
complémens
grammaticale sous
sentent
et sur-tout du cas auquel se trouvent les noms
et du
mode employé pour les verbes. Quoique j'en aie donné plusieurs
exemples je vais encore en présenter ici quelques-uns en
choisissant des propositions dont l'analyse ne présente aucune
; et
raison de la forme
,
en
,
,
,
,
difficulté.
Exemples d'analyse.
L>
Zéid
—
a
&
o*?.j
frappé
<~>j~°
Amrou.
La raison de cela est par rapport à «~J
<Iue c'est moins une prépo
>j
qu'un nom mis à l'accusatif par forme elliptique ; et par rapport à oïl
que les grammairiens regardent ce mot comme un nom indéclinable (n.° 82,6,
i.re p.). Quant à la particule Vif, quandelle régit un affixe, j'ai dit ailleurs ce
que je pense de cette expression (n.° 575 ),
Ff
/// PARTIE.
^
sition
,
»
,
45°
ETE
Cfyc verbe
SYNTAXE.
LA
prétérit: a.i) agent, mis au nominatif; ce cas est
caractérisé par le dhamma qui termine effectivement et d'une manière
sensible ce mot : fJJ£ patient (ou complément objectif du verbe) ; il
est mis a l'accusatif, et ce cas est caractérisé
par le fatha qui termine
au
d'une manière sensible.
ce mot
"•--'- sm
Mousa frappe
son
serviteur jusqu'à
J
-
'.-
J
J7
'
tant
qu'il
meure.
*a_5j *iûL*j i»3 [3 o^ujf ^y o^yki pj-jy py*** jâ* oj^j
*
f,
ï.ir.3^$, *-*-.
?.-,.--, S J.,
J{ ,r
tSjiïAa f^o i*3j A_« Acj Pj9J'°JSt'j tJJ"^? J*^ (S°j* ?>*"' cl »_>*vlj JtfcA*
.
foio*
jpU. j
"
V.*
'
«
.
$
J
«
*
^JtWUJf
i
f
.3
^3j jjiii'iwf
»'*
$l
$-»",$
jJ
\-
.
«jV
|-J$..
*
.
J
,
$
-
.
JjjaJf Uj^U ^« £î.* jjyi ji
•
-
$
3
-
-1
JT'ttî'
-
,
"
->
,j>,
»-
o-,
"
I»:*-'*
,,-
J
.
"
.
-»
-
^4 JJJ*^ ^-o-i j-?jw J ^ô^J
•'j-m--
Uj £)fj J*
-
*
-
«jJOJii'
—
l'aoriste,
mis
-
.*,f
-
*
*->>***? v#-fo
|
l^?.^
& 41
nominatif (c'est-à-dire, ûh wo^
indicatif) jww qu'il
l'influence d'aucun antécédent qui
exige l'accusatif ou le cas nommé djezm (c'est-à-dire, le sub
jonctif ou le mode conditionnel) ; le signe de l'indicatifest un dhamma
qui termine effectivement ce mot : y>y agent de ùjls mis au
nominatif; ce cas est caractérisépar un dhamrrîa placé virtuellement
surl'élif, mais qui n'est pas sensible, à cause de l'impossibilité (de
mettre ici un,
dhamma) attendu que ce nom se termine par un élif
bref; il conserve, en conséquence i la même forme à l'accusatif et au
génitif: &ÂÀ renferme l'antécédent et le conséquent d'un rapport
,
<z
n'est
au
sous
,
,
,
.
DE
d'annexion ; il
est
à
LA
45
SYNTAXE.
l'accusatif, comme complément objectifdu
l
verbe
L>j*ô* et ce cas est caractérisé par le fatha qui termine ce mot pro
affixe qui est virtuellement au génitifpar l'effet de l'annexion
0Â particule qui indique le terme d'une action et régit l'accusatif
( c'est-à-dire le subjonctif) <i>fû. verbe a l'aoriste et a l'accusatif
(c'est-à-dire au subjonctif) ; il est mis a ce mode, comme étant sous
l'influence de la particule y qui est nécessairement sous -entendue
après Js* ; ce mode est caractérisé par le fatha qui termine ce mot
l'agent du verbe é^fJt- est caché dans ce verbe, sans qu'il soit permis
ici de l'exprimer ; il équivaut a '£ la particule y, et ce qui la
suit, a le même sens qu'un nom d'action qui seroit au génitif; cela
équivaut a kSy J)
:
,
o
:
nom
,
,
:
,
,
,
:
:
.
Mon page
JlO
Lo (Je tjOJ* *■*-« **-9j
(jlii
mXà
^jJLff jju.
j
^.Iâ ïUii
ùi'Jjiii ï-é^yj.
j f Os!*
est
«-«JUij
présent.
«BltXXjaU
wy^\ ^ULuif
gj9>»
U^»
*IOw*X»
,£»£.
û-r? g* *^
i)j>j ^Lîy^ JJL4. my£ j y<^» >*h» *uifj
^yis (jj\
&d\
ïyjTy *jjXiii\. *j=s,'y>. j,yj -^b
nominatifpar lafonction qu'ilfait d'inchoa
tif ; ce cas est caractérisé par un dhamma qui est placé virtuellement
sur la lettre qui précède le ya mais qu'on ne peut pas rendre sensible,
le mettre est occupée par la motion
pa%ce que la place où l'on devroit
fj^ inchoatifmis
,
au
,
le
analogue: fSl antécédent d'un rapport d'annexion; ya
au
génitif, comme complément
pronom affixe qui est virtuellement
,
est un
d'un rapport d'annexion ; le mot jjU conserve la même forme à
et au
génitif. Par la motion analogue , j'entends le
l'accusatif
kesra du mim , motion
qui
est
analogue au
ya.
^U. énonciatif de
,
Ff
2
4$2
DE
l'inchoatif\g$& ; il est
le dhamma qui termine
au
SYNTAXE.
LA
nominatif,
et ce cas est
caractérisé par
ce mot.
II faut observer que les différentes parties intégrantes
entrent dans une proposition , sont souvent remplacées
par
926.
qui
expressions complexes qui ne peuvent pas être mises au
qui conviendroit à la partie intégrante représentée par cette
expression : c'est ce que l'on comprendra mieux par quelques
exemples.
l^y'^o U> JiUj Z»\ yZi Dieu n'a pas les yeux fermés sur ce
que vous faites. Le verbe yZJ doit avoir deux régimes : 1 ,° son
sujet, qu'il gouverne au nominatif; 2.°son attribut ou énonciatif,
qu'il gouverne à l'accusatif. Ici le sujet à»f est bien au nomi
des
cas
natif;
mais
,
lieu de dire SMl
au
,
en mettant
l'énonciatif à l'ac
employé ïa préposition c_> avec un complément au
génitif. Cette expression complexe JiUj représente donc l'ex
pression incomplexe ùtèlè. Pour l'analyser, il faut dire que la
préposition et son régime sont à l'accusatif ,% eu égard a la place
qu'ils remplissent, comme formant l'énonciatif de yZJ ; ce qui
cusatif,
on a
Jilî Jii. l^iL ^k *jyUù> j/jiJ\} j^f
Au contraire, dans cette proposition,
j^Vf j £_}ta ^ U
jjCJuif ^f V| g^sXÎJk.ykj jjIU VJJ // n'est point de bête sur la
s'exprime
terre
ainsi
ni d'oiseau volant
,
semblables à
et
le
:
nom
vous
avec ses
(n.° 670) ;
juta, au génitif, qui
deux ailes ,
qui
ne
soient des nations
il faudra dire que la préposition y
lui sert de complément, représentent
plutôt le nom de la particule négative U qui imite
yf et qu'en conséquence cette expression com
plexe par la place qu'elle occupe dans la proposition est au nominatif; ce qu'on exprime ainsi : jM^fj *ô^}j 0*3 ->j>Hj 3^ Ç^* Ot
l'inchoatif,
ou
la syntaxe du verbe
,
,
,
DE
J'ai
expliqué
mot
1
Lii'U
ci -devant
4")
SYNTAXE.
LA
(n.c 878),
ce
3
que l'on entend par le
.
927* ^e
Pas seufement des expressions complexes
et d'un
conséquent , qui remplacent
ne sont
formées d'un antécédent
des
parties intégrantes d'une proposition : ce sont souvent des
propositions tout entières complexes ou incomplexes.
028. Quand une proposition complexe ou incomplexe re
présente une partie intégrante de la proposition on dit qu'elle
occupe une place dans l'analyse o[j*Vf y Ju£ UJ jCLV j* Dans
le cas contraire on dit qu'elle n'occupe aucune place dans l'analyse ofj^Vf yj^ l$f y*}
Nous allons donner quelques exemples de l'un et de l'autre
,
.
,
.
cas.
Exemples
des
propositions qui occupent une place
l'analyse, parce qu'elles représentent une partie intégrante
proposition.
dans
de la
d3
o
dfj. -^Uof Js*
tout homme mourra.
proposition verbale ojX,
son
composée du verbe
agent caché, représente lenon:
elle
de
ciatif
l'inchoatif oUijJs"
occupe donc une place dans
l'analyse et elle est virtuellement au nominatif.
La
de
et
,
ICU jXà,
lettre, que
\y»yaJ y il
vous
je uni e^
bon pour vous que vous jeunie^ (à la
bon pour vous). La proposition que vous
est
est
jeûnie^ a place dans l'analyse et est virtuellement au nominatif,
parce qu'elle représente l'inchoatif lC*U-> votre jeûne.
,
*AAa.jfj *Aj(Njf ^ji Qyù. \yJs>.j
leurs mains
leurs
ils revinrent
La
en
marchant
sur
proposition verbale î^yù- &c.
représente le terme circonstanciel d'état JU : elle est donc, par
la place qu'elle occupe dans l'analyse virtuellement à l'accusatif.
Ffj
et sur
pieds.
,
,
454
SYNTAXE.
LA
DE
ûyÔég IxJyÇsL \y*y*' p qÎ
tous.
La
si
vous ne
croye^ point,
proposition composée ôyCX^i
proposition
corrélative que l'on
/<z condition,
ouVj^ff *[>*■ compensation
et comme
telle , elle
vàt£
est
tionnel
nomme
de
vouspêrireç
JXX»*^ représente la
.UpJf ofjâ» réponse de
la condition (n.° 867) ;
*-*j>=£ virtuellement
au
mode condi
(bu cas nommé djezm) par la place qu'elle occupe dans
l'analyse.
Toute proposition qui sert d'interprétation à un pronom
nommé pronom d'événement et formant un sujet vague (n.° 918),
occupe une place dans l'analyse ; car elle forme l'énonciatif
d'une proposition à laquelle ce pronom sert d'inchoatif. Exemple :
jjj^ff liyb voilà le vizir ; ce qu'il faut analyser ainsi: j^ "J>
,
mjfj Jj£ (j ys\„i£\j «sltjJi-S^f ïXlffj O-Î^ JrtjP^J *fjjC*_* fij (jlîfl
'i'f^su» y^ ^uJf /^*-« j-J^ l>*-jf d* c'est-à-dire, y» pronom
d' événement ; fi inchoatif, j-^Jf £f£ Jwz énonciatif : la proposition
composée de cet inchoatif et de son énonciatif est virtuellement,
par la place quelle occupe dans l'analyse au nominatif, parce
qu'elle sert d'énonciatifau pronom d'événement ; elle explique le sens
V
>
,
renfermé vaguement dans ce pronom.
Exemples des
propositions qui n'occupent
l'analyse, parce qu'elles ne représententpas
de la proposition.
o^j
stÂ. Zeïd
est venu.
céiZ o^jS Mahomet
ûjà-f ôU jjip
Ces
place dans
une partie
intégrante
aucune
le
propositions
(est)
frère
,
ne
malade.
a*Amrou
est mort.
dépendant.d'aueune autre
,
n'ont
point
DE
de
dans
place
d'aucune
*JJU»
l'analyse ;
LA
SYNTAXE.
car
elles
ne
455
parties intégrantes
sont
proposition (a).
yjcûj\ iUJJ
qu'elle dormoit le
soleil qui se levoit. La proposition incidente jU>j*J tandis qu'elle
dormoit, n'a point de place dans l'analyse, parce qu'elle est inter
j^j
ZflAj j'ai
tandis
vu,
£
-
,
°
-
,
posée
entre
rapport
le verbe
et son complément, et n'est liée par aucun
le verbe. II n'en seroit pas de même si l'on disoit
avec
iujU yj&}\ (jJ}éL Lifjt^jfJ j'ai
soleil
qui
se
couchait; la proposition
assis, auroit place dans l'anaïyse
seroit
satif, parce qu'elle
fiant le pronom de la
verbe
oûfj j'ai
un
,
terme
première
et
^j-JUL ufj
j'étois assis,
le
tandis que j'étois
seroit virtuellement à l'accu
circonstanciel d' état
personne
o
Jl^ modi
renfermé dans le
vu.
If uiU ô^=»
t£Î è>U,
tandis que
vu,
y
si
tu eusses
été ici,
mon
frère ne seroit
proposition mon frère ne seroit pas mort <$•) ^u. 11
n'a point de place dans l'analyse parce que la conjonction JJ
n'est point du nombre de celles qui exercent une influence sur
les verbes des deux propositions corrélatives liées par l'idée d'une
condition et qui en conséquence exigent l'emploi du mode
conditionnel. II en est de même de V^J si. .ne, et de lif quand,
toutes les fois que cette dernière particule n'exprime pas le sens
de la conjonction £>f si.
Les propositions conjonctives *_U>
jointes à leur antécédent
pas
mort.
La
,
,
,
,
.
,
(a)
lysée ;
et
tif
a
Cela
pas que chacune de ces phrases ne puisse être ana
ne soit une
proposition verbale composée d'un verbe
n'empêche
première
que la
d'un agent; la seconde, une proposition nominale composée d'un inchoa
une
et d'un énonciatif ; enfin la troisième
proposition composée qui
,
pour inchoatif
qui
est
mff
virtuellement
.
au
et
pour énonciatif la
proposition
verbale
»yà.f
nominatif.
Ff4
ov*
4$6
jyy
DE
,
soit par
un
LA
adjectif,
SYNTAXE.
comme
(jôJ\i lequel, soit par
une
Us ainsi que, n'occupent point
expression adverbiale,
de
dans
place
plus
l'analyse.
Au surplus mon intention n'est point d'indiquer ici tous
les cas où les propositions occupent une place dans l'analyse,
ni tous ceux où elles n'y occupent aucune place ; ce qui
peut
même quelquefois être sujet à contestation : j'ai voulu seulement
faire connoître ce que ïes grammairiens et les scoliastes en
tendent par ces expressions techniques.
comme
non
,
FIN.
ADDITIONS ET CORRECTIONS
POUR LA SECONDE PARTIE De LA
N.°
J'ai dit que
aucune
règle
néanmoins il
quent,
et
l'usage
certaine
est
des
^4- page
35 >
de l'aoriste
(n.° 54),
cas où
l'usage
d'autres où il
est
nëne
'9-
n'étoit assujetti à
énergique
et
ARABE.
GRAMMAIRE
cela
de
vrai
est
mode
ce
en
général;
est
très-fré
très-rare.
emploie fréquemment l'une ou l'autre forme de l'aoriste
énergique, lorsqu'on exprime un ordre une défense, un désir ;
lorsqu'on excite à faire quelque chose, ou qu'on interroge.
On en fait également un usage ordinaire après la conjonc
tion U>f si, composée de y et de U explétif. Exemple : yî L»
On
,
IXjm JLj
envoyés
II
(JC3Sj\3
Lof laf ô
choisis d'entre
en est
de même
enfant
d'Adam! s'il
vous
vient des
vous.
après
une
formule de
serment
,
pourvu
que l'aoriste soit pris dans le sens futur, que la proposition
soit affirmative , que le complément du verbe ne soit pas placé
entre
la formule de
serment et
le verbe
,
et
enfin
précédé de l'un des adverbes y
appelés particules de futur (n.° 848 //' p.).
ne
soit pas
-
que l'aoriste
,
{Sy
et autres
,
Toutes
au
mode
ces
conditions
énergique
avec
se trouvant
réunies
,
on
l'adverbe d'affirmation
met
J Exemples :
.
(JVA^M ÊLi^y&i cA-JjjftX9
J'en
jure
par
ta
puissance, je
le verbe
les séduirai
tous.
45§
ïT^.
ADDITIONS
3
^'
»
^
p^
ïT
«•
«
-
-
.*
,.
Â_Jj*oV« p&Mi* AÀ-Li»Vj Lôjj._À^o Lv^âj CiO'-jC
a»f ^yà. 0.>*»<yj
Certes
je
)
*vjujV|
/&-LH°V»
,
^^^
.
-
QO^V jlj»
q.IM ^x!Â^jT
je prendrai une certaine portion d'entre tes serviteurs, et
je leur inspirerai de (criminels) désirs ; je leur
les séduirai ;
donnerai des ordres,
certes ,
ront
en sorte
couperont les oreilles des bestiaux;
qu'ils
leur donnerai des ordres ,
je
(en
et
y
obéissant)
ils
défigure
les créatures de Dieu.
,.^ .j-, «.?;,
tfc»-*N &3j>j&3j
.\if
,
à
q_*
ij?J^'
Seigneur, puisque tu m'as trompé
leurs yeux (le péché) sur la terre
,
,
Ces deux derniers
tr-w-4;
.3 s
.
ci & ijHlj*
-.-*.*»
.,
J^^' ^-
.
je ferai paroitre agréable
certes je les tromperai.
certes
et
exemples auxquels je pourrais
,
beaucoup d'autres, font
m
Vj
voir que la formule de
en
joindre
serment
peut
être sous-entendue.
Si
quelqu'une des conditions exigées manque
employer le mode énergique de l'aoriste ; on se
de l'adverbe affîrmatif J
Exemples :
,
doit pas
contente alors
on ne
.
J
Certes ,
Certes ,
Il y
ton
vous
cJ.
C~°
-
-
serez^ rassemblés devant Dieu.
Seigneur te fera
d'autres
-
un
don,
en sorte
que
où l'on peut
tu
sois
satisfait.
employer le mode éner
gique de l'aoriste quoique ce ne soit pas l'usage ordinaire.
Ces cas sont : 1 .° après le mot U explétif ou servant à géné
raliser un nom appellatif (n.° 890, 1" p.) excepté cependant
dans le mot L'ij ;
2.0 Après l'adverbe négatif If ;
3.0 Ap'às l'adverbe négatif V;
a
cas
,
,
459
CORRECTIONS.
ET
4-° Dans les propositions conditionnelles où l'on emploie,
pour exprimer la condition , soit toute autre conjonction que
Uf , soit un mot renfermant la valeur de ïa conjonction y si
(n.°3i8,//</7.;n.°
5
,
,
2.<
p.)
;
affirmatives
5 .° Dans les
hypothétiques qui sont
propositions
et
dans la dépendance des propositions conditionnelles
que
l'on nomme J^Âft J*\yL compensation de la condition (n.° 51).
Enfin outre tous les cas dont nous venons de parler et où
ïes
l'on ne fait que rarement usage de l'aoriste énergique
ce mode dans les circons
encore
quelquefois
poètes emploient
tances mêmes où rien n'en autorise l'usage ; ce qui ne doit être
,
,
,
,
considéré que comme des licences.
II est bon d'observer aussi que , comme on peut subs
tituer au q de la seconde forme énergique la voyelle nasale f
p.) et dire ^»aj> au lieu de y~Uàj il résulte
de là que quand ces mots finissent une phrase et sont suivis
d'une pause
on
supprime la voyelle nasale et l'on dit -XJu
n.'
71, /.■>)•
(
N.°
87. Page yo, note.
(n.° 306
,
//'
,
,
,
Dans
lif
cette
expression _>^L' ^5
que les Arabes
«if
le pronom affixe <k>
,
mot
qUJÎ j^-î» ; et la manière
dont ils analysent ces façons de s'exprimer
prouve qu'il faut
dire jsAj au nominatif, et non fja.li à l'accusatif. Voye^, dans
les n.os p 1 8 et p 19.
cette seconde partie
est ce
nomment
,
,
N.°
87. Page
ji
,
note.
exemples que je rapporte dans cette note où le sujet
du verbe ytf semble être, contre la règle mis à l'accusatif, se
trouvent analysés ailleurs d'une manière plus satisfaisante. Voye*
le n.° 6 1 o de cette seconde partie.
Les
,
,
46*0
ADDITIONS
N.°
13 y Page 78, ligne g.
dit <>j L"
petit enfant, au lieu de ^
Dans "][>-> il y a suppres
comme U2I& U ou *<$& pour «Ole U
sion du (j qui caractérise l'affixe de la première personne , sui
C'est ainsi
qu'on
mon
,
.
vant
1>-j
ce
au
qui
été dit ailleurs
a
JjJ *
lieu de
comme
(n.° 809,
tlsj
//'
lieu de
au
1/42. Page 80, ligne
N.°
p.)
£j
,
et
l'on écrit
.
ip.
exprimé par les grammairiensJ* !jfoJf iLkUf y> *0ΣUf /* *//>
mots ( à la lettre une énonciation)
qui offre un
Ce que je dis ici est ainsi
Arabes : */A& ojXllif yéll y*Â
C0z//\r est une
sens, et
réunion de
après laquelle
,
on
N:°
peut bien
se
IC)6. Page
taire.
110, note.
Les
expressions que j'ai fait observer dans cette note pour
justifiées si le terme que j'ai considéré comme le
conséquent du rapport d'annexion étoit envisagé comme un
appositif de l'espèce nommée Jj^ (n.° 388) et concordoit,
en
conséquence en cas, avec le mot que j'ai regardé comme
l'antééédent, en sorte que l'on dît au nominatif, par exemple,
u>Âi£\ ^LLlff et à l'accusatif ô^ f <jUîlJf Je ne pense pas
que cela soit ainsi mais je n'ai point de preuve du contraire.
,
roient être
,
,
,
•
,
,
N.°
Je pense
qu'il
faut lire
fait, cJifj—If *jU=j;
mots
qui
est en
sont
croupe
IpCL Page
<j,$\yl\
on en sent
112, note
*JU>f
,
(b).
et non
,
comme
facïleinent la raison. Des deux
réunis par le genre d'union nommé
sur
croupe derrière lui,
l'autre
et est
cJ^|>»
je l'ai
,
et
l'autre
le
a
conséquemment i^ïYj*
.
ci^!>», l'un
précédent
en
ET
N.°
f.
ioy
2o4« Page
le commentaire
Voye^
4^£
CORRECTIONS.
sur
ligne y.
117,
l'Alfiyya,
man.
de S. G. n.°
4^5
>
recto.
N.° 205. Tâge 118,
Cette espèce de syntaxe dans
ligne
laquelle
13.
un
nom
prend
une
proposition entière pour son complément, et perd, en consé
quence , son tanwin comme servant d'antécédent à un rapport
,
grammairiens Arabes que pour
ïes noms qui indiquent le temps ou les portions du temps d'une
manière vague et indéterminée. J'ai pourtant observé quelques
exemples en petit nombre d'une semblable syntaxe dans les
quels l'antécédent n'est point un nom qui signifie le temps.
C'est ainsi qu'on lit dans ma Chrestomathie Arabe, r. 1 p. 11
d'annexion
,
n'a lieu , suivant ïes
,
,
,
,
,
,
comme
l'ai fait observer
je
*iùf y^LÂ.
de même
l'intention
feignant qu'il étoit
1.
,
1, p. 41 j
qu'il s'abouchât
N.°
enfin i o^é <->£>>**
N.°
Voyez^
f.
ioy
:
avec votre
mort
naturelle; On
144,
ligne
cjjj^ -o^j
<j**j>
dans
cjjj.**»-»
tx_Jj
l'Alfiyya,
10.
ou
l'esclave de Zéid
sur
est
J.I.*Jf
frappé.
17 et 18.
man.
de S. G. n.°
30O. Page 178, ligne
,
avant- dernière.
Par rapport à la manière dont les verbes admiratifs
à leurs complémens objectifs , c'est-à-dire , aux mots
rivent
4<£$
recto.
N.°
roient
jl^iif
trouve
ministre susdit.
282. Page ify, lignes
le commentaire
,
II; p. 37 , ôt-« *.^f
jjâ=>ùJL] fZU&s» £• jjA? ôf
cJ*J\
o^.j
t.
décédé de
241. Page
On peut donc dire
ou
,
,
ibid.
joignent
qui formele complément médiat ou immédiat du verbe duquel dé
les formules admiratives, voye^ ce que j'ai dit au n.°432
se
,
46z
ADDITIONS.
p. 24.9,
note.
à
Si l'on
trouve
n'est pas
formules
complément
complément objectif, mais un
après
ces
un
l'accusatif,
complément spécificatif ou un terme circonstanciel, comme dans
cet
exemple (n.° 297) *JUw l£> Vs£=>f dont le sens littéral est,
elle seroit très- ex ce IIente en fait d'amitié.
ce
un
,
,
,
N.°
33p. Page 198, ligne 20.
c.
Pour
Jl^J f j
plus
d'exactitude
par contestation
,
sur
j'aurois dû
le droit de
traduire les
mots
3
&jL_Q
régir.
Page 346 ligne
13.
,
§. VI. Construction des Noms avec les Adjectifs
et les Articles démonstratifs.
638
adjectifs
bis.
Lorsque
forment
les
noms
sont en
seule
concordance
de la
avec
des
partie
proposi
l'attribut,
sujet,
complément quelconque,
on doit
placer les adjectifs après les noms avec lesquels ils con
cordent. Si le nom a un complément l'adjectif se place après
le complément. Ex. ^xâ o&"" un vieux livre; A-k^f À»f ouè»
le respectable livre de Dieu.
Au contraire les articles démonstratifs se placent avant ïes
noms avec
lesquels ils forment une même partie du discours.
:
Exemples 4>UCJf fj«* ce livre; ïjÛJ\ tAtecct arbre ; o^f cîlfS
£Jy£\ cette maison ruinée.
Cependant les articles démonstratifs se placent souvent après le
nom avec
lequel il est en concordance. Exemples : f ji> ICljUé»
ce livre qui vous appartient; \à& tij-4^ j dans ce mois où nous
sommes; dfiiu-J* j dans sa noce dont il vient d'être parlé.
tion
,
,
et
soit le
ou
avec eux une
ou un
,
,
FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS.
TABLE
Des Mots
ALPHABÉTIQUE
techniques
de la
*
grammaire Arabe
contenus
dans la seconde Partie.
c\Jj\ Page 45 (note).
j^jjjokf
127
(note).
Slllî
164.
«s
if}* J f ci ^fj-i f
et
51-
«ULaIÎT îif
i<56
432-
81.
108, 295.
jjaàJ 299.
(jlP'ofjà.f
3<*4-
k^ua fi\jai>\
fcjjUa.f 382.
•eLé^Àf
fj
U35-*
«-i Lit
460.
(note).
*UjJCwf 315.
jLi'Làx*f
*
JçUff j*l|
II, f
^)f j«»lf
88
w
fj
'
•
*
'
'
1
»
-,
•
,
141.
Jj*îlif
f
'
79.
#/</.
(note)
cjfj-âj 449.
.
422.
oJaii uy <i
84.
fûJ*^
*wf
JUif
173.
<#JCJf^ esllff "JUif
57-
yl? ^J
*UiVf
j*-*.! 439*
JÏÏrcjUÎÎ23<J.
ojiïJf :tlt**î
"9-
4J9.
439-
j».0wflj ~£CÎf tlUjf
43T-
us
/Wy
4^4
TABLE
pjULLtf ^JUif
JUsf
iLÂ-di"
DES
MOTS
43^-
*73»
TECHNIQUES
SfôJUJf 96'
t^-^*^
236.
LifU ^JUiT 434-
z36» 44°-
lè-dlT S^î° 447 (»ote).
mm.
Aî/f 32,236, 440,
lsy**^-iï j^-*^^
Um^' 396-
à.fj y
J*GJf iuiyu 98
(«ou).
c*fà\yj\ çM^=>f
Ï91-
422.
JuvjLÂiî 38a.
J-*-* ^7» 96«
J.5J
J-'^Jf J
**;•
JCàsV f tfoô
«JLff
48 ^»W= 394.
(jUlif ^* JJj
276.
^jUi
'98-
^jfjj- 207, 383.
i&J&tt <JJ^ J*
-_jb 47 f«<*fA 4oa-
y*-
JjJ
JL5>^j 3^
^'
lojJiii\ *fjâ»
32»
çjb' 433-
oJ=y>
iJJÀ
*jL' 405 (note).
94-
43'
IhÊ <^
4«^ *^£
8'
piifj o^llff ^ ¥y£ ibid.
*ÏJM> «^
3°3-'
^4 /#</.
<iiyT of i
£kJdlf Jjtjiîf g*'
113
■
*-U* 81, 379.
442.
cjifjj'
38o«
(note).
tplLLtf ivàjj"
i^Jvff ibid.
79»
*^J^ «X^
^i^*?
38°-
'
«i? 8 3 («ote
82,
«-^ 81
,
380.
380.
otjijffj* fpâ
ly *Ii
DE
LA
4^5
ARABE.
GRAMMAIRE
*)j^f C^/j* $ j#*ûUr J^TjL_Lu}fc>^r
il-»Ûf
453-
if
:
I
^
*..*
'
t
«Jl^A-^iJ
»
-
*
3
tj—^sut
—
\\M',f 3.i,j\f
'..3
L>-
«
jj-f
3
JuV^Ij *#iCif c?jj*i
c^tjdï ^jH^
445-
*
419.
4*f«
l86-
'
**„
•&
«
*fj-^f ofj^
376 W
AxJVf
44°.
jfjâ»
UJCLX
^»U.
\$&U*
Jlâ.
76.
406.
^82.^
<L)y*xl\ j^f
64.
L?j*y*U ^4*^-*' Jl* 403'
Ljj*yl\ Jlar /&*£
t>^ J-^"
cjUi^t c>^
û^J~^-
36l«
#/</.
422.
O^jjj t-il/ <j
iibu_if ci>^» 7^«
*fjjjf cij-â.
et
361 fwort'/
f^J^
k
i
iéo.
,.
jwjcl-cto 4°4«
'!i^i ofjâ. cJ>» 3°J^* <i>* 87 f»o«;.
^JlçUJf
ij__îitf.>vf j,i_i.,uff c>^f
sjl^f 421'
&y&
^iîfwvfj ULùTci^f
jiif^u
fcU*l J? *A*UJI
~
-
I->T l'-îf
3*f
cijj-il
•
•jV-^l JiiJl J
«—
3
-T
l-ïf
«J-oWf
,
421.
■»
•'■'Vf
Ojj-^l
586.
32.
*^?J,,i
jÔJÏo
J
164.
j^jjj <^l^û
ju^slUf 4243-,Af
439*
*^[) a77-
«-■*•-.
.
>*»
84.
>* cjl>* 94*
J\»j\f
4°7«
382.
3.$7
-
34«.
(note).
S.t'J*?
*..£*«>* iÙJUo 142.
"!•-
3
cJT
cijO^S ciy-'j-*
.
$"-
*Xf 278.
430.
//.' PARTIE.
.
*-*•? '5* (»*"/•
Gg
466
TABLE
0VrfàJf jm~o
445,
J^fiJ f
DES
MOTS
dji y#s.
87.
>^«
TECHNIQUES
Jl^îxl^ ^
O^J-iî LJj&
96-
^$1 ci
yXLlll cijii
ibid.
Jrjî-tt ci
3*3 cij&
5"..
-
5
^
•
yg
ztf
88
»
ci 24.
ci
^
24-
335
f»^.
o4â*M £!■**
395.
l»}ijf Jii
225.
17<î-
431.
^UdT j^JfT 404.
87-
1^404.
^5^435.
LVj^
JUUifiU;^ 388.
384.
*ît>~JvAjf J
JS
*Xifi
/-4^!j439*4^f cMï*
*-*y**
3
ô-^y
384-
384» 441»-
J *fl£
*^?l*9
f&
4°4«
81, 379.
«4*^
.juôjV
42.
277.
'
*,.oo
**WÏ
#*£
t^lLàs ibid.
«Xii
224.
#"£
'#"*•
c^11 ci
(note).
ci-^é
25.
c^Tj *léiD ci
422*
('«'«A
<->j>*f ci^»
i^ç
'°5
JlU
yuyf ci^
gj^/Jf
ibid.
*lcÔJf ci
'5-
c£aJ J-0^
24.
'"'-»
-
(/r^«»* CijiJ» '^
t)Uj ^f qIC' cjj^
J^l»
JsàU
38 1 f»**/
e
277.
„
277-
tîvùbJf jj^ili j^è 186.
J
^îV43P.
j*}
p.
DE
LA
llfi ,kj 442-
fciijâ
»yzj\ jjj
I^°»
(_>-*-«*<•
(^_jçw 386.
277.
U 362.
CLjfj
422.
cJj-^J-i'
42«
K-3&J
4^7
ARABE.
GRAMMAIRE
^JÛLif 316,383.
jtiUs» U 53.
-jji-tf
jL-oJLll
tfâ/.
Jj-S
-r.îr*
*J2ULjoJu U 41*
y^ jjJb
»fjJUvO
ïîù**
#&/.
82.
tS»
224, 402.
'«jôâsî^llf 176,383.
448»
L*
t£*-"M
<>*?
(,jÔ.j_lf
$7.
o^illf
JU*««
U
J^j-^ 0*^-^ (^xJLJL\
Jj&Llf
fcU.f
«AkX» 422.
*lé
js'fjLj#32.
jS*L*
£><obJf cO^-^
.
«22
l8^»
^»o/^.
79*
'^
ibid.
**$
i64-
énotf)-
j4^ jô+*+
]^ jjJai
,29*
/&</.
'
331.
^«yt» 1*£ >^#JÎ a83«
110.
J»j-2âJÎ
-
.
-
c5j<Va-« 139.
Xjô 44»«
jja-^
c*^î
£
-
jj**^
316,425.
^»-*llf
»95-
«JjJL-i- 384.
eJ>y£& £$***
i*7"
^f£ ^Li.
331.
^y>î pj^«
43 '■
ibid.
L^ÂxJu..tf
8r.
tXÀnîw*
£j\ ojJLa
J
if
^0 ol*-^ltl
cA*A*a—tf 383.
$
J.*tX
qX—A^VO 386.
ibid.
CijjJfi
J-'^-M (Jj&âJil
JkAJ
ol»^-if
4*5*
Gg2
/^/</«
46%
TABLE
fin c>i^
108.
^X>
DES
435-
387.
402.
Jj «^f^ J^-w^lf *JuQii
—
4°3»
o^ff *iuLki
tf#
ixlVf jjjf
^f^^uf ^
j_£. o^Li4'0'
o^ 409.
Jp^f J^ 0^1*
JXif ci^i J^
JUs^f
c«>
pj 'j ^^ÎJ^CM ibid.
Jçûf iU;"pii]f ;yktf 405.
Jj«iu
au
JeUffj Jiiff liuU^
o^Ufj
388.
JJf Jjiiu
ibid.
0~*JLm j^àjk
94»
£UU
4oJ (note).
J^Cj^lji
TECHNIQUES
4****
y^j\ y^> K-*é$yjàZ
fuH
MOTS
409.
**^
4'°.
cJ^ ddiâJi
ibid.
96.
/#</.
^y*jyi xj'J^î; 39i.
qU' J^Jti*
96.
4.y> JL*Ju
94.
-^ *A ,&. mj.
«^
*Jy*ï 96.
£J l)^L ibid.
fc3
iiu^ii.- 96.
^ Ot î)j&* ibid.
j£j
$7,9$.
<>ï.3
OjuJW 109
y*-*
p^4 oi*«4'tf.
*^/~y
i>j
cjSQiir 76.
95-
95* 343-
*5^; 427.
oj^' 395.
ij^r 80.
«^Ac
«JLjLa* 425.
cij-k**
wdT.
<*^,
y^yi\ (j^
£->**
61
42^
4L ylîllf
<w,j.
^
243.
e
«<*
*lijVf 443.
416.
JJÛr^
122
^w;.
DE
"J&J ljy°y
LA
oilif
393-
(Jf** i^Jyoy
ibid.
y*£\ y^\ py°y
jVÂ-j Ai^f j-iôJ
frf+*
0^»j./t
228
(note),
JcUjf
qS.
<y->UJf
224.
(J^-' t^-J
436.
ij~aA
ARABE.
GRAMMAIRE
392.
99.
'^'
Ibid.
56'424«
JU. J^J
ibid.
*\i>>&v f
«-^fy
«^«fyjf
£j*^
Oj
29.
9^-
jfj
46-
4*1-
4&9
ERRATA
DE LA SECONDE PARTIE.
Malgré l'extrême attention que l'on a apportée à la correction de cet ouvrage,
il s'y est glissé plusieurs fautes, que l'on a cru devoir indiquer ici : elles
sont, pour la plupart, de très-peu d'importance, et elfes auroient cer
tainement échappé à l'œil des lecteurs ; mais l'Auteur n'a pas voulu
qu'elles pussent arrêter les commençans.
Pag.
Lisez
Lîgw
24-
dern.
27.
"3-
33-
17-
34-
3-
35-
8.
37-
13.
47.
dern.
O-JJ
ôij
A-iJ
[3
"jM^
X
—
a,_*J^f
£—^Mt
•
•
50.
19.
56.
3-
60.
3-
:
C
O
-Jj-a»
«
*
rO
(2LU
*
-
61.
i4-
63.
ai.
65-
1.
66.
6.
67.
»7.
7i-
*5-
cfr*
72.
"J-
LiL^i
Exemples :
Autre
exemple :
c*-
fil
fit
*
1
-
Pag. Lig.
finale
75-
*3-
78.
21.
91.
16.
S-*J
Jbid.
26.
lu
210.
28.
113.
26.
^-^!i
119.
23.
1
121.
lî-
126.
15.
129.
19.
J35-
1.
»37-
3-
140.
20.
154.
*3-
.»
Cyfj
•**
J
3
ci*
/«O
4&UI
—
i .3
t^* t)l^*"'
*
Ze/rf don* le père
est t\
ûd ,
son
dire,
152.
1.
169.
23.
177.
»3-
182.
12.
Ibid.
21.
185.
23.
187.
17 et
190.
dern.
193.
'3-
d
3-
0ji-^-
\jù$\
père
est
tué , c'est-à-
le père de Zéid
est
Â-Jl
_J<>
*
YoÙ
ï
Là.
£-»Lp*
fe_*ljjf
jl£Lj3Û
la.
V*^J
O—
*-?j
oïl»
-Jiï
UJ^J
t)il-»J
tué.
472
Lisez
Pag.
Lig.
205.
20.
éu-£»U»
206.
6.
<^
209.
5-
fondamenta
216.
7-
'Lui
217.
6.
Jj—**
223.
28.
jdXlj'lg-of
227.
1.
O-Jlj
o—
di
dit
Ibid.
25.
231.
1.
232.
14.
243.
7-
Ji=>
ni de
*
£j£I
22.
a7i.
dern.
272.
4.
274.
9-
281.
4-
U^Jf
291.
30.
ciM
293.
8.
de rien
Ibid.
14.
3^1
29.
ni de
^p-f
J—ij
258.
334-
"Jjèi
JIj
cW
14.
301.
•
*'JJJ
**
257.
9-
-f
y
4-
2.
fondamentale
^
251.
297.
:
Uf
*_àLÎLi
# :
o—
->J
o~H
(n.°* 894
ne
et
suiv.)
*UJf
ciî
»
—
de
ne
J
rien
wl
(n.os 894 et suiv., //'/r.)
seroit -ce pas
'
*i
Vf
.s
339-
Pag.
Lisez
Lig.
•
*
:
*
f<>-4j
339-
12.
357-
21.
#Lûut
»L_îcwl
375-
10.
femme
homme
379-
30.
A. Schultens.
H. A. Schultens.
388.
6.
390.
2.
IL_cU*
Ibid.
20.
MA
392.
22.
Ibid.
25.
410.
26.
418.
23.
421.
1.
*~>y-*~
rJL*ii
#
i/1
L-'xlr-
-
Ol/"
-
-
.
Uif
cjjL-»
ÔjL-9
iL-Â'o' *.'o
à
un
pronom
,
à
un
a.
compléme
'
422.
7-
425.
18.
427.
3«
429.
1.
Ibid.
10.
t-tfj-*!;
li_xltf
*
/// PARTIE.
-
i>
=wlt
—
précédé
jLÂ^UJf
privé
iL-^Ujf
Hh
IMPRIME
Par les soins de J. J.
impériale,
Marcel, Directeur
Membre de la
Légion
de
l'Imprimerie
d'honneur.
Suite du
Catalogue
fonds
et fils.
Tableau des maladies de Lommius
le corps humain, trad.
de De Bure père
des livres du
en
,
Description
ou
françois
des maladies
qui attaquent
par le Mascrier. Paris, iypz, in-iz,
broché.
2
fr. 50
c.
chronologiques de l'histoire universelle sacrée et profane depuis la
création du monde jusqu'à l'an 1775, par Lenglet du Fresnoy; nouvelle
édition, corrigée et augmentée par Barbeau de la Bruyère. Paris 1778',
Tablettes
,
,
gros vol. tn-8." ,br
Traité de l'Orateur de Cicéron, trad.
2
duction ,
des
avec
notes
,
1
en
françois,
par i'abbé Colin
le
texte
vis-à-vis de la
4.c édition. Paris
;
,
180 /
3 fr.
tra
in- 12 ,
,
broché.
3 fr.
Variétés morales
tirées du
Spectateur et autres livres Anglois de
traduites
ce
l'abbé
Blanchet.
Paris, 1784, 2 vol. in-12 br.. .5 fr.
genre,
par
Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761 par i'abbé Chappe-dAuteroche. Paris, 1768. 3 vol. in-j..' très-grand papier avec po fgares en tailleet amusantes,
,
,
,
dessinées par le Prince et très-bien gravées , représentant les
usage* mœurs
des habitons, et les vues de ce pays, avec un Atlas de U Russie et de la Sibérie ,
douce
,
,
fr.
qui fait le quatrième volume ; en feuilles,
Voyage pittoresque de la Grèce, par M. de Choiseul-Gouffier. Paris, i8op
tome II,
carton
60 fr.
première partie tu fol. allant, fg. br.
Vues en Egypte d'après les dessins originaux en la possession de Sir Robert
Ainslie, pris durant son ambassade à Constantinopie, par Louis Mayer.
Londres, 1802, in-fol. maximo papier vélin, avec 48 planches supérieurement
1 00
,
en
,
,
,
peintes.
Flora Danica, auct. GEder et Mart. Vahl. Haunice,
cicule 23 cum 1 j8o figuris 8 voi. in-fol. fig.
,
Idem opus ,
Cet ouvrage
1766
et an»,
sequent, fas
,
cum
est
figuris depictis.
d'une très-belle exécution.
Sexti Julii Frontini Strategematicon libri très Strategiçon liber
sione J. Valart. Lutetiœ, 1763 in-12 papier de Hollande
,
,
,
unus,
ex
recerj-
3 fr.
Lysise Opéra omnia, gr. et iat. cum versione nova et notis, edente Athanasio
Auger. Paris, Didot, 1783 2 vol. in-<f.° ch. mag. papier d'Annonay en
feuilles
72 fr.
Isocratis Opéra omnia, gr. et iat. cum versione nova et notis, edente eodem.
Paris Didot, s7 82, 3 vol. in-fS ch. mag. papier d'Annonay en feuilles. 108 fr.
,
,
,
,
Antboiogia Grseca,
Idem opus
Idem opus
,
Hugone Grotlo, édita ab Hieinrj..0
versibus Latinis reddita ab
rpnymo de Bosch.
Ultrajecti
in-*}..0 ch. mag.
,
?7Pf , 4 vol.
in-fol. ch. mag.
Apoilonii Sophiste? Lexicon Homericum,
,
Villoison. Lut. Par. 1773 2 vol. in'4..0
Idem opus 2 vol. in-fol. ch. mag, id.
,
gr.
en
et
Iat. éd. J. B.
dAnsse de
Casp.
,."..' gU,
feuilles
Idem opus ,
2
vol.
Sophoclis Tragcediae
ch.
in-fol.
,
gr.
et
max.
Iat.
.12
«...
,
id.
cum
scholiis veteribus
ac
novis
fr.
24 fr.
36 fr.
edente
,
Capperonnier. Paris, 178 1 2 vol. in-*f.° en feuilles
24 fr.
Musaeus, de Herone et Leandro, gr. et gall. ex versione D. Dutheii. Parisiis,
2 fr.
178^., in-12 avec une jolie figure
P. Virgilii Maronis- Opéra, cum notis Chr. Got. Heynii. Londini 179], fvol.
grand in-8." papier vélin
84 fr.
Lbngi Pastoraiium de Daphnide et Chloe libri quatuor, gr. et Iat, ex recensione
et cum notis J. B. C. dAnsse de Villoison. Parisiis, Didot,
1778 2 tom. en
J.
,
,
,
,
1
vol. in-8." ...'.
1
j Fr.
Opéra omnia, edente Ludov. Dutens. Geneva, 1768,
6 vol. in-4,0 fig. en feuilles.
42 fr.
De Re diplomaticâ libri sex, operâ Joan. Mabillon. Lut. Paris. 170p. in-fol. fig.
L&rorum de Re diplomaticâ supplementum, auct. Joan. Mabillon. Lut. Parisior.
1704 in-fol^ avec beaucoup de planches.
Le supplément se vend séparément
24 fr.
Anecdota Grseca, è regiâ Parisiens! et è Venetâ Sancti-Marci bibiiothecis
deprompta, edente J. B. C. dAnsse de Villoison, Venetiis, 17b'/ 2 vol. in-f.*
Idem opus 2 vol. in-fol. ch. mag.
God. Guill. Leibnitii
T
f
,
,
Opère 3el signor abate
avec fig, br. ....'...
Les
mêmes, in-8.°
Les mêmes ,
12
vol.
Pietro Metastasio. In
Parigi, 1780
,
12
vol. gr. in^S,*
90 fr.
*
fin.
in-j..' pap.
pap.
Cette édition est
240 fr. j
de Hollande
les
papiers.
superbe
îlDeeamerone di Giovanni Boccaceio. In Londra
in-8.' papier de Hollande,
sur tous
avec cent
(Parigi), 17S7
figures dessinées par Gravelot, br.
,
S
vol. gr.
....
.40 f.
Très -belle édition.
Il medesimo Decamerone. Londra
Cette édition
même que
de Grayelot de l'édition in-8."
est la
ce
,
178P,
3
tom. en
lie de la collection
,
6vol. in-12, fig. br.
à
laquelle
on
a
joint
...
les
24 fr.
figure»