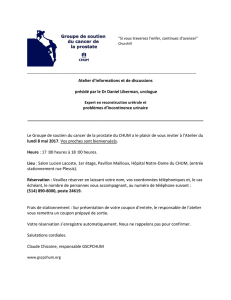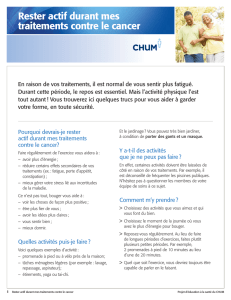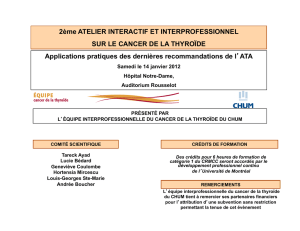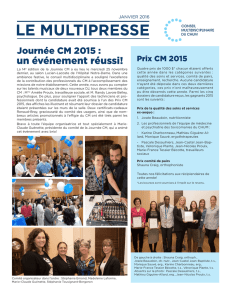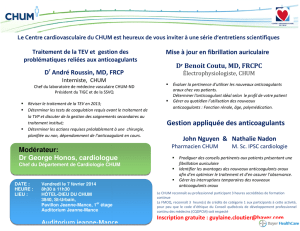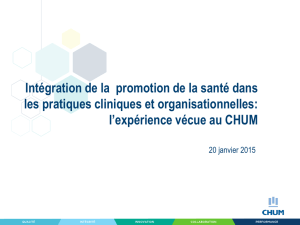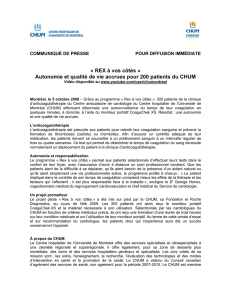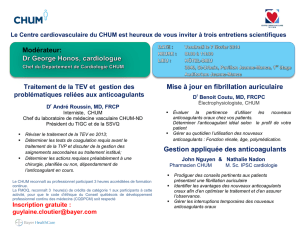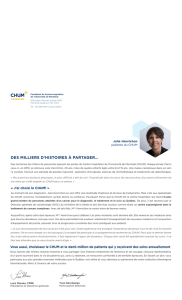le donataire - Fondation du CHUM

DONNONS-NOUS
LE MEILLEUR DE LA SANTÉ
LE DONATAIRE
BULLETIN DE LA FONDATION DU CHUM
Envoi de poste-publication, numéro de convention : 40051592
SGS-COC-2844
LA CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE
Le donataire est publié par la Fondation du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
500, place d’Armes, bureau 1405
Montréal (Québec) H2Y 2W2
Tél. : 514 890-8077 ou 1 866 DON-CHUM (366-2486)
fondationduchum.com
Rédactrice en chef : Élodie Grange
Rédactrices : Mariane Bouvette,
Raphaële Bourgon-Novel
Collaboration : Sandra Aubé
Conception graphique : Julie Sangollo
Crédits photos : Production multimédia - CHUM,
Shoot Studio
Révision : Marina Badani, Nicole Rivard-Royer
Donataire : organisme qui bénéficie de dons
ou de contributions de la part de donateurs.
Source : granddictionnaire.com.
SSN 1920-972X Le donataire
Août 2013
Volume 6, numéro 4
Renseignez-vous sur notre vaste choix
de soins en téléphonant au
514 890-8323
ou en visitant
cliniquesfchum.com.
POUR SE DONNER LE
MEILLEUR DE LA SANTÉ!
BD134
OUI,
je veux appuyer le CHUM et ses patients en faisant un don de : $*
Mode de paiement (s.v.p. ne pas envoyer d’argent comptant)
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Fondation du CHUM Visa MasterCard
N0 :
Exp. :
Signature
(obligatoire) :
Nom :
Adresse :
Ville : Province : Code postal :
Téléphone : Date de naissance (aa/mm/jj) :
Courriel :
S.V.P. nous faire parvenir votre formulaire dûment rempli avec votre don à :
Je désire que mon don soit anonyme
Merci de votre générosité !Numéro d’enregistrement : 88342 9961 RR 0001
FONDATION DU CHUM
1405 - 500, PLACE D’ARMES
MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2W2
*Un reçu officiel de don sera émis automatiquement pour les dons de 15 $ et plus.
ROCHE OCTROIE 100 000 $
Yvon Deschamps
Porte-parole bénévole
de la Fondation du CHUM
NOUS SOMMES
PRÊTS
Tous les profits des Cliniques sont
versés à la Fondation du CHUM!
La « rentrée » se vit de façon toute
particulière au CHUM cette année. Elle est
synonyme de renouveau, de découverte,
de synergies.
Au cours des prochaines semaines, nous
aurons en effet en main les clés du Centre
de recherche – comprenant également
le Centre intégré d’enseignement et de
formation (CIEF) et la Tour Saint-Antoine.
Débutera alors le déménagement de
plusieurs équipes dans ce qui s’avère
être la première phase du nouveau
CHUM. Nous sommes extrêmement
enthousiastes.
Déménager est une expérience en soi.
Lorsqu’on déménage des laboratoires,
que l’on installe un centre de simulation
ultramoderne, le défi est encore plus
grand! Mais nous sommes prêts.
Des activités d’accueil ont d’ailleurs
été préparées à l’intention de notre
personnel, qui découvrira petit à petit
son nouvel environnement de travail,
des aires intelligentes favorisant la
collaboration.
Chers donateurs, nous avons hâte de
vous faire découvrir nos nouvelles
installations, qui contribueront à faire du
CHUM et de la métropole des références
dans le domaine des sciences de la vie.
Et qui, concrètement, contribueront
au mieux-être des Montréalais et des
Québécois.
Merci d’être à nos
côtés dans cette belle
aventure.
Ensemble, nous offrons les meilleurs soins
à nos patients. Nous le faisons dans un
cadre intègre et profondément humain.
J’avais envie de partager avec vous un
témoignage qui m’a profondément touché
parce qu’il s’agit d’une véritable histoire de
courage et d’une impressionnante leçon de
vie. J’aimerais vous présenter Sandra Van
Tassel, une sympathique jeune femme qui
malgré un parcours difficile, célèbre chaque
moment de la vie. Voici un résumé de son
histoire :
Sandra a reçu un diagnostic de la maladie de
Crohn à 13 ans. À 18 ans, elle est transférée
au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) pour soigner cette maladie
inflammatoire chronique intestinale qui
touche à peu près 27 000 Québécois, dont
11 000 jeunes de moins de 25 ans. C’est alors
que commence une série de rencontres avec
plusieurs spécialistes du CHUM en gastro-
entérologie, en dermatologie, en chirurgie
digestive, et j’en passe...
Pour Sandra, les années qui ont suivi ont été
parsemées d’obstacles. Pendant près de 15
ans, elle a été confrontée aux symptômes les
plus difficiles de sa maladie. Elle a subi plus
d’une vingtaine de chirurgies et a également
développé une forme très rare de cancer, un
adénocarcinome. Malgré tout, Sandra a gardé
une confiance totale en son équipe soignante,
qui a travaillé d’arrache-pied pour trouver une
façon d’alléger ses souffrances.
À travers toutes ces épreuves, elle est
reconnaissante d’avoir pu côtoyer des
professionnels qui ont donné aux soins qu’elle
a reçus un côté très humain. Elle n’hésite pas
à dire que les équipes du CHUM lui ont sauvé
la vie, grâce aux technologies de pointe à leur
disposition, mais aussi par leur dévouement.
Cela fait maintenant cinq ans que je suis
porte-parole bénévole de la Fondation du
CHUM et je suis toujours aussi ému quand je
rencontre des patients qui, du fond du cœur,
me racontent comment les professionnels
du Centre hospitalier ont fait une différence
dans leur vie. À plusieurs occasions, Judi m’a
accompagné et chaque fois nous ressortons
de ces rencontres grandis et convaincus que
chaque jour, les professionnels du CHUM
donnent le meilleur de la santé aux patients.
Je suis tellement fier de m’impliquer au sein
de la Fondation quand je rencontre des
gens si inspirants. Votre soutien et votre
engagement font une différence dans la vie
de Sandra et de tous les patients du CHUM. Il y
a un peu de vous dans chacune des initiatives
que la Fondation accomplit pour son centre
hospitalier. Merci de votre générosité.
Pour connaître la suite de l’histoire de Sandra
et voir le témoignage que son médecin, la Dre
Carole Richard, nous a accordé dans le cadre
de notre campagne majeure de financement
Donnons-nous le meilleur de la santé, rendez-
vous au fondationduchum.com.
UN TÉMOIGNAGE UNIQUE, UNE
HISTOIRE INSPIRANTE
Le Département de pharmacie du CHUM a souligné plus tôt cet été le lancement du premier
programme de résidence spécialisée en pharmacie oncologique au Québec. Une première
rendue possible grâce à la collaboration de la Fondation du CHUM et de la pharmaceutique
Roche qui s’est engagée pour 2 ans, à hauteur de 100 000 $, à soutenir la surspécialisation
en oncologie de pharmaciens au CHUM.
Mme Marie-Andrée Fournier est la récipiendaire de la première bourse postdoctorale octroyée.
Déjà titulaire d’un Pharm. D. et d’une maîtrise en pharmacothérapie avancée, elle effectuera
une résidence spécialisée en oncologie d’une durée d’un an au cours de laquelle elle travaillera
en collaboration avec des patients, médecins, infirmières et autres professionnels en hémato-
oncologie, gynéco-oncologie et chirurgie oncologique au CHUM. Au long de cette année de
spécialisation, Mme Fournier fera également un stage d’un mois en oncologie pédiatrique au CHU
Sainte-Justine et un autre auprès de patients allogreffés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle
poursuivra parallèlement un projet de recherche intitulé Évaluation du protocole de traitement
de la neutropénie fébrile au CHUM (diminution de globules blancs à la suite d’un traitement de
chimiothérapie entraînant un risque d’infection élevé). Toutes ces activités seront encadrées
par l’équipe dynamique de pharmaciens chevronnés en oncologie du CHUM.
Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’enseignement est omniprésent. En effet,
il reçoit chaque année le plus grand nombre d’étudiants au Pharm. D. et de résidents à
la maîtrise en pharmacie à Montréal. Centre de référence reconnu dans l’ensemble de la
province, le Département de pharmacie peut compter sur des spécialistes qui excellent
dans leur domaine de pointe. Les pharmaciens du CHUM occupent une place importante
auprès des patients, assurant un suivi de leur médication et tissant des liens avec eux en
les informant, en répondant à leurs questions et en leur prodiguant des conseils, tout en
favorisant l’utilisation optimale des médicaments.
Les patients du CHUM peuvent compter sur la générosité de Roche depuis ses débuts. À ce
jour, plus d’un million et demi de dollars ont été versés par ce fidèle partenaire afin de leur
donner le meilleur de la santé. Par ce don, Roche prouve donc une fois de plus qu’il a à cœur
l’amélioration des soins aux patients.
PREMIER PROGRAMME QUÉBÉCOIS
DE RÉSIDENCE SPÉCIALISÉE EN
PHARMACIE ONCOLOGIQUE
Denis Bois, Département de pharmacie du CHUM; Anne-Marie Rivard, Roche; Nathalie Letarte, Département de
pharmacie du CHUM; Ékram Antoine Rabbat, Fondation du CHUM; Marie-Andrée Fournier, boursière; Dre Marie-Josée
Dupuis, Direction de l’enseignement du CHUM; Dr François Lespérance, Direction générale du CHUM
« Ma vision est d’assurer
que les patients soient au
coeur de nos décisions
en tant qu’organisation
humanitaire. »
Joanne Liu
514 890-8332 / info@santevoyage.com / santevoyage.com
MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL GEOSENTINEL
La Clinique est le seul site francophone d’Amérique du Nord membre de ce réseau
international qui se veut un outil de communication et de compilation de données
sur les maladies infectieuses des voyageurs émanant des cliniques santé-voyage et
des centres de médecine tropicale.
Pionnière dans son domaine au Québec, la Clinique Santé-voyage de la Fondation du
CHUM est devenue au fil des ans la référence en matière de santé-voyage. Elle est établie
depuis 1978 et reçoit chaque année près de 30 000 visiteurs, ce qui en fait l’une des plus
importantes cliniques du genre en Amérique du Nord. Ses professionnels prodiguent soins
et conseils à tous les types de voyageurs, qu’ils soient aventuriers ou plus conservateurs,
parmi lesquels : conseils de voyage, vaccins spécialisés et de base, prescriptions et
consultations, suivis postvoyage.
Elle offre aussi un espace-boutique où les visiteurs peuvent se procurer lotion antimoustiques,
crème solaire, assainisseur d’eau et trousse de premiers soins.
UNE MÉDECIN DE LA CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE NOMMÉE PRÉSIDENTE DU
CONSEIL INTERNATIONAL DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF)!
Joanne Liu, une médecin pratiquant à la Clinique, répondra officiellement à ce titre en octobre
2013. Elle a occupé par le passé différentes fonctions au sein de MSF, dont directrice des
programmes à Paris en 1999 et 2002 et présidente du conseil d’administration de 2004 à
2009 de MSF-Canada. Ayant œuvré pour plusieurs missions humanitaires auprès de réfugiés
maliens en 1996, de victimes du séisme et de l’épidémie de choléra en Haïti, de réfugiés
somaliens au Kenya et de survivants du tsunami en Indonésie, Mme Liu a une vaste expérience
en santé-voyage. Sa nomination fait la fierté de la Clinique Santé-voyage. Nous lui souhaitons
des moments des plus enrichissants dans le cadre de ses nouvelles fonctions!

ÉKRAM ANTOINE
RABBAT
Président-directeur
général de la
Fondation du CHUM
L’AXE MUSCULOSQUELETTIQUE FONCTIONNEL AU CHUM
Chaque année, le rapport d’activité nous permet
de revisiter les évènements des derniers mois et
de recentrer nos forces là où les besoins seront
les plus criants dans les mois à venir. Nous vous le
faisons parvenir en même temps que ce bulletin,
de sorte que vous puissiez constater une nouvelle
fois notre solide bilan financier. Nos forces et
notre vision communes ont permis de remettre
cette année la somme de 8 676 498 $ pour le plus
grand bénéfice des patients du CHUM.
À l’aube de son existence, la Fondation imaginait
déjà un centre hospitalier de haute technologie
pour la population québécoise. Quinze ans
plus tard, accompagnés de nos donateurs et
partenaires, nous posons un acte fort pour la
communauté présente et à venir. À l’automne,
une partie du personnel du CHUM s’installera
dans les nouveaux locaux du Centre de recherche
et du Centre intégré d’enseignement et de
formation. Et ce n’est que le début!
Les dernières années ont été particulièrement
denses. Notre plus grande richesse est de vous
savoir à nos côtés puisque, bien que nous ayons de
grandes aspirations, des projets ne peuvent voir le
jour sans le soutien de nos donateurs.
Permettez-moi également de vous partager,
au sein de cette chronique, le regret de la
Fondation du CHUM devant la perte d’un grand
philanthrope, vice-président de notre campagne
majeure de financement, M. Luc Beauregard. Il
sera certainement manqué par ses pairs de
l’univers des relations publiques pour lesquels
il fut un véritable mentor, mais également pour
la source d’inspiration qu’il a pu insuffler grâce
à son engagement social.
RÉSOLUMENT
TOURNÉS VERS
L’AVENIR
Plus que jamais, nous
sommes mobilisés autour
de ce projet de santé et
de société que constitue le
CHUM. Nous demeurons
tournés vers l’avenir!
L’axe musculosquelettique fonctionnel est l’un des cinq axes de spécialisation
adopté par le CHUM à la suite d’une planification stratégique tenue en novembre
2011. Moins connu du grand public, il englobe des maladies pourtant très
répandues, comme l’arthrose, l’ostéoporose ou les maux de dos. En plus de cela,
les professionnels du CHUM prennent en charge l’ensemble des pathologies ostéo-
articulaires, la physiatrie, la rhumatologie, de même que la chirurgie de la main.
Les brûlures graves font également partie de cet axe, car le centre hospitalier est un
Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves et les personnes qui y sont
soignées ont accès à une équipe de plusieurs professionnels, dont : chirurgiens
plasticiens, intensivistes, psychiatres, doctorants en psychologie, travailleurs
sociaux, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes.
Le CHUM et le Centre de recherche se distinguent, en outre, en étant les plus
importants centres de formation de médecins et chercheurs cliniciens en
rhumatologie au Canada. Les patients sont ainsi traités par d’éminents spécialistes
ayant accès aux technologies les plus avancées, notamment en ce qui a trait à la
biomécanique des articulations et à l’imagerie biomédicale.
Les chercheurs de l’axe musculosquelettique fonctionnel et le Service de
rhumatologie du CHUM œuvrent en collaboration avec plusieurs organismes
pour promouvoir l’importance de la recherche sur ces pathologies, ainsi que
l’éducation du grand public et des patients quant aux nouvelles méthodes de
diagnostic et de traitement.
Le Centre d’expertise provincial en
réimplantation et revascularisation
microchirurgicale d’urgence (CEVARMU) du
CHUM est un centre d’expertise qui accueille
toute personne victime d’amputation
traumatique aux membres supérieurs. Il est
le seul centre du genre au Canada et l’un
des seuls en Amérique du Nord. L’expertise
unique des professionnels qui y travaillent en
font une référence pour l’ensemble du Québec.
Sa mission comporte trois volets : les soins, la
recherche et l’enseignement.
Tous les Québécois ayant besoin d’une
réimplantation à la suite de l’amputation d’une
main ou d’un doigt, ou de tout autre accident
empêchant la circulation sanguine dans un
membre, ou encore de dévascularisation
nécessitant de la microchirurgie sont, depuis
2004, transférés au CHUM. Cela permet de
diminuer les délais de prise en charge et de
chirurgie et de standardiser un protocole de
soins. « Dès que l’accident survient, le patient
a un délai de 6 heures pour arriver au CHUM
et subir sa première opération. Le transport
doit se faire très rapidement », explique le
Dr Patrick Harris, chirurgien plasticien et
directeur du Centre de la main, qui pratique
également au CEVARMU.
La réimplantation se déroule habituellement
en plusieurs opérations, une première pour
remettre le morceau amputé et plusieurs
chirurgies secondaires, qui varient selon le
type d’accident et la guérison de chaque partie
touchée. Même si l’équipe du Centre réimplante
dans 99 % des cas des membres supérieurs
(bras, mains, doigts), il arrive également que la
microchirurgie soit nécessaire pour réimplanter
d’autres organes, tels l’oreille ou le nez.
Le LIO est un laboratoire multidisciplinaire international qui est associé à l’axe musculosquelettique du Centre de recherche du CHUM
(CRCHUM), en plus d’être affilié à l’École de technologie supérieure (ÉTS). Sa mission première est la recherche et le développement dans
plusieurs secteurs des hautes technologies de la santé, particulièrement dans les domaines de l’orthopédie, la physiatrie et la rhumatologie.
L’équipe du LIO, avec à sa tête l’ingénieur Jacques A. de Guise, est constituée d’une cinquantaine de professionnels, de diverses
disciplines telles l’ingénierie, la chirurgie, la physiothérapie ou la kinésiologie. Ils œuvrent sur une trentaine de projets de recherche.
Le LIO est également depuis un an le premier laboratoire au monde à se conformer à la norme ISO 13485, qui précise les exigences
des systèmes de management de la qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux.
UNE RÉFÉRENCE EN AMÉRIQUE DU NORD LE LABORATOIRE DE RECHERCHE EN IMAGERIE ET
ORTHOPÉDIE (LIO) : L’ALLIANCE DU GÉNIE ET DE LA SANTÉ
En plus de son rôle comme chercheur au CRCHUM et professeur à l’ÉTS, le Dr de Guise est
également titulaire depuis 10 ans de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en
orthopédie de l’Université de Montréal. Son objectif principal est de soutenir la recherche
effectuée en orthopédie et plus précisément dans les domaines suivants :
• l’imagerie en trois dimensions;
• chirurgie assistée par ordinateur
• biochimie de l’arthrose
• descellement des prothèses
• essais cliniques de prothèses articulaires et ligamentaires chez des malades
arthrosiques et de jeunes sportifs
Les recherches effectuées au sein de la Chaire permettent le développement de
meilleures prothèses ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant
besoin de soins orthopédiques.
AU CŒUR DE LA RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE
LA CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL :
L’équipe du Dr de Guise est à l’origine
d’une petite révolution dans le diagnostic
et le traitement de l’arthrose du genou,
aussi connue sous le nom d’ostéoarthrite,
une maladie qui touche les articulations
et qui se traduit par une dégénérescence
du cartilage qui enrobe l’extrémité
des os. Cette maladie dégénérative
des articulations, surtout associée au
vieillissement, affecte plus de 10 % des
adultes canadiens. Son développement
est lié au stress articulaire, comme les
blessures ligamentaires, ou à des facteurs
mécaniques, comme un surplus de poids.
L’arthrose est une pathologie complexe
à traiter, c’est pourquoi les techniques
innovantes du LIO arrivent à point pour
les patients qui souhaitent rester actifs
et mobiles plus longtemps. Pour aider les
patients atteints de cette maladie, le Dr
de Guise a créé le KneeKG : une nouvelle
technique d’évaluation novatrice qui permet
l’analyse 3D, en temps réel, des fonctions
du genou en mouvement. Un peu à la
façon d’un film d’animation, mais avec une
précision inégalée.
Comme l’explique le Dr de Guise : « À la
différence des rayons X et de la résonance
magnétique, qui offrent des images
statiques, cette technologie complète les
résultats obtenus en donnant un portrait
précis de l’articulation en mouvement. » En
plus de l’arthrose, le KneeKG permet aussi
de traiter d’autres pathologies comme
les tendinites et les blessures méniscales,
que l’on retrouve fréquemment chez les
sportifs. Lors de son utilisation, le patient
doit installer sur son genou un harnais
bardé de capteurs qui se fixe de façon non
invasive et qui permet d’analyser les signaux
issus de la captation des mouvements.
Ces informations de mouvements sont
transformées en informations utiles et
permettent :
• d’identifier les causes et les symptômes;
• de personnaliser et d’optimiser le plan
de traitement;
• de faciliter l’amélioration des soins.
Cet outil d’aide au diagnostic, conçu avec
fierté par une équipe du CRHUM, est
désormais commercialisé à l’échelle mondiale.
LE KNEEKG, INVENTION PHARE DU LIO
UNE ÉQUIPE UNIE
AU SERVICE DES PATIENTS
Le CEVARMU est constitué d’une équipe multidisciplinaire
regroupant des chirurgiens, ergothérapeutes, psychologues,
travailleurs sociaux et infirmières. La présence de chacun est
primordiale pour garantir l’accessibilité des soins, de même
qu’assurer la continuité des traitements pour les patients de
l’extérieur de la région montréalaise.
La rééducation commence tout de suite après la chirurgie et
le patient est rapidement impliqué dans le continuum de soins.
Comme le mentionne Josée Arsenault, ergothérapeute et
coordonnatrice du CEVARMU : « Nous voyons le patient comme
partenaire de ses soins, nous partageons la responsabilité du
traitement avec lui et nous avons comme but ultime un retour
fonctionnel au quotidien dans la dignité ».
Puisque 85 % des personnes traitées au CEVARMU proviennent de
l’extérieur de Montréal, le grand défi de l’équipe du Centre est le
transfert des connaissances dans chacune des régions accueillant
un patient réimplanté. La poursuite des activités thérapeutiques
débutées au CHUM après l’opération est un facteur déterminant
dans le rétablissement du patient.
UN PROGRAMME D’ENTRAIDE NOVATEUR
Les blessures soignées au CEVARMU sont toujours reliées à un
accident traumatisant pour les patients. Le projet patient-ressource
a été créé pour leurs apporter, ainsi qu’à leurs proches, un support
psychologique et social. Le patient-ressource est une personne
qui est passée à travers les mêmes épreuves et qui peut témoigner
des diverses étapes jalonnant la réadaptation qui, elle, peut
durer jusqu’à un an. « Il y a des hauts et des bas, mais grâce
à l’expertise des professionnels du Centre je peux maintenant
retourner travailler. Leur dévouement m’a permis de me sentir
partenaire de mes soins. À la fin de ma rééducation, j’ai moi-
même été patient-ressource pour aider d’autres personnes qui
ont eu un accident comme le mien », a expliqué Pascal Héneault,
patient du CEVARMU.
« lors de sa création, le
Centre accueillait une
majorité de gens victimes
d’accidents de travail.
Actuellement, les accidents
domestiques connaissent
une recrudescence. Des
appareils tels les fendeuses
à bois, les bancs de scie
et les souffleuses à neige
sont donc à l’origine de
plusieurs amputations ».
Dr Alain Danino
Directeur du CEVARMU
Le CEVARMU en bref
• 14 chirurgiens
• Entre 100 et 150 patients par année
• En majorité des hommes de 30 à 60 ans
• 140 doigts réimplantés en 2012
• Taux de réussite de 85 %
Le Dr Busson, psychologue du Centre et un patient en consultation avec le patient
Nonsenient omni ut est volorer ibusci conem rest, tem excepe el molorpore
conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae rest, tem excepe el
molorpore conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae rest, tem
excepe el molorpore conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae
Le CHUM et le Centre de recherche se
distinguent, en outre, en étant les plus
importants centres de formation des
médecins et chercheurs cliniciens en
rhumatologie au Canada.
Le Dr Jacques A. de Guise
1
/
2
100%