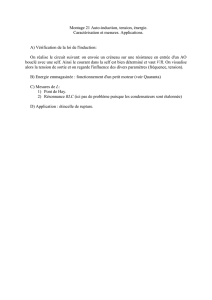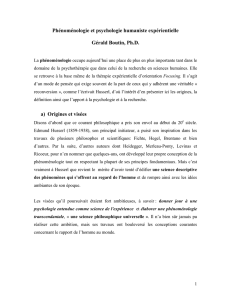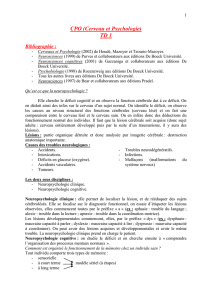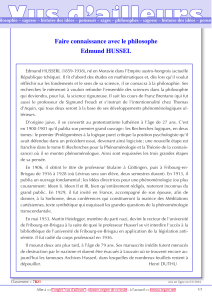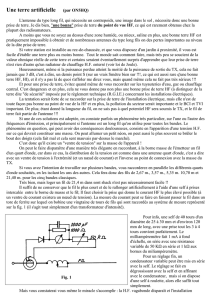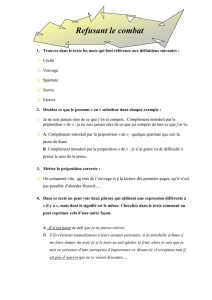Neuropsycho-phénoménologie, mémoire et self Neuropsycho

Journal Identification = NRP Article Identification = 0290 Date: April 15, 2014 Time: 10:59 am
doi: 10.1684/nrp.2014.0290
REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
11
Point de vue
Rev Neuropsychol
2014 ; 6 (1) : 11-6 Neuropsycho-phénoménologie,
mémoire et self
Neuropsycho-phenomenology,
memory and self
Marie-Loup Eustache-Vallée
Inserm, EPHE, Université
de Caen/Basse-Normandie,
Unité de recherche U1077, Laboratoire
de neuropsychologie, CHU Côte-de-Nacre,
14033 Caen cedex, France
<mleustache@hotmail.com>
Pour citer cet article : Eustache-Vallée ML.
Neuropsycho-phénoménologie, mémoire et
self.Rev Neuropsychol 2014 ; 6 (1) : 11-6
doi:10.1684/nrp.2014.0290
Quelques articles récents [1, 2] soulignent l’intérêt
d’une pluridisciplinarité fructueuse alliant phé-
noménologie et neuropsychologie, notamment
pour l’étude de la mémoire et de ses troubles.
Cette double approche est particulièrement pertinente dans
la problématique reliant mémoire et self, concepts abs-
traits et polysémiques, qu’il s’agit de mieux définir pour
comprendre les modifications dans les pathologies de
la mémoire. Ainsi, philosophie et neuropsychologie per-
mettent ensemble d’affiner l’essence du self en construisant
le profil théorique le plus adapté et pour que les études
scientifiques lui donnent un visage plus concret en décri-
vant ses changements et ses préservations lors de maladies
de la mémoire.
La phénoménologie est une méthode (et une disci-
pline philosophique) qui vise à décrire le fonctionnement
et les possibilités du sujet cherchant à connaître (appelé
en phénoménologie : le sujet transcendantal) : la phéno-
ménologie a ainsi pour ambition de mettre en lumière
les conditions de possibilité de la connaissance du sujet
humain, et d’une mémoire en lui. Cette branche de la phi-
losophie a permis des avancées majeures pour définir la
mémoire selon son mode d’apparition à la conscience,
notamment grâce à son fondateur, le philosophe allemand
Edmund Husserl (1859-1938) [3]. En effet, que la mémoire
soit un objet de connaissance pertinent pour la conscience
cherchant à connaître est compréhensible si l’on réfléchit
à l’essence même de la mémoire. Celle-ci est, par défini-
tion, en elle-même objet de conscience, et le fait de pouvoir
analyser en soi ce qui en quelque sorte est déjà en soi et
à soi, s’est avéré être un point essentiel pour proposer une
définition de la mémoire. Si la conscience est conscience
d’elle-même, n’est-ce pas parce qu’elle est en lien avec la
mémoire et que conscience et mémoire sont intrinsèque-
ment liées ?
La phénoménologie se révèle être une méthode permet-
tant de décrire et de comprendre ce qu’est précisément la
Correspondance :
M.-L. Eustache-Vallée
mémoire humaine et, au-delà, comment elle interagit avec
la construction de l’identité [3], mais bien que Husserl ait eu
l’espoir d’instituer la phénoménologie comme une science
à part entière, elle reste attachée au rang de la philosophie.
Toutefois, on assiste aujourd’hui, à travers l’étude scienti-
fique du cerveau, de la mémoire et de ce thème émergeant
qui est l’identité subjective, à un renouvellement de l’intérêt
des scientifiques pour la phénoménologie. La croisée de la
phénoménologie et de la neuropsychologie semble ainsi
montrer sa pertinence pour définir et comprendre le fonc-
tionnement de la mémoire humaine.
Afin d’illustrer cette pertinente réunion entre neuro-
psychologie et phénoménologie, nous procéderons en
trois temps. Nous préciserons tout d’abord la démarche
quasi kantienne de vouloir lier théorie et expérience pour
comprendre au mieux scientifiquement le fonctionnement
d’un sujet humain. Allier théorie et expérience nécessite
de voir en un sujet son corps et son esprit liés, étant à la
fois un corps en mouvement et ressentant un esprit doté
d’émotion en parallèle. Cette affirmation nous amènera
ensuite à décrire le sujet humain comme une personne se
définissant à la fois dans le temps, de fac¸on labile et chan-
geante, et comme une personne unique et toujours même.
À partir de ces définitions du self dans une identité même
et autre, nous développerons des études en neuropsycho-
logie sur le self face aux troubles de mémoire et à une
préservation du sentiment d’identité. Enfin, nous verrons
que ces conclusions font écho à des conceptions phénomé-
nologiques concernant les formes d’accès à la conscience
de soi, selon différents types d’intentionnalités. Étudier le
self en neuro-phénoménologie permet de penser, en aval
comme en amont, aux théories pertinentes de départ pour
choisir un profil standard du self, répondant aux probléma-
tiques liées à l’expérience en général, comme aux troubles
de la mémoire.
Unir neuropsychologie et phénoménologie permet
d’appréhender au mieux cette entité abstraite et complexe
du self, de manière scientifique, sans le déshumaniser, ni
trop le simplifier. Dans leur article consacré à une «étude
concrète »du cerveau, Khachouf, Poletti et Pagnoni utilisent
le terme neurophenomenology [2] car, en effet, l’étude
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = NRP Article Identification = 0290 Date: April 15, 2014 Time: 10:59 am
REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
12
Point de vue
du cerveau ne peut pas être une recherche uniquement
focalisée sur son niveau fonctionnel, mais celui-ci doit
être perc¸u comme habitant une certaine forme et qualité
d’expérimentation, au cœur de la vie d’un sujet. La phé-
noménologie, par sa démarche de mise en sens, et par sa
conception d’un sujet à la fois recevant et donneur de signi-
fication, permet de ne pas réduire le cerveau à un simple
organe physiologique et de l’insérer dans l’intentionnalité
du sujet lui-même. Ces auteurs parlent de l’intérêt de rendre
le «je »(de la première personne), à la troisième per-
sonne étudiée, porteuse de son cerveau. Ils font référence
àl’a priori kantien en faisant remarquer que les condi-
tions humaines de la connaissance ne sont reconnues que
si elles sont observées dans l’expérience. La phénoméno-
logie, dans une visée scientifique, replace l’objet d’étude
dans un contexte spatio-temporel, permettant alors à la rai-
son de ne pas trop s’épurer pour ne pas dépasser ses propres
limites de capacités de connaissance [4]. Kant s’était atta-
ché à montrer l’importance de l’expérience dans le sensible
de notre raisonnement pour qu’il puisse valoir comme
vérité acceptable et provisoirement acceptée dans notre
monde ; mais on peut ajouter également que la science
concrète peut s’appuyer elle-même sur une théorie fon-
dée pour être reconnue dans ses choix de définition de
départ.
En accord avec cette volonté de lier phénoménolo-
gie et neurosciences, nous soulignons ainsi la richesse de
situer l’émergence théorique de certains concepts avant de
les employer de manière scientifique, afin d’en compren-
dre réellement l’étendue et la signification, par la prise
en compte des problématiques englobées dans le concept
même. Finalement, si la phénoménologie husserlienne, ou
le «je transcendantal »kantien, semble faire partie de la
philosophie uniquement, appliquer scientifiquement une
volonté intentionnelle de découvrir les conditions de pos-
sibilité de la connaissance d’un sujet humain précis, ou du
sujet humain en général, donne vie à une discipline à part
entière, fondée et moderne : la neurophénoménologie.
La démarche de la neurophénoménologie semble ouvrir
un nouveau domaine de recherche et de réflexion qui est
finalement de replacer le cerveau/esprit dans son corps
propre : le replacer dans son contexte n’est-il pas en
effet redonner à l’être humain une allure et un corps
perceptible par les autres, comme par lui-même ? Étu-
dier le cerveau (normal ou pathologique), c’est étudier
un lien avec le comportement général et quotidien d’une
personne. Nous parlerions alors davantage de neuropsycho-
phénoménologie en ce que l’étude neurologique du
cerveau revêt une approche complète du cerveau d’un
sujet, si elle en perc¸oit les conséquences comportementales
et psychologiques sur le sujet humain. La phénoménologie
est une manière méthodologique d’étudier le cerveau selon
son intentionnalité et non simplement selon son caractère
purement fonctionnel. Cette discipline apporte une prise
en charge de l’individu conceptuel, puisque avant même
de procéder à l’évaluation, le cerveau sera perc¸u dans une
intentionnalité englobant toute une expérience et un res-
senti propre au sujet. La phénoménologie n’est pas pour
autant comparable à la psychologie, puisque le sujet reste
perc¸u de manière générale, comme tout autre sujet faisant
le même type d’expérience ; telle est d’ailleurs ce qui rap-
proche cette discipline de la neuropsychologie qui elle peut
être considérée comme étant une science. Il s’agit bien dans
la neuropsychologie, comme dans une phénoménologie de
la mémoire ou de l’identité, de saisir l’intimité d’un cerveau
vivant, sans pour autant vouloir saisir l’intériorité d’un sujet
précis.
La neuropsycho-phénoménologie naît finalement d’une
volonté de lier le cerveau/esprit à son corps d’origine, cela
de manière générale et scientifique pour tous les êtres
humains pouvant être comparés. Cette conception d’un cer-
veau dans un corps est assez moderne, car aujourd’hui,
la frontière entre corps et esprit n’est plus si visible
qu’auparavant. Si au temps de Descartes, nous n’étions plus
déjà dans notre corps tel un pilote en son navire, il existait
tout de même un certain dualisme, montrant une différence
d’essence entre corps et esprit. En effet, si l’être humain se
voit doté d’un lien vivant avec son corps, l’obligeant à en
ressentir les douleurs et les joies, Descartes insiste pour-
tant sur l’importance accrue de l’entendement (l’esprit), aux
dépens des sensations du corps. À travers «l’exemple du
morceau de cire »des Méditations métaphysiques, Des-
cartes démontre en quoi c’est l’entendement qui reconnaît
l’objet auquel nous faisons face et non simplement les sen-
sations données par le corps : si je me trouve face à un
morceau de cire doté de certaines qualités sensibles, si après
l’avoir chauffé, il a totalement changé d’aspect, au point que
chacun de mes sens en déduise être devant un autre objet ;
c’est bien parce que c’est par l’entendement seul que je
puisse connaître. Descartes montre en cela un privilège de
l’esprit sur le corps, plus qu’une union entre les deux, en
ce qui concerne la connaissance néanmoins (contrairement
aux passions de l’âme, où corps et esprit s’unissent pour
ressentir joie ou tristesse).
Aux antipodes de ce point de vue, les empiristes tels
que D. Hume reconnaissent un primat de l’expérience sen-
sorielle, et donc du corps, sur le savoir de l’entendement
(sur l’esprit) puisque c’est bien parce que cette bougie
est enflammée que je n’y mettrais pas les doigts et non
parce que mon entendement la reconnaît comme étant une
bougie.
Nous sommes bel et bien possesseurs d’un entende-
ment qui nous permet de connaître et de reconnaître, mais
il faut bien que, par l’entremise de nos sens et donc à
travers les sensations de notre corps, nous percevions la
matière à entendre. Ainsi, l’être connaissant est un être
de pensée dans un corps. E. Kant déduira que la raison
sera dans l’erreur tant qu’elle s’attachera à des questions
a priori, c’est-à-dire n’ayant pas d’objet dont nous faisons
effectivement l’expérience, comme les questions d’ordre
métaphysique, portant sur l’âme, Dieu, le monde [4]. Kant
montrera en quoi l’entendement est stérile sans l’expérience
sensorielle. L’union du corps et de l’âme permet la connais-
sance et lorsque la raison cherche à réfléchir sur des sujets
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = NRP Article Identification = 0290 Date: April 15, 2014 Time: 10:59 am
REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
13
Point de vue
auxquels nous ne pouvons avoir à faire concrètement dans
l’expérience, elle se perd dans des illusions inévitablement.
En neurologie également, Damasio réfute la dichotomie
classique raisonnement-émotion ; d’après lui le raisonne-
ment dénué d’affectivité ne suffirait pas pour la prise de
décision adaptée. Chaque événement serait mémorisé selon
un marqueur positif ou négatif et influencerait inconsciem-
ment la prise de décision du sujet [5]. Damasio appelle
alors marqueur somatique le signal d’alarme présentant
au dialecticien les conséquences bénéfiques ou non de
sa décision. Les marqueurs somatiques permettent alors
l’efficacité dans l’élimination du champ des possibles.
Damasio apporte ici une idée originale qui vient enrichir les
théories les plus récentes sur les fonctions exécutives per-
mettant la prise de décision, puisqu’il demande de prendre
en compte leurs fondements émotionnels et motivationnels.
Lier le corps et l’esprit est une volonté qui est apparue avec
les premières études sur le self identitaire d’un sujet humain.
Dans le self se joue en effet la rencontre des émotions
et de la volonté du sujet. Le lieu de la mémoire est en
cela un lieu à la fois actif et passif profondément conc¸u
de cette mise en forme dualiste du corps avec l’esprit. Si la
mémoire a un rôle important dans la construction du self,
c’est qu’elle lui permet d’être entier, avec un passé, un pré-
sent et un avenir, et ainsi d’être pleinement son corps, corps
l’accompagnant de traits de visage, selon les événements
vécus et l’âge atteint. Malgré ce rôle indéniable, le self n’est
pas réductible à ce travail de la mémoire. En effet, le self est
plus que la dynamique des mémoires. Le self naît bien d’un
conflit entre émotions et volonté, entre corps et esprit au fur
et à mesure du temps, mais il a aussi une image régulière
de lui-même, où ses traits de caractère comme ses traits de
visage restent toujours plus ou moins les mêmes, cela per-
mettant que le sujet se reconnaisse et soit reconnu par les
autres. Dans l’identité du self, nous pouvons ainsi lire deux
facettes du self, à la fois toujours changeant et toujours le
même.
Le fait d’être à la fois changeant et autre est un thème
hautement philosophique, révélant en quoi corps et esprit
s’entremêlent en l’identité d’un sujet, faisant de lui un être
que l’on reconnaît et un être qui évolue. Nous désignons
en philosophie par «mêmeté »le fait de rester le même à
travers le temps, et par «ipséité »le fait de changer avec le
temps, de mûrir, de vieillir, de changer de points de vue.
Paul Ricœur [6] conteste la vision personnelle de l’identité,
à la manière de John Locke. Pour Ricœur, l’identité se définit
selon un rapport à l’autre et à des engagements, en plus des
expériences vécues et des souvenirs emmagasinés. Dans
le dilemme de Locke, celui du prince dont on transplante
la mémoire dans le corps d’un savetier. La question est :
redevient-il alors le prince qu’il se souvient avoir été ? Ou
devient-il le savetier que les hommes continuent à obser-
ver ? D’après Locke, il resterait le prince dans un corps
de savetier. Ricœur critique cette idée : l’identité n’est pas
réductible à la mémoire : je ne suis assurée de moi-même
que par ma fidélité aux engagements pris. Nous pensons
qu’il existe à la fois une identité même et une identité mise
à jour, que notre vision de nous-mêmes peut être géné-
rale et/ou perc¸ue à ce temps précis de vie. Cette remarque
montre en quoi nous pensons que le corps et l’esprit sont
inséparables dans la prise de conscience de notre identité :
soit celle-ci est perc¸ue dans le corps au présent, soit celle-
ci est pensée en mémoire selon les vécus du corps et de
l’esprit. Ce développement du self dans un corps et un esprit
au présent et/ou dans le temps est finalement toujours lié
à un travail en mémoire retenant l’image générale de self
et/ou un temps précis du sujet.
Le self est le lieu unitaire du corps et de l’esprit dans le
temps de la mémoire et au présent.
Le corps et l’esprit se relient dans le self et par consé-
quent dans la mémoire.
Si la neuropsycho-phénoménologie naît de l’étude de
l’identité et de ses liens avec la mémoire de manière
physiologique et psychologique, cette discipline permet
aujourd’hui, à partir d’étude de patients ou de sujets sains,
d’établir des connaissances adaptées à un objet d’étude qui
n’en est pas un, mais qui est un sujet.
Des recherches récentes en neuropsychologie ont fait
l’hypothèse d’une partie persistante du self dans la maladie
d’Alzheimer, grâce à des études ayant montré une relative
préservation du sentiment d’identité, malgré une mémoire
sévèrement déficiente.
Des auteurs [7] ont suggéré que des patients atteints
de maladie d’Alzheimer, à un stade sévère, auraient tou-
jours une conscience d’eux-mêmes, fidèles à ce qu’ils sont
(ou plutôt, on va le voir, à ce qu’ils étaient avant la mala-
die). Ainsi, plutôt qu’une véritable préservation de l’identité,
nous soulignons une préservation du sentiment d’identité
chez le malade d’Alzheimer. En illustration de ce point de
vue, Hehman et ses collaborateurs [8] ont proposé à une
patiente de 83 ans, au stade sévère de la maladie, de se
reconnaître sur des photos, prises à différentes périodes de
sa vie. La patiente ne se reconnaît que sur les photos les plus
anciennes (quand elle avait une quarantaine d’années). Les
auteurs en concluent que la patiente garde bien une idée
d’elle-même, alors qu’elle semble avoir oublié toute la par-
tie récente de sa vie. Comment expliquer ce phénomène ?
Par l’anosognosie, du fait que la patiente se sente en parfaite
santé, voire dans la fleur de l’âge ? Par un déficit de mise à
jour du sentiment d’identité ?
L’étude de Klein et ses collaborateurs [9] s’intéresse à
une femme de 76 ans, elle aussi au stade sévère de la mala-
die qui, malgré ses troubles de mémoire importants et ses
déficits cognitifs, se révèle être toujours en possession d’une
connaissance fidèle d’elle-même. Toutefois, cette connais-
sance, ce sentiment d’identité, serait en adéquation avec
l’identité de la personne avant la maladie et non avec son
identité actuelle. Cette persistance de l’idée de soi cohé-
rente s’expliquerait notamment par la relative préservation
de la mémoire sémantique dans la maladie et notamment
de la mémoire sémantique personnelle qui comprend nos
propres traits de personnalité [10]. Il existerait ainsi une
résistance particulière du noyau du self sémantique, des
traits de caractère conscients.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = NRP Article Identification = 0290 Date: April 15, 2014 Time: 10:59 am
REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
14
Point de vue
Une autre étude menée récemment au sein du labo-
ratoire Inserm U1077 de Caen [11, 12], suggère une
préservation du sentiment d’identité chez des patients
atteints de maladie d’Alzheimer (aux stades modérés à
sévères de l’évolution). Les patients et les sujets contrôles
ont tous été examinés individuellement dans la même ins-
titution où ils résident, deux fois, à 15 jours d’intervalle.
Nous leur avons proposé un questionnaire permettant de
savoir comment ils se décrivaient (plutôt timide, honnête...)
selon certains traits de caractère, comment ils se disaient
réagir dans telle ou telle situation et enfin comment ils
se jugeaient, de manière introspective. Il leur a été égale-
ment demandé de donner dix phrases commenc¸ant par «Je
suis », afin qu’ils se décrivent de manière plus spontanée.
Enfin, ils étaient invités à donner une estimation de leur
âge. De fac¸on surprenante, les résultats montrent que les
patients répondent de fac¸on très similaire aux deux temps de
l’étude, alors qu’ils ne se souviennent pas avoir déjà effectué
les tests deux semaines auparavant. Une différence impor-
tante entre les deux groupes est cependant observée dans
l’évaluation de l’âge que les sujets se donnent, les patients
s’attribuant toujours un âge inférieur à leur âge réel (14 ans
de moins en moyenne). Par ailleurs, selon la neuropsycho-
logue de l’établissement qui connaît bien les patients, leurs
réponses aux deux tests refléteraient bien leur personna-
lité. Cette étude conclut à une préservation du sentiment
d’identité dans la maladie d’Alzheimer, aux stades modé-
rés à sévères de la maladie, et suggère une cohérence de
l’idée que les patients ont d’eux-mêmes selon ce qu’ils sont
au moment présent (et non seulement selon ce qu’ils étaient
avant la maladie).
Cette étude contredit-elle alors les conclusions émises
par Klein et collaborateurs, énoncée précédemment ? Nous
pensons qu’il s’agit d’une différence due à la formulation
des questions posées dans les différents tests choisis. Dans
l’étude de Klein, les traits de caractère évalués semblent
plus labiles et les réponses plus soumises à une référence
aux événements dans le temps, demandant de solliciter la
mémoire épisodique, laquelle est profondément déficitaire
dans ce type de pathologie : «Êtes-vous triste, indépendant,
alerte, ambitieux ?... »[10]. Les réponses à ces questions
peuvent éminemment changer selon les références aux
situations et à l’âge. Dans l’étude à laquelle nous avons
contribué au contraire [11, 12], les traits de caractère éva-
lués requièrent une réponse plus générale. Il est demandé
par exemple : «Êtes-vous quelqu’un de plutôt triste ? »La
réponse amène à être synthétique, générale, et connue inti-
mement par le sujet.
Dans les deux cas, l’idée d’un «corps-esprit »est visible,
même aux stades les plus sévères de la maladie : soit dans
une vision de soi qui n’est plus, d’un soi qui ne serait pas
remis à jour, un soi qui ne serait pas cohérent avec l’âge
du patient, mais auquel le patient ferait référence avec une
idée de son corps en adéquation avec cette image de soi ;
soit dans une vision générale de soi en laquelle le sujet
a eu tout le temps de faire corps, un soi plus basique et
plus instinctif, dont le corps ne serait pas perc¸u mais fon-
damentalement ressenti et bien connu par ses réactions
journalières repérables car quasiment identiques à travers
le temps. Finalement, le self dessine le lien vivant, unissant
ces deux instances que sont le corps et l’esprit. Le corps n’est
alors pas qu’une instance visible, mais il se vit de l’intérieur
et forme en l’esprit des couleurs et des vérités que seul son
possesseur est apte à déchiffrer pleinement : le self. Le sujet
se définit ainsi : comme un corps vivant et non un être dans
un simple corps ; il est un corps-esprit dont le corps malade
rend malade l’esprit, et inversement, et où la vision de soi
sans le corps est impossible.
Les conclusions ici font écho à d’autres plus théo-
riques retrouvées en phénoménologie : d’un point de vue
ontologique, nous avons abouti à deux manières de se
représenter soi-même, soit de manière très épurée (ou
basique, mêmeté), soit en parlant d’une identité plus labile
(ipséité), selon l’âge, le statut, la période de vie et la santé de
la personne (indépendant, triste, alerte). La première fac¸on
de se décrire serait d’autant plus résistante à la maladie qu’il
s’agirait de connaissances sur soi profondément charnelles
de soi à soi et non dérivées de la mémoire épisodique : il
s’agirait de connaissances sur soi forgées de longue date,
intimement perc¸ues et apprises par nos perceptions, réac-
tions, émotions et ressentis corporels. La deuxième fac¸on
de se décrire serait soumise à une référence temporelle de
la vie du sujet. S. Klein dans son article The sense of dia-
chronic personal identity [1] utilise en ce sens les termes de
«self diachronique »et de «self synchronique »exprimant
ainsi cette idée d’un soi à la fois même et toujours cons-
cient de lui-même et d’un soi perc¸u plus largement dans
son temps intime, un soi changeant au fur et à mesure du
temps.
Cette dualité de mise en perception intentionnelle de
soi par soi avait déjà été formulée par le phénoménologue
E. Husserl [3] : il s’agissait de voir dans la conscience cons-
ciente, intentionnelle donc, deux manières de concevoir sa
propre perception, dans le temps, ou hors du temps.
Husserl dénommait en effet deux sortes
d’intentionnalités de la conscience : l’«intentionnalité
longitudinale »et l’«intentionnalité transversale »:
–l’intentionnalité transversale permet de constituer atem-
porellement (en dehors du temps intime de la conscience
consciente) des phénomènes temporels (souvenus, imagi-
nés ou perc¸us) en les rendant temporellement perceptibles,
placés dans une suite temporelle ;
–l’intentionnalité longitudinale constitue atemporellement
des éléments atemporels (comme les perceptions de percep-
tions), mais saisis dans un ordre continu (dans un «flux »),
àlafac¸on d’une phrase.
La conscience serait alors capable d’un triple regard :
une première perception où la conscience regarde ce
qu’elle est en train de percevoir directement (ex : «je
perc¸ois cette salle dans laquelle je suis ») ; un autre type de
perception, où la conscience perc¸oit une donnée indirecte,
qui est passée, comme si je me rappelle d’un événement
vécu n’ayant plus aucune présence au présent : un sou-
venir. C’est l’intentionnalité transversale qui constitue ces
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = NRP Article Identification = 0290 Date: April 15, 2014 Time: 10:59 am
REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES
15
Point de vue
deux modes de donnée à la conscience. Il s’agit ici de per-
cevoir le résultat de constitution de sens de la conscience
et non de regarder la conscience elle-même.
Enfin, il existe une troisième perception, capable de
se regarder elle-même, il s’agit d’une perception de per-
ception, mais non plus de la perception d’une perception
passée, mais d’une perception de perception en elle-même
(je cherche à comprendre la possibilité même de cette per-
ception que j’ai de la salle, par exemple). Cette troisième
perception est un regard phénoménologique sur la percep-
tion elle-même et non plus sur le souvenir. Elle est permise
par l’intentionnalité longitudinale.
Les deux manières de se représenter soi-même se
retrouvent ainsi dans la description phénoménologique de
la conscience de soi, comme dans des cas concrets de
pathologies du cerveau faisant éclore ces deux procédés
différents de notre conscience. Décrire la vie intentionnelle
de la conscience, c’est suivre ce même projet que celui des
neurosciences, comprendre les conditions de possibilités
de la connaissance et de l’expérience humaine. Concer-
nant les thèmes d’identité et de subjectivité, il est intéressant
de relier ces deux disciplines, fondatrices toutes deux du
même objectif, celui de connaître de manière neutre et
objective ce qui mène au subjectif de chacun. La phéno-
ménologie permet alors à la neuropsychologie d’observer
le sujet comme un cerveau habillé d’un corps (et d’une
expérience), assimilable à d’autres sujets dans son genre,
sans pour autant être comparables à tous les autres sujets
humains.
Pour résumer et conclure ensuite, la neuropsycho-
phénoménologie pourrait permettre d’appréhender le
patient à la fois à la troisième personne, comme un «il »
comparable à tous, et comme une personne à part entière
dans une histoire et un corps bien à elle. La phénoménolo-
gie permet de donner une définition de base du cerveau
humain adaptée, et d’avoir à l’esprit les problématiques
émergentes, permettant à la science d’évoluer en ce qui
concerne des notions aussi complexes et aussi abstraites
que celles du self et de l’identité humaine. Inversement, la
neuropsycho-phénoménologie permet l’instauration d’une
philosophie pratique [13-15].
En plus d’un éclaircissement des problématiques sous-
jacentes à ces thèmes et d’une base théorique pour utiliser
de manière optimisée les concepts, les thèses de la phé-
noménologie permettent une meilleure évaluation de la
dimension subjective de la mémoire :
–en ce qui concerne le ressenti subjectif général face à
des événements précis, selon des contextes bien établis...
Appréhender le cerveau comme placé dans un corps,
apportant intentionnellement les informations au sujet, per-
met de saisir les situations à tester, selon le vecteur de
l’émotion ;
–en cherchant à étudier ces liens intrinsèques entre
mémoire et identité, au moyen de diverses méthodologies ;
–en continuant à déceler la préservation ou les menaces
identitaires dans les maladies de la mémoire, et à les expli-
quer, en appui aux paradigmes décrits jusqu’alors.
Tel est le bénéfice de relier parfois certaines disciplines
ensemble, notamment lorsque leur objectif est le même :
celui de décrire les conditions de possibilité de la connais-
sance et de l’expérience du sujet humain, de manière neutre
et objective.
À l’aide de cette «phénoménologie cognitive », nous
nous sommes plus particulièrement attachés à la mala-
die d’Alzheimer pour approfondir l’étude des relations
entre mémoire, conscience et identité. En effet, si les
troubles de mémoire chez ces patients sont bien établis,
le degré de l’intégrité de leur identité est mal connu,
même si cette dimension est déjà prise en compte dans
certaines approches thérapeutiques non-pharmacologiques
des démences. Les rares études qui ont été effectuées dans
ce domaine utilisent des méthodologies disparates et le plus
souvent mal contrôlées, ceci étant lié au fait que le concept
d’identité (ou de self) demeure mal défini et polysémique
en psychologie cognitive et en neuropsychologie. Enfin, un
élément très important est la sévérité de la démence car la
revue des études publiées suggère que l’identité est pré-
servée aux stades légers à modérés de la démence ; en
revanche, son intégrité semble affectée en cas de démence
sévère. Ce constat est important, mais il reste à comprendre
les mécanismes qui président à ces modifications identi-
taires [7].
Différents modèles proposent que l’identité s’appuie
non seulement sur la mémoire épisodique mais aussi sur
la mémoire sémantique. Dans la maladie d’Alzheimer, la
mémoire épisodique est altérée, mais la relative préserva-
tion de la mémoire sémantique, au moins à un stade léger
à modéré de la démence, pourrait fournir un «socle »qui
permet de maintenir un sentiment d’identité au moins glo-
bal. Par contre, à un stade plus avancé de la maladie, il est
possible que le sentiment d’identité soit altéré ou alors que
les capacités cognitives du patient ne lui permettent plus
d’exprimer la persistance de son identité. Ainsi, qu’est-ce
qui dégrade les représentations identitaires du patient atteint
de la maladie d’Alzheimer ? Est-ce le fait que son sentiment
d’identité est perturbé par la maladie elle-même, ou est-
ce dû au fait que les liens entre identité et mémoire à un
stade de démence relativement avancé sont détruits ou très
perturbés ?
Concernant la maladie d’Alzheimer, de nombreux tra-
vaux ont permis de bien préciser la nature des troubles
de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique,
qui surviennent au cours de l’évolution de l’affection.
L’intérêt porté à la modification (et à la préservation au
premier stade d’évolution de la maladie) des représenta-
tions identitaires, est une nouvelle thématique de recherche.
Elle est particulièrement intéressante car elle pourrait
déboucher sur de nouvelles thérapeutiques non médica-
menteuses, que ce soit auprès des patients ou des aidants.
La phénoménologie aurait donc dans ce projet une utilité
clinique.
Dans une perspective éthique enfin, le fait de voir une
conservation du sentiment d’identité devrait encourager à
améliorer encore les qualités de vie de ces personnes, qui
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
1
/
6
100%