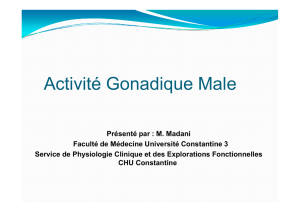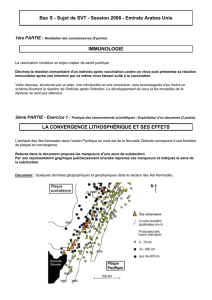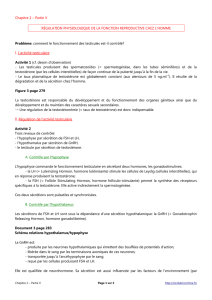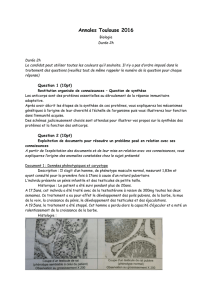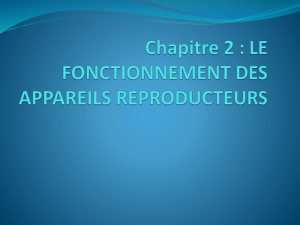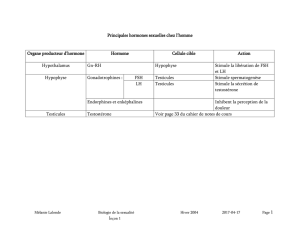Revue Évaluation hormonale de la fonction testiculaire chez l`adulte

Revue
Évaluation hormonale de la fonction
testiculaire chez l’adulte jeune
Evaluation of the testis endocrine function by the young adult
Yves Reznik
Service d’Endocrinologie
et Maladies Métaboliques,
CHU Côte de Nacre,
14033 Caen Cedex
Résumé.L’exploration de la fonction endocrine du testicule s’appuie sur le dosage de la
testostérone plasmatique totale réalisé le matin. Ce dosage suffit généralement à évaluer la
fonction leydigienne, mais peut être pris en défaut pour des valeurs proches du seuil inférieur
de la normale ou dans certaines situations cliniques qui perturbent la biosynthèse des
androgènes ou de sa protéine de liaison SHBG. Le dosage de la testostérone libre ou de la
testostérone biodisponible peut dans ces circonstances particulières être un appoint diagnos-
tique, et doit faire appel à des méthodes directes qui sont lourdes et relèvent de laboratoires
spécialisés, ou à des méthodes indirectes basées sur des équations validées. Le dosage des
gonadotrophines utilise des méthodes immunométriques qui ont une sensibilité généralement
suffisante pour différencier les insuffisances testiculaires primaires ou secondaires. Ces 10
dernières années ont été développés des immunodosages de l’inhibine et de l’hormone
antimüllérienne (AMH) qui permettent d’étudier la fonction sertolienne et pourraient consti-
tuer des marqueurs prédictifs au cours de l’infertilité masculine. Les tests dynamiques pour
l’exploration de l’axe gonadotrope ont un intérêt pour appréhender la physiologie du testicule
mais leur utilisation en pratique clinique est restreinte.
Mots clés : testicule, testostérone, gonadotrophine, dosage hormonal
Abstract.The measurement of morning total testosterone plasma concentration is pivotal for
evaluating the endocrine function of the testis. This parameter is generally sufficient for the
detection of leydig cell deficiency, but mild lowering of plasma total testosterone may be
misleading, particularly in clinical situations that affect SHBG plasma concentration. In such
situations, the measurement of free testosterone or bioavailable testosterone levels add
subsequent information, and may be performed by direct methods which are highly accurate
but performed only in specialized laboratories, or indirect methods based on validated
algorithms. Basal plasma gonadotropin measurement by immunometric methods are gene-
rally accurate tools for the distinction between primary testicular or secondary hypogonado-
trope deficiency. The measurement of plasma inhibin and anti-mullerian hormone are
promising tools for the in vivo evaluation of sertoli cell function, and may be used as
predictive markers for male infertility. Dynamic testing of the gonadotrope axis has limited
value in the clinical investigation of the physiology of the testis.
Key words: testosterone, testis, gonadotropin, hormonal concentration measurement
Le testicule exerce 2 fonctions dis-
tinctes, la sécrétion des hormones
androgéniques par les cellules inters-
titielles de Leydig d’une part, et la
formation et la maturation des sper-
matozoïdes au niveau des tubes sémi-
nifères et des cellules sertoliennes
d’autre part. Les perturbations de la
fonction testiculaire peuvent toucher
l’une des 2 fonctions – leydigienne ou
séminifère – ou les deux simultané-
ment. Nous nous attacherons princi-
palement à décrire les modalités de
l’évaluation hormonale de la fonction
endocrine du testicule, en précisant
les circonstances cliniques qui inci-
tent à réaliser ces explorations, les
outils biologiques dont dispose le cli-
nicien pour explorer le testicule endo-
crine, et enfin les modalités pratiques
de l’exploration d’une anomalie de
l’axe testiculaire.
Circonstances
qui amènent
à l’évaluation
de l’axe gonadotrope
L’exploration hormonale de la
fonction testiculaire chez l’adulte
mt médecine de la reproduction 2007 ; 9 (5) : 284-92
Tirésàpart:Y.Reznik
doi: 10.1684/mte.2007.0103
mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007
284
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

jeune sera motivée par l’observation par le clinicien d’une
constellation de symptômes qui réalisent le tableau d’hy-
pogonadisme, défini comme la défaillance du testicule
endocrine à produire un taux physiologique d’androgènes
circulants et/ou la défaillance quantitative de la spermato-
genèse révélée lors de l’exploration de l’infertilité du
couple [1]. Pour certains, l’hypogonadisme implique
l’existence d’une insuffisance leydigienne. Certains symp-
tômes possèdent une spécificité forte et indiquent à eux
seuls la réalisation d’un dosage hormonal : il s’agit en
premier lieu d’une baisse de la libido et/ou de l’activité
sexuelle habituelle de l’individu, plus rarement d’un trou-
ble de l’érection. Ces symptômes peuvent s’accompagner
de signes physiques caractéristiques comme une sensibi-
lité mammaire voire une gynécomastie, ou une raréfaction
de la pilosité axillaire et pubienne. Les testicules ont
souvent une consistance molle. Lorsque le déficit s’est
installé précocement en période péripubertaire, les testi-
cules peuvent être très petits (< 5 ml). Dans les formes
historiques avec un important retard diagnostique, la ca-
rence hormonale peut avoir un retentissement musculaire
(faiblesse, amyotrophie) ou osseux (déminéralisation, tas-
sements vertébraux, fractures). À côté de ces symptômes à
forte valeur diagnostique, d’autres manifestations du défi-
cit androgénique moins spécifiques peuvent être l’élé-
ment d’appel ou de consultation : une asthénie à tous les
modes, un manque d’énergie vitale, un trouble de l’hu-
meur de type dépressif, des troubles cognitifs (mémoire,
concentration), une baisse des performances physiques...
Ces symptômes moins spécifiques doivent faire recher-
cher les signes majeurs du déficit androgénique listés plus
haut. Ce tableau clinique, plus ou moins complet, cons-
taté chez un adulte jeune doit conduire à réaliser des
explorations hormonales simples pour confirmer – ou
infirmer –– le diagnostic d’hypogonadisme. Enfin, le défi-
cit androgénique peut parfois être révélé lors de l’explo-
ration de l’infertilité du couple.
En pratique, l’hypogonadisme de cause prépubertaire
est à l’âge adulte une évidence clinique du fait de l’im-
pubérisme. Mais l’hypogonadisme acquis post-pubertaire
est de diagnostic souvent difficile car les signes de virilisa-
tion acquis à la puberté sont quasi indélébiles, la pilosité
régresse peu et tardivement, la verge reste développée, et
il est évoqué sur des signes fonctionnels (libido, activité
sexuelle, asthénie...) non spécifiques, sans signe objectif
ou presque.
Évaluation hormonale
de l’axe testiculaire
Elle est basée sur l’exploration du testicule endocrine
qui s’appuie sur les dosages hormonaux en particulier de
testostérone et des gonadotrophines plasmatiques LH et
FSH. L’examen du sperme permet quant à lui d’explorer la
fonction exocrine du testicule dans ses aspects quantitatifs
et qualitatifs. Ce deuxième volet sera brièvement abordé
dans cet article axé sur l’exploration hormonale de la
fonction testiculaire.
Les dosages hormonaux statiques
Le dosage de la testostérone plasmatique totale cons-
titue en général un index suffisant pour affirmer ou infirmer
un déficit androgénique. Le dosage de la testostérone
plasmatique basale est le plus souvent suffisant [1], le
recours aux dosages dynamiques restant d’un usage d’ex-
ception dans certaines situations particulières.
Les explorations hormonales doivent être réalisées à
distance de toute maladie intercurrente, ou de prise de
médicaments ou drogues pouvant affecter l’axe gonado-
trope, comme les glucocorticoïdes qui ont un double
impact hypothalamo-hypophysaire et leydigien, le kéto-
conazole ou les opiacés.
Le dosage de la testostérone plasmatique
Son dosage est la pierre angulaire de l’évaluation
hormonale du testicule. La testostérone est secrétée de
manière pulsatile et suit un cycle nycthéméral avec un
taux maximal le matin vers 8 heures.
L’amplitude de variation nycthémérale de la testosté-
rone plasmatique est relativement faible (figure 1). Elle est
présente dans la circulation sous plusieurs formes : une
forme liée avec une faible affinité à l’albumine qui est la
forme prédominante (68 %), pour 30 % sous une forme
liée avec une forte affinité à sa protéine de transport
spécifique, la SHBG ou TeBG (constante d’association Ka :
1x10
9
L/mol), et enfin pour une faible fraction sous forme
de testostérone libre. En effet, la fraction libre de la testos-
térone ne représente que 0,5 à 3 % de la testostérone
totale, mais constitue le meilleur reflet de l’action des
androgènes circulants puisqu’elle est la fraction biologi-
Heure au cours du
nycthémère
Hommes âgés
Adultes jeunes
Testostérone (ng/mL)
8
7
6
5
4
8 12 16 20 24 4 8 (Heures)
Figure 1. Variations nycthémérales de la testostérone plasmati-
que chez l’homme adulte sain. D’après : « Bremner WJ. J Clin
Endocrinol Metab 1983 ; 56 : 1278 ».
mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007 285
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

quement active. La testostérone liée à l’albumine est rapi-
dement mobilisable du fait d’une liaison de faible affinité
(Ka : 3,6 x 10
4
L/mol) et ainsi d’une dissociation rapide du
complexe « stéroïde-protéine ». La testostérone non liée à
la SHBG, qui correspond à la testostérone libre plus la
testostérone liée à l’albumine, représente un fidèle reflet
de l’hormone biologiquement active [2]. La testostérone
totale est, dans certaines circonstances, un indice moins
précis pour évaluer la fonction androgénique. En effet,
différentes conditions physiologiques ou pathologiques
peuvent modifier la concentration d’albumine mais sur-
tout de SHBG, variations qui peuvent se traduire par une
anomalie de concentration de la testostérone totale alors
que la fraction libre active reste à un taux circulant nor-
mal. Ces circonstances sont cependant relativement rares
et peuvent justifier le recours à un dosage de la testosté-
rone libre ou de la testostérone biodisponible, principale-
ment lorsque le taux de testostérone totale est équivoque
(cf. infra).
Les conditions du dosage de testostérone plasmatique
Le dosage de testostérone plasmatique doit être réalisé
en début de matinée vers 8 heures, pour s’affranchir de la
fluctuation nycthémérale des sécrétions androgéniques
testiculaires qui se traduit par des taux vespéraux de
testostérone circulante réduits de 30 % par rapport au pic
matinal (figure 1). En cas de valeur de testostérone plas-
matique modérément abaissée en dessous du seuil de
normalité, le dosage devra être répété 1 ou 2 fois avant
d’affirmer un hypogonadisme.
Dosage de la testostérone totale
C’est le dosage à réaliser en première intention, du fait
de sa simplicité et de son faible coût. La mesure de la
testostérone totale après extraction et purification est la
technique la plus précise, et est parfaitement corrélée à la
mesure par spectrométrie de masse couplée à la chroma-
tographie gazeuse (CG-MS) ou liquide (CL-MS) qui cons-
titue le dosage de référence, mais n’a pas d’utilité en
pratique clinique courante. Des dosages directs sans étape
d’extraction sont largement diffusés dans les laboratoires
hospitaliers ou de ville, basés sur des méthodes immuno-
logiques (RIA) ou immunoradiométriques (IRMA). Ces do-
sages automatisés ont une précision suffisante pour diffé-
rencier la plupart des valeurs pathologiques des taux
normaux [3]. Il existe cependant une grande variabilité
des performances des immunodosages de la testostérone
qui sont commercialisés, ce qui rend nécessaire une
meilleure standardisation des techniques utilisées en rou-
tine [4]. Certaines circonstances pathologiques peuvent
affecter le taux circulant de la SHBG et ainsi mettre en
défaut la précision du dosage de la testostérone totale.
Une élévation de la SHBG conduira à une surestimation et
à l’inverse une baisse de la SHBG à une sous-estimation de
la production de testostérone (tableau 1). Les valeurs nor-
males du taux de testostérone plasmatique sont variables
en fonction des laboratoires et des méthodes de dosage
utilisées. Chez l’homme jeune, le seuil de 3 ng/mL
(10,4 nmol/L) est souvent considéré comme la limite infé-
rieure de la normale, mais le clinicien doit se baser sur les
valeurs de référence établies par le laboratoire qui réalise
le dosage [1]. En fait, il nous manque la connaissance du
seuil en-deçà duquel existe un déficit androgénique au
niveau des organes cibles : certains hommes n’ont aucun
signe fonctionnel avec une testostérone plasmatique infé-
rieure à 2 ng/mL, et la barre de 3 ng/mL reste arbitraire,
même si elle est le plus souvent admise. Néanmoins, la
testostérone plasmatique est généralement effondrée en
dessous de 1 ng/mL dans les hypogonadismes, rendant le
diagnostic biologique facile.
Dosage de la testostérone libre
La méthode de référence pour doser la fraction libre de
la testostérone est la dialyse à l’équilibre à 37 °C, qui
permet de séparer à travers une membrane semi-
perméable la testostérone libre marquée « [
3
H]testosté-
rone » qui diffuse librement à travers la membrane de
dialyse, de la testostérone liée aux protéines (SHBG, albu-
mine) qui, elle, ne diffuse pas. L’inconvénient de la mé-
thode est sa lourdeur technique et sa durée puisque l’équi-
libre est atteint après plusieurs heures [5, 6]. Cette
technique n’est réalisée que par quelques laboratoires
spécialisés. La valeur constituant le seuil inférieur de
la normale généralement rapportée par les laboratoires
de référence pour cette méthode est de 50 pg/ml
(0,17 nmol/L) [1].
Tableau 1.Circonstances associées à des modifications
de la SHBG, (en gras, les circonstances les plus fréquentes)
Circonstances associées
à une élévation de la SHBG
Circonstances associées
à une baisse de la SHBG
Vieillissement Obésité
Cirrhose hépatique Syndrome néphrotique
Hyperthyroïdie Hypothyroïdie
Infection HIV Glucocorticoïdes
Estrogènes Androgènes
Anticonvulsivants Progestatifs
Revue
mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007
286
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Des algorithmes ont été mis au point pour calculer
l’index de testostérone libre, à partir des concentrations de
la testostérone totale et de ses protéines de liaison, en
particulier la SHBG immunoréactive. Ces algorithmes ne
sont pas toujours applicables aux différentes concentra-
tions des protéines de liaison, et leur précision peut être
grevée par des variations importantes des concentrations
de ces protéines. La comparaison de plusieurs algorithmes
pour le dosage de la testostérone libre sur un pannel de
400 échantillons a montré une grande variabilité selon la
formule utilisée [7]. Une méthode indirecte basée sur la
mesure des concentrations de testostérone totale et de
SHBG par méthode immunoradiométrique permet de cal-
culer la testostérone libre par une équation du second
degré intégrant la constante d’association de testostérone
et SHBG. Cette méthode indirecte apparaît parfaitement
corrélée à la dialyse à l’équilibre (figure 2) et ne nécessite
pas d’ajustement pour des concentrations normales (40-
50 g/L) d’albumine [8, 9]. Un ajustement est nécessaire
dans les situations modifiant sévèrement l’albuminémie
comme le syndrome néphrotique ou la cirrhose hépati-
que. Cette méthode nécessite un programme d’analyse
informatique spécifique.
Un dosage direct de la testostérone libre utilisant un
analogue de la testostérone comme traceur a été commer-
cialisé, c’est la méthode couramment proposée par les
laboratoires d’analyse de routine pour évaluer la testosté-
rone libre. Cette technique a l’avantage d’être rapide, et
est bien corrélée à la méthode de dialyse à l’équilibre
(figure 2). Cependant, elle fournit des valeurs de testosté-
rone libre qui représentent une fraction variable (20 à
60 %) de la testostérone libre par dialyse à l’équilibre, en
fonction des taux circulants de SHBG [8], ce qui rend
délicate l’interprétation des valeurs basses.
Dosage de la testostérone biodisponible
La testostérone biodisponible peut être mesurée par
précipitation avec le sulfate d’ammonium à 50 % qui
sépare la testostérone liée à SHBG (précipitée) de la tes-
tostérone libre plus celle liée à l’albumine (non précipi-
tée). Cette méthode est également lourde, et n’est pas
standardisée. Une méthode indirecte est basée sur l’utili-
sation des constantes d’affinité théoriques de la SHBG et
de l’albumine pour la testostérone (supra), mais cette
méthode fournit des résultats discordants avec la méthode
de référence par précipitation. L’utilisation de constantes
d’association optimisées de SHBG et d’albumine pour la
testostérone permet d’améliorer la performance de la mé-
thode du dosage calculé de la testostérone biodisponible
[10]. Le dosage de la testostérone biodisponible apporte
une précision diagnostique lorsque le taux de testostérone
totale se situe dans la fourchette des valeurs plasmatiques
comprises entre 1,85 et 3,5 ng/mL [11].
Quelle méthode en pratique ?
Les discordances entre testostérone totale et testosté-
rone biodisponible sont le plus souvent observées pour les
concentrations de testostérone proches de la limite infé-
rieure de la normale, c’est-à-dire entre 1,8 ng/mL (6,5
nmol/L) et 3,5 ng/mL (13 nmol/L). Ainsi pour les valeurs de
testostérone totale en-deça ou au-delà de cette fourchette,
la mesure de la testostérone biodisponible est inutile. Pour
les valeurs intermédiaires, une méthode indirecte basée
sur la mesure de la testostérone totale et de la concentra-
tion de SHBG circulante peut apporter une précision par
rapport à la seule testostérone totale [11].
Le dosage des gonadotrophines
Les gonadotrophines hypophysaires LH et FSH ont
chacune une cible spécifique, la LH agissant sur la cellule
A
1000
800
n = 28
FT pMol/L
AFTC pMol/L
y = 1,002x + 0,877
R = 0,987
600
400
200
0
0 200 400 600 800 1000
B
250
200
n = 28
aFT pMol/L
AFTC pMol/L
y = 0,1859x + 4,3797
R = 0,937
150
100
50
0
0 200 400 600 800 1000
Figure 2. Corrélations entre la testostérone libre dosée par dialyse à l’équilibre (AFTC) et A- calculée à partir de la testostérone totale et
de la SHBG (FT) et B- mesurée par la méthode utilisant un analogue (aFT). D’après « Vermeulen A. J Clin Endocrinol Metab 1999 ; 84 :
3666 ».
mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007 287
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

de Leydig pour stimuler la production de testostérone, la
FSH agissant sur la cellule de Sertoli pour stimuler le
processus de maturation au cours de la spermatogenèse.
Les gonadotrophines LH et FSH constituent un dosage
de seconde ligne, demandé par le clinicien devant un
abaissement de la testostérone plasmatique dans le but de
distinguer son origine secondaire (déficit hypothalamo-
hypophysaire ou hypogonadotrope) ou primaire (déficit
testiculaire ou hypergonadotrope), ou devant une anoma-
lie du sperme (cf. infra). Les hormones LH et FSH sont
couramment dosées par des méthodes immunométriques
de type sandwich avec 2 anticorps utilisant la fluores-
cence ou un traceur radioactif (IRMA). Ces techniques
sont plus sensibles que les anciens RIA, et de plus sont
spécifiques de la molécule entière. Les immuno-dosages
automatisés de LH et FSH donnent d’assez faibles varia-
tions inter-essais dans une étude menée auprès de 15
laboratoires australiens [4]. Il est difficile de définir des
normes pour ces dosages, certains hommes normaux
ayant des taux circulants de LH et/ou FSH bas voire
indétectables. Le dosage des gonadotrophines repose gé-
néralement sur une seule mesure, cependant le caractère
pulsatile de leur sécrétion (en particulier LH) fait préférer
plusieurs mesures répétées à 15-20 minutes d’intervalle.
L’étude de la pulsatilité de LH est un moyen indirect pour
examiner l’activité du générateur hypothalamique de
GnRH qui est libéré sous forme de pulses (épisodes sécré-
toires) générant eux-mêmes des pulses de LH et FSH. Cette
technique nécessite des prélèvements toutes les 10 minu-
tes sur des périodes de plusieurs heures, et une analyse par
un logiciel informatique qui permet de calculer notam-
ment la fréquence et l’amplitude des pulses de LH. Cette
technique sophistiquée est réservée à la recherche.
L’information fournie par les dosages de LH et FSH de
base est généralement suffisante en pratique clinique :
lorsque la testostérone plasmatique est basse, un taux
élevé de LH signe un déficit primaire leydigien, alors
qu’un taux de LH abaissé en dessous de la norme du
laboratoire ou dans la zone des valeurs normales signe un
déficit secondaire hypothalamo-hypophysaire. Devant un
taux de testostérone plasmatique totale dans les valeurs
basses de la normale, un taux de LH élevé traduit généra-
lement un déficit leydigien compensé. Parfois, les valeurs
normales de testostérone et LH traduisent une fonction
leydigienne conservée alors que l’élévation de FSH et
l’oligospermie témoignent de lésions séminifères au cours
de certains hypogonadismes primaires. Une situation par-
ticulière est celle d’un hypoandrisme associé à une éléva-
tion conjointe des taux circulants de testostérone et de LH
qui traduit le rare syndrome de résistance partielle aux
androgènes [12].
La bioactivité de LH ou FSH peut être mesurée in vitro
en utilisant respectivement des cellules interstitielles ou
sertoliennes isolées de rongeur, mais ces techniques ont
été supplantées par des modèles de cellules transfectées
avec le récepteur de FSH qui sont plus standardisables
[13]. L’étude de la bioactivité est lourde et difficilement
utilisable en clinique, dans des situations particulières
comme la recherche de formes anormales de LH [14].
Autres dosages
La prolactine
En cas d’hypogonadisme hypogonadotrope caracté-
risé par un abaissement de la testostérone plasmatique et
un taux normal ou bas de LH, un dosage de prolactinémie
permettra de dépister un adénome à prolactine à l’origine
du déficit. Il s’agit souvent d’un macroprolactinome chez
l’homme, parfois révélé par un syndrome tumoral hypo-
physaire – céphalées, hémi-anopsie bitemporale – alors
que les signes du déficit gonadotrope sont frustes voire
absents, ou bien négligés (lire Salenave et al. p. 329–36).
L’inhibine B
Le dosage d’inhibine B est considéré comme un mar-
queur de la fonction sertolienne, et son taux est abaissé
dans les déficits testiculaires primaires et d’origine haute.
Le taux d’inhibine B est inversement corrélé au taux
circulant de FSH, par l’action de rétrocontrôle qu’exerce
l’inhibine B sur cette dernière [15]. Au cours du syndrome
de Klinefelter, les taux d’inhibine B sont normaux en
période prépubertaire mais chutent à la puberté et sont
très bas chez l’adulte, traduisant la faillite de l’appareil
sertolien [16]. L’hypogonadisme hypogonadotrope s’ac-
compagne aussi de taux abaissés d’inhibine B qui tradui-
sent le déficit en gonadotrophines LH et surtout FSH [16].
L’inhibine B basale est d’ailleurs un prédicteur de la
réponse au traitement par GnRH pulsatile de l’hypogona-
disme hypogonadotrope, en termes de croissance testicu-
laire et de fertilité [17, 18]. Sous traitement par GnRH
pulsatile, l’inhibine B est rapidement stimulée attestant de
sa régulation à court terme par les gonadotrophines [19].
Chez l’homme infertile, le taux d’inhibine B améliore la
valeur prédictive de FSH sur la qualité du sperme et les
paramètres histologiques [15, 20]. Le dosage d’inhibine B
repose sur une technique immunométrique qui est mainte-
nant largement disponible dans les laboratoires spécialisés.
L’AMH
L’hormone antimüllérienne (AMH) est un produit de la
cellule de Sertoli immature, et un marqueur sensible du
déclenchement de la puberté via l’élévation de la testos-
térone intratesticulaire qui s’accompagne d’une chute de
l’AMH. Ainsi, chez l’homme adulte, les taux circulants
d’AMH sont très bas. Au cours des hypogonadismes hypo-
gonadotropes, l’AMH est au contraire élevée et inverse-
ment corrélée à la testostérone plasmatique et au volume
testiculaire. Les taux d’AMH les plus hauts sont retrouvés
dans les formes congénitales, alors que les formes acqui-
ses ont une sécrétion résiduelle de testostérone et des taux
intermédiaires d’AMH [21]. L’administration de FSH re-
combinante est capable de stimuler la production d’AMH,
alors que l’hCG induit une forte chute de l’AMH circu-
Revue
mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007
288
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%