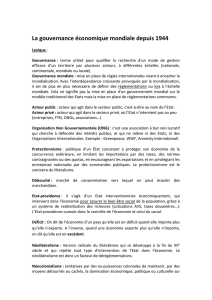La Mondialisation et l`imaginaire néolibéral de la

RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN ÉDUCATION
RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
Objectifs de
développement
durable
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
20
Introduction
La mondialisation
L’imaginaire néolibéral
Repenser la mission
del’éducation
Réformer la gouvernance
Problèmes soulevés par
l’imaginaire néolibéral
Conclusion: dépasser
l’imaginaire néolibéral
Fazal Rizvi1
Department of Global Studies in Education
Université de Melbourne
RÉSUMÉ
La plupart des politiques et des programmes récents de réforme de l’éducation ont été conçus,
légitimés et soutenus à partir de l’idée largement répandue qu’il est nécessaire d’aligner les
politiques et les pratiques éducatives sur les transformations économiques, politiques et culturelles
qu’implique la mondialisation. Cependant, cette implication a généralement été formulée d’un
point de vue néolibéral – en estimant que la mondialisation est un phénomène essentiellement
économique, où les marchés jouent un rôle fondamental dans la reconguration des relations
sociales. Ce mode de pensée s’est tellement répandu dans le monde que l’on peut à juste
titre parler d’un «imaginaire social». L’imaginaire néolibéral de la mondialisation a redéni la
mission et la gouvernance de l’éducation, en considérant celle-ci sous l’angle du capital humain
tout en soutenant les intérêts particuliers dans une société de plus en plus concurrentielle.
Leprésent article suggère que l’époque contemporaine impose de nouvelles façons d’interpréter
l’interconnectivité et l’interdépendance mondiales qui, par-delà les possibilités économiques de
lamondialisation, sont également sous-tendues par des préoccupations morales et interculturelles.
Il est, de ce fait, plus que jamais nécessaire d’œuvrer en faveur des biens communs mondiaux,
defaçon à ce que le monde cesse de dériver vers toujours plus d’inégalités, de déance et de
conit social.
1 Adresse électronique de l’auteur: [email protected]
Février 2017 La mondialisation et l’imaginaire
néolibéral de la réforme de l’éducation
ED-2017/WP/2

RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN ÉDUCATION • RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
2
INTRODUCTION
Les Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les États membres pour guider les gouvernements, le secteur privé
et la société civile en vue de mettre n à la pauvreté, de protéger la planète et de garantir à tous la prospérité, plaident en faveur
d’une nouvelle forme de mondialisation, qui conjuguerait bienfaits économiques, sociaux et environnementaux (Sachs, 2016).
Dans le domaine de l’éducation, l’idée de mondialisation s’est enracinée dans l’imagination populaire des responsables des
politiques éducatives du monde entier. La plupart des politiques et des programmes de réforme de l’éducation sont désormais
conçus, légitimés et soutenus à partir de l’idée largement répandue qu’il est nécessaire d’aligner les politiques et les pratiques
éducatives sur les transformations économiques, politiques et culturelles profondes qu’implique la mondialisation. Dans leur
ouvrage intitulé Handbook of Global Education Policy, Karen Mundy et ses collègues (2016) ont décrit de manière détaillée ces
transformations et la façon dont elles inuencent les directives en matière de réforme de l’éducation. Ils avancent ainsi que la
mondialisation du savoir et de l’économie a imposé de nouvelles façons d’aborder l’éducation. Ils observent que la circulation des
personnes dans le monde a transformé et diversié les communautés du monde entier, en leur permettant de rester en contact
malgré de vastes distances. Ils montrent que l’émergence des nouvelles technologies numériques a transformé la nature de la
communication, en encourageant la circulation mondiale des idées et des idéologies éducatives d’une manière inédite.
Dans le même temps, la mondialisation a fait apparaître de nouveaux modes de consommation, de nouveaux goûts culturels
et de nouveaux enjeux économiques, notamment chez les jeunes. La mondialisation a des eets très multiples sur l’existence
des jeunes, dont elle modie les aspirations et l’idée qu’ils se font des conditions sociales et économiques en mutation qu’ils
connaîtront plus tard. Ainsi, à l’heure actuelle, la majorité des jeunes sont conscients des pressions qui pèsent sur eux en
raison de l’évolution économique et culturelle inexorable. Ils réalisent qu’ils
connaîtront de nouveaux modes de travail et de subsistance, et que la
diversité culturelle, les échanges et les conits sont devenus un caractère
permanent de la vie sociale. Compte tenu de la dynamique qui caractérise
les médias sociaux de plus en plus mondialisés, les jeunes sont également
conscients que les établissements formels ne sont plus les seules sources
d’accès au savoir.
La mondialisation a transformé l’espace social qui servait de cadre à l’éducation. La plupart des responsables des politiques
éducatives réalisent que les établissements éducatifs ne peuvent plus promettre à leurs étudiants des vies professionnelles
dont la sécurité serait assurée. Ils reconnaissent que les profondes transformations associées à la mondialisation ont soulevé
des questions de légitimité et de conance à l’égard des établissements
éducatifs. Ils soutiennent toutefois que la mondialisation n’a pas uniquement
fait apparaître une série de nouveaux dés pour les établissements éducatifs,
mais a également suscité toutes sortes d’occasions nouvelles de repenser
l’éducation. Pour relever les dés de la mondialisation et réaliser son
potentiel, ils insistent sur le fait qu’il est non seulement souhaitable, mais
indispensable d’apporter des réformes majeures aux modes d’organisation
et d’administration de l’éducation. Ces préoccupations sont exprimées
dans le Cadre d’action Éducation 2030, qui souligne qu’il est essentiel que
l’éducation contribue à édier des sociétés paciques et durables, au sein du
monde globalisé que nous connaissons, traversé par des dicultés sociales,
politiques, économiques et environnementales non résolues. Le Cadre
d’action insiste également sur l’importance de renforcer la contribution de l’éducation à l’avènement des droits de l’homme,
de la paix et d’une citoyenneté responsable de l’échelon local à l’échelon mondial, de l’égalité des genres, du développement
durable et de la santé (UNESCO, 2015a).
En eet, certains spécialistes de l’éducation considèrent à l’instar de Zhao (2009) que la mission de l’éducation doit être
repensée et qu’il est nécessaire d’apporter des ajustements majeurs aux priorités des programmes d’études, aux approches
pédagogiques de l’apprentissage et aux pratiques d’évaluation à tous les niveaux de l’éducation. Cette façon de concevoir
la mondialisation et ses implications en vue de redénir la mission et la gouvernance de l’éducation semble désormais aller
desoi. Peut-être l’usage du terme «mondialisation» dans les discours sur l’éducation s’est-il en eet lui-même «mondialisé».
Cependant, si le mot semble être à la mode, l’idée à laquelle il renvoie fait par ailleurs l’objet de vifs débats. Sa dénition et ses
implications politiques sont loin de faire l’unanimité. Il a divisé les théoriciens comme les professionnels, et des controverses
majeures sont apparues quant aux origines historiques de la mondialisation, à ses diverses formes et à ses conséquences
[…] les jeunes sont également
conscients que les établissements
formels ne sont plus les seules
sources d’accès au savoir.
[…] la mondialisation n’a pas
uniquement fait apparaître une
série de nouveaux dés pour les
établissements éducatifs, mais a
également suscité toutes sortes
d’occasions nouvelles de repenser
l’éducation.

RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN ÉDUCATION • RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
3
politiques et culturelles. Certains associent l’idée de mondialisation au progrès, à la prospérité et à la paix, tandis qu’elle
évoque pour d’autres un sentiment de privation, de catastrophe et de malédiction. Sur le plan normatif, la mondialisation a
été diversement considérée comme une source majeure de possibilités nouvelles et d’optimisme pour le monde, et comme la
cause d’une instabilité et d’inégalités à des niveaux dangereusement élevés, au sein des nations et entre ces dernières.
La notion de mondialisation, aussi controversée soit-elle, renvoie
indiscutablement à de nouveaux modes d’organisation du monde
d’aujourd’hui, de production et de diusion du savoir, de communication des
communautés entre elles et de constitution des identités sociales. Il s’agit de
questions d’une importance considérable pour l’éducation. Ainsi, déterminer
la façon dont la mission de l’éducation pourrait être conceptualisée an
d’orienter les communautés vers des directions productives sur le plan social,
tout en conciliant les demandes concurrentes de l’économie et de la société,
est une question décisive. Toute aussi importante est la question de savoir
comment la réforme de l’éducation pourrait simultanément répondre aux
contraintes et aux priorités mondiales, nationales et locales.
Le présent article vise à encourager la réexion autour des récents débats
portant sur les enjeux de la mondialisation et les aspects politiques de
la réforme de l’éducation. Il émet l’idée que si les processus de mondialisation ont été décrits de diverses manières, une
conception particulière dans l’interprétation de ses formes et de ses eets s’est néanmoins imposée dans le monde, au
point qu’elle semble aller de soi. Cette conception repose sur un ensemble de postulats profondément idéologiques relatifs
à la notion de «néolibéralisme», l’idée selon laquelle il convient de laisser les marchés jouer un rôle fondamental dans la
dénition des priorités et des politiques de l’éducation. Cette interprétation de la mondialisation est aujourd’hui si répandue
et si communément admise dans notre conscience collective que l’on pourrait à juste titre considérer qu’elle constitue un
«imaginaire social» (Taylor, 2004).
D’après le présent article, l’imaginaire social néolibéral de la mondialisation a conduit à privilégier une façon particulière
de concevoir les besoins de la réforme de l’éducation, autour de la valorisation du marché. Cette approche a eu comme
conséquence majeure d’aaiblir le lien que l’éducation entretenait traditionnellement avec la notion de bien commun,
c’est-à-dire un bien à la disposition de tous envisagé comme une entreprise sociale collective, en mettant l’accent sur
l’importance d’un processus participatif pour le dénir, qui tiendrait compte de la diversité des contextes, des concepts de
bien-être et des écosystèmes de connaissances (UNESCO, 2015b). L’article soutient cependant que l’imaginaire néolibéral de
la mondialisation n’est en rien inévitable et que les postulats sur lesquels il repose doivent être remis en question sur le plan
politique. Si la mondialisation est un phénomène dont les manifestations ne peuvent plus être ignorées, il doit être possible
d’envisager les besoins de la réforme de l’éducation sans s’enfermer dans le cadre conceptuel de son imaginaire néolibéral.
Cela permettra également de considérer à nouveau l’éducation comme un bien commun, tout en prenant acte des réalités de
l’interconnectivité et de l’interdépendance mondiales et sans renoncer aux impératifs éthiques qui consistent à accorder une
égale importance aux dimensions économiques, sociales, culturelles et civiques de l’apprentissage.
LA MONDIALISATION
Ces trente dernières années, deux événements historiques majeurs peuvent être considérés comme à l’origine du phénomène
de la mondialisation contemporaine. Tout d’abord, les progrès des technologies de l’information et de la communication ont
modié les ux mondiaux de capitaux, d’informations, de personnes et de marchandises, à des volumes et à des rythmes sans
précédent. Enn, l’eondrement du bloc soviétique, dont la chute du Mur de Berlin est un symbole spectaculaire, a transformé
le paysage idéologique, imposant à l’échelle mondiale de penser les échanges économiques, politiques et culturels en termes
de marchés. Pour des auteurs tels que Fukuyama (1992), la n de la Guerre froide marque la «n de l’histoire», soit le triomphe
dénitif des principes du marché et de la démocratie libérale comme unique doctrine d’organisation des sociétés dans le monde.
Si la déclaration de Fukuyama peut sembler prématurée, il est indéniable que la faillite des discours idéologiques concurrents
tels que le communisme a créé les conditions favorables pour qu’une interprétation singulière de la mondialisation économique
occupe une place hégémonique dans le monde. Cette interprétation s’appuie sur toute une série de postulats concernant le
rôle des marchés dans l’organisation de la vie économique et sociale. Avec le temps, de nombreux aspect de l’existence ont
La notion de mondialisation, aussi
controversée soit-elle, renvoie
indiscutablement à de nouveaux
modes d’organisation du monde
d’aujourd’hui, de production
et de diusion du savoir, de
communication des communautés
entre elles et de constitution des
identités sociales.

RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN ÉDUCATION • RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
4
commencé à être dénis du point de vue des marchés, si bien que certains économistes comme Stiglitz (2002) en sont venus
à parler de «fondamentalisme de marché». À diérents égards, les postulats sur lesquels s’appuie ce fondamentalisme ont
légitimé les idées du libre-échange, favorisé de nouvelles façon de penser et d’organiser le travail et les relations de travail, et
privatisé des biens et des services autrefois considérés comme publics. Ils ont également validé les grands principes sur lesquels
les organisations internationales fondent leur action, permettant ainsi à ces dernières de promouvoir les idéologies de marché
plus largement et avec plus de conviction. Ils ont aussi encouragé de manière croissante des pays se considérant comme
socialistes, tels la Chine et le Vietnam, à adopter de nombreuses idées et pratiques du marché.
Les idéologies de marché se sont, semble-t-il, profondément enracinées dans notre conscience collective. Cela a conduit
un certain nombre de théoriciens à armer que la mondialisation est un phénomène largement économique, englobant
également un ensemble de processus sociaux qui suppose «l’inexorable intégration des marchés, des États-Nations et des
technologies à un degré jamais atteint auparavant, qui permet aux individus, aux entreprises et aux États-Nations d’étendre
leur portée tout autour du monde, plus loin, plus vite, plus résolument et à un moindre coût» (Friedman, 1999). L’expression
d’intégration mondiale est devenue universelle. Elle évoque un monde dans lequel les frontières nationales sont poreuses
et ne doivent pas faire obstacle à l’extension à l’échelle mondiale de l’accumulation de capital. L’activité économique doit
être débarrassée des barrières commerciales et des contraintes bureaucratiques imposées à l’échelon national. Même si cet
état d’esprit ne jouit plus d’une popularité aussi élevée qu’auparavant, l’idée d’échanges sans entrave à travers les frontières
nationales demeure le principe fondamental à partir duquel de nombreux responsables politiques cherchent à dénir les
formes appropriées des congurations économiques mondiales. L’«économie globale», un concept désormais largement
répandu dans notre lexique, se dénit comme fondée sur l’information et le savoir, post-industrielle et axée sur les services, et
bien entendu organisée en réseau à l’échelle mondiale (Castells, 2000).
L’idée d’économie globale appelle une nouvelle conception de la gouvernance, qui reconsidèrerait totalement les rôles et
les responsabilités des gouvernements nationaux, réduirait au minimum la nécessité de l’intervention des pouvoirs publics
et reposerait davantage sur les marchés. Elle suggère que les anciennes structures publiques bureaucratiques centralisées
sont trop lentes, inecaces et ne savent plus répondre aux nouveaux besoins du capital transnational, et que les formes
décentralisées de gouvernance sont plus compatibles avec les demandes de l’économie globale. Les discours en vogue
autour de l’économie globale tendent à montrer que celle-ci a également changé la nature de l’emploi, le rendant précaire,
temporaire et «exible», et nécessitant de nouvelles compétences et attitudes. Les rigidités du fordisme, qui privilégiaient
la standardisation, la production de masse et la prévisibilité des chaînes d’approvisionnement, ont été remplacées par
un nouveau modèle d’organisation post-fordiste reposant sur des formes d’administration verticalement intégrées et
des systèmes de livraison à ux tendus en vue de répondre aux besoins d’un marché mondial extrêmement sélectif.
Lesprocessus de production de plus en plus globaux laissent penser qu’il est désormais possible de travailler au sein d’équipes
transnationales, en mettant à prot le décalage horaire et les modes de consommation mondiaux liés à la diversité des goûts
et des préférences culturelles.
Tout cela a créé les conditions favorables à des interactions culturelles de plus en plus nombreuses entre les communautés
nationales et ethniques. Sans surprise, la mondialisation s’accompagne désormais de niveaux de mobilité de plus en plus élevés,
non seulement des capitaux, des nances, des biens et des services, mais aussi des personnes. Ces personnes traversent les
frontières nationales pour une multitude de raisons parmi lesquelles les migrations, l’accueil en tant que réfugié, le commerce
et les aaires, les perspectives d’emploi, le tourisme, la présence à des conventions et des conférences internationales, et
l’éducation. Ces niveaux de mobilité sans précédent sont à la fois la manifestation et le résultat des modes de fonctionnement
des systèmes économiques et politiques mondiaux (Urry, 2007). Ils reposent largement sur l’apparition de nouveaux goûts
culturels et modes de consommation, qui donnent lieu à des ux nanciers plus importants. La mobilité mondiale pour l’emploi
est aujourd’hui extrêmement valorisée par les capitaux mondiaux pour sa capacité à assurer une plus grande productivité
économique en faisant circuler les compétences les plus demandées et des ressources humaines abordables.
Autour de ces idées, de ces pratiques et de ces retombées de la mondialisation, il existe un discours populaire, qui englobe
toute une série d’idées relativement éloignées concernant de nouvelles formes de gouvernance politico-économique fondées
sur le développement des relations de marché. Le néolibéralisme ache une préférence pour une puissance étatique minimale,
s’attache à promouvoir les valeurs fondamentales de la concurrence, de la rentabilité économique et du choix, à déréguler
et à privatiser les fonctions de l’État. Comme l’arment Peck et Tickle (2002), le néolibéralisme favorise, et dans une certaine
mesure normalise, une approche des politiques fondée sur la croissance avant tout, faisant passer la protection sociale au
second plan. Il repose sur une adhésion généralisée à la logique du marché, souvent justiée en invoquant la rentabilité, voire la
«liberté», la «justice» et «l’équité». Il défend une idéologie du choix et privilégie le désengagement de l’État, la privatisation, la

RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN ÉDUCATION • RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
5
déréglementation et les régimes concurrentiels d’allocation des ressources.
Il défend le principe du libre-échange mondial, qui s’appliquerait aux biens
comme aux services, y compris les services de santé et d’éducation qui se
caractérisaient traditionnellement par leur dimension hautement nationale.
Le néolibéralisme remplace donc l’ancienne notion selon laquelle l’État était
tenu d’assurer certains biens et services pour garantir le bien-être social de la
population nationale.
L’IMAGINAIRE NÉOLIBÉRAL
Le néolibéralisme semble s’appuyer sur une représentation de la mondialisation dénie en termes objectifs, soit une description
neutre et allant de soi des réalités contemporaines. C’est pourtant loin d’être le cas puisque cette représentation ne se contente
pas de décrire une certaine évolution de l’organisation du monde, mais cherche également à dicter ce qu’elle devrait être.
Elle se présente comme la seule façon d’analyser la mondialisation, qui se composerait d’un ensemble de processus objectifs
donnant l’impression qu’ils doivent inévitablement se produire. Ce déterminisme historique encourage donc une lecture
spécique des transformations récentes de l’économie et de la culture mondiales – une façon particulière d’interpréter les
«faits» de l’interconnectivité et de l’interdépendance mondiales. Ses aspects normatifs passent ainsi inaperçus. Il masque
par exemple le postulat foncièrement idéologique selon lequel la mondialisation a principalement trait à la libéralisation et
à l’intégration mondiale des marchés et relève essentiellement de questions économiques. Les questions de politique et de
culture sont jugées secondaires, comme devant découler d’une logique économique présumée. Il donne par ailleurs à penser
que la mondialisation est une force historique inéluctable et irréversible qui bénécie à tous de la même manière. Sa neutralité
est également fondée sur l’illusion que personne ne maîtrise réellement les processus de la mondialisation et que les marchés
mondiaux possèdent leur propre logique intrinsèque.
Ces postulats idéologiques dépeignent donc des forces mondiales agissant hors de la portée de la volonté humaine.
Cependant, comme l’a fait observer Steger (2003), n’importe quel examen critique de ces postulats montre qu’ils sont fondés
sur des considérations politiques et contribuent à l’élaboration d’une dénition particulière de la mondialisation. En ce sens,
la conception néolibérale de la mondialisation est extrêmement normative et nous conduit vers une perception uniforme du
monde, espace unique au sein duquel nos problèmes seraient tous liés; imposant une vision du monde nous sommant de
reconnaître notre interdépendance, quoique d’un point de vue particulier. L’un des principaux problèmes soulevés par cette
conception cependant, c’est qu’elle considère la mondialisation comme «un phénomène prédéni, existant hors de la pensée»
(Smith, 2001) possédant sa propre logique. Elle n’admet pas que les processus mondiaux puissent être le résultat en perpétuelle
mutation de pratiques humaines, mais les perçoit plutôt comme l’expression de la logique plus profonde sous-tendant certains
prétendus impératifs économiques.
Le néolibéralisme présente donc divers aspects de la mondialisation comme des phénomènes inévitables avec lesquels les
populations, les institutions et les nations doivent simplement composer et négocier du mieux qu’elles peuvent. Certains sont
capables de tirer parti de ses possibilités, d’autres non. Ce point de vue s’appuie donc sur des hypothèses tenues pour acquises
concernant les modes de fonctionnement de l’économie mondiale et la manière dont les relations de pouvoir sont envisagées à
travers sa logique universelle. Il «ontologise» la logique de marché, en créant des sujets contraints de considérer leurs choix de
vie à travers le prisme conceptuel que constituent ses grands préceptes, qui mettent notamment l’accent sur les principes de
marché, le rôle minimal de l’État, un marché du travail déréglementé et, par-dessus tout, l’individualisme (Brown, 2014).
Bourdieu (2003) a montré comment les représentations prétendument descriptives de la mondialisation évoluaient souvent vers
des prescriptions normatives ou performatives en faveur d’un ordre économique qui devrait désormais englober l’ensemble
de la planète. Ce faisant, le rôle des choix politiques est passé sous silence. En ce sens, Bourdieu considère l’instauration d’une
économie globale dénie par le néolibéralisme comme un projet politique. Cette conception néolibérale de la mondialisation est
pourtant si dominante qu’elle s’est convertie au cours des dernières décennies en imaginaire social (Rizvi et Lingard, 2010).
Plus qu’une simple idéologie, elle a acquis un statut d’évidence, apparaissant comme l’unique manière dont il convient
d’envisager les relations économiques, politiques et culturelles. Elle est devenue une façon de penser partagée par les gens
ordinaires, une sorte de perception commune qui rend les pratiques quotidiennes possibles, et leur donne sens et légitimité.
Selon le philosophe canadien Charles Taylor (2004), l’idée d’imaginaire social renvoie à une combinaison complexe, non structurée
et contingente d’empirique et d’aectif, non pas «une interprétation pleinement articulée de l’ensemble de notre situation
Le néolibéralisme remplace donc
l’ancienne notion selon laquelle l’État
était tenu d’assurer certains biens et
services pour garantir le bien-être
social de la population nationale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%