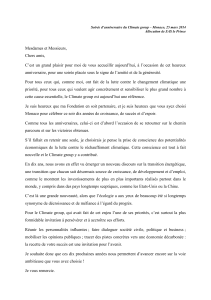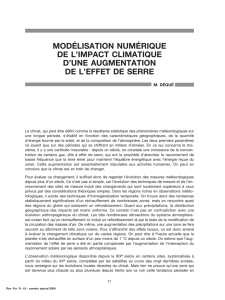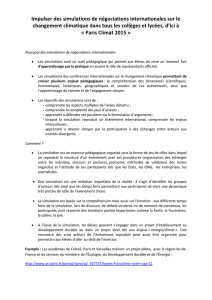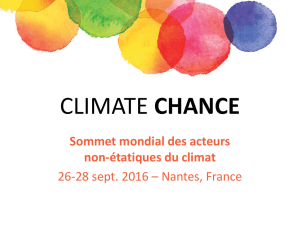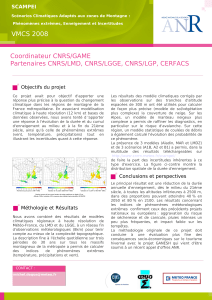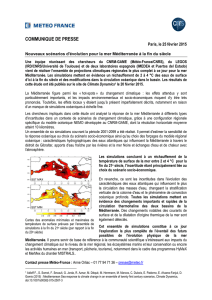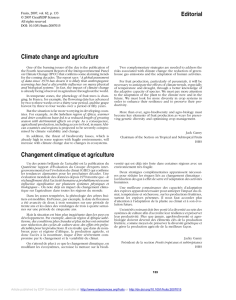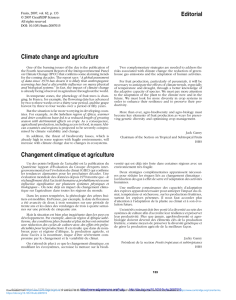Rapport principal - Centre National de Recherches Météorologiques

Compte-rendu de
fin de projet
Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
Projet ANR-08-VULN-0009-01
Scampei
Programme VMCS 2008
A I
DENTIFICATION
............................................................... 1
B R
ÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC
.................................................. 2
B.1 Instructions pour les résumés consolidés publics .......................... 2
B.2 Résumé consolidé public en français ........................................... 3
B.3 Résumé consolidé public en anglais ............................................ 4
C M
ÉMOIRE SCIENTIFIQUE
....................................................... 5
C.1 Résumé du mémoire ................................................................. 5
C.2 Enjeux et problématique, état de l’art ......................................... 6
C.3 Approche scientifique et technique.............................................. 7
C.4 Résultats obtenus..................................................................... 8
C.5 Exploitation des résultats......................................................... 10
C.6 Discussion ............................................................................ 10
C.7 Conclusions .......................................................................... 10
C.8 Références ............................................................................ 10
D L
ISTE DES LIVRABLES
........................................................11
E I
MPACT DU PROJET
............................................................13
E.1 Indicateurs d’impact ............................................................... 13
E.2 Liste des publications et communications................................... 14
E.3 Liste des éléments de valorisation............................................. 17
E.4 Bilan et suivi des personnels recrutés en CDD (hors stagiaires) .... 19
A I
DENTIFICATION
Acronyme du projet SCAMPEI
Titre du projet Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de
Montagne : Phénomènes extrêmes, Enneigement
et Incertitudes
Coordinateur du projet
(société/organisme)
CNRS / URA GAME
Période du projet
(date de début – date de fin)
1 janvier 2009
31 décembre 2011
Site web du projet, le cas échéant http://www.cnrm.meteo.fr/scampei/

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
2/20
Rédacteur de ce rapport
Civilité, prénom, nom M. Michel Déqué
Téléphone 05 61 07 93 82
Adresse électronique Michel[email protected]
Date de rédaction 01/02/12
Si différent du rédacteur, indiquer un contact pour le projet
Civilité, prénom, nom
Téléphone
Adresse électronique
Liste des partenaires présents à la
fin du projet (société/organisme et
responsable scientifique)
CNRS/GAME Michel Déqué
CNRS/LMD Laurent Li
CERFACS Laurent Terray
CNRS/LGP Vincent Jomelli
CNRS/LGGE Hubert Gallée
B R
ESUME CONSOLIDE PUBLIC
Ce résumé est destiné à être diffusé auprès d’un large public pour promouvoir les résultats du projet, il ne fera donc
pas mention de résultats confidentiels et utilisera un vocabulaire adapté mais n’excluant pas les termes techniques. Il
en sera fourni une version française et une version en anglais. Il est nécessaire de respecter les instructions ci-dessous.
B.1 I
NSTRUCTIONS POUR LES RESUMES CONSOLIDES PUBLICS
Les résumés publics en français et en anglais doivent être structurés de la façon suivante.
Titre d’accroche du projet (environ 80 caractères espaces compris)
Titre d’accroche, si possible percutant et concis, qui résume et explicite votre projet selon une logique grand public : il
n’est pas nécessaire de présenter exhaustivement le projet mais il faut plutôt s’appuyer sur son aspect le plus
marquant.
Les deux premiers paragraphes sont précédés d’un titre spécifique au projet rédigé par vos soins.
Titre 1 : situe l’objectif général du projet et sa problématique (150 caractères max espaces compris)
Paragraphe 1 : (environ 1200 caractères espaces compris)
Le paragraphe 1 précise les enjeux et objectifs du projet : indiquez le contexte, l’objectif général, les problèmes traités,
les solutions recherchées, les perspectives et les retombées au niveau technique ou/et sociétal
Titre 2 : précise les méthodes ou technologies utilisées (150 caractères max espaces compris)
Paragraphe 2 : (environ 1200 caractères espaces compris)
Le paragraphe 2 indique comment les résultats attendus sont obtenus grâce à certaines méthodes ou/et technologies.
Les technologies utilisées ou/et les méthodes permettant de surmonter les verrous sont explicitées (il faut éviter le
jargon scientifique, les acronymes ou les abréviations).
Résultats majeurs du projet (environ 600 caractères espaces compris)
Faits marquants diffusables en direction du grand public, expliciter les applications ou/et les usages rendus possibles,
quelles sont les pistes de recherche ou/et de développement originales, éventuellement non prévues au départ.
Préciser aussi toute autre retombée= partenariats internationaux, nouveaux débouchés, nouveaux contrats, start-up,
synergies de recherche, pôles de compétitivités, etc.
Production scientifique et brevets depuis le début du projet (environ 500 caractères espaces compris)
Ne pas mettre une simple liste mais faire quelques commentaires. Vous pouvez aussi indiquer les actions de
normalisation
Illustration

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
3/20
Une illustration avec un schéma, graphique ou photo et une brève légende. L’illustration doit être clairement lisible à
une taille d’environ 6cm de large et 5cm de hauteur. Prévoir une résolution suffisante pour l’impression. Envoyer
seulement des illustrations dont vous détenez les droits.
Informations factuelles
Rédiger une phrase précisant le type de projet (recherche industrielle, recherche fondamentale, développement
expérimental, exploratoire, innovation, etc.), le coordonnateur, les partenaires, la date de démarrage effectif, la durée du
projet, l’aide ANR et le coût global du projet, par exemple « Le projet XXX est un projet de recherche fondamentale
coordonné par xxx. Il associe aussi xxx, ainsi que des laboratoires xxx et xxx). Le projet a commencé en juin 2006 et a
duré 36 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de xxx € pour un coût global de l’ordre de xxx € »
B.2 R
ESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS
Des scénarios pour l'enneigement des massifs français au 21ème siècle
Modéliser le climat et son évolution en prenant en compte la diversité géographique du pays, en
particulier en montagne
La dernière génération de modèles climatiques régionaux atteint maintenant la résolution de 10 km, ce
qui est l'équivalent de la résolution horizontale des phénomènes observés sur la durée (analyses Safran
de Météo-France de 1958 à nos jours). Il reste cependant trois obstacles à franchir. Le premier est le
biais des modèles. Un système d'équations hydrodynamiques, même bien calibré, ne peut représenter
exactement la distribution des observations, ce qui pose un problème pour les phénomènes à seuil
comme la neige. Le deuxième est le climat de montagne. Même à résolution 10 km, on ne peut
représenter les pics et les vallées qui connaissent pourtant des conditions de surface très différentes, du
fait de l'altitude et des gradients verticaux de température. Le troisième est l'incertitude. On peut
contraindre les résultats des modèles à suivre plus ou moins le climat présent. On ne peut les empêcher
d'apporter des réponses différentes pour le climat futur. Le projet Scampei a développé une technique
originale pour produire des séries quotidiennes du climat sur trois périodes (passé, futur proche et futur
lointain) en fonction de la position géographique et de l'altitude. Les diverses sources d'incertitudes ont
été illustrées (3 modèles français) et quantifiées (14 modèles du Giec).
Une chaîne de modèles dynamiques et statistiques pour aboutir à des données d'enneigement par
tranche d'altitude
La construction de scénarios climatiques est issue au départ de scénarios du Giec. Une approche
directe consiste à utiliser un système d'identification de situations analogues qui relie une carte de
pression sur la France à une situation observée dans le passé. On peut ainsi, grâce aux analyses Safran
mentionnées plus haut fournir des séries météorologiques à haute résolution à partir de modèles à
résolution grossière (300 km) pour le passé comme pour le futur. Cette approche permet d'aborder
efficacement les incertitudes, mais ne s'appuie pas sur les phénomènes physiques de méso-échelle. A
partir de simulations Giec, nous avons extrait puis corrigé les températures de surface de l'océan
mondial. Nous les avons utilisées pour faire, avec des modèles atmosphériques, un deuxième jeu de
simulations plus fin (50 km sur l'Europe) et plus proche de la réalité. Les conditions atmosphériques
autour de la France ont été utilisées pour un troisième jeu de simulations à résolution encore plus fine
(10 km). Les séries quotidiennes issues des modèles ont été corrigées statistiquement par rapport à
Safran, par tranche verticale de 300 m. Les séries corrigées ont servi à piloter un modèle de sol-neige
de complexité supérieure à celle des modèles de climat.
Résultats majeurs du projet
Le principal résultat est la diminution forte dès le milieu du 21ème siècle de la durée d'enneigement de
tous les massifs, ce jusqu'à une altitude de 2500 m. A la fin du siècle la durée annuelle d'enneigement
est réduite de 80% dans les scénarios les plus pessimistes, mais 50% dans les scénarios optimistes. Ce
résultat est robuste malgré la forte disparité de la réponse des modèles en ce qui concerne les
précipitations. On note aussi une diminution du risque d'avalanche dans les Alpes du Nord, et une
augmentation du risque de lave torrentielle en été dans les Alpes du Sud.
Production scientifique et brevets depuis le début du projet
Le projet a donné lieu à un grand nombre de présentations nationales et internationales, orientées
parfois vers un public scientifique élargi. Des publications sont déjà parues, d'autres sont en cours
d'évaluation, d'autre enfin seront soumises en 2012. Pour n'en citer que trois, nous avons validé notre

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
4/20
modèle régional de climat sur la France (Colin et al., 2010) la technique statistique pour l'enneigement
sur les Alpes (Rousselot et al., 2012) et la technique statistique pour les laves torrentielles (Pavlova et
al., 2012).
Illustration
Variation (%) du nombre de jours par an à 1500 m avec une hauteur de neige au sol supérieure à 5cm
entre la période futur proche (2021-2050) et la référence (1961-1990) dans un des scénarios du projet.
Informations factuelles
Le projet Scampei (Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de Montagne : Phénomènes extrêmes,
Enneigement et Incertitudes) est un projet de recherche fondamentale coordonné par le Groupe d'étude
de l'atmosphère météorologique (CNRS/GAME). Il associe le Laboratoire de Météorologie
Dynamique (CNRS/LMD), le Centre Européen de Recherche et Formation Avancée en Calcul
Scientifique (CERFACS), le Laboratoire de Géographie Physique (CNRS/LGP) et le Laboratoire de
Glaciologie et Géophysique de l'Environnement (CNRS/LGGE). Le projet a commencé en janvier
2009 et a duré 36 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 555 k€ pour un coût global de 2388 k€.
B.3 R
ESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS
Scenarios for 21
st
century snow cover in French mountains
Modeling climate and its evolution taking into account the geographical diversity of the country,
in particular in mountain areas
The last generation of regional climate models reaches now 10 km horizontal resolution, which is
presently the resolution of long series of observed meteorological variables (Safran analyses, from
Météo-France, covers 1958-present). Three difficulties are to be coped with. The first one is model
bias. A set of hydrodynamical equations, even highly calibrated, cannot represent exactly the observed
series, which may be problematic with threshold phenomena like snow. The second difficulty is
mountain climate. Even at 10 km resolution, one cannot represent peaks and valleys. Due to
temperature vertical gradient, they undergo a different climate. The third difficulty is uncertainty. One
can tune models so that they represent past observed climate. But one cannot prevent different models
from proposing different responses for future expected climate. The Scampei project has developed an
original technique for producing daily series describing French climate over three time-slices (past,
near future, far future) as a function of geographical position and altitude. Various sources of
uncertainty have been illustrated (three French regional models) and quantified (14 IPCC global
models)
A suite of dynamical and statistical models leading to snow distribution as a function of elevation
Building possible future climates starts from IPCC scenarios. A straightforward technique consists of
using weather typing and analogs to connect surface pressure over France from a climate model with a
past observed situation. Thanks to the above mentioned Safran analyses, one can produce high
resolution meteorological series for the past as well as the future, using coarse resolution (300 km)
models. This approach is efficient for evaluating uncertainties, but does not rely upon mesoscale
phenomena in a physical way. A more complex technique has been developed from global sea surface
temperature of two IPCC models. The monthly means have been bias-corrected and injected in higher
resolution (50 km over Europe) global atmosphere models. This second set of simulations is more
reliable over Europe. The atmospheric data around France from this set have been used to produce a
third set of simulations at higher (10 km) resolution. The daily series of this third set have been
statistically corrected with respect to Safran analyses for different elevations (300 m vertical
resolution). The corrected time series have driven a soil-snow model of higher scientific complexity
than the snow parameterizations generally used in climate models.
Major results of the project
The main result is a strong decrease of snow cover duration over most areas below 2500m, as soon as
the middle of the 21
st
century. At the end of the century, the snow annual duration decreases by 80% in
the most pessimistic scenarios, by 50% in the most optimistic ones. This result is robust despite a
strong divergence of model responses, as far as precipitation is concerned. One can note also a
decrease in avalanche risk in northern Alps in winter, and an increase in debris flow risk in southern
Alps in summer
Scientific production and patents since the start of the project

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
5/20
The project has produced many national and international conferences toward our scientific
community, but also toward a broader public. A few scientific papers have been accepted. Some are
under review, and some will be submitted in 2012. To quote just three of them, we have validated our
climate model over France (Colin et al., 2010), the statistical downscaling technique for the Alps
(Rousselot et al., 2012) and the statistical scheme for debris flows (Pavlova et al., 2012).
Illustration
Variation (%) of the number of day per year at 1500 m elevation with snow depth above 5 cm,
between near future (2021-2050) and reference (1961-1990) in one of the scenarios of the project
Factual informations
Scampei (French acronym for « climate scenarios designed for mountain areas : extreme phenomena,
snow cover and uncertainties ») is a fundamental research project coordinated by the Groupe d'étude
de l'atmosphère météorologique (CNRS/GAME). It involves the Laboratoire de Météorologie
Dynamique (CNRS/LMD), the Centre Européen de Recherche et Formation Avancée en Calcul
Scientifique (CERFACS), the Laboratoire de Géographie Physique (CNRS/LGP) and the Laboratoire
de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement (CNRS/LGGE). The project has started in January
2009 and covered 36 months. It received a support from ANR of 555 k€ for a total cost of 2388 k€.
C M
EMOIRE SCIENTIFIQUE
Maximum 5 pages. On donne ci-dessous des indications sur le contenu possible du mémoire. Ce mémoire peut être
accompagné de rapports annexes plus détaillés.
Le mémoire scientifique couvre la totalité de la durée du projet. Il doit présenter une synthèse auto-suffisante rappelant
les objectifs, le travail réalisé et les résultats obtenus mis en perspective avec les attentes initiales et l’état de l’art. C’est
un document d’un format semblable à celui des articles scientifiques ou des monographies. Il doit refléter le caractère
collectif de l’effort fait par les partenaires au cours du projet. Le coordinateur prépare ce rapport sur la base des
contributions de tous les partenaires. Une version préliminaire en est soumise à l’ANR pour la revue de fin de projet.
Un mémoire scientifique signalé comme confidentiel ne sera pas diffusé. Justifier brièvement la raison de la
confidentialité demandée. Les mémoires non confidentiels seront susceptibles d’être diffusés par l’ANR, notamment
via les archives ouvertes http://hal.archives-ouvertes.fr.
Mémoire scientifique confidentiel : non
C.1 R
ESUME DU MEMOIRE
La dernière génération de modèles climatiques régionaux atteint maintenant la résolution de 10 km, ce
qui est l'équivalent de la résolution horizontale des longues bases de données observées sur la France,
comme les analyses Safran qui couvrent de 1958 à nos jours. Il reste cependant trois obstacles à
franchir pour pouvoir utiliser les sorties de modèles dans les études d'impact et de vulnérabilité. Le
premier est le biais de ces modèles. Un système d'équations hydrodynamiques, même bien calibré, ne
peut représenter exactement la distribution des observations, ce qui pose un problème pour les
phénomènes à seuil comme la neige. Le deuxième est le climat de montagne. Même à résolution 10
km, on ne peut représenter les pics et les vallées qui connaissent pourtant des conditions de surface
très différentes, du fait de l'altitude et des gradients verticaux de température. Le troisième est
l'incertitude. On peut contraindre les résultats des modèles à suivre plus ou moins le climat présent. On
ne peut les empêcher d'apporter des réponses différentes pour le climat futur. Le projet Scampei a
développé une technique originale pour produire des séries quotidiennes du climat sur trois périodes
(passé, futur proche et futur lointain) en fonction de la position géographique et de l'altitude. Les
diverses sources d'incertitudes ont été illustrées (3 modèles régionaux français à haute résolution) et
quantifiées (14 modèles globaux du Giec).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%