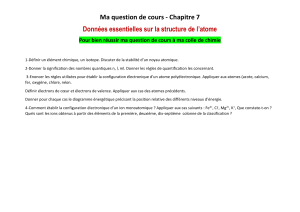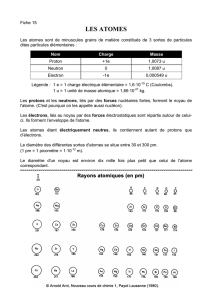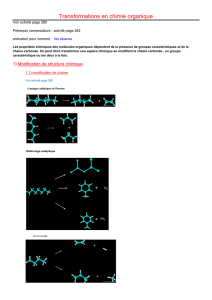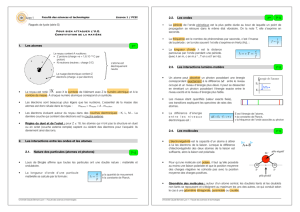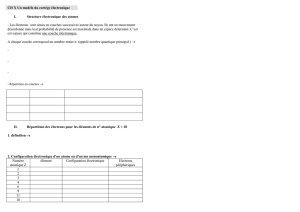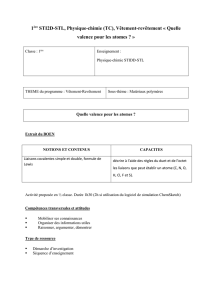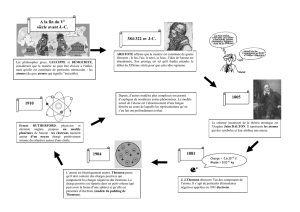Résumé - STI2D - lycée Saint Joseph Pierre Rouge

!
STAGE&DE&REMEDIATION&:&Les&bases&de&la&chimie&
A. L’atome,&molécules&et&ions&:&STRUCTURE&DE&LA&MATIERE&
!
!
!
!
!!
10
Chapitre 1 – SP20
L’
atome est constitué
d’
un noyau et
d’
é
l
ectrons en mouvement autour
d
u noyau.
Il
est é
l
ectriquement neutre.
L
’atome a une structure lacunaire, constitué par un no
y
au très petit, entouré d’un
e
space important et presque vide, le no
y
au étant char
g
é d’électricité positive.
L
es nucléons sont les particules qui peuplent le no
y
au : ce sont les protons et les
neut
r
o
n
s.
L
a masse
d’
un neutron est sensi
bl
ement éga
l
e à ce
ll
e
d’
un proton.
L
a quasi totalité de la masse de l’atome est concentrée en son no
y
au (plus de
9
9,97 %
)
.
L
e numéro atomique Z (ou nombre de char
g
e) d’un no
y
au est é
g
al au nombre de
p
rotons
q
u’il contient.
L
e nom
b
re
d
e nuc
l
éons
d’
un noyau est A. On
l’
appe
ll
e aussi nom
b
re
d
e masse.
L
e no
y
au de l’atome est s
y
mbolisé par : Z
AX
R
ésumé
Chapitre 1
C
himi
e
© Cned – Académie en ligne
16
Chapitre 2 – SP20
D
es atomes sont isotopes, s
’
i
l
s possè
d
ent
l
e même numéro atomique Z, mais
s
’ils di
ff
èrent par leur nombre de nucléons A.
U
n ion monoatomique est un atome qui a
g
a
g
né ou perdu, un ou plusieurs
é
l
ect
r
o
n
s.
L
es entités chimi
q
ues (atome, ion,)
p
ossédant le même numéro atomique
(
c’est-à-dire le même nombre de
p
rotons
)
a
pp
artiennent au même élément
chimique.
U
n élément chimique est caractérisé par un symbole chimique
(
et un nom
)
qui
l
ui sont propres.
U
n corps pur simple est un cor
p
s
p
ur constitué d’un seul élément chimi
q
ue.
U
n corps pur composé est un cor
p
s
p
ur constitué de
p
lusieurs éléments chimi
-
q
ues.
L
es é
l
ectrons
d
e
l’
atome se répartissent par couches électroniques
.
-
K pour
l
a première couc
h
e
-
L pour
l
a
d
euxième couc
h
e
-
M pour
l
a troisième couc
h
e
-
N pour
l
a quatrième couc
h
e et ainsi
d
e suite...
La
structure électronique d’un atome s’obtient en rem
p
lissant successive
-
m
ent les couches en commen
ç
ant
p
ar la
p
remière c’est-à-dire la couche K,
p
uis
l
ors
q
u’elle est saturée, la couche L et ainsi de suite de manière à ré
p
artir tous les
é
l
ect
r
o
n
s
de
l’
ato
m
e
.
R
ésumé
16
Chapitre 2 – SP20
Chapitre 2
C
himi
e
© Cned – Académie en ligne

!
!
!
!
!
Activité!1!:!livre!interactif!
!
http://www.col6bugatti6molsheim.ac6
strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=atomes3!
!
http://www.col6bugatti6molsheim.ac6
strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=atomes42008!
!
http://www.col6bugatti6molsheim.ac6
strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=ions!
!
!
Activité!2!:!applications!
!
http://sciencesphy.free.fr/lycee/index1.htm!puis!dans!«!seconde!»!et!!
6!exercice!sur!la!structure!de!l’atome!
6!exercice!sur!la!composition!de!l’atome!!
6!QCM!
6!constitution!des!ions!1!et!2!
6!structure!des!atomes!et!configuration!électronique!
!
Aide!structure!électronique!
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/tableau_cl
assification_periodique_elements_mendeleiev_lewis_structure_electronique.htm!
!
Activité!3!:!formation!des!ions!et!des!molécules!
24
Chapitre 3 – SP20
L
es gaz rares sont inertes c
h
imiquement parce qu
’
i
l
s possè
d
ent
d
eux é
l
ectrons
(
pour l’hélium
)
ou huit électrons
(
pour les autres
)
sur leur couche électronique
e
x
t
erne
.
A
u cours de réactions chimi
q
ues, on constate
q
ue les autres atomes du tableau
p
ériodique des éléments cherchent à acquérir cette confi
g
uration externe stable à
d
eux (rè
g
le du « duet ») ou huit électrons (rè
g
le de l’octet). Ils peuvent s’associer
e
ntre eux
p
ar des liaisons covalentes
p
our former des molécules
.
L
e nombre de liaisons covalentes établies par un atome est é
g
al au nombre
d’
é
l
ectrons à ra
j
outer sur sa couc
h
e externe pour o
b
éir aux rè
gl
es
d
u
d
uet et
d
e
l’octet
.
!
L
a
f
ormule
b
rute
d’
une mo
l
écu
l
e in
d
ique
l
a nature et
l
e nom
b
re
d’
atomes
q
ui
l
a constituent.
!
La
f
ormule d
é
velo
ppé
e
d’
une mo
l
écu
l
e
p
récise
l’
or
d
re
d
ans
l
e
q
ue
l
l
es
ato
m
es
so
n
t
li
és
l
es
u
n
s
au
x
aut
r
es
e
n
sc
h
é
m
at
i
sa
n
t
l
es
li
a
i
so
n
s
co
v
a
l
e
n
tes
(
doublets liants
)
.
!
La
f
ormule semi-dévelo
pp
ée sim
p
lifie l’écriture en ne re
p
résentant
p
as
l
es liaisons concernant les atomes d’h
y
dro
g
ène de la molécule
.
D
es molécules a
y
ant même formule brute sont isomères lors
q
u’elles ont un
e
n
c
h
a
în
e
m
e
n
t
d
’
ato
m
es
d
iff
é
r
e
n
t
.
R
ésumé
24
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
himi
e
© Cned – Académie en ligne

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Aides!:!
la!structure!de!LEWIS!et!formation!des!molécules!:!
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/tableau_cl
assification_periodique_elements_mendeleiev_regle_de_l_octet_du_duet.htm!
!
Les!molécules!en!3D!:!
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/molecules
_en_3D_flash_animation.htm!
!
!
19
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
h
i
m
i
e
1.2. Énoncé des rè
g
les
Ces rè
g
les concernent donc les électrons des couches externes
des
ato
m
es
.
Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en
g
a
g
és lors de la forma-
t
i
o
n
des
i
o
n
s
et
des
m
o
l
écu
l
es.
En adoptant la structure électronique d’un
g
az noble, l’élément chimique ne se
transforme
p
as en un autre élément car son numéro atomi
q
ue Z reste identi
q
ue ;
seu
l l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
é
l
ect
r
o
n
s
v
a
ri
e.
Un élément tend vers la structure électronique du
g
az noble le plus proche car
il est plus facile pour lui de
g
a
g
ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un
g
rand nombre
.
1.3. A
pp
lication aux ions monoatomi
q
ues stables
L’atome de sodium Na de structure électroni
q
ue
(
K
)
2
(
L
)
8
(
M
)
1
,
non sta
bl
e car
couche externe M non saturée, ne
p
eut exister seul.
Soit il
f
orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de
sodium Na), ou il s’ionise sous
f
orme Na
+
.
Pourquo
i
N
a
+
.et pas
N
a
-
?
En vertu
d
e
l
a rè
gl
e
d
e
l’
octet,
l’
atome Na a ten
d
ance à acquérir
l
a structure é
l
ec
-
tronique
d
u gaz rare
l
e p
l
us proc
h
e, soit
l
e néon
10
N
e ce qui se pro
d
uira s
’
i
l
per
d
1 électron et se « trans
f
orme » en ions N
a
+
stable car la couche externe
(
saturée
)
de l’ion est la couche L :
(
K
)
2
(
L
)
8
.
En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er
l’existence de l’ion monoatomique Cl-.
Nous com
p
renons mieux, maintenant,
p
our
q
uoi le chlorure de sodium NaCl (sel
de cuisine
)
(
constitué d’ions sodium et chlorure
)
existe
.
Les éléments de numéro atomi
q
ue com
p
ris entre 3 et 20 ne
f
orment
q
u’un seul
t
y
pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char
g
e porté par celui-ci en appli
-
quant
l
es rè
gl
es
d
u
d
uet ou
d
e
l’
octet.
Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-
ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro
atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :
• par formation d’ions monoatomiques
• par formation de molécules.
Activité 2
19
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne
18
Chapitre 3 – SP20
!
Connaître
l
es règ
l
es
d
u
d
uet et
d
e
l’
octet et savoir
l
es app
l
iquer pour ren
d
re
c
ompte
d
es c
h
arges
d
es ions monoatomiques existant
d
ans
l
a nature
.
!
D
onner
l
a représentation
d
e Lewis
d
e que
l
ques mo
l
écu
l
es simp
l
es
.
!
R
eprésenter des
f
ormules développées et semi – développées compatibles avec
l
es règ
l
es
d
u
d
uet et
d
e
l’
octet
d
e que
l
ques mo
l
écu
l
es simp
l
es
.
!
C
onnaître
l
a notion
d’
isomérie
.
!
S
avoir qu’à une
f
ormule brute peuvent correspondre plusieurs
f
ormules semi-
d
éveloppées di
ff
érentes.
1
.
L
es rè
gl
es
d
u
d
uet et
d
e
l’
octe
t
1
.1. Stabilité des
g
az nobles
Donner la structure électronique des gaz rares :
2
He ;
10
Ne ;
18
Ar
8
8
Quels est le nom de chacun de ces éléments ?
O
n constate
q
ue chacun de ces éléments a sa couche externe saturée ce
q
ui
e
x
p
li
q
ue leur
q
uasi-absence de réactivité (inertie chimi
q
ue) : ils ne
p
artici
p
ent
q
ue très rarement à des réactions chimi
q
ues.
D
e tous les éléments, les
g
az nobles (ou rares) sont stables à l’état d’atome
isolé
ca
r l
eu
r
couc
h
e
e
x
te
rn
e
est
saturée. Seuls les atomes de
g
az nobles (He,
N
e, Ar, Kr...) présentent une certaine inertie chimique, ce sont des
g
az monoato-
m
iques dans les conditions ordinaires de température et de pression. Cela si
g
nifie
q
ue tous les autres éléments sont instables à l’état d’atomes isolés
;
en effet
,
l
eur couche externe n’est
p
as saturée.
L
’étude des réactions chimi
q
ues montre
q
ue ces éléments évoluent vers l’état de
s
tabilité chimi
q
ue
q
ui corres
p
ond à la saturation de leur dernière couche d’élec-
t
rons, ce qui revient, pour eux, à acquérir la structure électronique du
g
az rare de
n
uméro atomi
q
ue le
p
lus
p
roche
.
*
soit 2 é
l
ectrons ou un «
d
uet »
d’
é
l
ectrons pour
l
es atomes
d
e numéro atomique
p
roc
h
e
d
e ce
l
ui
d
e
l’h
é
l
ium.
*
soit 8 é
l
ectrons ou un « octet »
d’
é
l
ectrons
p
our
l
es autres atomes
.
C
e sont
l
es règ
l
es
d
u
d
uet et
d
e
l’
octet que
l’
on peut écrire
.
Objectifs
Activité 1
Chapitre
3
Les molécules
18
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
himi
e
© Cned – Académie en ligne
19
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
h
i
m
i
e
1.2. Énoncé des rè
g
les
Ces rè
g
les concernent donc les électrons des couches externes
des
ato
m
es
.
Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en
g
a
g
és lors de la forma-
t
i
o
n
des
i
o
n
s
et
des
m
o
l
écu
l
es.
En adoptant la structure électronique d’un
g
az noble, l’élément chimique ne se
transforme
p
as en un autre élément car son numéro atomi
q
ue Z reste identi
q
ue ;
seu
l l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
é
l
ect
r
o
n
s
v
a
ri
e.
Un élément tend vers la structure électronique du
g
az noble le plus proche car
il est plus facile pour lui de
g
a
g
ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un
g
rand nombre
.
1.3. A
pp
lication aux ions monoatomi
q
ues stables
L’atome de sodium Na de structure électroni
q
ue
(
K
)
2
(
L
)
8
(
M
)
1
,
non sta
bl
e car
couche externe M non saturée, ne
p
eut exister seul.
Soit il
f
orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de
sodium Na), ou il s’ionise sous
f
orme Na
+
.
Pourquo
i
N
a
+
.et pas
N
a
-
?
En vertu
d
e
l
a rè
gl
e
d
e
l’
octet,
l’
atome Na a ten
d
ance à acquérir
l
a structure é
l
ec
-
tronique
d
u gaz rare
l
e p
l
us proc
h
e, soit
l
e néon
10
N
e ce qui se pro
d
uira s
’
i
l
per
d
1 électron et se « trans
f
orme » en ions N
a
+
stable car la couche externe
(
saturée
)
de l’ion est la couche L :
(
K
)
2
(
L
)
8
.
En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er
l’existence de l’ion monoatomique Cl-.
Nous com
p
renons mieux, maintenant,
p
our
q
uoi le chlorure de sodium NaCl (sel
de cuisine
)
(
constitué d’ions sodium et chlorure
)
existe
.
Les éléments de numéro atomi
q
ue com
p
ris entre 3 et 20 ne
f
orment
q
u’un seul
t
y
pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char
g
e porté par celui-ci en appli
-
quant
l
es rè
gl
es
d
u
d
uet ou
d
e
l’
octet.
Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-
ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro
atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :
• par formation d’ions monoatomiques
• par formation de molécules.
Activité 2
19
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne
19
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
h
i
m
i
e
1.2. Énoncé des rè
g
les
Ces rè
g
les concernent donc les électrons des couches externes
des
ato
m
es
.
Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en
g
a
g
és lors de la forma-
t
i
o
n
des
i
o
n
s
et
des
m
o
l
écu
l
es.
En adoptant la structure électronique d’un
g
az noble, l’élément chimique ne se
transforme
p
as en un autre élément car son numéro atomi
q
ue Z reste identi
q
ue ;
seu
l l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
é
l
ect
r
o
n
s
v
a
ri
e.
Un élément tend vers la structure électronique du
g
az noble le plus proche car
il est plus facile pour lui de
g
a
g
ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un
g
rand nombre
.
1.3. A
pp
lication aux ions monoatomi
q
ues stables
L’atome de sodium Na de structure électroni
q
ue
(
K
)
2
(
L
)
8
(
M
)
1
,
non sta
bl
e car
couche externe M non saturée, ne
p
eut exister seul.
Soit il
f
orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de
sodium Na), ou il s’ionise sous
f
orme Na
+
.
Pourquo
i
N
a
+
.et pas
N
a
-
?
En vertu
d
e
l
a rè
gl
e
d
e
l’
octet,
l’
atome Na a ten
d
ance à acquérir
l
a structure é
l
ec
-
tronique
d
u gaz rare
l
e p
l
us proc
h
e, soit
l
e néon
10
N
e ce qui se pro
d
uira s
’
i
l
per
d
1 électron et se « trans
f
orme » en ions N
a
+
stable car la couche externe
(
saturée
)
de l’ion est la couche L :
(
K
)
2
(
L
)
8
.
En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er
l’existence de l’ion monoatomique Cl-.
Nous com
p
renons mieux, maintenant,
p
our
q
uoi le chlorure de sodium NaCl (sel
de cuisine
)
(
constitué d’ions sodium et chlorure
)
existe
.
Les éléments de numéro atomi
q
ue com
p
ris entre 3 et 20 ne
f
orment
q
u’un seul
t
y
pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char
g
e porté par celui-ci en appli
-
quant
l
es rè
gl
es
d
u
d
uet ou
d
e
l’
octet.
Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-
ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro
atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :
• par formation d’ions monoatomiques
• par formation de molécules.
Activité 2
19
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne

!
!
!
!
ECRIRE%LA%REPRESENTATION%DE%LEWIS%DE%CES%MOLECULES%
%
Applications%:%http://sciencesphy.free.fr/lycee/index1.htm!puis!dans!«!seconde!»!et!!
6!exercice!sur!la!représentation!de!Lewis!1,!2!et!3.!
! !
20
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
himi
e
2
. Formules dévelo
pp
ée et semi-dévelo
pp
ée
d’u
n
e
m
olécule
D
ans la
f
ormule brute d’une molécule, on indi
q
ue le nombre d’atomes de cha
q
ue
é
lément en indice à droite du s
y
mbole. L’absence d’indice équivaut à 1
.
a.
La formule brute de la molécule d’eau est H2O. Indiquer le nombre
d’atomes de chaque élément de cette molécule.
b.
Même question pour la molécule de dioxyde de carbone CO2 et la
molécule d’éthanol : C2H6O.
2
.1. Liaison cova
l
ente
U
ne
l
iaison cova
l
ente est
l
a mise en commun
d’
un
d
ou
bl
et
d’
é
l
ectrons
p
ar
d
eux
a
tomes, c
h
aque atome apportant 1 é
l
ectron.
L
es deux électrons de la liaison covalente
f
orment un doublet liant.
U
n
d
ou
bl
et
l
iant est représenté par un tiret entre
l
es
d
eux atomes
.
L
i
a
i
so
n
co
v
ale
n
te
e
n
t
r
e
les
ato
m
es
A
et
B : A —
B
Compléter la phrase :
«
La
f
ormation d’une liaison de covalence entre deux atomes donne, à cha
q
ue
at
ome
,
.
.................................
électron(s) supplémentaire(s) sur sa couche externe. »
D
ans
l
a mo
l
écu
l
e AB chaque atome a gagné un électron
.
Les
d
eux é
l
ectrons
a
ppartiennent à la
f
ois à A et à B
.
la molécule satisfont aux règles de l’octet (ou du
duet) plus stables isolés
D
ans les modèles moléculaires, les atomes sont re
p
résentés conventionnellement
p
ar des boules de couleur. A cha
q
ue élément chimique corres
p
ond une couleur:
Élément
Ca
r
bo
n
e
A
z
ote
Oxyg
è
ne
Souf
r
e
Chlo
r
e
Couleur
B
l
a
n
c
N
oir
Bl
eu
Rou
g
e
Jau
n
e
Ve
r
t
L
es liaisons entre atomes sont matérialisées
p
ar des tiges
.
U
n
e
molécule
est
u
n
e
association électri
q
uement neutre d’atomes
.
Activité 3
Activité 4
D
u
Le nombre de liaisons covalentes n éta
bl
i par un atome est é
g
a
l
au
nombre d’électrons manquant
s
ur sa couche externe
p
our obéir aux
règles du duet ou de l’octet.
20
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne
21
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
h
i
m
i
e
a.
Faire un tableau avec les lignes suivantes: le nom, le symbole, le numéro
atomique Z, la structure électronique, et le nombre d’électrons sur la
couche externe, des atomes suivants placés en colonnes:
H (Z=1), C (Z=6), N (Z=7), O (Z=8), S (Z = 16) et Cl (Z=17).
b.
Ajouter au tableau précédent une ligne indiquant le nombre d’élec-
trons manquant sur la couche externe de l’atome pour obéir aux règles
du duet ou de l’octet.
c.
Ajouter au tableau précédent une ligne indiquant le nombre de liaisons
covalentes noté n.
Pour satis
f
aire à la rè
g
le de l’octet, certains atomes sont liés entre eux par plus
d’un doublet liant : ce sont
d
es liaisons multiples : doubles
(
deux tirets
)
ou
A
—
— B
—
triples
(
trois tirets
)
A
—
—
—
B
.
2.2. Formules dévelo
pp
ée et semi-dévelo
pp
ée d’une molécule :
! L
a
form
u
l
e
br
u
t
e
d’
une mo
l
écu
l
e in
d
i
q
ue
l
a nature et
l
e nom
b
re
d’
atomes
qui la constituent.
! L
a
formule dévelo
pp
é
e
d’une molécule
p
récise l’ordre dans le
q
uel les
ato
m
es
so
n
t
li
és
l
es
u
n
s
au
x
aut
r
es
e
n
sc
h
é
m
at
i
sa
n
t
l
es
li
a
i
so
n
s
co
v
a
l
e
n
tes
(
doublets liants
)
.
!
L
a
f
ormule semi-d
é
velopp
é
e simpli
f
ie l’écriture en ne représentant pas
l
es
l
iaisons concernant
l
es atomes
d’h
y
d
rogène
d
e
l
a mo
l
écu
l
e.
La molécule de
p
ro
p
ane : Formule dévelo
pp
ée :
F
o
rm
ule
b
r
ute
:
C
3
H
8
H
CH
H
H
C
H
H
C
H
H
Formu
l
e semi-
d
éve
l
oppée :
H
3
C
-
C
H
2
-C
H
3
Activité 5
!
E
xem
p
le
Formules développées et semi-développées sont des
re
p
résentations
p
lanes des molécules et ce, même si
la
p
lu
p
art des molécules sont tridimensionnelles
.
Remarque
21
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne
22
Chapitre 3 – SP20
Chapitre 3
C
himi
e
2
.3. Comment déterminer la
f
ormule développée (ou semi-déve-
l
o
pp
ée) d’une molécule à
p
artir de sa formule brute ?
P
renons
l’
exem
pl
e
d
e
l
a mo
lé
cu
l
e
d’
eau. Des
é
tu
d
es ex
pé
r
i
menta
l
es montrent
q
ue la molécule est
f
ormée de deux atomes d’h
y
dro
g
ène et de un atome d’ox
y
-
g
ène. On représente ainsi la
f
ormule de l’eau :
Fo
rm
ule
b
r
ute
de
l’eau
: H
2
O.
a
. la molécule est constituée de 2 éléments : oxygène O :
(
K
)
2
(
L
)
6
et
h
y
d
rogène
H
:
(
K
)
1
.
b
.
l’
atome
d’
oxygène contient
d
onc n
e
= 6 é
l
ectrons et
l’
atome
d’h
y
d
rogène 1
é
lectron dans leur couche externe. Donc l’oxygène
f
orme 2 liaisons et chaque
h
y
d
rogène 1 seu
l
e
l
iaison.
c
. La
f
ormule développée de la molécule d’eau est alors : H-O-H.
En utilisant la méthode illustrée ci–dessus, établir la formule développée
des molécules :
•
Di
hyd
ro
g
ène H
2
•
Dic
hl
ore C
l
2
•
C
hl
orure
d’hyd
ro
g
ène HC
l
•
Ammon
i
ac NH
3
•
L
e
m
ét
h
a
n
e
C
H
4
D
ans tous ces exemples, les atomes ne
f
orment entre eux qu’une seule liaison
d
e cova
l
ence
.
D
ans les exemples qui vont suivre, il
f
aut envisager l’existence de plusieurs
l
iaisons entre certains atomes ; ce sont
d
es
l
iaisons mu
l
tip
l
es :
•
2
l
iaisons entre 2 atomes est appe
l
ée liaison double.
(
ou double liaison
)
.
•
3
l
iaisons entre 2 atomes est appe
l
ée liaison triple.
(
ou triple liaison
).
D
ans la formule dévelo
pp
ée de la molécule, on
p
lace alors les tirets (re
p
résentant
l
es liaisons
)
les uns au dessus des autres
.
Donner la formule développée des molécules suivantes :
•
diox
yg
ène O
2
•
l’
ét
h
è
n
e
C
2
H
4
•
diox
y
de de carbone CO
2
O
n remar
q
uera
q
ue l’éthène est une molécule
p
lane
.
l’
l
d
l
lé
l
d
’
é
d
é
i
l
a.
A partir
d
es numéros atomiques
,
écrire
l
a structure électronique
d
e tous
l
es
é
l
éments c
h
imiques contenus
d
ans
l
a mo
l
écu
l
e.
b.
En
d
é
d
uire
l
enombre de liaisons covalentes que doit
f
ormer chaque atome
pour respec
t
er la règle du duet ou de l’octet
.
c.
Chercher alors la (ou une )
f
ormule développée ou semi-développée.
Activité 7
Activité 8
22
Chapitre 3 – SP20
© Cned – Académie en ligne

B. La&quantité&de&matière&
!
!
!
!
!
Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!ne!dépend!que!de!la!température!et!de!la!
pression!:!
Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!à!0°C!sous!1!atm!est!de!22,4!L!
Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!à!20°C!sous!1!atm!est!de!24,0!L!
!
!
!
L
a mo
l
e est
l’
unité
d
e quantité
d
e matière. E
ll
e permet au c
h
imiste
d
e passer
d
e
l
’échelle microscopique
(
atome, molécule
)
à l’échelle macroscopique
(
la nôtre
)
.
U
ne mo
l
e
d’
entités c
h
imiques correspon
d
à un paquet
d’
entités contenant
6
,
02
.1
0
23
entités. Ce nom
b
re, noté
N
A
est appe
l
é constante
d’
Avoga
d
ro ;
N
A
=
6
,
02
.1
0
23
mo
l
-1
.
L
a quantité de matière dési
g
ne le nombre de moles de matière contenues dans
u
n échantillon donné ; elle est s
y
mbolisée par la lettre n.
A
insi
,
en consi
d
érant un éc
h
anti
ll
on
d
e matière contenant N entités é
l
émentaires
,
à
cha
q
ue
f
ois
q
ue l’on a 6,02.10
23
entités, on dit
q
ue l’on a 1 mole d’entités. Il
y
a donc proportionnalité entre le nombre N et la quantité de matière n selon :
nN
NA
=
n
:
q
uantité de matière (mol.)
N
A
: constante d’Avo
g
adro (mol-
1
)
N
: nombre d’entités (sans unité)
L
a masse molaire atomi
q
ue est la masse d’une mol e d’atomes. Elle est notée M
e
t est exprimée en
g
.mol-
1
.
La
m
asse
m
o
l
a
ir
e
m
o
l
écu
l
a
ir
e
est
l
a
m
asse
d
’
u
n
e
m
o
l
e
de
m
o
l
écu
l
es
. Ell
e
s
’exprime aussi par le s
y
mbole M. elle se calcule en additionnant les masses
m
olaires atomi
q
ues de chacun des atomes constituants cette molécule.
L
a re
l
ation entre quantité
d
e matière et masse est :
m
=
n
!
M
m
: masse de l’échantillon
(
g
)
n
: quantité de matière
(
mol.
)
M
: masse molaire du corps pur
(
g.mol
-1
)
.
Chapitre 5
C
himie
48
Chapitre 5 – SP20
R
ésumé
© Cned – Académie en ligne
46
Chapitre 5 – SP20
Chapitre 5
C
himi
e
O
n
d
onne
l
es masses mo
l
aires atomi
q
ues :
El
é
m
e
n
t
H
C
N
O
S
M
asse
m
o
l
a
ir
e
M
(
g
.mol
-1
)
1
12
14
16
32
! Masse mo
l
aire ioni
q
ue
La masse molaire ionique est la masse d’une mole d’ions. On
p
eut
n
é
g
li
g
er la masse des électrons devant la masse du no
y
au de l’atome ; la masse
m
olaire d’un ion se calcule sans tenir compte de la masse des électrons
g
a
g
nés
o
u
p
erdus
.
M
N
a+ ≈
M
N
a= 23 g.mo
l
-1
M
SO
4
2
-
≈M
SO
4 =
M
S
+
4M
O
= 96 g.mo
l
-1
Calculer la masse molaire des ions :
•
K
+
•
C
l
-
•
PO
4
3
-
Données :
Mgmol
Mgmol
Mp g mol
M
Cl
O
K
=
=
=
=
−
−
−
35 5
16
31
3
1
1
1
,.
.
.
99 1
gmol
.−
2
.2 Relation entre
q
uantité de matière et masse.
D’a
p
rès la défi nition de la masse molaire, on a la relation :
! Exem
ple
Activité 3
n= m
M
n:quantitédematière(mol)
m:masse(g)
M::massemolaire(g.mol )
–1
Exemple:dans100gd'eau, quelle quantité ddematière ?(M = 18g.mol )
n=
m
M
HO -1
HO
HO
HO
2
2
2
2
== 100
18 =5,55mol.
© Cned – Académie en ligne
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%