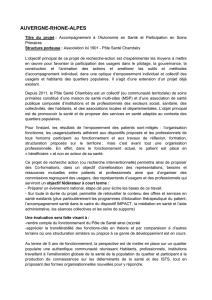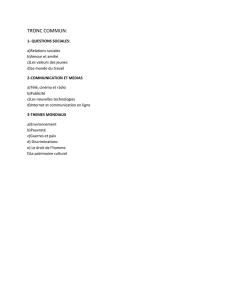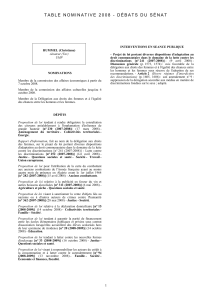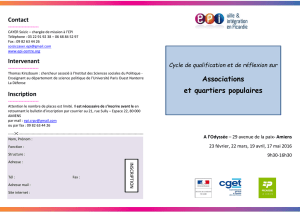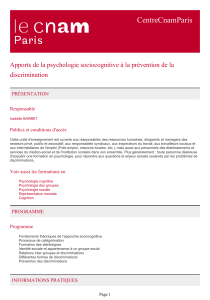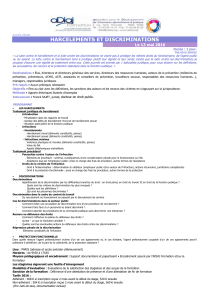Claris. La revue n3 - Site Ressources des Ceméa Pays de Loire

www.groupeclaris.org
CLARIS. LA REVUE
Avril 2007
Discriminations, ségrégation, ghettoïsation :
quel avenir pour les quartiers populaires ?
Numéro
3

CLARIS. LA REVUE, 2007, n°3 (avril)
1
11
1
Au sommaire
Editorial (pages 2-3)
L’emploi : des discriminations qui persistent malgré les beaux discours
Le processus de ghettoïsation : éléments d’introduction (pages 4-6)
Par Laurent Mucchielli
Les discriminations à l’embauche (pages 7-10)
Par Michel Luci
Des discriminations plus légitimes que d’autres ? Les emplois fermés aux étrangers (pages 11-13)
Par Christophe Daadouch
L’école : une ségrégation qui contredit tous les jours l’idéal républicain
Les mécanismes de la ségrégation scolaire (page 14-16)
Par Agnès Van Zanten
La carte scolaire face à la ségrégation urbaine (pages 17-21)
Par Marco Oberti
L’annonce de la désectorisation comme d’un progrès: prémisse à une solitude éducative totale ?
Par Laurent Ott (pages 22-25)
Le logement social : une situation critique et des réponses politiques hypocrites
Les enjeux du logement social (pages 26-31)
Par Eric Pélisson
La gestion du risque socio-ethnique dans le logement social (pages 32-39)
Par Mohamed Belqasmi
C L A R I S : « C L A R I F I E R L E D E B A T P U B L I C S U R L A S E C U R I T E »
R é d a c t e u r e n c h e f
: L a u r e n t M u c c h i e l l i
C o m i t é d e r é d a c t i o n
: M a n u e l B o u c h e r , C h r i s t o p h e D a a d o u c h , N a s s e r D e m i a t i ,
R o g e r K e n t c h u a i n g , Y a z i d K h e r f i , V é r o n i q u e L e G o a z i o u M a r w a n M o h a m m e d ,
L a u r e n t O t t .
W e b m a s t e r
: J é r é m i e W a i n s t a i n .
C o n t a c t s
: c o n t a c t @ g r o u p e c l a r i s . o r g

CLARIS. LA REVUE, 2007, n°3 (avril)
2
22
2
Editorial
Clarifier le débat sur la sécurité : telle est la devise de Claris depuis sa fondation autour de l’été 2001,
à un moment où « l’insécurité » envahissait le débat médiatico-politique de façon quasi exclusive et
dans une moralisation qui interdisait pratiquement toute analyse intellectuelle. Evoquer les problèmes
économiques, sociaux et politiques devenait alors presque impossible, sous peine d’être dénoncés
comme de dangereux irresponsables méprisant les victimes et cherchant à « donner des excuses » aux
délinquants.
En ce mois d’avril 2007, à l’approche d’un autre second tour d’élection présidentielle, après cinq
années marquées par une accentuation considérable de la répression (création de nouvelles infractions
en pagaille, renforcement des moyens et des contrôles policiers, révolution dans la procédure pénale,
abaissement des seuils d’âges pour les sanctions, alourdissement des peines et augmentation de près de
20 % de la population carcérale), la situation ne nous semble pas avoir fondamentalement évolué.
Pourquoi ne parle t-on pratiquement pas de sécurité dans la campagne de 2007 ?
La raison principale de ce demi silence tient naturellement au fait que cela reviendrait à faire le bilan
du gouvernement sortant et en particulier du ministre de l’Intérieur N. Sarkozy. Or ce bilan nous
semble globalement négatif, pour au moins trois raisons. Premièrement, sa façon d’instrumentaliser
les statistiques de police, à des fins de management mais aussi de communication politique et de
promotion personnelle, a rendu pratiquement impossible une analyse de la réalité de l’évolution de la
délinquance connue des services de police et de gendarmerie. Deuxièmement, son discours vindicatif,
guerrier, insultant et méprisant envers les habitants des quartiers populaires a été une des causes des
émeutes de novembre 2005. Troisièmement sa façon de gérer les forces de police, et notamment
d’enterrer la police de proximité qui tentait péniblement de se mettre en place, a accru non seulement
les violences policières, mais aussi les violences subies par les policiers. De manière générale, son
action a accéléré une dégradation des relations entre la police et les citoyens dont nous sommes tous
victimes, y compris les policiers qui s’en rendent compte même s’ils n’osent généralement pas le dire
ouvertement de peur des représailles. On lira à ce propos le tout récent sondage réalisé par le Syndicat
Général de la Police (FO) et disponible sur http://www.sgp-fo.com. Sur les 5 051 policiers qui ont
rempli le questionnaire, 55 % déclarent que leur situation professionnelle s’est « plutôt dégradée »,
69 % pensent que leurs conditions de travail se sont « plutôt détériorées », 76 % pensent que les
conditions de leurs interventions sur la voie publique se sont également « plutôt dégradées », 74 %
pensent que leurs rapports avec la population ne se sont pas améliorés depuis 5 ans, 77 % pensent que
l’image de la police nationale ne s’est pas améliorée depuis 5 ans et pour finir 60 % ne conseilleraient
pas ce métier à leurs propres enfants…

CLARIS. LA REVUE, 2007, n°3 (avril)
3
33
3
Certes, au contraire de 2002, la campagne électorale a été marquée par une grande diversité dans
les thèmes abordés, au point même de reléguer les questions de sécurité en deçà des attentes des
Français si l’on en croit les enquêtes d’opinion. Mais la façon dont ces thèmes ont été traités ne nous
rassure pas. Sans même parler des dérives du candidat de droite qui visait, et qui a réussi, à attirer vers
lui une partie des électeurs du Front national, il nous semble que, derrière les déclarations d’intention
et les indignations, certains enjeux de fond pour l’avenir de la société française n’ont même pas été
aperçus par la plupart des candidats. C’est le cas en particulier des processus de ghettoïsation qui
travaillent la société depuis un quart de siècle et sur lesquels nous voulons insister aujourd’hui.
Les quartiers populaires – « zones urbaines sensibles » dans la vocabulaire officiel – ne sont certes
pas les seuls territoires en grande difficulté dans la société française. Et les processus que l’on y
observe n’y sont pas toujours spécifiques. A certains égards, ils sont seulement un « miroir
grossissant » de problèmes qui concernent toute la société. Reste que, ne pas analyser ces problèmes
est doublement dramatique. D’abord parce que, une fois de plus, cela risque de conduire le futur
gouvernement à développer des politiques publiques qui, quelles que soient leurs intentions, ne seront
pas au niveau des problèmes et conduiront à constater au final leur incapacité à changer la donne.
L’histoire de la politique de la ville devrait tout de même nous servir de leçon ! Ensuite parce que, en
sous-estimant gravement la nature comme l’ampleur des processus de ghettoïsation, on finit toujours
d’une façon ou d’une autre par accuser les habitants de ces quartiers d’être des « assistés » et de ne pas
faire ce qu’il faut pour « s’en sortir ». Et, en fin de compte, comme ces habitants ont notamment pour
caractéristique d’être souvent « issus de l’immigration », on risque fort de renforcer encore davantage
la peur, la suspicion et la xénophobie dont ils sont de plus en plus victimes.
Sortir de ce cercle vicieux suppose non seulement que nos dirigeants soient capables de
transformer notre regard sur ces quartiers et sur leurs habitants, mais encore qu’ils soient en mesure
d’identifier les véritables causes des problèmes. Faute de quoi, ils continueront à creuser les tranchées
qui séparent de plus en plus les conditions de vie des uns et des autres, ils continueront à nous dresser
de plus en plus les uns contre les autres.
LM

CLARIS. LA REVUE, 2007, n°3 (avril)
4
44
4
Le processus de ghettoïsation : éléments d’introduction
Laurent Mucchielli
*
A
u terme de plus de vingt ans d’études sur les quartiers populaires et de diagnostics liés à la politique
de la ville, la démonstration n’est plus à faire
1
. Les 751 ZUS, dans lesquelles vivaient 4,7 millions de
personnes au recensement de 1999 (soit 8 % de la population française, et 12 % des Franciliens),
concentrent les situations de précarité et d’exclusion. A tel point qu’il nous semble légitime de parler
d’un processus de ghettoïsation. Certes, il ne s’agit pas de suggérer une comparaison directe entre les ZUS
françaises et les ghettos de certaines grandes villes d’Amérique du Nord ou du Sud
2
. Pour autant, il ne
faudrait pas s’interdire de penser l’existence d’un processus de « séparatisme social » éloignant de plus
en plus les conditions de vie et les destins des différents groupes sociaux
3
. Pour nous, ce processus de
ghettoïsation a deux faces, trop rarement étudiées de concert : l’une objective, relative aux conditions
de vie des habitants et aux difficultés d’insertion socio-économique qui se posent massivement pour la
jeunesse, l’autre subjective, relative aux représentations que les habitants se forgent d’eux-mêmes, des
différents groupes sociaux qui composent la société et de leurs relations.
Les ZUS se caractérisent par une triple concentration 1) des familles nombreuses, voire très
nombreuses, et donc la jeunesse de leur population (les moins de 25 ans peuvent représenter 50 % de
la population sur certains îlots), 2) des milieux populaires à faible revenu et à fort taux de chômage, 3)
des populations étrangères et d’origine étrangère. Ces premiers facteurs peuvent déjà susciter un
sentiment de « différence » par rapport au reste de la société. Ce sentiment peut ensuite s’enraciner de
façon décisive dans le rapport des familles aux institutions et, en premier lieu, à l’école. Faiblement
dotés en capital culturel et scolaire, ayant souvent des difficultés de maîtrise de la langue française, les
parents sont à la fois peu outillés face à la culture de l’institution et très démunis pour assurer le suivi
scolaire des enfants
4
. De fait, les problèmes précoces de scolarité, le taux de redoublement, le taux
d’échec scolaire, le poids des orientations vers l’enseignement professionnel et l’absentéisme sont
*
Sociologue, chercheur au CNRS. Ce texte est extrait de la nouvelle édition de Quand les banlieues brûlent. Retour sur les
émeutes de novembre 2005 (Paris, La Découverte, mars 2007, sous la direction de L. Mucchielli et V. Le Goaziou).
1
. Voir la synthèse de C. Avenel, Sociologie des « quartiers sensibles », Paris, Armand Colin, 2004 ; ainsi que les rapports de
l’Observatoire national des ZUS (http://www.ville.gouv.fr).
2
L. Wacquant, Parias urbains. Ghetto, banlieues, État, Paris, La Découverte, 2006, p. 145-171.
3
Voir les constats convergents de E. Maurin, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Paris, Seuil, 2004 ; H.
Vieillard-Baron, Des banlieues françaises aux périphéries américaines : du mythe à l’impossible confrontation ?,
Hérodote, 2006, 122, p. 10-24 ; J. Donzelot, Quand la ville se défait, Paris, Seuil, 2006.
4
A. Van Zanten, L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Presses Universitaires de France, 2001 ; M.
Millet, D. Thin, Ruptures scolaires. L’école à l’épreuve de la question sociale, Presses Universitaires de France, 2005.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
1
/
39
100%