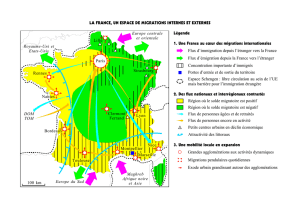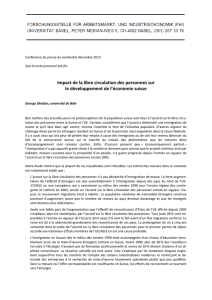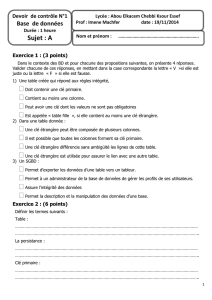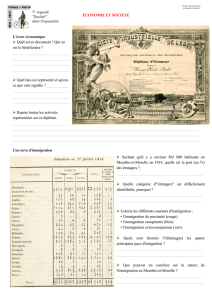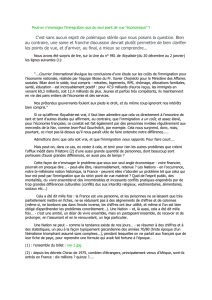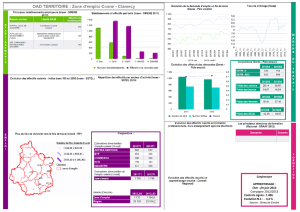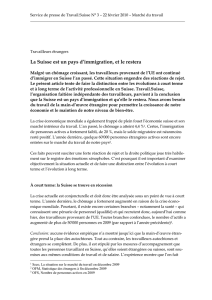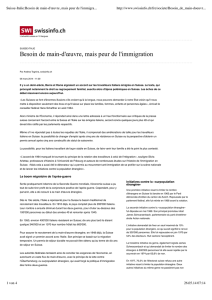Alexandre Afonso

TRAVAUX DE SCIENCE POLITIQUE
Nouvelle série
n° 16
INTERNATIONALISATION, ECONOMIE
ET POLITIQUE MIGRATOIRE
DANS LA SUISSE DES ANNEES 1990
Alexandre Afonso
Université de Lausanne
Département de Science Politique
BFSH 2 - 1015 Lausanne

6
Cette collection vise à diffuser des travaux de chercheurs rattachés au Département de Science Politique
de l'Université de Lausanne. Il peut s'agir de textes en pré-publication, de communications scientifiques
ou de documents pédagogiques. Ces travaux sont publiés sur la base d’une évaluation interne par trois
membres de l’IEPI. Les opinions émises n'engagent cependant que la responsabilité de l'auteur.
Le texte publié ici est une version légèrement remaniée d’un mémoire de licence
soutenu à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de
Lausanne en octobre 2003, effectué sous la direction du Dr. André Mach.
Je tiens ici à remercier chaleureusement André Mach pour ses conseils pertinents
et l’opportunité qu’il m’a offerte de publier ce travail. Merci également à Yannis
Papadopoulos et à Florence Passy, qui ont eu la gentillesse de relire le présent
document et d’y apporter leurs commentaires, à Antonio Cunha qui a accepté
d’officier en tant qu’expert lors de la défense du mémoire, et enfin à Nadine
Félix pour sa relecture attentive de la version originale.
Selon la formule consacrée, je reste seul responsable des propos publiés ici.
© Copyright by Alexandre Afonso, 2004
Prof. responsable pour la présente publication:
Ioannis Papadopoulos, 2004

Internationalisation, économie et politique migratoire en Suisse
5
Introduction
« Notre politique des étrangers n'a pas pour vocation d'encourager le
maintien en place de structures économiques qui ne peuvent survivre
que grâce à des salaires trop bas ».
Ruth Metzler, Le Temps, 8 février 2001.
La problématique des politiques migratoires a connu une médiatisation relativement
importante en Suisse au cours de ces dernières années, que ce soit sur le thème très
politisé de l'asile ou à l’occasion de votations populaires ayant trait à ce domaine, liées
par exemple à la question de l’intégration européenne (Accord bilatéral sur la libre
circulation des personnes). Cette médiatisation n’a toutefois laissé entrevoir que de
manière superficielle les enjeux économiques et politiques qui se cachent derrière la
problématique de l’immigration, et notamment le rôle très important des travailleurs
étrangers dans l'économie suisse1. C’est dans le souci d’une meilleure compréhension
de ces enjeux que ce travail a été rédigé.
La politique suisse d’immigration a subi des réformes importantes depuis le début
des années 1990 : mise en place puis abandon du modèle dit des « 3 cercles » au profit
d’un modèle binaire (travailleurs européens/travailleurs extra-européens), mise en place
graduelle de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne,
élaboration d’un nouveau projet de loi sur les étrangers (Létr). La perspective que nous
adoptons ici analyse ces réformes comme l’expression d’une réorientation importante de
la politique migratoire suisse par rapport à celle qui avait été menée depuis la Seconde
Guerre Mondiale. Nous tâchons d’expliquer cette réorientation par la conjonction de
dynamiques externes (processus de globalisation économique et d’intégration
européenne notamment) et internes (crise économique, augmentation du chômage et
changement des préférences de certains acteurs politiques) au système politique suisse.
La politique de la main d’œuvre étrangère en Suisse a souvent été considérée
comme favorisant les branches structurellement faibles de l’économie (construction,
hôtellerie, restauration, agriculture) tournées vers le marché intérieur, au détriment des
branches compétitives et internationalisées (Freiburghaus et Guggisberg 1998). Le
statut de saisonnier, notamment, fournissait à ces branches une main-d’œuvre bon
marché, captive (car dotée d’une mobilité professionnelle restreinte) et particulièrement
flexible : les travailleurs qui voyaient leur emploi disparaître étaient contraints de rentrer
chez eux. Pour leur part, les entreprises compétitives sur le plan international
1 En 2000, les 969'000 travailleurs étrangers établis en Suisse ont effectué 26% des heures de travail
prestées. Dans certains secteurs, comme l'hôtellerie ou la restauration, cette proportion s'élève à plus de
50% (OFS 2002 : 30).

Travaux de science politique
6
éprouvaient parfois plus de peine à obtenir des permis de travail pour engager des
travailleurs étrangers qualifiés, dans la mesure où le nombre global de permis était
contingenté :
« Alors qu’on a toutes les peines du monde à obtenir un permis pour faire venir un
analyste financier de New York, par exemple, de nombreux saisonniers voient leur
statut être stabilisé automatiquement dès lors qu’ils ont « tiré leur temps », si on ose
dire. Est-ce rationnel et est-ce dans l’intérêt du pays tout entier ? » (Lambelet 1993:
157).
Cette configuration particulière de la politique migratoire peut selon nous être reliée
au fort dualisme de l’économie suisse et au compromis entre représentants des différents
intérêts qui en découlait. Jusqu'aux années 90, le « modèle politico-économique » suisse
se caractérisait ainsi par un compromis entre les représentants des deux pans de
l’économie : secteurs domestiques protégés d’une part, secteurs exportateurs compétitifs
d’autre part. Le modèle « corporatiste libéral » d’après-guerre était fondé sur une
combinaison d’ouverture économique, nécessaire à l’expansion des industries
d’exportations, et sur la mise en place de mesures de compensation favorables aux
secteurs domestiques de l’économie : subventions, protections de natures diverses,
tolérance envers les pratiques concertées cloisonnant le marché suisse (Bonoli et Mach
2000). La politique d'immigration peut être interprétée comme relevant de ce type
d’arrangements, et profitait largement aux secteurs protégés (construction, tourisme,
agriculture), leur assurant un mode de subvention indirecte sur les salaires via une main
d'œuvre abondante et bon marché.
Alors que la Suisse n’avait été jusque-là touchée que de manière marginale par les
turbulences économiques internationales (le chômage est resté un phénomène peu
important au cours des années 1970, en raison notamment du départ de nombreux
étrangers), la dynamique de globalisation l’affectera de manière beaucoup plus marquée
au cours des années 1990. On observera ainsi l’accroissement des pressions qui
s’exerceront sur la politique et l’économie suisse en vue de leur « adaptation » à un
environnement externe de plus en plus soumis à la concurrence entre entreprises et entre
places économiques nationales.
Avec les accords du GATT (Uruguay Round) et le rapprochement commercial avec
l'UE, la position des secteurs internationalisés se voit renforcée et les tensions entre
secteurs se font plus vives. Le processus de libéralisation des échanges, s'il ouvre de
nouvelles perspectives pour l'expansion des secteurs internationalisés de l'économie,
constitue également une menace pour les secteurs protégés. D’autre part, la crise
économique, l’augmentation du chômage et la détérioration des finances publiques
rendent moins supportables les charges occasionnées par les mesures de compensation.
Une frange importante et influente du patronat, ainsi que des économistes, plaident
de manière très affirmée pour une remise en cause des avantages octroyés aux secteurs
protégés. Ces avantages ne profiteraient qu'à une catégorie restreinte d'acteurs, et
prétériteraient les secteurs tournés vers l'exportation, portant atteinte à leur compétitivité

Internationalisation, économie et politique migratoire en Suisse
7
internationale. Les nouveaux mots d'ordre sont libéralisation et ouverture à la
concurrence; la libéralisation du marché intérieur suisse devient un enjeu central dans
un contexte de compétition internationale accrue. A ce titre, la politique des étrangers,
caractérisée par la limitation de l’offre de travailleurs et par les restrictions concernant
leur mobilité professionnelle, constitue une entrave importante à la libéralisation du
marché suisse du travail.
L’augmentation du chômage dans des proportions inégalées depuis les années 30 a
en outre rendu plus visibles les « dysfonctionnements » de la politique d’immigration :
le taux de chômage chez les étrangers, en majorité peu qualifiés, est beaucoup plus
élevé que chez les autochtones. La main-d’œuvre étrangère ne joue plus le rôle de
« coussin conjoncturel » comme elle l’avait fait lors de la crise des années 70, et la
politique migratoire menée jusque-là est accusée d’avoir retardé la restructuration de
secteurs faibles de l’économie (Flückiger 1998). Entre autres, les auteurs des Livres
Blancs plaident pour l'abolition du statut de saisonnier, qui engendrerait des coûts
importants pour la collectivité, pour l’adoption de la libre circulation intégrale des
personnes en faveur des ressortissants de l’Union Européenne, tout comme pour les
cadres et spécialistes étrangers en provenance du monde entier (De Pury et al. 1995).
Les nouvelles orientations de la politique d'immigration suisse vont précisément
dans ce sens. Il s'agit de favoriser l'arrivée de travailleurs très qualifiés – les
« immigrants utiles » – et de freiner, voire interdire, l’afflux massif de travailleurs extra-
européens dotés d’un bas niveau de qualification. La libéralisation progressive du
marché du travail, induite par l’ouverture à la main d’œuvre européenne, implique
également la suppression des barrières à la mobilité professionnelle des étrangers, qui
peuvent désormais choisir d’aller travailler là où les salaires sont les plus élevés. Ces
nouvelles mesures favorisent ainsi les secteurs compétitifs, mais amènent les secteurs
autrefois protégés à subir le changement économique de manière beaucoup plus
affirmée : « Les secteurs n’arrivant plus à rémunérer les employés selon les contrats-
types doivent impérativement se restructurer2 ».
Questions et hypothèses de recherche
Les questions abordées dans le présent travail n’ont été traitées à notre
connaissance que de manière marginale par la littérature sur la politique migratoire. Il
s’agit de questionner l’impact des pressions internes et externes sur la politique
migratoire suisse, en accordant une place importante aux facteurs économiques.
- Quelles sont les caractéristiques du nouveau contexte national et
international dans lequel s’inscrit la politique migratoire suisse des années
1990 ? (variable explicative)
2 Pascal Couchepin, cité sur le site www.prometerre.ch: « Prométerre souhaite l’introduction d’un statut
légal pour les travailleurs hors Union européenne » (22.06.01).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
1
/
87
100%