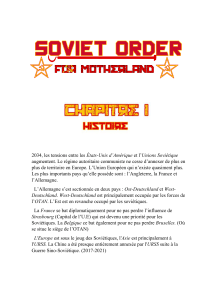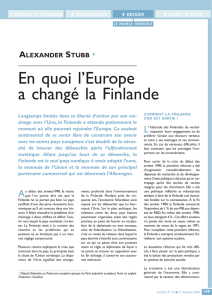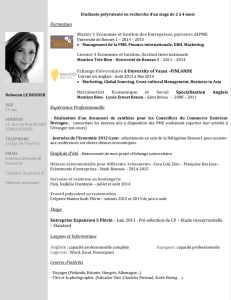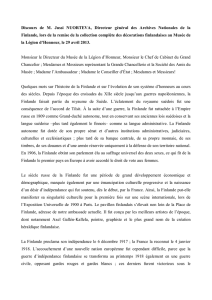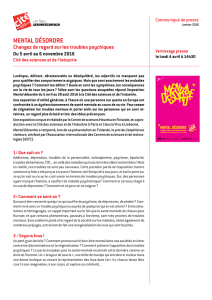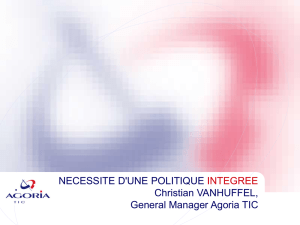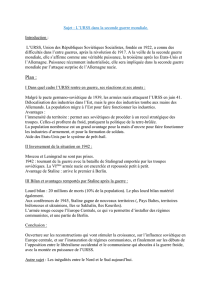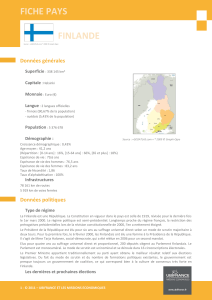La Finlande et la Seconde Guerre Mondiale - 1940

La Finlande et la Seconde Guerre Mondiale
De l’indépendance au traité de Moscou
L’une des facettes les plus curieuses et les moins connues de la Deuxième Guerre Mondiale
est sans doute la neutralité de la Finlande. Après avoir livré une guerre particulièrement
sanglante contre l’URSS en 1939-1940 alors que l’affrontement principal commençait de
l’autre côté de l’Europe, ce petit pays nordique faillit bien être entraîné dans le conflit
mondial en mai 1942. Seule une véritable offensive diplomatique orchestrée par le Secrétaire
d’Etat américain, Cordell Hull, au nom du Président Roosevelt, put éviter qu’un incident de
frontière ne dégénère en une guerre ouverte entre la Finlande et l’Union Soviétique – du
moins, c’est en général le point de vue des historiens. Les Etats-Unis – eux-mêmes en guerre
depuis six mois contre l’Allemagne – firent en effet tout pour éviter que leur nouvel (et
quelque peu inattendu) allié, l’URSS, n’ait pas à subir l’assaut d’un ennemi de plus, sur un
front de plus.
Quoi qu’il en soit, la Finlande fut l’un des quelques pays d’Europe à rester neutre jusqu’à la
fin du conflit mondial, même si, un peu comme l’Espagne (mais pour des raisons fort
différentes), la Guerre elle-même ne l’avait pas épargnée. Le moins qu’on puisse dire est que
cette neutralité ne fut nullement facile à maintenir. Pendant plus de deux ans, la Finlande dut
marcher sur la proverbiale corde raide tendue au dessus d’un précipice. Il reste qu’à la fin, les
efforts diplomatiques et politiques des dirigeants finlandais s’avérèrent fructueux : grâce à
eux, la Finlande est aujourd’hui l’une des nations les plus prospères et les plus industrialisées
du monde.
Cependant, avant de considérer l’attitude finlandaise à partir de mai 1942, il nous faut
examiner l’histoire du pays depuis la naissance d’une Finlande indépendante, en 1917.
De l’indépendance aux années Trente
Les révolutions de février et octobre 1917 signifiaient la fin de l’union personnelle entre la
Russie et la Finlande, qui durait depuis 1809 – la Finlande était un grand-duché autonome au
sein de l’empire russe. Après la tenue d’élections, le Parlement finnois se déclara le 5
novembre 1917 « possesseur du pouvoir politique suprême » sur le territoire finlandais, selon
la Constitution de Finlande et plus précisément selon le §38 du vieil Instrument de
Gouvernement de 1772, instauré par les Etats Généraux de Suède après le coup d’état réussi
sans verser de sang par le roi Gustave III.
Le 4 décembre, le « Sénat de Finlande » – le gouvernement désigné en novembre par le
Parlement – présenta une proposition d’un nouvel Instrument de Gouvernement, républicain
celui-ci. La Déclaration d’Indépendance avait, pour des raisons techniques, pris la forme d’un
préambule à cette proposition et devait recevoir l’accord du Parlement. Ce fut fait le 6
décembre 1917 ; à partir de 1919, le 6 décembre devint la Fête de l’Indépendance finlandaise.
Le 4 janvier 1918, la République Socialiste Fédérative de Russie (RSFR) reconnut
l’indépendance de la Finlande, bientôt suivie par d’autres pays.
En dépit de cette reconnaissance de la Finlande par le nouveau régime russe, un état de guerre
s’installa bientôt entre le nouvel état et la Russie soviétique en raison du déclenchement de la
guerre civile finlandaise, qui dura de janvier à mai 1918. Plus de 35 000 personnes furent
tuées pendant cette guerre, mais essentiellement lors de combats entre les Gardes Rouges et
Blancs finlandais. Il n’y eut jamais de batailles majeures entre les Gardes Blancs et les forces
russes. Les Gardes Blancs étaient commandés par le général Carl Gustaf Emil Mannerheim.
Il faut s’arrêter ici un instant sur ce personnage. Agé à ce moment de 51 ans, Mannerheim,
issu d’une famille de l’aristocratie suédophone, s’était engagé dans l’armée (russe bien sûr) et

avait été nommé colonel après la bataille de Moukden, où il s’était distingué par son courage.
Il avait commandé la brigade de cavalerie de la Garde durant la Première Guerre Mondiale.
Promu lieutenant général, puis relevé de ses fonctions par le gouvernement Kerensky, il était
rentré en Finlande à la fin de 1917.
A la suite de la guerre civile, la Finlande passa sous influence allemande jusqu’à la défaite de
l’Allemagne en novembre 1918. Cette défaite condamnait le projet de faire de la Finlande une
monarchie dirigée par le prince Frédéric-Charles de Hesse, beau-frère de Guillaume II. Le
général Mannerheim (après avoir démissionné de son poste de commandant des Gardes
Blancs) fut désigné Régent de Finlande. Il se présenta à la première élection présidentielle de
l’histoire du pays, mais fut battu par K.J. Ståhlberg.
A la même période, après la fin de la guerre civile, des forces de volontaires finlandais avaient
mené des expéditions militaires en Estonie, en Carélie de l’est et dans la région de Petsamo.
Ces campagnes sont connues sous le nom de “heimosodat”, terme finnois que l’expression
“guerres familiales” traduit sans doute mieux que “guerres tribales”.
Le 14 octobre 1920, après quatre mois de négociations, la Finlande et la Russie soviétique
signèrent le traité de Tartu. Il confirmait la vieille frontière entre le Grand Duché de Finlande
et la Russie Impériale, qui devenait la frontière soviéto-finlandaise. De plus, la Finlande
recevait la région de Petsamo, au nord-est, avec son port libre de glaces sur l’Arctique. La
revendication de cette région par la Finlande remontait à une promesse faite par le Tsar
Alexandre II en 1864, selon laquelle le Grand-Duché devait recevoir Petsamo en échange
d’une partie de l’isthme de Carélie. De son côté, la Finlande acceptait d’évacuer les régions de
Repola et de Porajärvi, en Carélie russe, qu’elle occupait. Enfin, certains articles concernaient
le transit par voie de terre entre la Russie soviétique et la Norvège via Petsamo.
Cette même année 1920, la Finlande rejoignit la Société des Nations. Ce faisant, elle
recherchait les garanties de sécurité offertes par la SDN, mais son but principal était de
resserrer les liens avec les pays scandinaves. Les armées finlandaise et suédoise entamèrent
une large coopération ; l’objet de celle-ci était plus l’échange de renseignements et la défense
des îles que des manœuvres communes ou le déploiement de matériels nouveaux. Par ailleurs,
dans le plus grand secret, l’armée finlandaise entama une coopération avec l’Estonie.
Sur le plan politique, les années Vingt et le début des années Trente furent une période
d’instabilité en Finlande. En 1929, l’extrême-droite tenta de faire du général Mannerheim une
sorte de dictateur, car le général avait exprimé un certain soutien pour ses positions, mais
Mannerheim refusa. En 1931, le Parti Communiste fut déclaré illégal et le Mouvement
d’extrême-droite Lapua se lança dans des violences anticommunistes organisées, culminant en
1932 dans une tentative de soulèvement avortée. Dans le même temps, le Mouvement
Patriotique du Peuple (IKL), de tendance ultra-nationaliste, parvenait à avoir quelques élus
(au maximum 14 sièges sur 200) au parlement finlandais.
Néanmoins, à la fin des années Trente, l’économie finlandaise, orientée vers l’exportation,
était en plein essor et le pays avait presque résolu les problèmes posés par les mouvements
politiques extrémistes, de gauche comme de droite.
Les relations politiques soviéto-finlandaises de 1920 à 1939
Malgré la signature du traité de Tartu, les relations entre la Finlande et la Russie soviétique
(puis l’URSS) restèrent tendues. Le gouvernement finlandais permit à des combattants
volontaires de passer la frontière pour soutenir la révolte de Carélie Orientale en 1921. En
face, les communistes finlandais exilés en Union Soviétique continuèrent à préparer la
revanche de la guerre civile perdue, lançant même en 1922 un raid en Finlande, la « mutinerie

du porc »1.
En 1931, le général Mannerheim fut nommé par le président de la République, Pehr Evind
Svinhufvud, à la tête du Conseil de Défense, avec promesse de devenir commandant en chef
des armées en cas de guerre. Deux ans plus tard, il devenait maréchal.
En 1932, l’URSS et la Finlande signèrent pourtant un pacte de non agression, qui fut
réaffirmé en 1934 pour une durée de dix ans. Cela n’empêcha pas les relations entre les deux
pays de rester très réduites. Alors que le commerce extérieur de la Finlande explosait, moins
de 1 % se faisait avec l’Union Soviétique. L’inscription de cette dernière à la SDN en 1934
n’y changea rien. Alors que Staline avait succédé à Lénine, la propagande soviétique
continuait à peindre les gouvernants finlandais comme « une clique fasciste vicieuse et
réactionnaire ». Le maréchal Mannerheim et Väinö Tanner, le chef du Parti Social-
Démocrate finlandais, étaient particulièrement voués aux gémonies.
Cependant, quand Staline eut gagné un pouvoir quasi absolu après la Grande Purge de la fin
des années Trente et qu’Hitler eut accédé au pouvoir en Allemagne, l’URSS changea de
politique à l’égard de la Finlande. En effet, les Soviétiques étaient très préoccupés par la
sécurité de Leningrad, dont les faubourgs n’étaient qu’à 25 km de la frontière finlandaise.
En avril 1938, un agent du NKVD nommé Boris Yartsev (de son vrai nom Boris Rybkin) prit
contact avec le ministre des Affaires Etrangères finlandais, Rudolf Holsti. Il lui expliqua que
l’URSS était certaine d’être un jour ou l’autre attaquée par l’Allemagne, et craignait que le
territoire finlandais ne fût utilisé comme l’une des bases de départ d’une telle agression. Ces
entretiens se poursuivirent durant l’été 1938 avec le Premier ministre Aimo Cajander et le
ministre des Finances Väinö Tanner. Yartsev les informa que l’Union Soviétique serait
heureuse d’assister la Finlande de toutes les manières si cela contrariait les plans allemands.
L’URSS était prête à accepter la militarisation des îles Åland si elle était autorisée à participer
à l’armement des fortifications et à superviser la concentration de forces. En contrepartie, la
Finlande devait accepter que les Soviétiques fortifient l’île de Suursaari, qui était un territoire
finlandais, mais qui était aussi vitale pour la sécurité de Leningrad. Le gouvernement
finlandais refusa la totalité de ces propositions, car elles auraient gravement compromis la
souveraineté de la Finlande en même temps que sa politique de neutralité.
En mars 1939, l’ambassadeur soviétique, Boris Stein, rencontra Eljas Erkko, le nouveau
ministre des Affaires Etrangères2. Stein dévoila une nouvelle proposition de Staline, selon
laquelle les îles du Golfe de Finlande devaient être louées pour 30 ans à l’URSS. En échange,
la Finlande recevrait une partie de la Carélie Orientale. Mannerheim était prêt à abandonner
les îles – qui étaient de toutes façons indéfendables – ainsi qu’à accepter certaines
rectifications de frontières sur l’Isthme, mais Erkko répliqua sèchement que le territoire
finlandais n’était pas à vendre. Les négociations furent rompues le 6 avril.
Pendant ce temps, la Finlande et la Suède avaient établi des plans pour une protection
militaire conjointe des îles Åland. Ces plans s’écroulèrent, cependant, quand il devint évident
que l’URSS ne les admettrait pas. En juin 1939, le gouvernement suédois annonça qu’il
abandonnait tout projet de ce genre en raison de l’opposition soviétique.
Durant l’été 1939, tandis que la situation en Europe continuait à se détériorer, le haut
commandement finlandais s’inquiétait de l’état de préparation de l’armée. Dès février, le
Conseil de Défense, présidé par le maréchal Mannerheim, avait demandé de façon répétée
d’accroître le budget de la Défense pour réarmer rapidement l’armée finlandaise. Mais le
gouvernement centriste et social-démocrate refusa fermement cette augmentation des
dépenses militaires, au point que Mannerheim, frustré, proposa à plusieurs reprises de
1 Ainsi nommée parce que le chef communiste harangua ses hommes debout sur une caisse contenant du porc…
2 Holsti s’était retiré en novembre 1938 pour différents problèmes : mauvaise santé, attaques sur son salaire – de
plus, il aurait fait des remarques offensantes sur Hitler alors qu’il était ivre lors d’un dîner entre diplomates à
Genève.

démissionner. Cajander et Erkko auraient accepté de remplacer le vieux maréchal, mais le
président Kyösti Kallio y était totalement opposé, car il craignait que la démission de
Mannerheim – qui était alors devenu une sorte d’icône nationale – ait un effet désastreux sur
le moral du pays. Pendant ces querelles politiques, la défense finlandaise n’était pas
complètement inactive : à l’initiative de la Société Académique de Carélie et de la Garde
Civile (Suojeluskunta), 60 000 volontaires participaient à la construction d’une série de
tranchées, de bunkers, d’obstacles antichars et autres fortifications sur l’Isthme de Carélie, qui
serait surnommée “Ligne Mannerheim” lors du déclenchement de la guerre.
Finalement, le gouvernement et Mannerheim parvinrent à un compromis selon lequel le
maréchal restait à son poste et, en échange, le gouvernement augmentait les fonds consacrés
aux dépenses militaires. Cependant, cette dispute devait faire définitivement taxer de
médiocrité le gouvernement Cajander et les uniformes finlandais symboliques de la Guerre
d’Hiver (que seules une cocarde et une ceinture distinguaient des vêtements civils) seraient
ironiquement baptisés “uniformes modèle Cajander”.
Tout changea le 23 août 1939, quand l’Allemagne et l’URSS signèrent le Traité de Non-
Agression qui serait bientôt connu comme le Pacte Ribbentrop-Molotov. Outre les
stipulations publiques sur la non-agression, le traité incluait un protocole secret qui divisait les
territoires de Roumanie, de Pologne, des Etats Baltes et de Finlande en « zones d’influence »
nazie et soviétique, prévoyant des « remaniements territoriaux et politiques » de ces pays.
Dès le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Trois jours plus tard, la France et
le Royaume-Uni déclaraient la guerre au Reich. Le 17, après la conclusion officielle de
l’Incident du Nomonhan entre l’URSS et le Japon, l’Union Soviétique envahit elle aussi la
Pologne. En octobre, à la suite de l’anéantissement de la Pologne, les Etats Baltes – Estonie,
Lettonie et Lituanie – furent contraints de conclure des traités d’assistance mutuelle avec
l’URSS, qui permettaient à l’Union Soviétique d’établir des bases militaires sur leur territoire
« pour la durée de la guerre en Europe ». C’était en réalité la première étape de l’occupation
soviétique des Etats Baltes.
Après la chute de la Pologne, Mannerheim avait demandé : « A qui le tour à présent,
maintenant que l’appétit de ces messieurs [Hitler et Staline] a commencé à grandir ? » La
Finlande devait le savoir très vite.
Le 5 octobre 1939 vint la convocation à Moscou d’une réunion destinée à discuter de « sujets
politiques concrets ». Ces entretiens se déroulèrent en trois étapes : du 12 au 14 octobre, du 3
au 4 novembre et le 9 novembre. Lors du premier round de négociations, la délégation
finlandaise était constituée de Juho Kusti Paasikivi, l’ambassadeur finlandais en Suède, Aarno
Yrjö-Koskinen, l’ambassadeur finlandais en URSS, Johan Nykopp, un diplomate de haut
rang, et le colonel Aladár Paasonen, premier aide de camp du président Kallio. Lors des deux
autres sessions, le ministre des Finances, Tanner, se joignit à Paasikivi à la tête de la
délégation.
Cependant, le gouvernement finlandais avait laissé très peu de latitude à ses négociateurs et le
13 octobre, Paasikivi fut forcé de rejeter les exigences soviétiques, qui comprenaient la
location de la péninsule de Hanko (incluant le village de Lappohja) pour y établir une base
navale, le déplacement de 70 km vers l’ouest de la frontière sur l’Isthme de Carélie et la
cession des îles du Golfe de Finlande en échange de vastes (mais inhabitées) zones de Carélie
Orientale. En raison de l’opposition du parlement et de l’opinion publique, le gouvernement
finlandais refusa l’échange tel qu’il était proposé, acceptant seulement d’abandonner les
régions de Kuokkala et Terijoki, les plus proches de Leningrad. « Oubliez que l’Union
Soviétique est une grande puissance ! » fut la dernière instruction donnée par le ministre des
affaires Etrangères, Erkko, à Paasikivi quand ce dernier quitta Helsinki pour Moscou pour la
dernière fois, le 31 octobre.
Le 13 novembre, les négociations furent définitivement rompues.

On peut douter que Staline ait espéré que les Finlandais acceptent ses « exigences
minimales ». Voyant ce qui arrivait à leurs voisins estoniens, les Finlandais avaient bien des
raisons de ne pas lui faire confiance. De plus, les secteurs de l’Isthme réclamés étaient
d’importance vitale – sans eux, la Finlande perdait toute possibilité de se défendre contre une
agression soviétique, de même que la Tchécoslovaquie avait été incapable de se défendre en
1939 après avoir abandonné les Sudètes en 1938. L’instruction donnée par Erkko à Paasikivi
montre bien que les plus hauts responsables politiques finlandais avaient joué le tout pour le
tout. De plus, a posteriori, il peut sembler qu’accepter les exigences soviétiques aurait eu des
conséquences fatales pour la Finlande
Quoiqu’il en soit, du côté soviétique, les préparatifs d’invasion avaient commencé dès le
printemps, et la constitution d’une République Socialiste Soviétique de Finlande dirigée par le
communiste finlandais en exil Otto W. Kuusinen était bien avancée. Les négociations avaient
donné à l’Armée Rouge tout le temps de concentrer des troupes à la frontière soviéto-
finlandaise, car la mobilisation avait commencé dès le début des entretiens de Moscou.
Côté finlandais cependant, on n’était pas resté inerte : les réservistes avaient été rappelés pour
des manœuvres organisées les 9 et 10 octobre, correspondant en pratique à une mobilisation
générale des forces armées. L’entraînement au black-out et aux alertes aériennes avait
commencé, ainsi que l’évacuation volontaire des populations des villes vers la campagne, que
le ministre de l’Intérieur Urho Kekkonen avait jugé nécessaire en raison de « la gravité de la
situation politique générale ».
Devant l’échec des négociations, Staline résolut de régler la question par la force. Il est clair
qu’il s’attendait à ce que la guerre soit aussi facile que l’invasion de l’est de la Pologne. Bien
que certains officiers de l’Armée Rouge aient recommandé la prudence, l’opinion générale à
Moscou était que la Finlande tomberait en dix à douze jours. Cela ne semblait pas
déraisonnable étant donné le déséquilibre des forces.
Ironiquement, la rupture des négociations de Moscou poussa la plupart des membres du
gouvernement finlandais à croire que le pays était en sécurité, car ils pensaient que Staline
avait bluffé et qu’il n’était pas prêt à la guerre. Les menaces semblant s’éloigner, Erkko et
Tanner crurent qu’une partie au moins des réservistes pouvaient être démobilisés pour assurer
les travaux agricoles. Le 23 novembre, ce sentiment de sécurité fut renforcé par un discours
du Premier ministre Cajander, proclamant que la vie en Finlande revenait à la normale. Cet
optimisme étrange et irréaliste conduisit la population à croire que le pire était passé.
Mannerheim considérait le comportement du gouvernement comme irresponsable. Les
demandes d’Erkko et de Tanner tendant à diminuer l’effort de défense le mirent dans une telle
fureur qu’il donna une fois de plus sa démission. Cette démission était accompagnée d’un
long mémorandum où il critiquait le gouvernement pour la médiocrité de sa politique
étrangère et pour la négligence avec laquelle il avait préparé la défense du pays. Cette fois,
même le président Kallio était prêt à remplacer le « vieux et grincheux » maréchal par un
homme plus jeune. Mais ce remplacement fut brutalement interrompu par l’Incident de
Mainila.
Le 26 novembre, le ministre soviétique des Affaires Etrangères, Molotov, envoya à Helsinki
une protestation officielle par laquelle il accusait la Finlande d’avoir bombardé le village de
Mainila, su côté soviétique de la frontière. La missive exigeait que les forces finlandaises se
retirent immédiatement à 20 ou 25 km de la frontière. Dans sa réponse, le gouvernement
finlandais expliqua que Mainila n’était à portée d’aucune unité d’artillerie finlandaise et
proposa que un retrait mutuel des deux armées à distance de la frontière. Mannerheim, qui se
trouvait à ce moment en inspection sur l’Isthme, répliqua sèchement que toutes les forces
finlandaises du voisinage étaient à la messe au moment de l’incident !
Dans un nouveau message, Molotov accusa la Finlande d’aggraver les tensions entre les deux
pays et déclara nul et non avenu le pacte de non agression de 1932. La réponse finlandaise –
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%