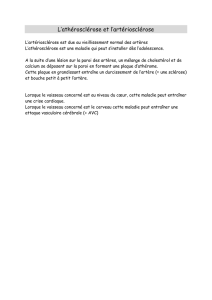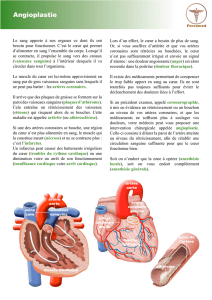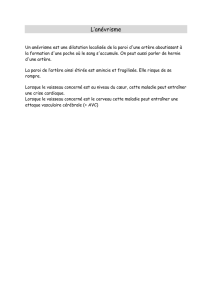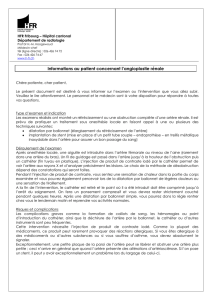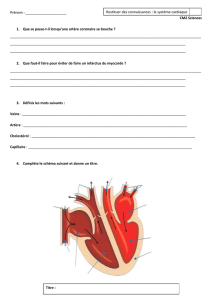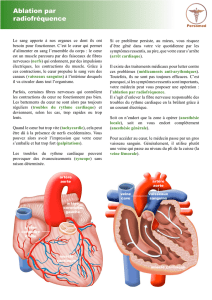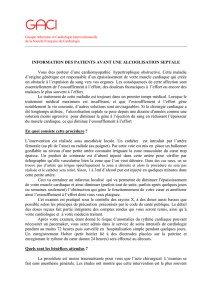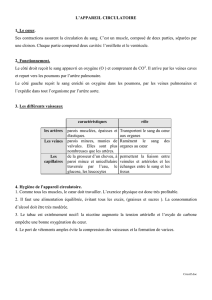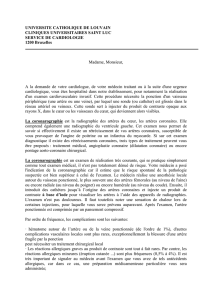Interventions sur les vaisseaux périphériques

Interventions sur les vaisseaux
périphériques (PTA et stents)
Brochure d’information à l’intention du patient
Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale
Fondation Suisse
de Cardiologie

Sommaire
Introduction 2
Les artères périphériques 3
La maladie artérielle occlusive 3
Comment en vient-on à la maladie artérielle
occlusive? 5
Que sont les interventions artérielles
périphériques par cathéter? 6
Quand la PTA est-elle indiquée et quand
une opération? 7
PTA des artères rénales 8
Interventions par cathéter sur l’artère carotide 10
L’aspiration et la thrombolyse 10
Succès et risques des interventions par cathéter 10
Les préparatifs en vue d’une PTA 11
Déroulement de la PTA 11
Que se passe-t-il après la PTA? 12
Quelle est la conduite à tenir après une PTA? 14

22
Introduction
Depuis plus de quarante ans, les patients souffrant de troubles de
la circulation sanguine dans les membres inférieurs peuvent béné-
ficier, outre les traitements chirurgicaux, de traitements efficaces
par cathéter. Cette technique permet d’ouvrir les vaisseaux san-
guins obstrués de l’intérieur, sans avoir recours à une opération
chirurgicale.
La méthode de dilatation des vaisseaux la plus utilisée emploie
un cathéter à ballonnet. Elle est appelée angioplastie translumi-
nale percutanée ou PTA. L’ouverture transluminale des vaisseaux
obstrués a été décrite pour la première fois par l’Américain Charles
T. Dotter puis perfectionnée, dans les années 70, par l’invention
d’Andreas Grüntzig du cathéter à ballonnet pour les artères péri-
phériques et coronaires. C’est lui qui, à l’Hôpital universitaire de
Zurich, pratiqua pour la première fois au monde une dilatation
par ballonnet, tout d’abord sur une artère de la jambe, plus tard
sur une artère coronaire. C’est à Lausanne, dans les années 80,
qu’un stent fut posé pour la première fois. Ce dispositif permet
d’améliorer les résultats de la dilatation par ballonnet en renfor-
çant la paroi de l’artère d’un fin treillis métallique cylindrique.
Cette brochure se donne pour objectif de vous présenter com-
ment se déroulent ces opérations. Elle peut aussi vous aider, par
ses descriptions et ses illustrations, à mieux engager le dialogue
avec votre médecin traitant.
La formulation au masculin implique naturellement les deux sexes.

33
Les artères périphériques
Toutes les cellules de notre corps ont besoin d’oxygène. Il est trans-
porté par les globules rouges du sang dans les artères, jusqu’aux
cellules les plus éloignées de chaque organe interne et des extré-
mités. Les artères qui mènent aux bras et aux jambes sont appe-
lées artères périphériques (figure 1). La circulation sanguine est
assurée par le cœur qui joue un rôle essentiel de pompe. On sent
bien ce travail du cœur, sous forme de pouls, à certains endroits du
corps, par exemple à l’aine, au creux du genou, à la cheville (mal-
léole interne), sur le dos du pied ou au poignet.
La maladie artérielle occlusive
Si une artère est fortement rétrécie (sténose) ou totalement obs-
truée par la calcification (athérosclérose), le sang, et avec lui l’oxy-
gène, ne va parvenir où on l’attend qu’en quantité insuffisante,
voire plus du tout. Si ces sténoses et occlusions sont présentes dans
les artères des jambes qui irriguent aussi les muscles, c’est ce que
l’on appelle la maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP).
Au stade initial de sa maladie, la personne touchée ne remarque
en général rien. Au deuxième stade, des douleurs à la marche se
font sentir dans la jambe concernée. Les besoins accrus en oxy-
gène de cette musculature en action ne sont plus couverts par les
apports sanguins et le patient doit alors marquer un temps d’arrêt
après une certaine distance pour reposer sa jambe. Ainsi parle-t-
on également de «maladie du lèche-vitrines» ou, dans le langage
scientifique, de «claudication intermittente».
Si les troubles circulatoires continuent à évoluer, les besoins de
base des tissus en oxygène ne sont plus couverts et, même au
repos, la jambe est douloureuse (troisième stade de la maladie).
Les douleurs nocturnes du pied sont typiques. Elles obligent le
patient à se lever, car la jambe est alors mieux irriguée. En l’ab-

44
Figure 1: Artères des membres inférieurs avec sténose
Rétrécissement (sténose) de l’artère
par des dépôts (athérosclérose)
Circulation «de contournement»
(collatérale)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%