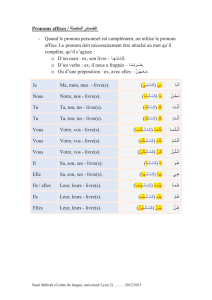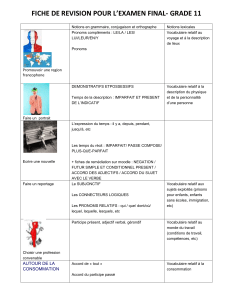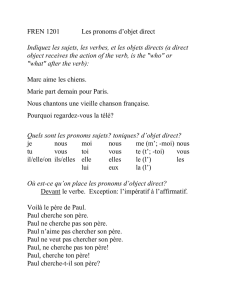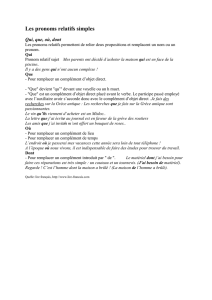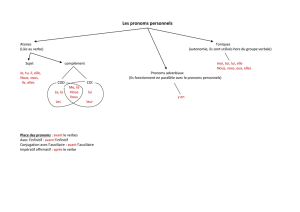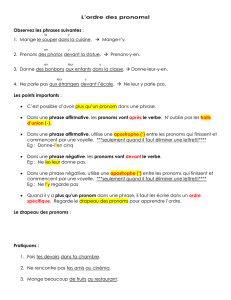LES PRONOMS LIÉS EN ARABE CLASSIQUE SONT

LES PRONOMS LIÉS EN ARABE CLASSIQUE SONT-ILS DES CLITIQUES*?
Adel Jebali
Université du Québec à Montréal
Résumé
Les clitiques ont à la fois les propriétés des mots indépendants et celles des affixes. En
d’autres mots, ils peuvent être considérés comme des éléments autonomes, mais ils ont,
en même temps, besoin d’un hôte fort auquel ils s’attachent pour pallier leur déficience
accentuelle. Ces propriétés ont donné lieu à des questions qui ne cessent d’alimenter les
débats linguistiques : dans quelle composante de la grammaire sont formés les clitiques?
Est-ce en syntaxe, en morphologie (c.-à-d. en lexique) ou en phonologie? Et quel impact
aura ce choix sur la théorie en général? Et si les clitiques n’étaient en fin de compte que
des éléments d’interface qui impliquent toutes les composantes de la grammaire? Quelle
est donc la relation entre ces modules (dans une conception modulaire)? Cette
problématique est encore actuelle en ce qui concerne les pronoms liés en arabe classique.
La question que nous posons ici est la suivante : est-ce qu’on peut considérer ces
pronoms comme des clitiques? Nous développons une hypothèse qui répond à cette
question par la négative et nous apportons des arguments pour une telle position, en
appliquant les critères communément appelés les critères de Zwicky (Zwicky et Pullum
(1983) et Zwicky (1977)).
Abstract
Clitics have both the properties of independent words and of affixes. In other words,
they can be regarded as autonomous elements but, at the same time, they need a strong
host to which they cliticise to compensate for their accentual deficiency. These properties
have given room for questions which keep feeding linguistic debates: in which
component of grammar are the clitics formed? Is this in syntax, in morphology (i.e., in
lexicon) or in phonology? And what will be the impact of this choice on the theory, in
general? And what if the clitics were, in the final analysis, only elements of interface
which involve all the components of grammar? In what way are these modules related (in
a modular concept)? etc. This problematic still exists with regard to the dependent
pronouns in classical Arabic. The question that we pose is as follows: can these pronouns
be regarded as clitics? We will develop a hypothesis which answers this question
negatively, and will argue in favour of such a position by applying the criteria commonly
called the criteria of Zwicky (Zwicky and Pullum (1983) and Zwicky (1977)).

RÉLQ/QSJL
Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005
21
Introduction
Le système pronominal en arabe classique distingue deux sortes de pronoms selon leur
attachement morphologique à leurs gouverneurs. Il faut noter que notre utilisation du
terme « gouverneur » dans ce texte fait appel à la notion traditionnelle en grammaire
arabe et non à la théorie du gouvernement et du liage. Dans la conception traditionnelle,
un gouverneur est un élément de la phrase qui assigne un cas morphologique à un autre
élément. Cette définition distingue les gouverneurs lexicaux (le verbe, la préposition et
nom) et des gouverneurs « syntaxiques » (la prédication qui assigne le cas nominatif et la
flexion casuelle au sujet des phrases nominales).
Les formes liées : (voir le tableau 1) sont toujours suffixées et ne peuvent être
préfixées ou infixées. Ces pronoms sont toujours attachés à leurs gouverneurs (qui
peuvent être de plusieurs types catégoriels : des verbes, des prépositions, des noms et des
adjectifs) comme nous pouvons le voir en (1) :
Tableau 1 : Les pronoms liés non nominatifs1
Personne Genre Singulier Duel Pluriel
1 -ā -nā -nā
2 Masc. -ka -kumā -kum
Fém. -ki -kumā -kunna
3 Masc. -hu -humā -hum
Fém. -hā -humā -hunna
(1) a. RaAay-tu fī-hā xalāS-ī.2
Voir.accompli-je dans-elle salut-je
Je l’ai considérée mon salut.
b. Kān-a jamīl-a š-šacr-i Tawīl-a-hu.
Être.accompli-il beau-acc les-cheveux-gén long-acc-il
Il avait les cheveux beaux et longs.
* Cet article est la version écrite de notre communication orale au 72e congrès annuel de l’ACFAS
qui s’est déroulé à l’UQAM en mai 2004. Nous la reproduisons ici telle quelle, même si, depuis ce
premier contact avec le monde compliqué et fascinant des clitiques, nous avons acquis une
meilleure compréhension de ces éléments en arabe et dans les autres langues. Nous désirons
remercier Pierrette Mathieu qui a corrigé la version anglaise du résumé et les deux lecteurs
anonymes pour leurs remarques constructives.
1 Sous cette appellation, sont groupés les pronoms accusatifs et les pronoms génitifs; ces derniers
n’ont pas une forme particulière propre à eux.
2 Les gloses font référence aux clitiques du français. Ainsi, chaque fois qu’il s’agit d’un pronom
lié, nous le glosons par un clitique français et chaque fois qu’il s’agit d’un pronom libre, nous
employons le pronom fort français correspondant.

RÉLQ/QSJL
Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005
22
Les pronoms liés entretiennent une relation étroite avec ces gouverneurs et ne peuvent
être séparés d’eux par des mots, à l’exception, par contre, d’autres pronoms liés.
Considérons (2) par exemple :
(2) a. RaAay-tu bayt-an.
Voir.accompli-je maison-acc
J’ai vu une maison.
b. * RaAay bayt-an tu.
Voir.accompli maison-acc je
c. RaAay-tu-hu.
Voir.accompli-je-il
Je l’ai vu.
Les formes libres : ces formes sont indépendantes de leurs gouverneurs lexicaux, d’où
leur liberté d’apparaître avant ceux-ci dans la structure et même d’être séparées d’eux par
d’autres éléments phonologiquement réalisés. Dans l’exemple (3), le pronom libre huwa
(=lui) précède son gouverneur lexical (le verbe raAā) en (a) et (b) et peut être séparé de
ce gouverneur en (b) :
(3) a. Huwa raA-ā bayt-an.
Lui voir.accompli-3MS maison-acc
Il a vu une maison.
b. Huwa llaDī raA-ā bayt-an.
Lui qui voir.accompli-3MS maison-acc
C’est lui qui a vu une maison.
Les formes liées constituent le cas non marqué. En effet, on ne peut recourir aux
pronoms libres que sous certaines conditions en nombre limité que nous ne pouvons
discuter ici. Mais si nous prenons l’exemple (2a), et remplaçons le pronom lié de la
première personne du singulier par son équivalent libre Aanā, la phrase sera
agrammaticale (4a). Par contre, quand ce pronom est topicalisé (et donc non gouverné par
le verbe (4b)), la phrase est grammaticale :
(4) a.*RaAay Aanā bayt-an.
Voir.accompli moi maison-acc
J’ai vu une maison.
b. Aanā raAay-tu bayt-an.
Moi voir.accompli-je maison-acc
Moi, j’ai vu une maison.

RÉLQ/QSJL
Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005
23
De plus, les pronoms liés ne constituent pas la forme réduite des pronoms libres,
malgré ce que nous pouvons constater au tableau 2, où tous les pronoms libres non
nominatifs sont composés de la ‘particule’ Aiyyā et du pronom lié non nominatif
correspondant. En fait, la relation entre les pronoms libres nominatifs et les pronoms liés
nominatifs n’est pas aussi directe et ne peut soutenir une telle hypothèse. Prenons les
tableaux 3, 4 et 5. Dans ces tableaux on voit clairement que le pronom lié tu, a et at par
exemple ne constituent pas la forme réduite de leurs équivalents libres Aanā, huwa et
hiya.
Tableau 2 : Les pronoms libres non nominatifs
Personne Genre Singulier Duel Pluriel
1 Aiyyā-ya Aiyyā-nā Aiyyā-nā
2 Masc. Aiyyā-ka Aiyyā-kumā Aiyyā-kum
Fém. Aiyyā-ki Aiyyā-kumā Aiyyā-kunna
3 Masc. Aiyyā-hu Aiyyā-humā Aiyyā-hum
Fém. Aiyyā-hā Aiyyā-humā Aiyyā-hunna
Tableau 3 : Les pronoms libres nominatifs
Personne Genre Singulier Duel Pluriel
1 Aanā naHnu naHnu
2 Masc. Aanta Aantumā Aantum
Fém. Aanti Aantumā Aantunna
3 Masc. huwa humā hum
Fém. hiya humā hunna
Tableau 4 : Le nominatif lié avec les verbes accomplis
Personne Genre Singulier Duel Pluriel
1 -tu -nā -nā
2 Masc. -ta -tumā -tum(ū)
Fém. -ti -tumā -tunna
3 Masc. -a -ā -ū
Fém. -at -atā -na
Tableau 5 : Le nominatif lié avec les verbes inaccomplis
Personne Genre Singulier Duel Pluriel
1 A- n- n-
2 Masc. t- t-ā t-ū
Fém. t-ī t-ā t-na
3 Masc. y- y-ā y-ū
Fém. t- t-ā t-na

RÉLQ/QSJL
Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005
24
Malgré ces propriétés exceptionnelles des pronoms en AC, les études qui leur sont
consacrées ne sont pas nombreuses. C’est pour cette raison que nous voulons apporter de
nouveaux éléments à ces recherches en examinant quelques hypothèses qui s’inscrivent
dans les travaux sur les clitiques, et surtout les clitiques pronominaux. Considérant que
les pronoms liés ont des propriétés très singulières, nous allons examiner deux
hypothèses concernant ceux-ci : est-ce que les pronoms liés sont mieux traités comme
clitiques? Ou bien faut-il les traiter comme des affixes? L’examen de ces hypothèses est
important surtout quand on sait que la première, par exemple, a été adoptée sans
argumentation dans quelques travaux récents en linguistique arabe, par exemple dans
Kouloughli (1994) et Letourneau (1993).
La première partie de cet article sera consacrée à la réfutation de la première
hypothèse. La deuxième partie est un examen de la deuxième hypothèse et la troisième
partie montrera les limites de celle-ci.
1. Les pronoms liés sont-ils des clitiques?
1.1 Qu’est-ce qu’un clitique?
Le terme « clitique » est une généralisation moderne des deux catégories
traditionnelles proclitique et enclitique. Le proclitique est un clitique qui apparaît au
début d’un mot ou d’un syntagme et l’enclitique apparaît à la fin de ceux-ci. Ce que ces
deux entités ont en commun c’est surtout leur déficience accentuelle. Ils ne peuvent
porter d’accent, d’où leur besoin de s’attacher à d’autres mots pour pallier cette
déficience et former une unité prosodique avec leur hôte. Ainsi, le proclitique je en (5a) a
besoin de s’attacher au verbe regarde pour former une unité prosodique avec celui-ci et
pallier sa déficience accentuelle. De même pour l’enclitique ‘s en (5b) :
(5) a. Je regarde la partie éliminatoire des Canadiens de Montréal.
b. Leslie’s house.
De plus, le comportement des clitiques « est en apparence intermédiaire entre celui des
mots indépendants et celui des affixes habituels. S’ils semblent jouir d’une plus grande
autonomie que ces derniers, ils s’appuient phonologiquement à un hôte, contrairement
aux mots.» (Miller et Monachesi 2003). Cette ambiguïté définit l’un des critères
essentiels des clitiques que nous pouvons récapituler dans les points suivants : (voir :
Zwicky (1977, 1985), Zwicky et Pullum (1983) ainsi que Anderson et Zwicky (2003)) :
• La dimension phonologique : le clitique forme une unité prosodique avec son hôte à
cause de sa déficience accentuelle.
• La dimension morphosyntaxique : le clitique est un élément dont l'emplacement dans
une plus grande construction syntaxique est déterminé par des principes autres que
ceux de la syntaxe normale de la langue. En d’autres mots, les clitiques occupent des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%