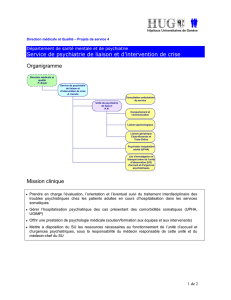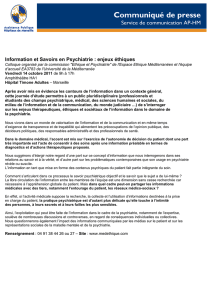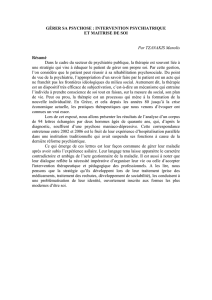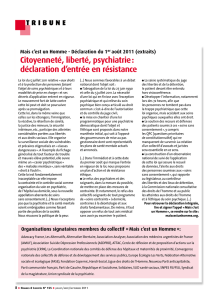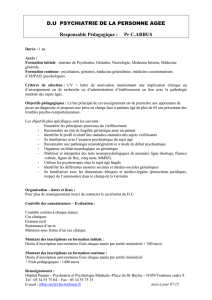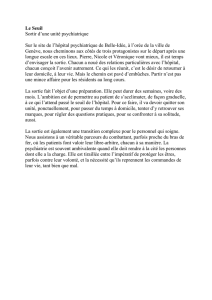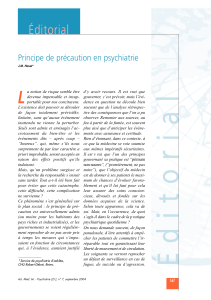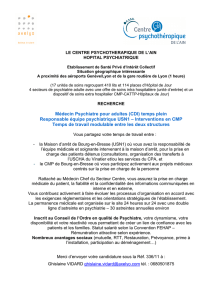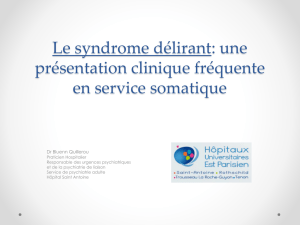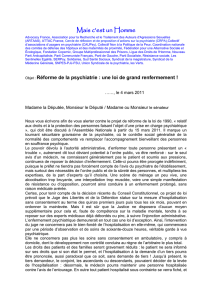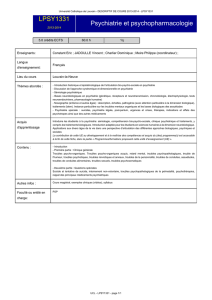Les soins ambulatoires sous contrainte au Danemark : code civil ou

LETTRE DE L’ÉTRANGER
Rubrique dirigée par P. Noël
Les soins ambulatoires sous contrainte
au Danemark : code civil ou pénal
ou code pénal et civil ?
Dans L’Information psychiatrique, vol. 81, n° 7 (septembre 2005), Jean-Louis Senon plaidait avec conviction pour que
les soins ambulatoires sous contrainte deviennent possibles. Afin d’alimenter le débat, nous nous sommes tournés vers
nos correspondants européens et nord-américains pour connaître leur point de vue et leur éventuelle pratique. Après les
contributions de Tilo Held pour l’Allemagne (n° 7), d’Arnaldo Ballerini pour l’Italie (n° 8), de J. Parratte pour le
Québec (n° 9) et de J. A. Inchauspe pour l’Espagne (n° 10), voici celle de A. Urfer Parnas.
Annick Urfer Parnas*
Le Danemark n’est pas épargné par ce phénomène
actuel, ce sentiment d’insécurité, observé dans les sociétés
occidentales. Certaines franges de la population sont
davantage visées comme responsables de ce phénomène.
Parmi elles, les patients souffrant de graves troubles psy-
chiques, dont on a observé une croissance régulière du
nombre d’actes criminels, mais aussi une tendance à être
marginalisés. Il est intéressant d’étudier ces problèmes
dans ce petit pays de 5,5 millions d’habitants, riche, avec
une bonne croissance économique, doté d’un service de
santé public, dont l’accès est gratuit pour toutes les person-
nes munies d’une autorisation de séjour. La pratique privée
de la psychiatrie est encore restreinte même si, ces derniè-
res années, on note une augmentation du nombre de cabi-
nets privés de psychiatres. Il faut souligner que la psychia-
trie danoise est réglementée depuis des années par la Loi
psychiatrique (Code civil) mais aussi par le Code pénal,
pour les personnes commettant des actes criminels et
jugées inaptes à une peine de prison en raison de troubles
mentaux, surtout psychotiques.
Il est difficile pour les services publics danois de psy-
chiatrie de faire face aux besoins de ces patients sévère-
ment malades, et les services carcéraux et sociaux sont
débordés. Ces problèmes sont jugés si importants et aigus
que le Parlement danois doit se prononcer en 2006 sur une
révision de la Loi psychiatrique, déjà revue en 1999.
L’enjeu de cette révision est l’introduction d’une possibi-
lité de traitement ambulatoire sous contrainte pour toute
personne, chroniquement et gravement malade, qui refuse
d’être traitée.
Dans cette communication, les différentes lois dictées
par les codes civil et pénal, leurs applications et limites sont
décrites, ainsi que brièvement celles en vigueur en Norvège
et en Suède.
Une attention spéciale est apportée à la nouvelle révision
de la loi psychiatrique qui sera débattue par le Parlement
danois l’an prochain. Quels sont les différents enjeux et
points de vue et que penser de cette « évolution discipli-
naire » de la psychiatrie ?
Les lois civiles psychiatriques
La première loi psychiatrique date de 1683 et a été
établie sous le règne de Christian V. Elle visait à protéger la
société contre les personnes psychiquement malades et
dangereuses. Elle a été révisée en 1938, 1989 et 1999. Son
contenu évolue depuis sa première parution au XVII
e
siècle
de mesures de protection de la société vers une protection
de l’individu contre les abus potentiels de la société à son
égard [3].
Cette loi contient la législation des hospitalisations sous
contrainte, la réglementation des traitements d’office,
médicamenteux, ECT, et des contentions physiques, admi-
nistration de calmants, obligation pour un patient à rega-
gner sa chambre, attachement d’un patient dans son lit,
fréquence des contrôles, obligation d’une garde person-
nelle 24 heures sur 24.
Les deux possibilités d’admission sous contrainte sont
justifiées soit par des critères d’urgence et de dangerosité,
*
Psychiatre, assistante de recherche, Hvidovre Hospital, Brøndyøstervej
160, 2605 Brøndby, Danemark
L’Information psychiatrique 2006 ; 82 : 71-6
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 71
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

soit par des besoins de soins, à condition qu’elles permet-
tent une amélioration de l’état du patient. Avant tout traite-
ment d’office ou privation de liberté, il est stipulé par la loi
que tout doit avoir été mis en œuvre pour essayer de
convaincre la personne de se laisser soigner volontaire-
ment. La loi n’est applicable que si le patient est « insensé »
(sindssyg), sous-entendu psychotique ou équivalent à un
état psychotique. Les symptômes doivent être décrits pré-
cisément sur les papiers d’admission pour être validés par
l’autorité aussi bien médicale que policière. Une hospitali-
sation sous contrainte d’un homme âgé dément, qui se
mettait en danger dans sa maison, a été désavouée par le
Conseil légal de psychiatrie parce que cette personne
n’était pas psychotique et qu’il n’existait aucun traitement
susceptible d’améliorer son état.
Il y a une dissociation entre soins et traitement : les
traitements sous contrainte ne sont administrables qu’en
milieu hospitalier. L’administration aiguë de tranquilli-
sants n’est possible qu’en présence d’un danger potentiel
envers le patient ou son entourage. Il doit être documenté
dans le dossier médical que l’on a essayé de convaincre le
patient de prendre un médicament par voie buccale avant
une injection forcée. La procédure des traitements sous
contrainte non aigus est soumise à une législation très
précise. Une période de 10 jours est prévue pour essayer de
convaincre le patient de prendre le médicament qu’on lui
propose deux fois par jour. Si le patient persiste dans son
refus, le psychiatre responsable de son traitement rédige un
rapport au conseil des patients et demande la permission
d’effectuer ce traitement. La réponse sera donnée après la
réunion à l’hôpital du conseil des patients (un juriste, un
médecin extérieur à l’hôpital, un greffier et un représentant
d’une association de patients) avec le malade, son référent,
le médecin demandeur du traitement.
Chaque acte effectué sous contrainte doit être répertorié
dans un protocole ainsi que dans le dossier médical et
infirmier. Seul le médecin est en droit d’ordonner un acte
sous contrainte, comme l’administration aiguë d’un médi-
cament ou d’une contention physique, sauf dans des situa-
tions exceptionnelles. Le patient, dans les 24 heures qui
suivent cet acte, est en droit de voir son conseiller (patien-
trådgiver), qui lui expliquera ses droits et les moyens de se
plaindre.
Si le conseil de patients (Sundhedsvæsenets Patientkla-
genævn) ne reconnaît pas la nécessité de la poursuite d’une
hospitalisation sous contrainte, dès que la réponse parvient
au médecin et au malade, celui-ci peut sortir, sauf contre-
indication du médecin qui peut faire recours (figure 1).
Chaque année, le ministère de la Santé publie sur inter-
net le nombre de gestes pratiqués sous contrainte par caté-
gorie et par hôpital pour tout le pays, ce qui provoque un
débat public dans les médias, qui inquiète les médecins-
chefs des services les plus mal côtés, surtout en ce qui
concerne les fixations dans le lit.
En 2003, on a enregistré pour tout le Danemark un total
de 24 448 hospitalisations (volontaires et involontaires) et
5 061 personnes ont été touchées par une forme ou une
autre de contrainte. Cette même année, on a pratiqué
4 673 privations de liberté (admission à l’hôpital ou prolon-
gation de séjour), 456 traitements d’office médicamenteux
Hospitalisation
sous contrainte
Validation
par le directeur
de la police
ou son substitut
Validation
par le médecin-chef
du service d’admission
ou son substitut
Papiers
rédigeables
par n’importe
quel médecin
non affilié
au service
d’admission
ou proche du
malade
Continuation
en volontaire
Continuation
sous contrainte
Traitement
volontaire
Traitement non
volontaire
Traitement
volontaire
Traitement non
volontaire
Réévaluation
à des intervalles
de temps précis
Figure 1. Procédure d’hospitalisation sous contrainte au Danemark.
A. Urfer Parnas
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200672
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

non aigus, 1 787 fixations au lit (durée non répertoriée),
1 487 administrations de tranquillisants [9].
En Norvège, la psychiatrie est également très réglemen-
tée, avec toutefois quelques distinctions majeures. Il est
possible de traiter en ambulatoire sous contrainte certains
patients sévèrement malades, et dont on a l’expérience
qu’ils répondent au médicament proposé. En revanche, il
n’est pas possible de changer une admission volontaire en
prolongation de séjour involontaire. Le patient doit être
réadmis à l’hôpital après un examen pratiqué à l’extérieur
et avec la reconnaissance de l’autorité de police. Il n’y a
aucune statistique norvégienne sur l’effet des traitements
ambulatoires sous contrainte.
La loi suédoise ne reconnaît pas les traitements ambula-
toires sous contrainte, mais un médecin-chef hospitalier
peut donner « une permission » hors de l’hôpital, parfois de
plusieurs semaines, à un patient hospitalisé d’office et qui
reçoit un traitement sous contrainte, à condition qu’il le
suive pendant son congé.
Les plans de coordination entre
l’hospitalier et l’ambulatoire
Lors de la révision de la loi psychiatrique en 1999, deux
nouvelles procédures ont été inscrites, « le rendez-vous de
sortie » et « le plan de coordination ». Elles concernent les
personnes sévèrement malades, typiquement des patients
schizophrènes sans observance et souvent avec un pro-
blème de dépendance. Ces deux nouvelles lois permettent
au médecin-chef hospitalier d’établir, avec ou sans l’accord
du patient, un contrat avec le secteur ambulatoire, une
policlinique psychiatrique, les autorités sociales, les méde-
cins généralistes. Ce contrat permet d’échanger des infor-
mations entre les différents intervenants. Sans lui, ces
informations, de l’ordre du secret médical, ne peuvent pas
être transmises par l’hôpital à ces services, sans l’accord
écrit du patient. Ces contrats ne permettent pas un traite-
ment sous contrainte, mais sont un moyen d’essayer de
garder le contact avec la personne, de se rendre à son
domicile, de la joindre par téléphone, de parler avec son
assistant social de la commune.
Mille contrats annuels étaient attendus après la mise en
vigueur de cette nouvelle loi. Depuis 1999, environ cent par
année ont été enregistrés. Leur réalisation est chaotique,
peu de personnes se soucient de leur suivi en milieu aussi
bien hospitalier qu’extrahospitalier, personne ne se sent
vraiment responsable.
Les lois pénales psychiatriques
La psychiatrie légale au Danemark n’est pas une spécia-
lité, mais appartient à la psychiatrie générale. À partir du
XIX
e
siècle, les délinquants présentant des troubles psychi-
ques peuvent ne pas être condamnés à une peine de prison.
Philosophes, juristes, psychiatres, politiciens ont débattu
sur l’expression « straffefri », littéralement traduisible par
« libre de peine » lié au terme « insensé », sous-entendu
psychotique ou équivalent à un état psychotique comme un
état confusionnel dû à une maladie somatique [7].
Dans la loi de 1930, les psychiatres, influencés par un
optimisme thérapeutique, jouissaient d’un grand pouvoir
décisionnel quant aux mesures psychiatriques et à la durée
de leur application. Lors de la révision du Code pénal en
1973, cette fois sous l’influence de la pensée de la Neo-
classic School of Penology, les délinquants psychiquement
malades mais non psychotiques doivent subir une peine
ordinaire ; seules les personnes psychotiques ne peuvent
pas être condamnées ou emprisonnées, suivant ainsi les
conventions internationales européennes. Les années 1990
ont été davantage marquées par des discussions concernant
la durée des traitements psychiatriques imposés pénale-
ment, qui sont sans limite temporelle pour les patients jugés
dangereux.
La personne délinquante, à la demande de son avocat, du
tribunal ou du procureur, doit subir une expertise psychia-
trique, pas obligatoirement demandée même en cas d’anté-
cédents psychiatriques. Cet examen se passe soit dans un
service spécialisé (quatre cliniques de psychiatrie légale
pour tout le Danemark), soit dans un service public de
psychiatrie. Le psychiatre se prononce sur l’état mental au
moment des faits, mais aussi sur un diagnostic plus général.
Il propose, s’il l’estime nécessaire, des mesures de rempla-
cement de peine, afin de prévenir une potentielle récidive,
et il peut aussi s’exprimer sur la dangerosité de la personne.
La décision finale appartient au tribunal, qui accorde « une
liberté de punition » si la personne était considérée comme
psychotique au moment du crime et remplace la peine par
des mesures psychiatriques, décrites ci-dessous :
1) Placement en en quartier de haute sécurité : concerne les
personnes dangereuses, sans limite temporelle.
2) Placement en milieu psychiatrique, en division de psy-
chiatrie légale, s’ilyadelaplace autrement en division de
psychiatrie générale, sans limite temporelle.
3) Traitement psychiatrique à l’hôpital avec le contrôle de
l’autorité sociale judiciaire.
4) Traitement psychiatrique ambulatoire avec ou sans
contrôle de l’autorité sociale judiciaire.
5) Traitement psychiatrique ambulatoire avec une close
permettant au médecin-chef psychiatre d’hospitaliser la
personne d’office sans passer par la Loi psychiatrique
(Code civil).
Le placement en milieu psychiatrique implique que le
patient séjourne en milieu psychiatrique ouvert ou fermé,
décision prise par le médecin-chef du service, mais ses
permissions sont décidées par la justice et la sortie défini-
tive de l’hôpital par le tribunal. Les traitements psychiatri-
ques ont une durée déterminée, ils peuvent être prolongés si
Soins ambulatoires sous contrainte au Danemark
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 73
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

nécessaire et les permissions de sortie du week-end sont
décidées par le médecin psychiatre responsable.
Il existe un conseil médicolégal indépendant, une com-
mission d’experts psychiatres mandatés par les autorités
publiques. Ce conseil se prononce dans toutes situations de
litige concernant les gestes et hospitalisations sous
contrainte. Les experts sont consultés dans des cas de
graves délits, crimes ou délits sexuels, mais aussi dans des
cas de placement, de changement entre un placement obli-
gatoire vers une forme de traitement plus ouverte. Ces
psychiatres traitent les situations sur dossier et chaque cas
est jugé par trois experts.
Quand le pénal rencontre le civil
Si une personne, condamnée par la justice à un traite-
ment ambulatoire, vient à arrêter son traitement médica-
menteux, la loi pénale n’autorise pas l’administration for-
cée du médicament en ambulatoire. Elle doit être
hospitalisée selon la loi civile, comme tout autre patient, si
son jugement ne contient pas de close permettant une
hospitalisation ou selon la loi pénale si son jugement men-
tionne une possibilité d’hospitalisation, c’est-à-dire sans
les procédures liées à une hospitalisation sous contrainte.
Une fois en milieu hospitalier, la loi civile régit les traite-
ments et les gestes sous contrainte pour tous les patients,
légaux ou pas. Les patients légaux, soumis à un traitement
obligatoire, bénéficient des mêmes moyens de recours que
les autres ; ils reçoivent la visite d’un conseiller de patient
et passent aussi devant le conseil des patients (loi civile).
En revanche, si son jugement comprend une close permet-
tant une hospitalisation d’office (loi pénale), la personne ne
peut faire recours contre une privation de liberté, la situa-
tion est identique pour un prisonnier transféré de la prison
en milieu psychiatrique hospitalier, mais elle peut se plain-
dre à son avocat.
Quand le civil rencontre le pénal
En milieu hospitalier, le personnel (infirmier et médical)
a de plus en plus tendance à porter plainte à la police à
l’encontre de patients qui se comportent violemment ou
profèrent des menaces. Les causes en sont multiples. Un
des facteurs essentiels est un haut niveau d’agressivité
verbale et physique dans les divisions fermées où le person-
nel qui, soit manque parfois d’expérience, soit est tempo-
raire en raison d’un haut taux d’absentéisme, se sent parti-
culièrement exposé et vulnérable, et a un sentiment
constant de surcharge de travail. Il faut aussi noter
l’absence de personnel masculin. Certaines nuits, médecin
et personnel infirmier ne sont que des femmes et il est
parfois nécessaire de faire appel à la police locale, qui
intervient au sein de l’hôpital rapidement, aussi discrète-
ment que possible, ce qui représente des situations difficiles
pour les autres patients de la division.
Le personnel hospitalier a un sentiment d’impuissance
face à certains patients réhospitalisés fréquemment, sans
amélioration de leur état. Il ne se sent pas soutenu par
l’institution, souvent le corps médical tarde à envisager des
prises en charge globales à plus long terme, à la place
d’actions ponctuelles non coordonnées. Parfois porter
plainte contre un patient violent peut mener à un jugement
avec traitement obligatoire. Le danger évident de cette
pratique, si elle devenait une forme de routine, est la perte
du milieu hospitalier comme lieu de soins et d’encadrement
thérapeutique au profit d’une attitude disciplinaire avec une
punition comme outil.
La psychiatrie confrontée aux
problèmes de violence
et de paupérisation touchant certains
patients
Les psychiatres légaux sont exposés à une augmentation
considérable de demandes d’examen comme en témoigne
la croissance du nombre d’expertises pratiquées dans tout
le pays : 300 en 1980 à 1 500 en 2004, soit une augmenta-
tion annuelle de 6,5 %.
Durant cette même période, le nombre total de lits psy-
chiatriques a diminué de 10 000 à 4 000 dans tout le pays et
continue à décroître actuellement. Le nombre de patients
légaux en traitement psychiatrique est passé de 297 en 1980
à 1 134 en 1999, l’incidence augmentant de 6,18 % annuel-
lement [5]. Selon les auteurs de cet article, l’origine de
cette augmentation ne s’explique ni par un changement de
la législation psychiatrique ou pénale, ni par une augmen-
tation de la criminalité dans la population, ni par un chan-
gement des modalités des traitements psychiatriques
légaux. La cause en serait un nombre croissant de patients
psychotiques commettant des actes délictueux et qui, avec
les patients schizophrènes, représentent la majorité des
patients légaux (tableau 1).
Selon Peter Kramp [6], médecin-chef responsable de la
clinique de psychiatrie légale de Copenhague, une des
causes principales de ce phénomène serait la désinstitutio-
nalisation de la psychiatrie, entre autres une diminution
drastique des lits hospitaliers et des durées de séjour de plus
en plus courtes. Par ailleurs, le temps d’attente pour une
hospitalisation dans un service de psychiatrie peut être si
long que certains patients légaux préfèrent rester en prison
plutôt que de se trouver dans un service de psychiatrie
bondé.
Dans la revue hebdomadaire médicale danoise [2], un
médecin-chef psychiatre se demande si l’augmentation du
taux de criminalité parmi les malades psychiatriques est
liée au remplacement, en 1989, du tribunal judiciaire qui
jugeait les actes de privation de liberté et de traitement sous
A. Urfer Parnas
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200674
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

contrainte, par le conseil des patients, qui se passe à l’inté-
rieur de l’hôpital sans le cérémonial lié à une réunion dans
un tribunal, qui pourrait avoir un impact à plus long terme.
Munkner et al. [8], étudiant une cohorte de patients
schizophrènes à partir des registres danois de psychiatrie et
de criminalité, ont observé que 50 % de tous les jeunes
schizophrènes sont enregistrés dans le registre criminel. Le
temps médian entre le premier contact avec le milieu psy-
chiatrique hospitalier et le premier délit s’échelonne entre
7,1 et 6,7 années et, pour les personnes diagnostiquées
schizophrènes, ce temps diminue entre 5,4 et 4,9. Une
grande partie des délinquants a eu un contact avec la psy-
chiatrie avant de commettre leur premier délit. Un abus de
substance augmente le risque de criminalité, quel que soit
le diagnostic [1].
Kramp et Gabrielsen, en 2004 [6] montrent, dans une
étude transversale effectuée dans les services de psychiatrie
du district de Copenhague, que 10 % des patients schizo-
phrènes entre 20 et 44 ans sont des patients légaux et qu’ils
sont jugés plus souvent pour des actes violents ou de
pyromanie que les autres patients légaux.
Une autre question intéressante soulevée par Kramp est
celle de l’aspect économique : qui paie pour ces patients
légaux ? Par la justice, ils dépendent de l’État, mais par
leurs problèmes de santé, ils dépendant du canton.
Traitement ambulatoire sous contrainte
Les ministères danois de l’Intérieur et de la Santé, à
propos d’une proposition de révision de la Loi psychiatri-
que en 2006, ont commandé un rapport à une entreprise
privée, Rambøll Management, pour étudier les traitements
psychiatriques ambulatoires sous contrainte (qui pourront
se faire hors de l’hôpital psychiatrique) avec, comme but
principal, d’éviter des hospitalisations d’office. Cette
mesure touchera particulièrement les malades psychiatri-
ques les plus graves et non obligatoirement condamnés
pénalement.
Un rapport effectué par une commission de psychiatres
(5 membres), mandatée par l’Association danoise de psy-
chiatrie, qui s’est rapidement prononcée contre cette forme
de mesure, estime à environ 150 le nombre de personnes
qui pourraient subir cette forme de contrainte.
L’entreprise Rambøll Management arrive à la conclu-
sion que les patients schizophrènes gravement malades
n’auront plus besoin d’hospitalisation. Il suffit de les traiter
à la maison et si nécessaire sous contrainte.
Cette conclusion rendue publique a soulevé un vif débat
dans la population danoise et le monde psychiatrique. Plu-
sieurs associations de défense des droits des patients
s’opposent vivement à cette possibilité, soulignant son
aspect non éthique et le fait que cette mesure cache en
réalité une défaillance du fonctionnement actuel de la psy-
chiatrie, un manque de suivi entre l’hospitalier et l’ambu-
latoire, une diminution des ressources financières, l’oubli
du temps et de la difficulté d’établir une relation, le manque
de places en milieu hospitalier ou la brièveté des séjours
[10]. Ces associations soulignent également l’échec des
plans de traitement mis en place lors de la révision de la Loi
psychiatrique en 1999, qui auraient dû permettre une
meilleure coordination, mais qui n’ont pas été appliqués.
D’autres questions se posent sur le fondement éthique
d’une telle proposition, mais aussi en fonction du type de
médicaments, qui ne sont pas curatifs et qui ont un nombre
considérable d’effets secondaires. Plusieurs personnes
évoquent le meurtre de la ministre suédoise en 2004 par un
malade psychique qui avait consulté un service de psychia-
trie quelques jours avant de commettre ce crime, mais avait
été renvoyé à la maison.
Parmi les membres de la commission mandatée par
l’Association danoise de psychiatrie, deux psychiatres pré-
tendent que cette forme de traitement permettra à certaines
personnes d’éviter une déroute sociale et qu’il est non
éthique de laisser ces patients sans traitement et risquer
qu’ils finissent dans la rue ou criminels, « il ne faut pas les
laisser tomber ». Les trois autres, en revanche, soulignent la
liberté individuelle, le droit au domicile privé, l’aspect
discriminatif, l’intervention possible de la police au domi-
cile du patient, la peur pour les personnes de chercher de
l’aide avec, à la clé, le risque de subir un traitement chez soi
sous contrainte... Une étude Cochrane datant de 2005 [4]
montre que les traitements sous contrainte n’ont pas de
meilleurs effets sur la qualité de vie, le niveau social et le
coût des soins qu’un traitement ordinaire.
Les modalités de ce mode de traitement sous contrainte
ne sont pas encore précisées. Sera-t-il possible de forcer le
domicile d’un patient pour l’obliger à prendre son médica-
ment ? La police pourra-t-elle intervenir ? Combien de
temps le traitement durera-t-il ? Quels seront les critères
pour arrêter un traitement ?
Tableau 1.Distribution diagnostique (%) en fonction des expertises psychiatriques entre 1996 et 2001 (Retspykiatrisk Klinik, Copenhague)
Diagnostic 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Schizophrénie 17 31 32 23 24 21
Schizotypie 5 3 8 4 6 3
Autres appartenant au spectre de la schizophrénie 11 10 13 9 6 8
Maladies mentales autres 2 3 4 3 4 6
Retards mentaux 4 3 1 2 4 6
Non psychotiques 60 50 41 59 58 58
Soins ambulatoires sous contrainte au Danemark
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 75
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
1
/
6
100%