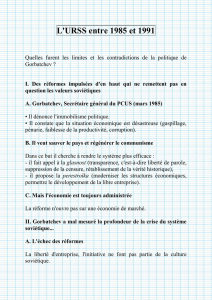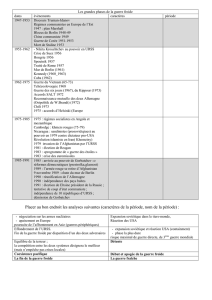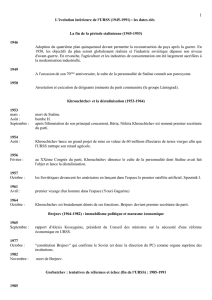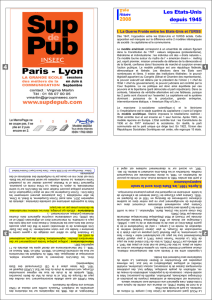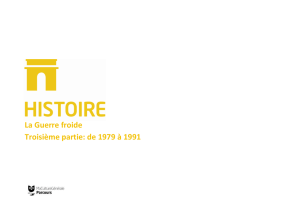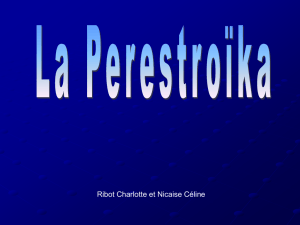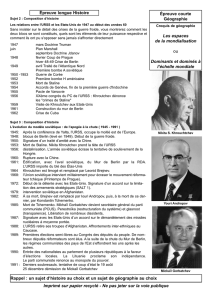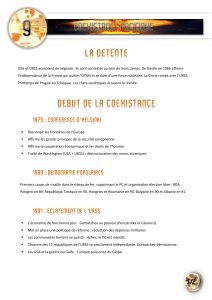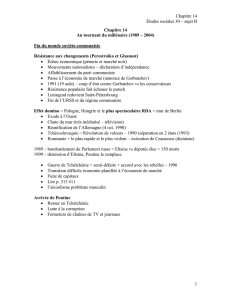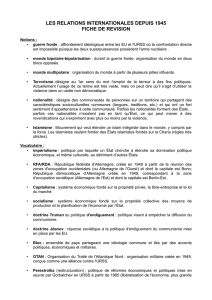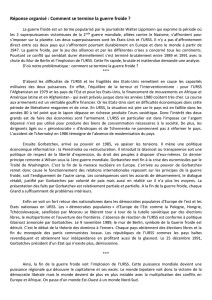theme 3 le siecle des totalitarismes

1
THEME 3
LE SIECLE DES TOTALITARISMES
QUESTION 2
LA FIN DES TOTALITARISMES
CHAPITRE 2
LA SORTIE PROGRESSIVE DU TOTALITARISME EN URSS
Définition du sujet : Tandis que l’Allemagne nazie pour laquelle la
défaite de la 2nde Guerre mondiale a précipité la fin du nazisme ; au
contraire, le régime soviétique sort glorifié par la victoire (notamment
par la bataille de Stalingrad et la libération des camps de concentration
nazis). Cette différence détermine les modalités de sortie du
totalitarisme dans ce pays : un processus progressif d’épuisement
interne qui s’inscrit dans le temps long. Il n’aboutit à la chute
définitive du régime que dans la dernière décennie du XXème siècle. En
effet, même si l’effondrement de l’URSS peu de temps après la chute
du mur de Berlin donne l’impression d’une sortie brutale et rapide du
totalitarisme ; celle-ci a des racines profondes.
Problématique :
Comment les reformes de Gorbatchev ont-elles conduit à la fin du
système soviétique ?
Plan de la leçon :
1. Le poids des facteurs externes
2. Les réformes de Gorbatchev remettent en question les fondements
mêmes du régime soviétique.
BILAN VIDEO :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMVideos/vvv5.jsp?no=20

2
1. Le poids des facteurs externes
A- Retard technologique de l’URSS par rapport aux EUA et au reste
du mode occidental en général.
A la fin des années 1970, le KGB commande une enquête confidentielle pour
évaluer le PNB de l’URSS selon les critères qualitatifs occidentaux et non plus
seulement en volume. Les résultats confirment le déclin de l’URSS dont
l’économie est désormais dépassée par le Japon et la RFA. Au même moment
(à partir de 1978), la Chine met en place les Zones Economiques Spéciales
(ZES) qui fonctionnent selon les règles du capitalisme et redynamisent
l’économie chinoise.
La situation de l’URSS est alors inquiétante. Elle n’est plus capable de
soutenir le rythme de la course aux armements. Les EUA y consacrent 8% de
leur PIB, tandis que le budget militaire de l’URSS absorbe entre 15 et 20% de
son PIB et alors que son économie stagne et n‘est pas en mesure de satisfaire
les besoins de sa population.
Malgré quelques succès ponctuels de l’URSS dans le domaine de la conquête
de l’espace (Spoutnik, Bases spatiales habitées), l’URSS accumule du retard
technologique dans trois domaines fondamentaux du développement à la fin
du XXème siècle : l’informatique, l’espace et la biochimie. L’accident
nucléaire de la centrale de Tchernobyl en 1986 est une des conséquences de
ce retard technologique.
C’est dans ce contexte que le Politburo porte un représentant de la
« nouvelle » génération au pouvoir en la personne de M. Gorbatchev alors
âgé de 54 ans en mars 1985. En effet, le Bureau Politique du PCUS compte
quelques membres qui croient encore à son idéologie et qui ne supportent
plus la corruption croissante à l’intérieur du Parti qui s’est accentuée pendant
l’ère Brejnev. En outre, les couches éduquées et techniquement compétentes
qui faisaient fonctionner le pays savaient que l’inefficacité et la rigidité du
système conduirait inévitablement à son effondrement à moins d’un

3
changement drastique. L’économie soviétique en faillite n’était plus capable
de répondre aux exigences d’un statut de superpuissance militaire.
B- Multiplication des révoltes dans les Démocraties Populaires
d’Europe orientale.
Les Démocraties Populaires d’Europe de l’Est étaient devenues le point faible
de l’URSS.
A cet égard, la situation de la Pologne en est la plus emblématique. Le climat
politique et économique s’y est dégradé à partir du début des années 1970 et
dans ce pays, plus qu’ailleurs, les ouvriers, les intellectuels et les cadres de
l’Eglise catholique y ont été plus solidaires et se sont rejoints à la fois sur les
terrains des revendications économiques et du respect des Droits de
l’Homme. Ainsi, le 23 septembre 1976, après la répression brutale des grèves
ouvrières, les intellectuels fondent le Comité de Défense des Ouvriers (KOR).
Au cours des mois suivants, sont créées des organisations indépendantes et
des journaux ouvertement opposés aux autorités en place. Dans ce pays
trois facteurs se conjuguèrent pour faire perdre toute légitimité au régime
communiste :
o L’opinion publique y était très largement unie par son hostilité au
régime et par un nationalisme très antirusse et catholique.
o L’Eglise conservait une organisation nationale indépendante. Le 2 juin
1979, le pape Jean-Paul II (polonais) génère une explosion de ferveur
religieuse et d’unité nationale qui démontre le déclin du communisme.
o Depuis les années 1950, la classe ouvrière avait régulièrement montré
sa puissance politique par des grèves massives. A partir du milieu des
années 1970, le mouvement ouvrier devint politiquement organisé
(Syndicat Solidarnosc) et soutenu par de nombreux intellectuels et
l’Eglise catholique.
Vis- à-vis de ces formes d’opposition, le régime avait adopté une attitude de
tolérance tacite.

4
Même si elle y avait atteint un niveau d’organisation moins abouti, une
opposition, souvent née dans les milieux intellectuels avait également réussi
à se développer en Hongrie, en Tchécoslovaquie (Cf. rôle de Vaclav Havel) et
en RDA. Dans ces pays, en revanche, l’opposition a plus de mal à dépasser les
milieux intellectuels qui cristallisent l’essentiel des revendications. Ainsi, en
Tchécoslovaquie, 243 intellectuels publient le 1er janvier 1977, la Charte 77,
exigeant le respect des Droits de l’Homme. A l’inverse de Solidarnosc en
Pologne, qui est devenu un mouvement de masse sur une base syndicale et
chrétienne, la Charte 77 demeure limitée aux cercles intellectuels
tchécoslovaques. Cependant, dans les deux cas, Solidarnosc et la Charte 77
ont contribué de façon directe à la chute du communisme.
2. Les réformes de Gorbatchev remettent en question les fondements
mêmes du régime soviétique
A. Des réformes destinées à sauver le régime soviétique.
Dès son arrivée au pouvoir en 1985, Gorbatchev proclame une nouvelle
orientation politique de l’URSS. Sur le plan économique, ces réformes visent
à assoupir le système centralisé et à accorder des marges d’autonomie aux
acteurs individuels ou collectifs, comme la concession de baux à très long
terme aux paysans, l’autorisation de créer des entreprises unipersonnelles ou
des coopératives.
Gorbatchev a conscience que le retard économique et technologique de
l’URSS est dû à l’extrême centralisme de l’économie soviétique, qui empêche
toute initiative individuelle. Ainsi, les entreprises ne peuvent fixer leurs
objectifs de production elles-mêmes en fonction des commandes reçues,
mais selon les objectifs du plan quinquennal.
Glasnost (« Transparence »)
Ce terme désigne la politique de libéralisation de la vie politique mise en
place par M. Gorbatchev dès 1985. Elle se manifeste par l’instauration du

5
multipartisme, des élections libres, la liberté de la presse, la fin de la
censure (ce qui donne alors lieu à la publication de nombreux ouvrages qui
avaient jusque là été censurés comme ceux de Soljenitsyne). Des prisonniers
politiques furent aussi libérés et des exilés dissidents purent rentrer dans leur
pays.
Cette politique approfondit la politique de déstalinisation qui avait été initiée
par Khrouchtchev. Comme Khrouchtchev, Gorbatchev dénonce les crimes
commis par Staline, mais cette fois il le fait publiquement.
L’objectif était de moderniser l’URSS, mais aussi de faire pression sur les
conservateurs du Parti opposés à la politique de restructuration
économique.
La Glasnost a provoqué une montée des contestations, notamment parce
qu’elle est mise en place en même temps que la politique de reformes
économiques (Perestroïka) qui a elle-même entraîné une grave crise
économique.
Perestroïka (« Restructuration »)
C’est le nom donné aux reformes économiques et sociales impulsées et
mises en œuvre par M. Gorbatchev en URSS d’avril 1985 à décembre 1991.
Dès les années 1960, un économiste soviétique, Evsei Liberman avait averti
que l’extrême centralisme de l’économie soviétique ainsi que la rigidité de la
planification étaient les causes du retard de l’économie soviétique qui ne
laissait aucune place aux initiatives personnelles.
Gorbatchev conduit alors une série de reformes structurelles profondes :
o Restitution de la terre aux paysans qui bénéficient de baux à long
terme (50 ans) pour des exploitations personnelles.
o Autorisation pour les particuliers de créer des entreprises
unipersonnelles ou des coopératives (restaurants, salons de coiffure,
petit artisanat…)
o Tentative de libéralisation de l’activité économique des grandes
entreprises d’Etat en responsabilisant le personnel.
o Diminution du rôle du Parti à partir de 1988
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%