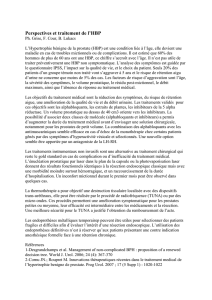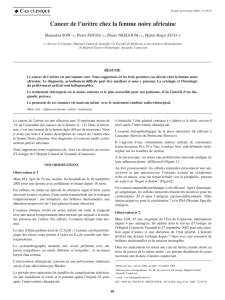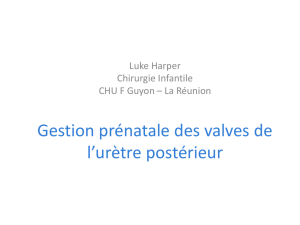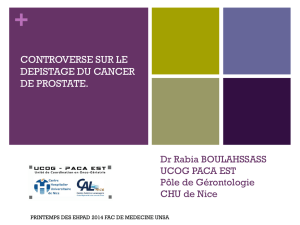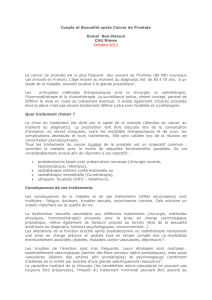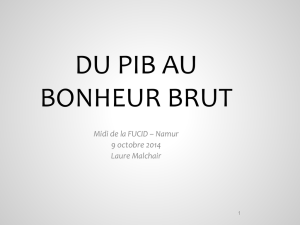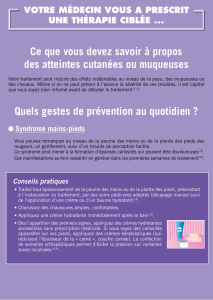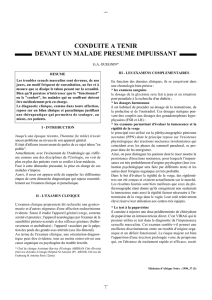Le traitement chirurgical des ruptures traumatiques de l

◆ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2000), 10, 58-64
58
Le traitement chirurgical des ruptures traumatiques
de l’urèthre postérieur
Rachid ABOUTAIEB, Ismail SARF, Mohammed DAKIR, Ali EL MOUSSAOUI, Abdennabi JOUAL,
Fathi MEZIANE, Saad BENJELLOUN
Service d’Urologie, C.H. Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
Les traumatismes de l’uréthre masculin sont en aug-
mentation du fait de l’accroissement du trafic routier et
de l’accélération des véhicules. Les victimes sont
essentiellement les piétons et les conducteurs de moto-
cyclettes. Ces traumatismes sont graves par leurs
conséquences néfastes sur l’activité sociale, la fertilité
et la fonction érectile, surtout quand ils touchent des
sujets jeunes et actifs.
L’uréthre postérieur est profondément enchâssé dans
le pelvis, il est cependant exposé par sa situation au
contact des os du bassin. Son atteinte est en régle asso-
ciée à une fracture du bassin. Ce sont les fractures de
Manuscrit reçu : mai 1998, accepté : septembre 1999.
Adresse pour correspondance : Dr. R. Aboutaieb, Service d’Urologie, C.H. Ibn
Rochd, Casablanca, Maroc.
RESUME
Buts : Comparer les résultats thérapeutiques du traitement chirurgical en urgence
différé et du traitement tardif des ruptures traumatiques de l’urèthre postérieur.
Matériel et Méthodes : 35 patients sont opérés pour traumatisme de l’urèthre posté-
rieur.Leur âge moyen est de 25 ans (extrêmes : 7 à 79 ans). Il s’agit dans la majorité
des cas d'un traumatisme secondaire à un accident de la voie publique, entraînant
une fracture du bassin. Une fois le diagnostic de rupture de l’urèthre postérieur rete-
nu, l’attitude ultérieure dépend de l’état du patient et des lésions associées. En l’ab-
sence de lésions viscérale ou squelettique graves, le patient est opéré dans les 3
semaines suivant le traumatisme après un bilan radiologique. Ceci a concerné 16
patients du Groupe I. Dans le cas contraire, il n’est opéré qu’au sixième mois après
stabilisation de toutes les lésions traumatiques. Cette attitude a été pratiquée chez 19
patients (Groupe II).
Résultats : Ils sont jugés sur la qualité du jet mictionnel, la continence urinaire et
l’impuissance sexuelle. Ainsi, le jet était jugé bon dans 93,75% des cas (Groupe I) et
78,8% des cas du Groupe II. La continence a été parfaite dans 100% des cas (Groupe
I), contre 89,4% (Groupe II). L’impuissance sexuelle a été observée dans 18,7% des
cas du Groupe I contre 5,3% des cas du Groupe II.
Conclusion : Les traumatismes de l’urèthre postérieur sans lésions associées graves
peuvent être opérés en urgence différée avec d’excellents résultats du point de vue
mictionnel (80% de bons résultats) mais avec une fréquence plus élevée d’impuis-
sance sexuelle. Chez les patients porteurs de lésions associées graves, la prise en char-
ge thérapeutique des traumatismes de l’urèthr
e n’est effectuée que dans des délais de
3 à 6 mois, au stade de sténose uréthrale. La chirurgie consiste alors en la résection
du callus fibreux suivie d’anastomose uréthrale. Les résultats de cette intervention
sont bons, au prix de sténose itérative traitée par endoscopie, mais avec moins d’im-
puissance sexuelle.
Mots clés : Urèthre, traumatisme, sténose de l’urèthre, incontinence urinaire, impuissance sexuelle,
uréthrorraphie.

59
l’arc antérieur qui sont les grandes pourvoyeuses des
lésions uréthrales [8]. Ce type de lésion explique par
ailleurs en partie la fréquence de l’impuissance sexuel-
le par atteinte traumatique vasculaire mais surtout par
lésion des nerfs érecteurs. Ces derniers ont en effet un
trajet qui passe sous les branches pubiennes [5].
La prise en charge thérapeutique des ruptures de l’uré-
thre postérieur reste encore controversée. En effet, ils
peuvent être traités par voie endoscopique ou chirurgi-
cale, en urgence immédiate, différée ou tardivement
après le traumatisme.
L’intervention chirurgicale en urgence est abondonnée
par la majorité des auteurs. En effet, l’importance de
l’infiltration hémorragique des tissus et l’énorme perte
sanguine par le périnée rend difficile l’identification
des structures, et expose à des lésions surajoutées res-
ponsables de taux élevés d’impuissance sexuelle et
d’incontinence urinaire [7].
L'intervention chirurgicale en urgence différée consiste
à opérer les patients entre la premiére et la troisiéme
semaine, après tarissement du saignement mais avant
l’installation de la fibrose [3, 10, 16].
L’intervention chirurgicale tardive, est effectuée après
des délais de 3 mois [19], 6 mois [20, 21, 22] voire 9
mois selon l'importance de l'hématome et de l’écarte-
ment des deux extremités uréthrales [6]. Ces délais
auront permis de réparer toutes les autres lésions asso-
ciées prioritaires. Cependant, sur le plan local, l’héma-
tome s’est organisé en un callus fibreux d’étendue
variable et qui maintient les deux extrêmités uréthrales
en décalage.
Nous rapportons une série rétrospective de 35 patients
opérés pour traumatisme de l'uréthre postérieur en
comparant les résultats thérapeutiques en fonction de la
date de l’intervention par rapport au traumatisme.
MATERIEL
De janvier 1987 à décembre 1997 trente-cinq patients
présentant une rupture de l’urètre membraneux ont été
opérés dans notre service. Tous les malades sont de
sexe masculin avec un âge moyen de 25 ans (7 à 79
ans) . Les accidents de la voie publique représentent
l’étiologie la plus fréquente, rencontrée dans 80% des
cas. Il s’agit dans la majorité des cas de conducteurs de
motocyclette ou de piétons heurtés par un véhicule.
Par ailleurs, tous ces patients présentent une fracture du
bassin, et plus de la moitié ont d’autres lésions asso-
ciées : cranio-cérébrales (15 cas), abdominales et/ou
thoraciques (11 cas), et fractures des membres (10
cas).
Le diagnostic clinique a été posé devant des signes
urinaires : uréthrorragies, associées au globe vésical.
Dès leur admission au service des urgences, tous ces
malades ont bénéficié d’une cystostomie sus pubien-
ne.
Nous avons réparti nos patients en 2 groupes :
Le Groupe I
Ce groupe comporte 16 malades ne présentant pas de
lésions associées sévéres et ne nécessitant par consé-
quent aucun geste chirurgical associé. Pour ceux là,
un bilan urologique comportant une urographie
intraveineuse et une uréthrocystographie rétrograde
et mictionnelle (UCRM) est effectué les premiers
jours aprés l’accident. Ce bilan a montré une extra-
vasation du produit de contraste typique d’une ruptu-
re compléte de l’uréthre membraneux (Figure 1),
accompagné d’une surélévation de la vessie par l’hé-
matome pelvien.
Le Groupe II
Ce groupe est composé de 19 malades présentant des
lésions associées sévéres nécessitant un séjour dans les
R. Aboutaieb et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 58-64
Figure 1. Extravasation du produit de contraste au cours
d’une uréthrocystographie témoignant de l’existence d’une
rupture uréthrale.

différents services pour traitement des lésions priori-
taires. La cystostomie est effectuée dés l’admission aux
ur
gences et gardée jusqu’à l’hospitalisation du patient
au service d’urologie 3 à 6 mois plus tard. Un bilan est
effectué à cette date. Il comporte une urographie intra-
veineuse et une uréthrocystographie rétrograde couplée
à une cystographie mictionnelle (UCRM). Dans tous
les cas, cet examen a mis en évidence une sténose de
l’uréthre membraneux, dont l’étendue varie entre 3 et 5
centimètres (Figure 2).
METHODES
L’intervention a consisté dans tous les cas en une ana-
stomose termino-terminale des 2 extremités uréthrales
rompues. La voie d’abord, et le délai opératoire sont
différents dans les 2 groupes.
Groupe I : (16 cas )
Le patient est opéré entre J7 et J21 après l’accident.
La voie d’abord est périnéale en Y renversé. On pro-
céde à l’évacuation de l’urohématome, l’ablation des
sequestres osseux puis la dissection des bouts distal et
proximal jusqu’en zone saine, en essayant de préser-
ver les artéres bulbaires. Le bout proximal est en
général repéré par un béniqué introduit par la cysto-
tomie. Au delà du 15éme jour, nous avons remarqué
l’installation de l’hémostase, les tissus sont plus
fermes rendant les sutures plus aisées sans qu’il y ait
de véritable fibrose. Enfin la suture termino-termina-
le par 4 à 6 points de Vicryl 4/0 est effectuée en pre-
nant soin de bien prendre la muqueuse. L’ a d o s s e m e n t
des deux bouts est facile, car il n’ya pas encore d’ins-
tallation de phénoméne fibreux. Une sonde tutrice est
immédiatement mise en place et gardée pendant 2
s e m a i n e s .
Groupe II (19 cas)
Ces patient sont opérés au delà du 3ème mois. La voie
d’abord est soit périnéale (16 cas) soit transsymphysai-
re (3 cas). Au cours de l’abord par la voie périnéale, on
procéde à la dissection premiére de l’uréthre périnéal,
la résection du cal fibreux et le repérage du bout proxi-
mal par l’introduction d’un béniqué par l’orifice de
cystostomie. Le manque entre les 2 bouts peut être
important nécessitant alors quelques artifices tech-
niques tels que la dissection lointaine de l’uréthre anté-
rieur ou la séparation des corps caverneux sur la ligne
médiane. Enfin l’anastomose termino-terminale permet
l’adossement muco-muqueux.
La voie transsymphysaire a été utilisée pour les
60
Tableau 1. Résultats thérapeutiques, comparaison entre la
réparation en urgence différée (groupe I) et la réparation tar -
dive (groupe II).
Groupe I Groupe II
(16 cas) (19 cas)
Bon 13 cas (81,25%) 9 cas (47,3%)
Jet mictionnel Moyen 2 cas (12,5%) 6 cas (31,5%)
Mauvais 1 cas (6,25%) 4 cas (21,2%)
Continence Bon 16 cas (100%) 17 cas (89,4%)
Mauvais -2 cas (10,6%)
Erection Bon 13 cas (81,25%) 18 cas (94,7%)
Mauvais 3 cas (18,75%) 1 cas (5,3%)
Le jet mictionnel :
- bon : absence de dysurie clinique et une débitmétrie > 15 ml/seconde,
- moyen : une dysurie modérée ou une débitmétrie entre 10 et 15 ml/seconde,
- mauvais : dysurie importante et débitmétrie inférieure à 10 ml/seconde. Dans
ces cas la radiologie a confirmé l’existence d’une sténose post-opératoire.
La continence :
- bonne : absence d’incontinence,
- mauvaise : incontinence totale.
La fonction érectile :
- bonne en présence d’une érection permettant la pénétration,
Tableau 2. Résultats thérapeutiques comparant la réparation
tardive et la réparation en urgence différée.
Nombre de Sténose Incontinence Impuissance
cas sexuelle
Réparation
en urgence
différée
Koratim [6] 4 2 - 2
Mundy [16] 17 3 - 12
Notre série 16 5 0 5
Réparation
tardive
Morey [15] 82 9 4 31
Koratim [7] 73 71 2 9
Ennemoser [5] 31 0 0 3
Notre série 19 4 2 1
Figure 2. Uréthrocystographie rétrograde couplée à une cysto -
graphie mictionnelle. Noter l’arrêt net du produit de contraste
au niveau de l’urèthre membraneux témoignant de la sténose
et indiquant son étendue.
R. Aboutaieb et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 58-64

patients présentant un bout proximal fixé en position
haute rétropubienne associé à un diastasis important de
la symphyse pubienne. Aucune pubectomie n'a été pra-
tiquée. Dans ces cas, le premier temps consiste en un
repérage premier de l’uréthre membraneux en s’aidant
d’une cystotomie. Le deuxième temps est une résection
du cal scléreux puis repérage du bout distal par voie
périnéale. Enfin, on effectue une anastomose termino-
terminale en prenant soin de suturer la muqueuse.
Dans tous les cas, un drainage par sonde uréthrale et
sonde de cystostomie est gardé pendant 2 à 3 semaines.
RESULTATS
Le recul varie de 4 ans pour les malades les plus
anciens à un an. En effet, les premiers patients de la
série qui sont guéris ne reviennent plus en consultation.
Le recul moyen est alors de 2 ans dans les deux
groupes.
Les complications locales comprennent : un abcés péri-
néal (1cas), un abcès de paroi (1 cas), un hématome
périnéal (1 cas). Il n'a pas été observé de fistules uri-
naires.
L’analyse des résultats a pris en considération la quali-
té de la miction, la continence et la fonction érectile
(Tableau 1).
Le jet mictionnel a été jugé bon dans plus de 80% des
cas du groupe I, alors qu’il n’était que de 47% dans le
groupe II. De même, le taux de resténose a été, dans le
groupe I, de 6,25% des cas, alors qu'il a été de 21,2%
des cas dans le groupe II. Ce taux plus élevé serait pro-
bablement en rapport avec la difficulté d'exciser toute
la fibrose constituée. En effet, plus la fibrose est éten-
due, moins les résultats sont satisfaisants. Ces sténoses
apparaissent au dela de la premiére année et répondent
bien aux uréthrotomies endoscopiques à un rythme
d’une intervention par an en moyenne.
Le taux d'incontinence est de 0% dans le Groupe I
contre 10,6% dans le groupe II. Cette incontinence peut
être expliquée par l'importance du traumatisme, détrui-
sant le sphincter interne et les fibres nerveuses. Aucun
patient n’a rapporté d’incontinence urinaire à l’effort.
L'impuissance sexuelle est difficile à évaluer chez nos
patients. L’évaluation a été effectuée par l’examen cli-
nique seul sans autre examen paraclinique. Les patients
du groupe I rapportent une impuissance sexuelle dans
18,7% des cas, alors que seulement 5,3% des patients
du groupe II ne sont pas satisfaits de leur activité
sexuelle. Ceci est à l’origine de problémes médico-
légaux. Il est en effet difficile de faire la part de l’inter-
vention et du traumatisme dans la genése de cette
impuissance, de même qu’il est difficile de connaître
exactement l’état de l’érection avant l’accident.
DISCUSSION
Les ruptures de l’urèthre postérieur sont de plus en plus
fréquentes avec l’augmentation des accidents de la cir-
culation. La majorité des patients de notre série sont
des piétons ou des conducteurs de motocyclette heurtés
par un véhicule.
Les traumatismes de l’urèthre s’observent en général
dans le cadre d’un polytraumatisme, associant des
lésions squelettiques et une atteinte viscérale. L’atteinte
de l’uréthre postérieur est observée dans 10% des cas
de fractures du bassin. En effet, l’uréthre postérieur est
bien protégé car il est profondément enchâssé dans le
pelvis. Il reste cependant vulnérable du fait de ces rap-
ports avec l’aponévrose périnéale moyenne.
Le diagnostic de rupture traumatique de l’uréthre est
retenu cliniquement en présence d’une rétention vési-
cale associée à l’uréthrorragie chez un traumatisé du
bassin. Dans le cadre du bilan lésionnel, l’échographie
authentifie la rétention vésicale, et permet de guider le
cathétérisme sus pubien. Ce dernier représente un geste
primordial. En l'absence de globe vésical, il faut se
méfier d'une rupture vésicale associée qui s'observe
dans 10% de cas [22]. Il faudrait alors mettre en condi-
tion ce traumatisé, effectuer un remplissage et des
transfusions en fonction de sont état, et refaire l’exa-
men clinique et echographique. La réapparition du
globe vésical signe l’intégrité de la vessie.
Le reste du bilan lésionnel va conditionner la modalité
de la prise en charge thérapeutique ultérieure.
L'intervention en urgence immédiate n'est justifiée que
s'il ya une lésion traumatique d'un organe pelvien
comme une rupture traumatique du rectum ou une rup-
ture vésicale. L'intervention est effectuée par une lapa-
rotomie qui répare les lésions pelviennes.
En l’absence de lésion associée intrapelvienne ou vis-
cérale grave, une UIV et une UCRM sont effectuées
entre la 1ére et la 3ème semaine. L’existence d’extra-
vasation d’urine sur l’UCRM pose le diagnostic de
lésion uréthrale. La réparation chirurgicale est effec-
tuée dans ces mêmes délais. Cette intervention a l'avan-
tage d'éviter la morbidité liée à l'intervention immédia-
te, tout en réglant le probléme uréthral rapidement.
Nous utilisons toujours la voie périnéale. Elle a l'avan-
tage d'être simple, peu délabrante et donne un bon jour
sur l’uréhre. Cette voie d'abord préserve les artéres
périnéales et les nerfs érecteurs tout en permettant l’ex-
position correcte de l’uréthre [5]. Elle permet une ana-
stomose simple avec une morbidité opératoire faible
par rapport à la laparotomie. Elle a l'inconvénient de ne
pouvoir être utilisée chez certains traumatisés du bas-
sin qui ne peuvent être placés en position de lithotomie
quelques jours après le traumatisme [22].
L’accès au foyer de fracture, trouve alors l’hémorragie
61
R. Aboutaieb et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 58-64

bien contrôlée, l' hématome qui est circonscrit est éva-
cué, de même que les fragments osseux et les débris
tissulaires. La rupture uréthrale est encore fraiche avec
des extrémités uréthrales souples. L'anastomose termi-
no-terminale est effectuée en s'assurant que la suture
prend bien la muqueuse uréthrale des 2 côtés. Les
résultats concernant la qualité du jet mictionnel sont
supérieurs à 80% [10, 16]. Dans notre série, ce résultat
était de 81,25%.
Dans les cas de traumatismes graves avec instabilité
hémodynamique, ou lésion viscérale ou cutanée
importante, la réparation uréthrale n'est pas une priori-
té. Ces malades sont pris en charge tardivement au delà
du 3ème mois. Cette attitude que nous adoptons de
nécessité est suivie de principe par un ensemble d’au-
teurs [12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22]. Le délai d'attente
permet la réparation des autres lésions associées mais
aussi la cicatrisation locale et la résorption de l’héma-
tome pelvien, ce qui prend 3 à 4 mois [19].
A ce stade, la rupture uréthrale s'est alors transformée
en une sténose uréthrale avec décalage des deux extré-
mités. En effet, les deux extrémités uréthrales sont
séparées par un cal fibreux, dû à l' organisation de l'hé-
matome. La longueur de ce cal dépend de l'importance
de la résorption de l'hématome, du degré de la descen-
te du bloc vesico-prostatique et de l’importance du
déplacement osseux. La distance entre les deux extre-
mités n'est ainsi pas dûe à une perte de substance mais
à un déplacement vers le haut de la prostate et une
rétraction vers le bas de l'uréthre bulbaire. Si l'hémato-
me est massif et l’écartement des deux extrêmités uré-
thrales est important, il est peu probabale d'avoir une
descente spontanée vers une position normale, et il faut
s'attendre à une sténose longue [20]. Pour juger l’éten-
due de la sténose, et l'importance du décalage, l’uré-
throcystographie rétrograde combinée à l’uréthrogra-
phie mictionnelle est d' un grand apport. Des artifices
techniques pourraient être utilisés chez les patients qui
ont des difficultés à uriner durant l'examen [4].
La majorité de ces sténoses sont réparées par une voie
d’abord périnéale. Dans les cas difficiles cependant,
lorsque le manque est étendu, et l'uréthre proximal est
fixé en position haute par rapport à la symphyse
pubienne, il devient nécessaire d'associer une voie
d'abord transsymphysaire, afin d'avoir un jour sur le
bout proximal de l'uréthre. La voie transsymphysaire
est plus simple et ne nécessite pas de pubectomie
quand il y a un diastasis pubien important. C'est le cas
de nos trois malades. En l'absence de diastasis de la
symphyse pubienne, une symphysiotomie ou une
pubectomie est effectuée classiquement par voie haute.
La possibilité de lésion des nerfs érecteurs augmentant
le pourcentage des dysérections a été soulevée [6].La
voie périnéale permet d'effectuer une pubectomie infé-
rieure qui donnerait moins de complications et moins
de déperdition sanguine [20, 21]. Dans tous les cas, il
faut résequer tout le callus fibreux, disséquer les deux
extrémités uréthrales puis effectuer une anastomose
termino-terminale sans tension. Dés que la sténose
dépasse 2,5 cm., il y aurait un risque de suture sous ten-
sion de l'uréthre avec raccourcissement et déviation de
la verge [5]. Aucun de nos patients n'a présenté une
telle complication. D’autres techniques chirurgicales
ont été effectuées dans les cas de sténose étendue ou
complexe : uréthroplastie cutanée en un ou deux temps
[20].
Les résultats de la résection-anastomose des sténoses
traumatiques de l’uréthre membraneux sont dans l'en-
semble satisfaisants avec un jet mictionnel correct dans
85 % (15) à 87% [1]. Le taux d’incontinence est faible
et de 2,7% [7]. Les sténoses itératives sont observées
dans 11% des cas (15) et répondent avec succés à l’uré-
throtomie endoscopique dans 72% [17]. Les taux de
succés élevés de l’uréthrotomie optique comme com-
plément à une uréthrorraphie termino-terminale sont
expliqués par le fait qu’il s’agit de sténoses courtes réa-
lisant un anneau fibreux fin au niveau de l’anastomose.
Deux complications majeures peuvent s'observer après
traitement chirurgical des ruptures traumatiques de
l'urèthre : les dysfonctionnements érectiles et l'inconti-
nence urinaire. Leur origine dûe au traumatisme ou à
l'intervention est controversée.
Le dysfonctionnement érectile est observé dans 11,6%
à 44% [20]. Il est d'origine nerveuse et vasculaire.
L'origine nerveuse serait la plus fréquemment en cause
puisque les taux de succés par traitement pharmacolo-
gique sont élevés [11]. Les études anatomiques ont par
ailleurs montré que les les branches de l’artére honteu-
se interne, ainsi que les nerfs érecteurs cheminent de
part et d’autre de l’uréthre membraneux. Ces éléments
peuvent être lésés au cours de la fracture du bassin ou
au cours d’une intervention chirurgicale [2]. Les taux
les plus élevés sont observés après intervention chirur-
gicale en urgence immédiate par suture termino-termi-
nale alors que les taux les plus faibles sont observés
après cystostomie sus pubienne seule. Ceci suggére la
responsabilité de la mobilisation intempestive du bloc
vésicoprostatique dans la genése de l'impuissance
sexuelle [8]. C’est d’ailleurs la mobilisation prosta-
tique qui rend compte du taux élevé d’impuissance
sexuelle après réparation en urgence différée dans
notre série et non la voie d’abord. Dans les cas où
aucun geste n'a été effectué, l'impuissance sexuelle
serait alors directement en rapport avec la sévérité du
traumatisme [9]. Ainsi, dans les cas nécessitant une
intervention en urgence immédiate, il faut éviter une
ouverture du fascia endopelvien, et la mobilisation de
la région périprostatique.
L'incontinence urinaire est observée dans 0 à 44%. La
aussi, les taux les plus faibles sont rapportés après cys-
tostomie sus pubienne seule, alors que les taux les plus
62
R. Aboutaieb et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 58-64
 6
6
 7
7
1
/
7
100%