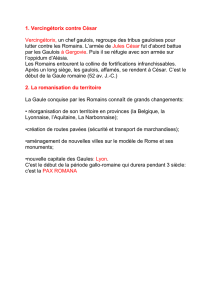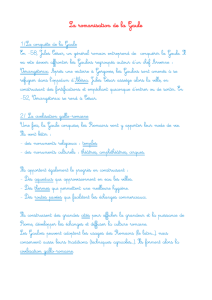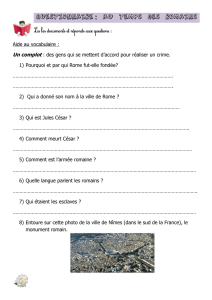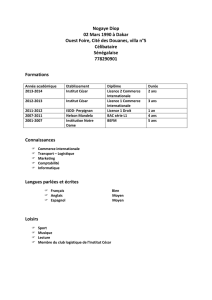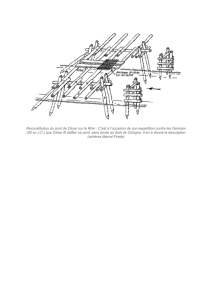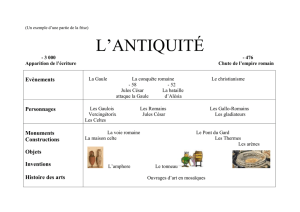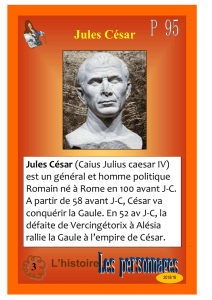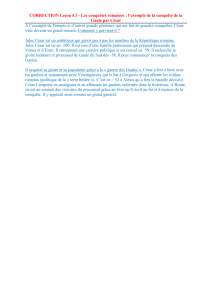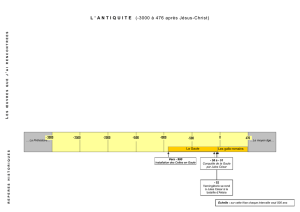JULES CÉSAR EN GAULE - L`Histoire antique des pays et des

JULES CÉSAR EN GAULE
TOME PREMIER
PAR JACQUES MAISSIAT.
PARIS - 1865

AVANT-PROPOS.
INTRODUCTION. — COMMENTAIRES DE JULES CÉSAR.
NOTICE GÉOGRAPHIQUE
SUR LES RÉGIONS DU SUD-EST DES GAULES AU TEMPS DU
JULES CÉSAR.
I. PARTIE PHYSIQUE. — II. PARTIE HISTORIQUE.
MOYENS MILITAIRES
EMPLOYÉS DE PART ET D'AUTRE DANS LA GUERRE DE
GAULE.
I. ARMES DE MAIN. — II. ARMES DE BATTERIE. - LÉGION. — III.
ATTAQUE DES PLACES.
COUP D'ŒIL RETROSPECTIF
SUR LA GUERRE DE GAULE CISALPINE ET SUR LA POLITIQUE
DES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS D'ITALIE.
INVASION DE LA GAULE CELTIQUE.
ÉMIGRATION DES HELVÈTES.

AVANT-PROPOS.
Les grands peuples ont eu le culte des aïeux. Suivre les beaux exemples donnés
par les aïeux, more majorum, a été la grande maxime du peuple romain. Nous
retrouverions sans doute cette maxime au fond des annales de tous les peuples
qui ont occupé une large place dans l'histoire.
Mais il ne suffit point de garder la mémoire des hauts faits et des vertus des
aïeux, il faut aussi savoir se souvenir de leurs fautes et de leurs malheurs, afin
de s'en préserver. Se connaître soi-même est encore plus nécessaire pour les
nations que pour les individus : les enseignements de l’histoire portent ce fruit.
Car Ion rencontre dans les races d'hommes des qualités bonnes ou mauvaises
qu'elles tiennent de leur sang, des aptitudes et des défauts qui font leur force et
leur faiblesse. Dans chaque race l'ensemble de ces tendances natives, heureuses
ou malheureuses, utiles ou nuisibles, constitue le caractère propre de la nation,
caractère qui persiste dans l'histoire comme le caractère de l'homme durant sa
propre vie. Les races qui n'ont pas vécu sans gloire paraissent, en effet, avoir
conservé leur caractère primitif et se perpétuer dans les mêmes régions, malgré
tous les ébranlements de la politique.
A ce point de vue, l'histoire des Gaulois, au temps de César, n'est pas seulement
l'histoire de nos aïeux : c'est la nôtre ; c'est là que nous pouvons voir à quoi
nous exposent les tendances naturelles de notre race ; et l'expérience de ce qui
leur est arrivé montre assez à un peuple intelligent son côté fort et son côté
faible : à lui de conclure s'il veut grandir ou déchoir.
Est-elle d'ailleurs sans intérêt général pour la philosophie de l'histoire des
peuples, cette guerre de nos pères à laquelle la plus fameuse guerre des Grecs
n'est comparable que par sa durée de dix ans ? cette guerre de Gaule rapportée
par l’un des plus parfaits écrivains, par celui dont le génie universel a peut-être
plus fait pour sa propre grandeur avec son livre qu'avec les légions romaines ?
cette guerre soutenue par un barbare de noire race contre le plus grand guerrier
de Rome ; par notre patrie, dans l’état primitif de tribus isolées, contre le peuple
romain dans toute sa force, au moment où l'unité romaine envahissante
atteignait déjà le haut Rhône, la ligne des Cévennes ? cette guerre dans laquelle
le souffle de la liberté qui remuait les Gaules y fit sortir de la terre des Arvernes
le germe, arrosé de tant de sang, qui devait un jour devenir l'unité française ?
N'y a-t-il pas un intérêt général à connaître les lieux de cette terrible guerre,
pour la mieux comprendre ? Les antiquités locales qui nous en ont conservé le
souvenir depuis les Gaulois ne disent-elles rien des malheurs des peuples, en
parlant à nos cœurs du premier âge de notre patrie ?
L'opinion publique, en France, ne s'y est pas trompée. Elle a bien vite, à
l’occasion des recherches spéciales publiées il y a sept ans, saisi tout l'intérêt que
présente l'étude des Commentaires de César : cette base de notre histoire
nationale posée de la main d'un ennemi. Les publications se sont succédé depuis
lors en grand nombre ; et l'Empereur lui-même a chargé une commission,
composée de savants de toute classe, d'exécuter une carte des Gaules en
concordance avec les Commentaires. Les recherches ont été provoquées partout
et poussées avec beaucoup d'ardeur.
Au sujet du point capital, l'emplacement du lieu fatal où succomba la Gaule, et
d'où sortit, on peut le dire, l'empire des Césars, deux opinions se trouvaient en

présence : fallait-il voir Alesia ou Alexia
(car les manuscrits donnent l'un et l'autre
nom)
dans Alise, en Bourgogne, ou dans Alaise, en Franche-Comté ? La première
opinion était la plus ancienne, et c'est également celle que la commission
impériale a adoptée. Elle a fait elle-même des recherches, pratiqué des fouilles
sur le terrain du mont Auxois, où est Alise. On a trouvé là nombre d'objets
intéressants, l’on y a reconnu des indices d'anciens fossés ; mais ces fossés ne
sont ni en même nombre, ni à la même distance, ni de la même forme que ceux
dont César nous a laissé une description si précise. En outre, l’on a produit
beaucoup d'objections contre l’opinion nouvelle ; mais l’on est loin d'avoir réfuté
toutes celles qui ont été produites contre l’opinion ancienne ; si bien que,
aujourd'hui, en résumé et sans compter nos propres objections qui porteront des
deux côtés à la fois, chacune des deux opinions discutées semble plus ébranlée
par ses adversaires qu'affermie par ses partisans.
En face d'un texte aussi correct que celui de César, après tant d'investigations
poursuivies par des hommes si compétents, l'incertitude est un résultat qui
pourrait paraître surprenant. L'oubli d'un certain nombre de passages essentiels
dans les auteurs, de frappantes erreurs d'interprétation du texte de César, que
nous aurons dans notre travail l'occasion de signaler plus d'une fois,
surprendront encore davantage, de la part de savants dont personne ne peut
mettre en doute ni les connaissances ni la bonne foi scientifique. Certes, l’on a vu
souvent des idées préconçues obscurcir les points les plus lumineux dans les
meilleurs esprits ; mais en considérant l’ensemble des travaux mis au jour sur la
matière qui nous occupe, l’on est frappé d'un caractère général tenant à la
marche qu’on a suivie. A nos yeux, il y aurait là plus que des erreurs
accidentelles : il s'y trouverait un vice fondamental ; quelque chose d'incohérent
s'y reconnaît ; il nous semble qu'il y manque une interprétation large et suivie
des textes, et une vue suffisamment étendue de la question.
On s'est renfermé dans les détails en omettant les caractères généraux. Or ce
sont les caractères généraux qui peuvent fournir les plus sûrs éléments de
certitude.
On s'est appuyé avec confiance sur la similitude entre un nom local et le nom
d'Alésia. Il est vrai que le nom est un indice, mais cet indice est incertain : car le
nom d'Alésia peut n'être pas resté au véritable emplacement do cet oppidum. Ne
voyons-nous pas que les noms de Genabum, d'Avaricum, ont disparu de la
surface du sol de la Gaule ? Et puis, est-il donc impossible que des noms à peu
près semblables aient été donnés à des localités différentes ?
Quant à la similitude entre un terrain et celui de l’oppidum, il la faudrait absolue,
et il est de fait qu'elle n'est ici qu'approximative de part et d'autre.
La situation géographique d'Alésia relativement au pays lingon, au pays séquane,
et dans la direction de la Province romaine, a été discutée ; mais l’on n'a
présenté aucune donnée précise qui servît à la déterminer.
On s'en est tenu là. Or, dans ces tenues, le problème nous parait insoluble ; ainsi
posée, la question est une impasse.
Deux éléments ont manqué dans la discussion, à savoir : la porte de sortie de la
Gaule ; le dessein de Vercingétorix se rendant à Alésia. En d'autres termes, le
nœud de la question est l'attitude militaire des deux ennemis. Car, si l’on arrive à
démontrer que César avait en vue une porte de sortie de la Gaule, et quelle était
celte porte ; que Vercingétorix lui a coupé la retraite, et sur quels points
seulement le fait était possible, il devient facile de déterminer avec certitude les

conditions caractéristiques du lieu de l'oppidum où Vercingétorix s'est arrêté. Et
même s'il est prouvé qu'une seule région de la Gaule peut avoir été le théâtre de
ces événements, la méthode suivie conduira sûrement à l’exclusion de tout lieu,
quel qu'il soit en lui-même, qui n'est pas situé dans cette région.
Nous n'avons pas l'avantage que donne, dans une discussion de cet ordre,
l'expérience de l'art militaire moderne ; mais nous y apportons, avec une
méthode nouvelle, avec la connaissance de quelques textes négligés jusqu'à ce
jour et le secours de traces romaines de cette guerre qu’on n'avait point encore
observées, une longue habitude du livre de César, et des notions complètes du
terrain de la région à laquelle s'appliquent les événements.
Nous avons pu lire et relire les Commentaires sur les lieux mêmes qui y sont
décrits. Nous avons traduit César par lui-même ou par des comparaisons tirées
des livres de Salluste, son lieutenant. Nous avons suivi rigoureusement l'ordre du
récit de César. Nous avons établi les faits avec continuité ; nous n'avons rien
omis dans l'examen du texte qui pût se rattacher à la question.
Pour ce qui tient à notre plan, nous avons d'abord rapproché deux campagnes, la
première et la septième, qui s'éclairent l’une l’autre ; les circonstances
particulières de ces deux campagnes nous ayant fait préjuger que César, dans le
cours de la septième, avait dû chercher à reprendre, pour sortir de la Gaule, les
passages qu'il avait suivis en sens inverse, au début de la première, pour y
pénétrer.
Nous avons étudié, dans l’ensemble et dans le détail, l’orographie de cette partie
de la Gaule, au point de vue des passages des montagnes, tels qu'ils étaient à
l’époque des événements rapportés. Nous avons déterminé, au moyen de toutes
les indications de César et de Strabon, qui lui est peu postérieur, la géographie
des peuples dont les noms, rencontrés dans le récit, servent de renseignements
pour les lieux.
Nous avons ainsi pu suivre la marche de César dans les deux campagnes pas à
pas sur le terrain, sans laisser aucun point indéterminé derrière nous : confirmé
sans cesse dans notre méthode par la facilité constante de l'application des faits
successivement présentés, et par l'accord des deux récits.
... Tantum series juncturaque pollet !
De cette étude patiente des textes en regard du terrain de l’ancienne Gaule,
disons-le dès à présent, car cette considération importe, et c'est là le point
capital que nous cherchons à démontrer par ce travail, il est résulté peu à peu
dans notre pensée, comme appréciation définitive et sommaire : que Jules César
est loin d'avoir eu sur Vercingétorix et les Gaulois la supériorité militaire qu’on lui
accorde généralement dans l'histoire, et que l'illusion provient de l'art que César
lui-même a mis dans ses Commentaires de la guerre de Gaule. Il était, dit
Appien, très-habile dans l'art de l’hypocrisie. Et c'est l'usage qu'il a fait
généralement de cette habileté dans la réduction des Commentaires qui formera
l'objet de notre Introduction ; car le texte de César étant la base de toutes nos
preuves, il est indispensable que le lecteur apprécie bien d'avance avec nous la
valeur et l'esprit de ce texte célèbre.
Nos premières communications faites à l'Académie impériale des inscriptions et
belles-lettres, touchant la guerre de Gaule, remontent à 1856. Nous y
présentâmes une opinion nouvelle, à savoir, que le véritable emplacement de
l'oppidum d'Alésia est le plateau d'Izemore, dans le département de l'Ain. Depuis
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
1
/
182
100%