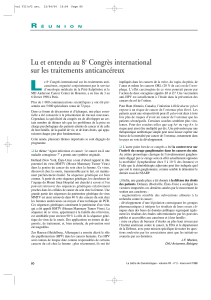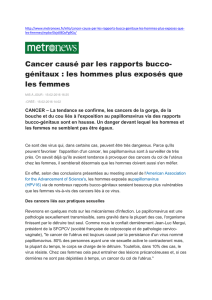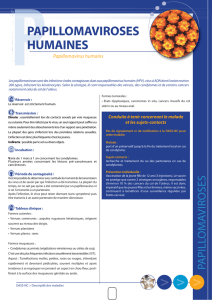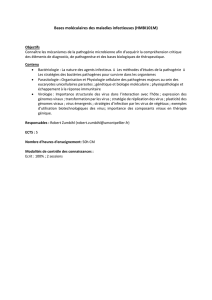Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

REVUE MÉDICALE SUISSE
WWW.REVMED.CH
27 janvier 2016
170
Virus et risques de cancer
Vignette clinique
Vous avez été invité à une discussion avec des parents
d’élèves concernant les vaccinations de la préadoles-
cence. Un parent vous challenge en demandant quel est
vraiment le bénéfice de ces vaccinations (HBV et HPV)
pour sa fille. Vous souhaitez lui répondre avec des don-
nées montrant dans quelle mesure ces vaccins protègent
d’infections et de leurs complications parmi les plus
graves : des cancers.
INTRODUCTION
Qu’est-ce qui peut amener un virus à pousser une cellule en
direction d’une transformation maligne ? Pour certains virus,
l’état fonctionnel d’une cellule en phase intermitotique G0
n’est pas optimal pour leur réplication. Ainsi, pousser la cel-
lule à s’engager dans la phase S de synthèse de l’ADN pour
préparer la mitose fournit à certains virus un environnement
plus favorable à leurs propres synthèses. Par ailleurs, les ano-
malies induites par l’infection virale induisent couramment
des réponses immunitaires innées, ainsi que des signaux d’alerte
cellulaire induits par la présence d’acides nucléiques (ADN ou
ARN), de structure ou de localisation cellulaire « anormales »
pour la cellule. Ces signaux conduisent potentiellement à alerter
la cellule et à enclencher la mort programmée (apoptose) de
la cellule. On n’est donc pas surpris d’appendre que la plupart
des virus ont développé des fonctions pour induire la mitose
et prévenir l’apoptose, avec le risque pour la cellule de la faire
basculer dans une prolifération incontrôlée.1 A noter deux
contraintes pour qu’un virus puisse être responsable d’une
prolifération tumorale : il ne doit pas lui-même entraîner la
mort de la cellule, et l’expression des gènes viraux favorisant
la transformation cellulaire oncogène doit être « sous le radar »
du système immunitaire afin que ce dernier ne puisse contrôler
la prolifération cellulaire. En jouant avec le contrôle de la
division cellulaire, les virus jouent avec le feu oncologique, et
il n’est donc pas étonnant que certains soient impliqués dans
la pathogenèse de certaines tumeurs, y compris de cancers
humains de grande importance épidémiologique et clinique.
C’est ainsi que l’on a pu estimer au niveau mondial qu’environ
deux millions de cas de cancer sont causés par des infections
chroniques, en majorité virale (figure 1), représentant de l’ordre
de 16 % des cancers au niveau mondial, avec une surreprésen-
tation dans les pays relativement peu développés, de 23 %
comparés à 7,4 % dans les pays les plus développés.2
L’intérêt évident de l’identification du rôle d’un micro-orga-
nisme dans la pathogenèse d’un cancer, c’est de fournir, à travers
les approches thérapeutiques et prophylactiques de l’infection,
des moyens de prévention du cancer.
On connaît sept virus humains (tableau 1) jouant un rôle
étiologique dans des cancers d’importance épidémiologique
variable. Nous allons les passer en revue ci-après en mention-
nant le mécanisme par lequel ils perturbent la réplication cel-
lulaire, leur importance épidémiologique, mais aussi l’impact
de la prévention de ces infections sur leurs conséquences on-
cologiques. Enfin, nous terminerons par deux sujets d’actualité,
c'est-à-dire la migration des papillomavirus génitaux dans la
sphère ORL, ainsi qu’une hypothèse décoiffante concernant
la relation entre consommation de viande rouge et cancer du
côlon.
VIRUS DE L’HÉPATITE B ET C
En tant que virus non cytopathiques, le VHB et le VHC peuvent
induire une infection chronique des hépatocytes et s’accom-
pagnent d’une cytolyse hépatique due aux réponses immuni-
Dr PASCAL MEYLAN a
Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 170-2
a Institut de microbiologie et Service des maladies infectieuses, CHUV,
1011 Lausanne
pascal.meylan@chuv.ch (D’après réf.2 dans http://epi.grants.cancer.gov/infectious-agents/).
World Cancer Incidence Attributed to Infections in 2008
fig 1
Importance épidémiologique
des cancers causés par des micro-
organismes au niveau mondial
On remarque le rôle prépondérant de virus.
Hepatitis B and C viruses ; Human papillomavirus ; Helicobacter pylori ;
Epstein-Barr virus ; Human herpes virus type 8 ; Human T-cell
lymphotropic virus type 1 ; Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis ;
Schistosoma haematobium.
10_12_38949.indd 170 21.01.16 09:32

WWWREVMEDCH
janvier
171
QUADRIMED
taires cellulaires. Cette situation s’accompagne d’un risque très
augmenté de l’ordre de 20 fois de développer des carcinomes
hépatocellulaires.2 On estime que ce risque est dû à un méca-
nisme complexe et indirect de carcinogenèse lié à : a) la proli-
fération hépatocellulaire induite par et visant à compenser la
cytolyse ; b) l’action mutagène de dérivés actifs de l’oxygène
produit par les cellules inflammatoires ; c) concernant le VHB,
des mutations suite à l’intégration de fragments du génome
du virus dans le génome de l’hôte et d) l’effet activateur de la
transcription de proto-oncogènes (gènes affectant positivement
la division cellulaire) et inhibant l’apoptose de la protéine X de
VHB, et concernant le VHC un effet antiapoptotique de cer-
taines protéines virales (en particulier NS5A souvent exprimée
dans les cellules tumorales). Ce mécanisme se déroule proba-
blement par étapes sur des décennies.3
On estime au niveau mondial qu’environ 400 et 170 millions
d’individus souffrent d’hépatite chronique due respectivement
à une infection chronique par le VHB et le VHC. L’implémen-
tation de programmes de vaccination du vaccin contre l’hépa-
tite B, disponible dès 1981, et dont l’efficacité chez les indivi-
dus en bonne santé est > 95 %, a la capacité, démontrée déjà il
y a une vingtaine d’année, de réduire la prévalence de l’hépa-
tite B chronique et l’incidence de carcinome hépatocellulaire
chez les enfants taïwanais vaccinés à la naissance.4 On peut
s’imaginer que la prévention de l’hépatite B par la vaccination,
couplée à la réduction du risque de progression et de carcino-
genèse par les traitements antiviraux chez les patients déjà in-
fectés,5 puisse conduire à terme à prévenir le rôle du VHB
dans la pathogenèse de ce cancer.
En l’absence de vaccins actifs sur le VHC, la révolution en cours
liée à l’apparition des antiviraux directs actifs sur le VHC laisse
entrevoir un contrôle de l’épidémie et de ses complications,
inclus cirrhose et carcinome hépatocellulaire, à un horizon se
situant bien avant la moitié du siècle présent, dans la plupart
des pays.6 On voit donc que les moyens d’éradiquer les carci-
nomes hépatocellulaires d’origine virale existent.
PAPILLOMAVIRUS GÉNITAUX
Les papillomavirus humains ont la capacité d’infecter les cel-
lules épithéliales basales de la peau et des muqueuses, aux-
quelles ils ont accès lors de (micro)traumatismes. Ces virus
présentent un couplage du contrôle de leur réplication avec la
différenciation des cellules pavimenteuses : les particules virales
sont ainsi produites par les cellules plus proches de la surface
cutanée ou muqueuse, assurant ainsi la dissémination à de
nouveaux hôtes. Il peut arriver, par un accident génétique
rare, qu’une partie du génome du virus, normalement une
molécule circulaire d’ADN, s’intègre dans le génome de la cel-
lule hôte. Si cette intégration respecte les cadres de lecture
des protéines virales E6 et E7, alors ces dernières peuvent être
exprimées et respectivement inactiver les protéines cellulai res
Rb et p53 impliquées dans les points de contrôle du cycle cel-
lulaire, permettant à la prolifération cellulaire de continuer
malgré un ADN endommagé, sans que soit déclenchée la mort
programmée de la cellule (apoptose) (figure 2). La lente pro-
gression des anomalies génétiques sous-jacentes à la transfor-
mation maligne progressive (carcinogenèse) est récapitulée du
point de vue pathologique par des lésions de dysplasie crois-
sante jusqu’au cancer invasif. Il existe plus d’une centaine de
génotypes différents de papillomavirus humains, dont certains
causent préférentiellement des lésions (verrues) bénignes (par
exemple, HPV-6 et -11), tandis que d’autres sont préférentiel-
lement associés à des lésions de haut grade (par exemple,
HPV-16 et -18).
Ces derniers jouent un rôle étiologique majeur dans la carci-
nogenèse des cancers du col de l’utérus dans l’immense majo-
rité des cas, ainsi que dans une fraction substantielle des can-
cers ano-génitaux d’autres localisations,2 mais aussi, résultant
sans soute de changements de la prévalence de pratiques
sexuelles, d’une proportion croissante des cancers ORL !8
La disponibilité de vaccins dirigés contre un nombre crois-
sant de génotypes (2, 4 et 9 génotypes) a permis de vérifier
(D’après réf.1).
Virus Génomes Cancers notables Année de
description
Virus d’Epstein–Barr (EBV ; aussi connu
comme human herpesvirus 4 (HHV4))
Herpesvirus à ADN à double brin La plupart des lymphomes de Burkitt et des carcinomes
nasopharyngés, des maladies lymphoprolifératives chez
l’immunosupprimé, certaines maladies de Hodgkin, et certains
lymphomes non hodgkiniens et gastro-intestinaux
1964
Virus de l’hépatite B (VHB) Hepadnavirus à ADN à simple et
double brin
Carcinomes hépatocellulaires 1965
Human T-lymphotropic virus-I (HTLV-I) Rétrovirus à ARN simple brin de
polarité positive
Leucémie à cellules T de l’adulte 1980
Papillomavirus humains à haut risque (HPV)
16 et HPV 18 (certains autres a-HPV types
sont aussi carcinogènes)
Papillomavirus à ADN double brin La plupart des cancers du col utérin et du pénis, certains
autres cancers ano-génitaux, ainsi qu’une proportion croissante
des cancers ORL
1983-1984
Virus de l’hépatite C (VHC) Flavivirus à ARN simple brin de
polarité positive
Certains carcinomes hépatocellulaires et certains lymphomes 1989
Herpesvirus du sarcome de Kaposi (KSHV ;
aussi connu comme human herpesvirus 8
(HHV-8))
Herpesvirus à ADN à double brin Sarcome de Kaposi, lymphome primitif des séreuses
et certaines maladies de Castelman multicentriques
1994
Polyomavirus associé au carcinome des
cellules de Merkel (MCV)
Polyomavirus à ADN à double brin La plupart des carcinomes à cellules de Merkel 2008
Tableau 1 Virus connus pour jouer un rôle dans la pathogenèse de cancers humains
par ordre chronologique de découverte
10_12_38949.indd 171 21.01.16 09:32

REVUE MÉDICALE SUISSE
WWW.REVMED.CH
27 janvier 2016
172
1 Moore PS Chang Y Why do viruses
cause cancer? Highlights of the first
century of human tumour virology Nat
Rev Cancer
2 de Martel C Ferlay J Franceschi S
et al Global burden of cancers attribu
table to infections in A review
and synthetic analysis Lancet Oncol
3 Flint J Racaniello V Rall G Skalka
AM In Flint J Racaniello V Rall G
Skalka AM ed Principles of virology
Washington American Society for
Microbiology
4 Chang MH Chen CJ Lai MS et al
Universal hepatitis B vaccination in
Taiwan and the incidence of hepatocel
lular carcinoma in children Taiwan
Childhood Hepatoma Study Group N
Engl J Med
5 Papatheodoridis GV Lampertico P
Manolakopoulos S Lok A Incidence of
hepatocellular carcinoma in chronic
hepatitis B patients receiving
nucleostide therapy A systematic
review J Hepatol
6 Alfaleh FZ Nugrahini N Maticic M
et al Strategies to manage hepatitis C
virus infection disease burden volume
J Viral Hepat Suppl
7 Leemans CR Braakhuis BJ Braken
hoff RH The molecular biology of head
and neck cancer Nat Rev Cancer
8 Farsi NJ ElZein M Gaied H et al
Sexual behaviours and head and neck
cancer A systematic review and meta
analysis Cancer Epidemiol epub
ahead of print
9 Luckett R Feldman S Impact of
and valent HPV vaccines on morbi
dity and mortality from cervical cancer
Human Vaccin Immunother epub
ahead of print
leur très grande efficacité contre les infections incidentes et
contre les dysplasies de haut grade. Il reste à observer, dans
des études prospectives de populations, le déclin de l’incidence
de cancer cervical qui devrait faire suite à toute utilisation à
large échelle de ces vaccins, ainsi qu’à déterminer l’intérêt de
la vaccination des garçons également, afin de mieux bénéficier
d’une immunité de troupeau, ainsi que de prévenir les cancers
ORL liés à l'HPV.9
Parmi les autres virus impliqués dans la pathogenèse de can-
cers, le virus d’Epstein-Barr (EBV) et du sarcome de Kaposi
KHSV ou HHV-8), transforment les cellules par des signaux
imitant les stimuli physiologiques à la prolifération cellulaire.
Ils causent des tumeurs relativement fréquentes (figure 1), mais
il n’existe pas de vaccin en développement dont on puisse es-
pérer une commercialisation dans un délai prévisible.
Mentionnons encore que, parmi les hypothèses avancées pour
expliquer la corrélation entre la consommation de viande
rouge et le cancer du côlon, il existe la possibilité que des frag-
ments d’ADN issus du génome de petits virus bovins (circovi-
rus) puissent pénétrer dans les cellules épithéliales intestinales
et perturber leur expression génétique. Si cette hypothèse se
révèle vraie, elle justifierait l’attribution d’un prix Nobel, à une
liste déjà longue pour des progrès dans l’élucidation de la re-
lation entre divers virus et tumeurs.
Finalement, dans un juste retour des choses, la FDA vient
d’approuver une formulation injectable d’un virus de l’Herpès
simplex modifié (Imlygic, T-Vec pour les intimes) pour le rendre
spécifique de cellules tumorales, le premier virus oncolytique,
pour le traitement de mélanomes non opérables.
On voit donc que l’étude de la relation entre virus et cancers
a débouché sur de nombreux progrès importants, dont nous
allons encore récolter les fruits dans les décennies qui
viennent.
fig 2 Rôle des protéines virales E6 et E7 de papillomavirus
En inactivant Rb et p53, elles permettent à la cellule de se diviser malgré des anomalies de l’ADN qui, en l’absence d’infection, causerait l’apoptose de la cellule bloquée
au point de contrôle G1/S ou G2/M.
(D’après réf.7).
10_12_38949.indd 172 21.01.16 09:32
1
/
3
100%