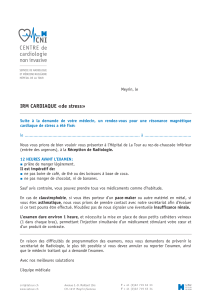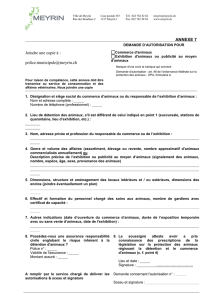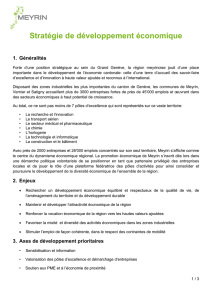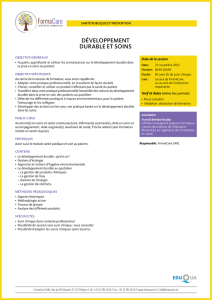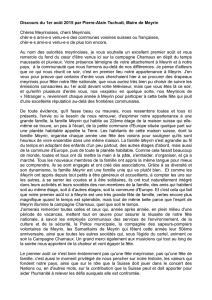Si_No 7_Mise en page 1

No7IJanvier_Février_ 2010
Publication commune du THÉÂTRE FORUM MEYRIN
et du THÉÂTRE DE CAROUGE –ATELIER DE GENÈVE

107 Édito. Par Jean Liermier et Mathieu Menghini
108–109
Saison 2010-2011 de Meyrin. Anne Brüschweiler aux commandes du vaisseau Forum Meyrin. Par Coré Cathoud
110 (A)pollonia. Par Julie Decarroux-Dougoud
111 (A)pollonia. Livret. Par Eva Cousido
112–113 (A)pollonia. Une passion polonaise déferle sur Genève. Par Anne Bisang
114–115 Théma Secrets et mensonges. Par Mathieu Menghini
116–117 Antonio Saura, contes et mensonges. Par Laurence Carducci
118–119 Platonov. Par Delphine de Stoutz
120–121 Platonov. La sainte, la mère et la putain. Parole donnée à Catherine Gaillard
122–123 Rashõmon. Par Camille Dubois
124–125 La ménagerie de verre. Par Sylvain De Marco
126–127 La ménagerie de verre. L’écran inattendu. Par Jacques Nichet
128–129 La ménagerie de verre. Un rendez-vous manqué ? Par Delphine de Stoutz
130–131 Pinocchio. Par Rita Freda
132–133 Irrégulière. Par Ludivine Oberholzer
134–135
Vous n’imaginez pas tout ce que la pub sait faire pour vous! Entretien avec Benoît Lecat. Par Sylvain De Marco
136–137 Turba. Par Julie Decarroux-Dougoud
138–139 L’art du mensonge politique. Par Mathieu Menghini
140–141 Les aventures de Pinocchio. Par Vincent Adatte
142–143 Jules et Marcel. Entretien avec Philippe Caubère. Par Mathieu Menghini
144–145 Madame de Sade. Par Ludivine Oberholzer
146–149 Philoctète. Entretien avec Christian Schiaretti. Par Christine-Laure Hirsig
150–151 Philoctète. Variation et palimpseste. Par Delphine de Stoutz
152–153 Pacamambo.
Entretien avec François Marin. Par Ushanga Elébé
154 Le Théâtre à la rencontre du musée.
Ou comment lier Racine à Saint-Ours. Par Murielle Brunschwig et Isabelle Burkhalter
155 Théâtre et musique.
Le Théâtre de Carouge et le Chat Noir confirment leurs fiançailles ! Par Roland Le Blévennec
156–157 É… mois passés
158 Bar du théâtre de Carouge.
Franck Leclerc derrière le comptoir. Par Coré Cathoud
159 Impressum. Partenaires
160 Agenda. Renseignements pratiques
Pp. 124 – 129
La ménagerie de verre
Pp. 132 – 133
Irrégulière
Pp. 146 – 151
Philoctète
SOMMAIRE
— 106 —

— 107 —
Mathieu Menghini : Jean, tes mises en scène prennent-elles en compte
l’impératif classique de la vraisemblance ?
Jean Liermier : Je suis comme saint Thomas, je crois à ce que je vois. Le pre-
mier mouvement du travail en répétitions est d’essayer de faire en sorte
qu’on croie les personnages. Lors d’un deuxième mouvement on sculpte.
Suivant les situations, les intentions ne sont peut-être plus si définitives,
la partition de l’acteur se nuance, les indications s’additionnent, forment
des strates. En fait, je ne me soucie que de la vraisemblance des rapports
entre les personnages. Car la magie du théâtre, contrairement au cinéma,
c’est que tu peux prendre une chaussure et faire croire que c’est un télé-
phone… Il y a une convention tacite avec le spectateur qui est prêt à rece-
voir de l’invraisemblance. Qui en redemande même parfois.
À propos, je voulais te faire part d’une histoire : il y a quelque temps est
paru un livre «coup de poing»: le récit documentaire d’un homme qui,
enfant, avait été déporté dans un camp de concentration en Allemagne.
Son témoignage bouleverse, il se voit couvert de prix, honoré de toutes
parts. Jusqu’au jour où quelqu’un qui avait vécu à cette même période
dans ce même camp relève plusieurs incohérences dans les faits. Et l’on
découvre que le présumé auteur déporté n’a, en réalité, jamais été dans
un camp ! Il avait tout inventé. Du «coup de poing» au «coup de ton-
nerre» : on lui retire tous ses prix et on l’attaque de toutes parts. Il avait
trahi, en vendant de la fiction pour un témoignage. Il avait menti sur la
nature du récit et les lecteurs lui en voulaient, car ils avaient été émus
pour « rien », puisque c’était faux. Malgré l’émotion initiale suscitée par le
texte, la vraisemblance ne suffisait pas…
MM : Ah oui, j’avais vu cette affaire. Restons dans l’appropriation d’iden-
tité : partages-tu les idées de Stanislavski sur la préparation du comé-
dien, appelé à s’imaginer les moteurs conscients et inconscients de son
personnage, à agir comme s’il incarnait – au sens fort – un autre être ?
JL : Il y a presque autant de méthodes que d’acteurs. Chacun développe la
sienne, qui correspond aux rencontres, aux expériences menées. L’acteur
n’est jamais dupe du fait qu’il joue, à moins qu’il ne franchisse les barrières
de la folie, où il n’y a plus de limites. La psychologie, les moteurs conscients
ou inconscients du personnage sont des outils qui servent à se frayer un
chemin pour l’acteur. Ils sont utiles, comme une lampe de poche dans la
nuit, mais en aucun cas ils n’ont valeur de jeu.
Je me souviens d’un travail avec André Engel sur une version française du
livret de l’opéra Don Giovanni de Mozart. Je devais jouer le rôle titre, le
séducteur… Inutile de te dire que j’étais maladroit, coincé et inhibé. Après
une semaine, le metteur en scène nous annonce que nous allons conti-
nuer le travail, mais en italien… Passé le cap de la surprise (je ne parle pas
un mot d’italien), tout s’est décoincé chez moi. La langue devenait un
masque qui me révélait : je pensais en français le texte que j’avais appris
par cœur et je le disais dans une langue étrangère. L’espace entre l’instant
de la pensée et celui de la profération, le moment où j’adressais mes
répliques, était un espace de liberté : l’espace du jeu. Alors là , oui, j’incar-
nais
un personnage. Et je n’ai jamais été autant moi, justement parce que
ce n’était plus tout à fait moi…
Jean Liermier : Et toi, Mathieu, que penses-tu de la formule qui dit que
l’acteur «ment vrai» quand il joue ?
Mathieu Menghini : Par-delà la séduction de tout oxymore, je n’aime pas
trop cette expression. Elle me paraît prétentieuse. D’ailleurs, l’illusion du
réel n’est pas, n’est plus – en elle-même – un critère esthétique.
À mon tour de te raconter une anecdote, fameuse : une dame qui visitait
son atelier reprocha à Matisse «le bras beaucoup trop long» d’une femme
peinte ; l’artiste répondit: «Ceci n’est pas une femme, madame, c’est un
tableau.»
Mais par-delà l’art, existe-t-il effectivement une vérité de nature ? Dans
bien des cas, le vrai paraît affaire de perspectives (les thémas du Théâtre
Forum Meyrin ne disent pas autre chose). Notre perception n’est pas
immédiate : bien des conventions, des préconceptions la cadrent et
l’orientent. Nous regardons par l’esprit autant que par les yeux. Peut-être
l’appréhension directe, crue, de la pâte informe du monde, l’immersion
dans l’infini grouillement des choses provoqueraient-elles en nous une
insoutenable nausée.
En art et au théâtre, c’est l’écart qui me ravit ; non la coïncidence. L’écart
qui permet à l’imaginaire et à la lucidité de s’épanouir. Le biais, la parole
figurée, le geste stylisé proposent un accès parfois plus direct, plus «effi-
cace» à la réalité ineffable que l’on vise. En un mot, suggérer est plus fort,
moins vain que reproduire, et implique un spectacteur, pour parler… en
bon carougeois !
JL : Cette septième édition du magazine Si accorde une large place aux
questions de la traduction et de l’adaptation (lire pages 118-119, 128-129
et 150-151). Prenons la traduction : à quel niveau se situerait l’éventuelle
trahison du traducteur ?
MM : Traduttore, traditore («traduire, c’est trahir» : littéralement, «traduc-
teur, traître»), dit l’expression italienne bien connue. Elle nous ramène à
la notion d’écart. Il y a maints écarts possibles entre un texte original et
sa traduction : les référents du lieu, de l’époque, la sonorité des mots, le
rythme de la syntaxe, le souffle, le «sens» sont parfois problématiques.
Un seul exemple : le théâtre étant œuvre physique, Benno Besson accordait
une grande importance au rendu des respirations dans ses traductions.
Plus largement, toute réception est «trahison». Est-il possible que je per-
çoive telle parole avec les mêmes dénotations et, surtout, connotations
que le poète a «voulu» y instiller ? C’est déjà miracle qu’il y ait si souvent
vibration ; mais que cette vibration soit, en tout point, fidèle, qui peut le
croire ?
La littéralité est une passion triste. L’intérêt du dialogue des altérités
tient sans doute à cette asymétrie : d’elle vient l’élan qui nous pousse hors
de nous-mêmes.
ÉDITO
VRAI… MENT ?
Dialogue où il est question du vraisemblable, de la fiction et du rapport de l’écart à la vérité

SAISON 2010 -11 DE MEYRIN
ANNE BRÜSCHWEILER AUX COMMANDES
DU VAISSEAU FORUM MEYRIN
Compte rendu de la conférence de presse du 17 novembre 2009
— 108 —
Anne Brüschweiler, directrice artistique du
Théâtre Forum Meyrin à partir de la saison 2010-
2011, dessine sa ligne artistique d’une plume
trempée dans l’encrier de la poésie. Accompa-
gnée par Laurent Gisler, codirecteur en charge
de l’administration, et les membres de l’équipe
actuelle, elle favorisera le rapprochement entre
l’art et la Cité en proposant chaque année une
résidence d’artiste. Les nouvelles saisons feront
davantage de place aux spectacles de chanson
et de cirque contemporain. Les collaborations
actuelles sont étendues et renforcées.
La future directrice du Théâtre Forum Meyrin
estime que, dans une société qui privilégie les
chiffres et la feuille Excel, une institution théâ-
trale doit servir à redonner du poids aux mots,
participer à la création de nouvelles formes, se
ressourcer, « aller vers ce que l’on ignore encore»,
rester vivant. Il est également souhaitable que le
spectateur puisse éprouver du plaisir, de l’émo-
tion, et sortir du théâtre avec un désir de change-
ment – pour lui-même ou pour le monde.
Il s’agit aussi d’être attentif à la langue. Une
langue qu’Anne Brüschweiler souhaite inventive,
en phase avec les propos défendus sur scène,
une langue qui retrouverait l’impact qu’elle tend
à perdre, «notamment dans l’espace politique».
C’est pourquoi la poésie règne au cœur de son
projet, sous toutes les formes que metteurs en
scène, auteurs, musiciens, chanteurs, danseurs
et artistes de cirque sont prêts à lui donner. La
pluridisciplinarité restera donc la marque dis-
tinctive du Théâtre Forum Meyrin, dont la pro-
grammation compte plus de trente spectacles
par année. Qu’on la décline à travers l’écriture, la
mise en scène, le mouvement, la lumière, la voix,
la musique, le décor, les costumes ou le jeu, la
poésie traverse toutes les formes artistiques et
peut se parer de toutes les nuances. Grave,
intense, légère ou candide, Anne Brüschweiler
souhaite explorer ses multiples facettes pourvu
qu’elles nous entraînent vers des élans toujours
nouveaux.
En lien avec la Cité
Entamées par le premier directeur du TFM, Jean-
Pierre Aebersold, les collaborations avec le Teatro
Malandro d’Omar Porras et la compagnie Alias de
Guilherme Botelho, résidentes à Meyrin, seront
maintenues. Ce qui n’empêche pas la nouvelle
directrice d’indiquer qu’elle restera attentive à la
création locale. Parmi les nouveautés de cette
ligne artistique, la volonté d’élargir l’offre
de
spectacles de chanson, «la poésie en musique»,
en privilégiant des récitals originaux. En outre, le
domaine du cirque contemporain, «l’un des
pôles les plus dynamiques du spectacle vivant
aujourd’hui», sera plus présent que précédem-
ment, avec de nouvelles propositions destinées
au jeune public et aux familles – mais pas uni-
quement.
Anne Brüschweiler prévoit encore de
multiplier les liens entre le Forum et ses alen-
tours – la commune de Meyrin, en priorité, mais
aussi la Cité au sens large. C’est la raison pour
laquelle elle prévoit d’initier chaque année un
projet de résidence artistique. L’objectif consis-
tera à faire travailler des artistes sur des théma-
tiques proches des citoyens, afin que résonnent
au Forum les échos de la Cité. Les modalités de
la résidence (durée, forme, aboutissement, etc.)
seront définies en fonction du profil des artistes
invités. Par ailleurs, des ateliers (destinés aux
enfants et aux adultes), des expositions et des
parcours artistiques poursuivront le travail de
démocratisation des arts entrepris par les pré-
cédents directeurs.
Des partenariats étendus
Le partenariat entre le Théâtre Forum Meyrin et
le Théâtre de Carouge, initié par Mathieu Men-
ghini et Jean Liermier en 2008, subsiste et s’élar-
git en franchissant les frontières grâce à l’arri-
vée d’une troisième institution, la scène du
Châtelard dirigée par Hervé Loichemol à Ferney-
Voltaire. Le projet de rendre visible un espace
artistique commun, avec des préoccupations
semblables, sera, par conséquent, proposé à un
public plus large. Mais le trio s’engage égale-
ment à contribuer, par des ateliers d’écriture, de
théâtre, des laboratoires de mise en scène, à
favoriser l’émergence de jeunes talents. L’axe
périphérique sera renforcé, les spectateurs de
Genève et de France voisine pourront profiter
d’un abonnement commun et d’un journal qui
mettra en valeur la programmation des trois
institutions.
Soucieuse d’éveiller l’imagination du specta-
teur et de l’ouvrir à la réflexion, Anne Brüschweiler
est persuadée que ce travail s’opère sur scène et
hors scène. Elle n’ignore pas qu’il faudra, pour
faire mouche, inventer à chaque fois un nouvel
espace de dialogue avec les artistes et avec le
public, définir pour chaque élément du pro-
gramme une approche spécifique, construire sa
pertinence.
Coré Cathoud

— 109 —
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
1
/
56
100%