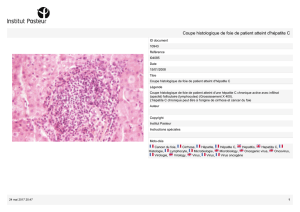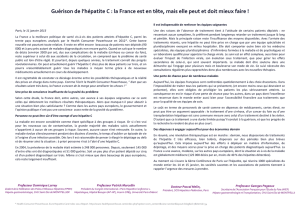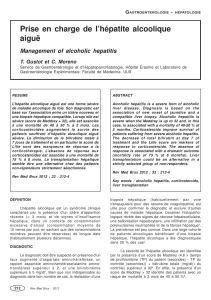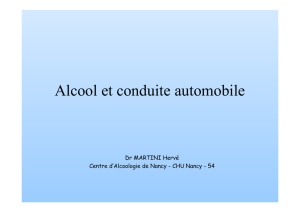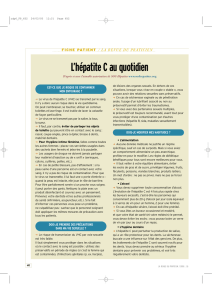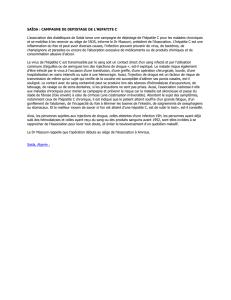Hépatite alcoolique sévère

Mise au point
mt 2012 ; 18 (2) : 136-42
Hépatite alcoolique sévère*
Alexandre Louvet, Florent Artru, Valérie Canva-Delcambre,
Sébastien Dharancy, Philippe Mathurin
CHRU de Lille, Hôpital Huriez et Unité Inserm 995, service des maladies de l’appareil
digestif, rue Polonovski, 59037 Lille cedex, France
L’hépatite alcoolique sévère est une maladie grave qui survient le plus souvent chez un patient
ayant une cirrhose et qui met en jeu le pronostic vital. Son diagnostic est facilité par la réalisa-
tion d’une biopsie hépatique transjugulaire qui doit être proposée à tous les patients buveurs
excessifs ayant un ictère depuis plus de trois mois en l’absence d’autre cause identifiée. La
définition du caractère sévère d’une hépatite alcoolique repose sur un score de Maddrey
supérieur ou égal à 32, seuil retenu pour l’instauration d’un traitement par prednisolone
(ou pentoxifylline) pendant 28 jours. La corticothérapie doit être précédée d’un bilan infec-
tieux systématique et son efficacité est évaluée au septième jour par le score de Lille. En cas
d’échec, peu de traitements sont efficaces et la transplantation hépatique doit être discutée
chez quelques patients très sélectionnés.
Mots clés : alcool, cirrhose, survie, corticoïdes
Severe alcoholic hepatitis is a serious disease, which mostly affects patients with underlying
cirrhosis and which may compromise vital outcome. Its diagnosis is facilitated by liver biopsy,
which is performed via a transjugular procedure, and which should be proposed to every
patient who suffers from a recent onset (less than three months) of jaundice, in the absence
of another cause. Severity of alcoholic hepatitis is defined by a Maddrey function above or
equal to 32, which corresponds to the threshold that meads to initiation of prednisolone
(or pentoxifylline) for 28 days. Initiation of corticosteroids must be preceded by a systematic
infection screening and prednisolone’s efficacy is estimated after seven days by the Lille score.
When prednisolone fails in improving liver function, few therapies are efficient and liver
transplantation might be discussed in a subgroup of very carefully selected patients.
Key words : alcohol, cirrhosis, survival, corticosteroids
Généralités
L’hépatite alcoolique est obser-
vée chez environ 20 % des patients
consommateurs excessifs d’alcool.
Il s’agit d’une entité hétérogène
associée à un risque de progres-
sion de la fibrose important et qui
recouvre une forme sévère, caracté-
risée par un ictère chez un patient
ayant fréquemment une cirrhose,
et une forme non sévère, souvent
asymptomatique. Dans ce dernier
cas, les études longitudinales repo-
sant sur des biopsies répétées chez
des patients consommateurs exces-
sifs permettent de mieux comprendre
l’histoire naturelle. Par exemple,
dans une série rétrospective de 193
patients, il était démontré que le fait
de présenter des lésions d’hépatite
alcoolique sur une première biop-
sie était associé à la présence de
ces mêmes lésions sur une seconde
biopsie effectuée3à4ansplus
tard. Ceci suggère la possibilité, chez
certains patients, d’épisodes répétés
d’hépatite alcoolique avec un risque
nettement majoré de progression vers
la cirrhose [1].
∗«Cet article est paru dans la revue Hépato-Gastro et Oncologie Digestive sous la référence :
Louvet A, Artru F, Canva-Delcambre V, Dharancy S, Mathurin P. Hépatite alcoolique sévère.
Hépato-Gastro 2012 ; 19 : 38-44. »doi : 10.1684/hpg.2012.0680
doi:10.1684/met.2012.0363
mt
Tirés à part : A. Louvet
136
Pour citer cet article : Louvet A, Artru F, Canva-Delcambre V, Dharancy S, Mathurin P. Hépatite alcoolique sévère. mt 2012 ; 18 (2) : 136-42
doi:10.1684/met.2012.0363
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

L’hépatite alcoolique dans sa forme sévère est associée
à un risque de mortalité à 6 mois de l’ordre de 40 %,
ce qui nécessite une prise en charge adaptée et précoce
[2]. Afin de ne proposer un traitement spécifique qu’aux
patients atteints de cette maladie, il est indispensable de
bien respecter le cadre nosologique, même si les critères
diagnostiques restent imparfaits.
Cadre diagnostique
Le diagnostic de l’hépatite alcoolique sévère repose
sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques et his-
tologiques (figure 1). Le point d’appel clinique le plus
fréquent est l’ictère récent (de moins de trois mois) chez
un patient consommateur excessif d’alcool. À ce stade,
une cirrhose est fréquemment associée aux lésions hépa-
tiques inflammatoires, ce qui pose d’emblée le problème
du diagnostic d’autres facteurs responsables d’ictère chez
un patient cirrhotique. Il a été bien démontré que
l’hémorragie digestive sévère chez un patient ayant une
cirrhose pouvait être responsable d’ictère [3], notamment
en cas de transfusions itératives, et la plupart des centres
experts s’accordent à exclure des protocoles d’essai les
patients ayant rec¸u plus de trois concentrés érythrocy-
taires à l’occasion d’une hémorragie digestive. Il en est de
même pour les infections sévères, notamment l’infection
du liquide d’ascite, qui peuvent également décompenser
la cirrhose et être responsable d’ictère. Le point plus spéci-
fique du lien entre infection et corticothérapie est abordé
au paragraphe dédié.
D’un point de vue biologique, on retient comme
paramètres évocateurs de l’hépatite alcoolique sévère
une cytolyse modérée, ne dépassant que très rarement
300 UI/L, et prédominant sur les ASAT (TGO). La bilirubine
totale est élevée, avec une prédominance fréquente sur la
Figure 1. Biopsie hépatique d’hépatite alcoolique.
bilirubine conjuguée (ce n’est pas toujours le cas). Le taux
de prothrombine et l’INR sont altérés de manière propor-
tionnelle à l’insuffisance hépatique. L’hyperleucocytose
avec une prédominance de polynucléaires neutrophiles,
classiquement décrite, n’est pas constante, de même que
le syndrome inflammatoire (élévation de la CRP) [4].
Compte tenu de l’absence de spécificité de ces
critères cliniques et biologiques, la confirmation histo-
logique du diagnostic a été proposée par de nombreux
auteurs, notamment franc¸ais. En raison des troubles de
l’hémostase et de l’ascite fréquemment observés dans
cette situation, la documentation anatomopathologique
doit être faite par voie transjugulaire dans l’immense majo-
rité des cas. Cette voie permet de contourner l’écueil
des troubles de l’hémostase, mais pose le problème
du biais d’échantillonnage et du caractère parfois clair-
semé des lésions. L’atteinte histologique caractéristique de
l’hépatite alcoolique sévère comporte des lésions hépa-
tocytaires sous forme de clarification et de ballonisation
(œdème cellulaire lié aux atteintes membranaires) et
de corps de Mallory (inclusions cellulaires éosinophiles
correspondant à des désorganisations du cytosquelette
induites par l’alcool, et qui précèdent la mort cellulaire.
Il s’y associe un infiltrat à polynucléaires neutrophiles,
d’intensité variée, très évocateur du diagnostic bien que
manquant de spécificité. En fonction de l’ancienneté
du sevrage et de la présence de cofacteurs, en parti-
culier d’une obésité, une stéatose micro- mais surtout
macrovacuolaire peut être observée avec une intensité
variée. Compte tenu de l’ancienneté de la consomma-
tion d’alcool, une fibrose hépatique est observée de
fac¸on presque systématique. Cette fibrose se rencontre à
l’étage sinusoïdal, mais aussi dans les topographies péri-
centrolobulaire et périportale [1, 4]. Au stade d’hépatite
alcoolique sévère, la cirrhose est quasiment constante.
Il faut d’emblée insister sur le fait que la ballonisa-
tion, l’infiltrat à polynucléaires neutrophiles, les corps de
Mallory ne sont pas spécifiques de l’hépatite alcoolique
et se rencontrent également dans la stéatohépatite non
alcoolique, bien que cette dernière entité ne se révèle
qu’exceptionnellement par un ictère.
Il faut donc être très drastique dans les critères de
sélection de manière à ne pas considérer à tort un patient
ictérique qui consomme de l’alcool comme ayant «obliga-
toirement »une hépatite alcoolique. Dans cette situation,
il peut être intéressant d’obtenir des résultats de bilirubi-
némie antérieurs car les patients ont parfois des difficultés
à dater l’apparition de l’ictère. Un patient ayant une bili-
rubine élevée 6 mois avant l’hospitalisation présente plus
probablement une cirrhose terminale qu’une réelle hépa-
tite alcoolique sévère.
Au total, il semble raisonnable de retenir le diagnostic
d’hépatite alcoolique sévère chez un patient consomma-
teur excessif, ayant développé un ictère récent (de moins
de 3 mois), sans autre facteur causal mis en évidence,
mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012 137
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Mise au point
notamment infectieux ou hémorragique, et pour lequel
la biopsie hépatique montre l’association d’une balloni-
sation hépatocytaire, de corps de Mallory et d’un infiltrat
à polynucléaires neutrophiles.
Place des marqueurs non invasifs
Compte tenu de la place de la biopsie hépatique dans
l’hépatite alcoolique sévère, les marqueurs non invasifs
sont assez peu utilisés. La mesure de l’élasticité hépa-
tique par le système Fibroscan®est limitée par le fait
qu’environ 70 % des patients ont une ascite qui empêche
la réalisation de l’examen. Par ailleurs, le Fibroscan®est
plus une mesure de la fibrose que de l’activité inflam-
matoire, même si l’élasticité semble être augmentée par
les lésions d’inflammation hépatique, notamment dans les
hépatites aiguës. En revanche, le test sanguin AshTest®a
des résultats intéressants dans le diagnostic de l’hépatite
alcoolique [5]. Les paramètres de ce test sont les mêmes
que ceux du FibroTest-ActiTest®[6] avec l’inclusion du
taux plasmatique d’ASAT. Dans ce travail, un AshTest®
élevé était associé à un infiltrat à polynucléaires neutro-
philes abondant, à la présence de corps de Mallory et
d’une ballonisation hépatocytaire. Les performances diag-
nostiques de l’AshTest®méritent une validation extérieure
par d’autres groupes pour définir sa place dans le dia-
gnostic de l’hépatite alcoolique sévère.
Quelques éléments de physiopathologie
La compréhension des mécanismes impliqués dans
la toxicité hépatique de l’alcool se heurte aux difficul-
tés des modèles animaux qui ne reproduisent que très
partiellement la complexité du tableau observé chez
l’homme, associant cirrhose, stéatose et atteinte inflam-
matoire. Cependant, les modèles animaux ont permis de
mettre en évidence le rôle essentiel de la cellule de Küpf-
fer et du TNF-␣qu’elle sécrète dans la progression des
lésions. En effet, une injection de gadolinium ou de clo-
dronate (ayant pour effet d’entraîner une déplétion du
foie en cellules de Küpffer) permet de neutraliser les
effets toxiques de l’ingestion d’alcool [7]. Il en est de
même pour l’administration d’anticorps anti-TNF chez
l’animal ou l’utilisation de souris invalidées pour le récep-
teur du TNF-␣[8]. Ces travaux expérimentaux ont permis
de mieux comprendre l’effet bénéfique de la cortico-
thérapie et de proposer un rationnel pour l’utilisation
de la pentoxifylline. L’effet bénéfique des corticoïdes est
essentiellement en rapport avec l’inhibition de la cascade
pro-inflammatoire causée par le facteur de transcription
NF-B, responsable d’une réduction des quantités circu-
lantes de TNF-␣, ainsi que de l’expression hépatocytaire
des molécules d’adhésion comme ICAM-1, ce qui limite
le recrutement des polynucléaires neutrophiles [4].
Comment évaluer le caractère sévère
d’une hépatite alcoolique ?
De manière très simplifiée, on peut considérer qu’une
forme sévère est une forme associée à un risque de mor-
talité à court terme en l’absence de traitement. Le score
de Maddrey a permis une avancée dans ce domaine
en démontrant pour la première fois que la mortalité
s’exprimait dans un sous-groupe de patients définis par
un score supérieur ou égal à 32 [9].
Le score de Maddrey est calculé assez simplement par
la formule suivante : 4,6 ×(temps de Quick du patient –
temps de Quick du témoin) + ((bilirubine en mol/L)/17).
Par la suite, la plupart des essais randomisés ayant la sur-
vie comme critère principal de jugement n’ont inclus que
les patients avec score de Maddrey supérieur ou égal à
32. D’autres scores spécifiques de l’hépatite alcoolique
ont été développés plus récemment : le score de Glasgow
[10, 11] et le score ABIC [12], avec des seuils proposés de
sévérité respectivementà9età6,71. Ces scores incluent
à des degrés divers les paramètres suivants : bilirubine,
INR ou temps de Quick, créatinine ou urée, âge, taux de
globules blancs (tableau 1). L’intérêt de ces scores n’a
pour l’heure pas été confirmé par d’autres équipes dans
le cadre d’une validation externe et la pratique franc¸aise
s’en tient pour l’heure au score de Maddrey. Par ailleurs,
l’intérêt du score MELD a été évalué pour définir la sévé-
rité de l’hépatite alcoolique [13, 14]. Le score MELD est
utilisé en pratique courante en transplantation hépatique
et intègre trois variables : INR, bilirubine et créatinine. Le
seuil de 21 semblait être au moins aussi performant que le
seuil de 32 du score de Maddrey pour définir la mortalité.
Tableau 1. Scores pronostiques dans l’hépatite alcoolique sévère et paramètres inclus
Âge INR TP Albumine Créatininémie
Ins. rénale
Urée Leucocytes Bili Différence Bili
J0-J7
Lille X X X X X X
Maddrey X X
MELD X X X
ABIC X X X X
Glasgow X X X X X
138 mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Comment traiter un patient présentant
une hépatite alcoolique sévère ?
Une fois le caractère sévère de l’hépatite alcoolique
retenu, l’indication de traitement est validée. De nom-
breux traitements ont été évalués mais ont donné des
résultats négatifs en comparaison au placebo : andro-
gènes, propylthiouracile, colchicine...
Actuellement, la corticothérapie est considérée
comme le traitement de référence par les équipes
franc¸aises et anglo-saxonnes, notamment à la lumière
de plusieurs méta-analyses des données individuelles
[15, 16]. Dans ces travaux, la corticothérapie a été compa-
rée au placebo et permettait d’améliorer la survie à court
terme (28 jours). Il faut cependant souligner que d’autres
méta-analyses provenant du même groupe [17, 18] ont mis
en cause l’efficacité de la corticothérapie mais souffrent de
biais méthodologiques dans la mesure où elles ont inclus
certaines études de qualité insuffisante et d’autres mélan-
geant des patients avec hépatite alcoolique sévère ou non
sévère.
D’un point de vue pratique, se pose souvent la ques-
tion de la justification du traitement chez les patients ayant
une amélioration biologique spontanée, c’est-à-dire pré-
sentant une baisse du taux de bilirubine avant la mise
sous traitement. Compte tenu du fait que la corticothérapie
permet d’améliorer le taux de bilirubine plus rapidement
et avec une plus grande amplitude que le placebo, ces
patients doivent être traités au même titre que les autres.
Le seul autre traitement ayant fait la preuve de son effi-
cacité de manière convaincante est la pentoxifylline. Son
utilisation dans l’hépatite alcoolique sévère était justifiée
par des effets anti-inflammatoires in vitro ciblant la voie
du TNF-␣. Ce traitement a été testé dans une étude rando-
misée contrôlée américaine [19] dans laquelle les patients
traités par pentoxifylline avaient une meilleure survie à 6
mois que les patients traités par placebo. Il faut cependant
souligner que les effets supposés anti-TNF n’étaient pas
confirmés in vivo (dosage du TNF-␣circulant). Ces résul-
tats positifs étaient rapportés à un effet néphroprotecteur
avec une diminution de l’incidence du syndrome hépa-
torénal. Bien que largement utilisée aux États-Unis et au
Royaume-Uni, ce traitement est peu utilisé en France en
monothérapie. Des études sont en cours pour démontrer
si ce traitement est efficace en association à la corticothé-
rapie.
Bilan préthérapeutique
Comme cela a été précisé plus haut, il est primordial de
n’inclure que les patients ayant «vraiment »une hépatite
alcoolique. D’un point de vue pratique, il est indispen-
sable que tout patient candidat à une corticothérapie ait
le bilan minimal suivant :
–sérologies VHB, VIH et VHC. En l’absence de trai-
tement antiviral, seule l’infection à VHC n’est pas une
contre-indication à la corticothérapie ;
–échographie abdominale à effectuer avant la biopsie
hépatique à la recherche d’un carcinome hépatocellulaire
notamment ;
–bilan infectieux systématique (hémocultures, exa-
men cytobactériologique des urines et ponction d’ascite
exploratrice, radiographie thoracique) ;
–la ponction-biopsie hépatique est fortement recom-
mandée.
Conduite pratique
du traitement corticoïde
Une fois le bilan préthérapeutique initié, la corticothé-
rapie est débutée à la dose de 40 mg de prednisolone par
jour en une prise orale le matin. Les tenants de la pen-
toxifylline (Torental®) débuteront le traitement à 1 200 mg
par jour en trois prises de 400 mg. La durée du traitement
est de 28 jours. Il n’est pas recommandé d’effectuer de
décroissance progressive des corticoïdes mais de les arrê-
ter brutalement, sans qu’aient été décrits de phénomènes
d’insuffisance surrénale aiguë dans cette situation. Dans la
mesure où la corticothérapie peut être associée à des pro-
blèmes de tolérance, il semble logique de ne pas exposer
à cette molécule un patient qui ne s’améliore pas sous ce
traitement. L’évaluation de la réponse thérapeutique est
donc nécessaire.
Plusieurs outils peuvent être utilisés. Le premier a été
décrit sous le terme de réponse biologique précoce [20],
définie par une diminution du taux de bilirubine entre les
premier et septième jours de traitement, quelle que soit
l’amplitude de diminution. Ce faisant, on définit un groupe
de patients répondeurs aux corticoïdes (ayant une réponse
biologique précoce) et qui ont une bonne survie à 6 mois
(de l’ordre de 80 %) et un groupe de patients non répon-
deurs (dont le taux de bilirubine au septième jour stagne
ou augmente par rapport au début de la corticothérapie)
et qui ont une mauvaise survie à 6 mois, de l’ordre de
25 %. La réponse biologique précoce a l’avantage d’être
très facile à identifier et d’être très spécifique de la mor-
talité à 6 mois. Elle manque cependant de sensibilité car
des décès sont observés chez les patients avec réponse
biologique précoce.
Pour tenter de pallier le manque de spécificité de la
réponse biologique précoce, notre groupe a développé
un nouvel outil pronostique : le modèle de Lille [21].
Ce modèle intègre plusieurs paramètres au premier jour
de traitement : l’âge, les taux de bilirubine, d’albumine,
de prothrombine et la présence éventuelle d’une insuffi-
sance rénale et un paramètre dynamique : la différence
de bilirubine entre les premier et septième jours de traite-
ment. Dans ce cas, c’est l’amplitude de modification de la
mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012 139
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Mise au point
bilirubine qui compte et non plus la réponse à la question
binaire : y-a-t-il ou non une amélioration de la biliru-
bine ? Après une transformation exponentielle, on obtient
un résultat chiffré entre 0 et 1. La formule est disponible sur
Internet (www.lillemodel.com) et sur l’application Med-
Calc des smart-phones. Grâce au modèle de Lille, les
patients sont divisés en deux groupes de part et d’autre
du seuil de 0,45 : les patients répondeurs aux corti-
coïdes caractérisés par un score de Lille bas (<0,45) et
les non-répondeurs aux corticoïdes caractérisés par un
score de Lille élevé (≥0,45) (figure 2). Le score de Lille
classe mieux les patients que la réponse biologique pré-
coce et a de meilleures performances pronostiques que
les autres scores pronostiques testés dans la prédiction
de la mortalité dans l’hépatite alcoolique sévère (MELD,
ABIC, Child-Pugh, Glasgow) [10, 12-14, 21]. La réponse
aux corticoïdes définie par un score de Lille <0,45 est
observée chez environ 60 % des patients.
En l’absence d’étude randomisée sur le sujet, on peut
proposer d’arrêter la corticothérapie au septième jour chez
les patients non répondeurs définis par un score de Lille
supérieur ou égal à 0,45. En effet, quand on s’intéresse au
sous-groupe de patients ayant un score de Lille supérieur
ou égal à 0,45, la survie est la même, que ces patients
soient traités par corticoïdes ou par placebo [21].
Y a-t-il un risque infectieux accru
sous corticoïdes ?
Compte tenu de l’immunosuppression relative des
patients ayant une maladie grave du foie et de la fréquence
de la translocation bactérienne (passage de bactéries via
les nœuds lymphatiques vers la circulation générale), on
peut supposer que les infections bactériennes sont plus
fréquentes et plus graves chez les patients traités par cor-
ticoïdes.
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
0 33 67 100 133 167 200
Temps en jours
Survie
Patients non-répondeurs
modèle de Lille ≥ 0,45
Patients répondeurs
modèle de Lille < 0,45
p < 0,0001
Figure 2. Survie des patients en fonction de la réponse thérapeu-
tique évaluée par le score de Lille.
Une étude prospective récente a inclus plus de 200
patients atteints d’hépatite alcoolique sévère et a mon-
tré qu’environ 25 % des patients étaient déjà infectés
au moment de l’hospitalisation sans qu’on ne mette en
évidence de facteur prédictif évident [22]. Un grand
nombre de ces patients ne présente pas de symptômes
infectieux et les infections sont donc dépistées lors
du bilan d’évaluation systématique, ce qui en souligne
l’importance. Une fois le contrôle de l’infection obtenu,
l’évolution des patients est la même que les patients non
infectés et il n’est pas mis en évidence de risque de récidive
infectieuse sous corticoïdes.
Dans ce même travail, l’infection survenant sous corti-
coïdes n’était pas associée de manière indépendante à la
survie, mais survenait beaucoup plus fréquemment chez
les patients non répondeurs aux corticoïdes, soulignant
que c’est l’absence de réponse thérapeutique et non la
corticothérapie en soi qui promeut l’infection. Bien que
la corticothérapie ne favorisait pas l’infection de manière
indépendante, il semble cependant raisonnable de ne
pas continuer ce traitement chez les patients non répon-
deurs au septième jour, car ce travail ne permettait pas
d’écarter complètement un éventuel rôle aggravant des
corticoïdes.
Le point spécifique
de la nutrition artificielle
La dénutrition est très fréquente chez les patients ayant
une hépatite alcoolique sévère. L’apport calorique, par
voie entérale ou parentérale, améliore l’état nutritionnel,
mais pas la survie. Cependant, une étude a comparé la
nutrition entérale à la corticothérapie et semble démon-
trer que la survie est identique à 1 mois et 1 an, suggérant
que le soutien nutritionnel puisse être aussi efficace que la
corticothérapie [23]. Il semble logique de proposer cette
assistance nutritive à ces patients en adjonction de la cor-
ticothérapie. Un essai belge actuellement en cours doit
répondre à la question de l’intérêt de cette association.
Que faire en cas
d’absence de réponse aux corticoïdes ?
Il s’agit malheureusement d’un espace où peu de
traitements sont efficaces. L’absence de réponse à la cor-
ticothérapie, quel que soit l’outil utilisé pour la définir, est
associée à une probabilité de décès de l’ordre de 75 %
à 6 mois. Dans cette situation, la pentoxifylline n’est pas
efficace [24], pas plus que ne l’est le système MARS de
dialyse à l’albumine [25]. L’une des options pourrait être
la transplantation hépatique en procédure accélérée chez
un sous-groupe de patients très sélectionnés [26, 27].
140 mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%