Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

Y. Henchoz
introduction
La lombalgie est une douleur ou gêne fonctionnelle située entre
la douzième côte et le pli fessier, associée ou non à des irra-
diations dans les membres inférieurs. La lombalgie est typi-
quement classifiée selon sa durée. Les six premières semaines correspondent à
la période de lombalgie aiguë. Entre six et douze semaines, la lombalgie est dite
subaiguë. Au-delà de douze semaines la lombalgie est chronique.1 On différen-
cie les lombalgies spécifiques ou non spécifiques. Les lombalgies spécifiques
(ou symptomatiques) présentent des symptômes clairement identifiés (infection,
tumeur, fracture, etc.). Il est essentiel de rechercher les signes d’alerte d’une éven-
tuelle cause symptomatique. Le traitement de cette cause suffit généralement à
guérir le mal de dos. A l’inverse, les lombalgies non spécifiques (ou communes)
n’ont pas de cause identifiable et représentent 85 à 90% des cas.2 C’est pour ce
type de lombalgie que l’exercice et les activités sportives présentent le plus d’in-
térêt et ont par conséquent été le plus étudiés. Cet article a pour but de clarifier
l’état des connaissances sur l’efficacité, les mécanismes et les recommandations
en matière d’exercice et d’activités sportives dans la lombalgie non spécifique.
rappel épidémiologique
Il est généralement admis que 70 à 85% des adultes souffrent au moins une fois
au cours de leur vie d’un épisode de lombalgie.3 La prévalence annuelle dans les
pays occidentaux se situe autour de 30% et la prévalence ponctuelle autour de
20%.4 Cette différence reflète probablement la nature instable et épisodique de
la lombalgie. Par ailleurs, la prévalence est variable en fonction de l’âge avec un
maximum entre 40 et 60 ans.4 En Suisse, la lombalgie est le problème de santé le
plus répandu. L’Enquête suisse sur la santé 2007 5 a révélé que 47% des femmes
et 39% des hommes avaient souffert de divers problèmes de dos dans les quatre
semaines précédant l’interrogation.
La littérature sur la progression à long terme a souvent décrit le pronostic de
la lombalgie comme favorable. Soixante à 70% des patients guérissent sans perte
fonctionnelle résiduelle en six semaines, et 80 à 90% en douze semaines (figure 1).
Non-specific low back pain : are exercise
and sporting activities recommended ?
Low back pain is the most prevalent health
problem in Switzerland. Exercise is the most
effective means of primary and secondary
prevention. In acute low back pain, it is re-
commended to reduce exercise and sporting
activities but maintain a daily physical activity
as usual as possible. Exercise is however ef-
fective in subacute or chronic low back pain. It
reduces deconditioning and breaks the down-
ward spiral of chronicity. Sporting activities
have been little studied but could promote
long-term adherence more than a prolonged
exercise program. It seems reasonable to ad-
vise against sports involving heavy loads to
lift or sudden changes of direction. However
the notion of pleasure must remain a priority.
Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 612-6
La lombalgie est le problème de santé le plus prévalent en
Suisse. L’exercice est le moyen de préventions primaire et se-
condaire le plus efficace. Dans la lombalgie aiguë, il est re-
commandé de réduire l’exercice et les activités sportives mais
de maintenir une activité physique quotidienne aussi normale
que possible. L’exercice est en revanche efficace dans la lom-
balgie subaiguë ou chronique. Il permet de réduire le décon-
ditionnement et briser la spirale de la chronicité. Les activités
sportives ont été peu étudiées mais pourraient favoriser l’ad-
hésion à long terme davantage qu’un programme d’exercice
prolongé. Il semble raisonnable de déconseiller les sports im-
pliquant des charges importantes à soulever ou des change-
ments de direction brusques. Cependant, la notion de plaisir
doit rester prioritaire.
Lombalgies non spécifiques :
faut-il recommander l’exercice et
les activités sportives ?
pratique
612 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
16 mars 2011
Dr Yves Henchoz
Service de rhumatologie et de
médecine du sport
Département de l’appareil locomoteur
CHUV, 1011 Lausanne
44_48_35522.indd 1 10.03.11 09:24

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
16 mars 2011 613
Au-delà, la récupération est lente et incertaine. Moins de
la moitié des personnes invalides depuis plus de six mois
retournent au travail et, après deux ans d’arrêt de travail,
le taux de retour au travail est proche de zéro.3 Les pa-
tients qui deviennent invalides de manière temporelle ou
permanente ne représentent que 10% des cas, mais engen-
drent 85% des coûts totaux.6 En 2005 en Suisse, les coûts
directs ont été mesurés à € 2,6 milliards et les coûts indi-
rects entre € 2,2 et € 4,1 milliards, soit un total représentant
1,6 à 2,3% du produit intérieur brut.7
chronicisation de la lombalgie
Un regard sur le processus de chronicisation de la lombal-
gie permet de comprendre à quels niveaux l’exercice peut
être bénéfique aux patients lombalgiques. Les mécanismes
sous-jacents à la transition de la lombalgie aiguë à chroni-
que ne sont pas totalement élucidés. Toutefois, il est géné-
ralement admis que des facteurs cognitifs et comportemen-
taux sont le plus souvent en cause. Le modèle de la peur
liée à la douleur 8 illustre bien comment un épisode dou-
loureux initial peut conduire à une cascade de conséquen-
ces, parmi lesquelles le déconditionnement global de l’in-
dividu contribue à perpétuer le cercle vicieux caractéristi-
que de la lombalgie chronique (figure 2). Ce modèle oppose
deux réponses comportementales face à la douleur : la con-
frontation et l’évitement. Le catastrophisme se réfère au
processus au cours duquel la douleur est interprétée comme
extrêmement menaçante. Dans ce processus interviennent
plusieurs facteurs parmi lesquels l’information délivrée par
le médecin et l’entourage du patient, ainsi que les expé-
riences douloureuses antérieures du patient qui jouent un
rôle important. Le catastrophisme génère très logiquement
une peur liée à la douleur. La prochaine étape dans le
cercle vicieux est l’évitement et l’hypervigilance envers les
activités supposées augmenter la douleur, en particulier
l’activité physique. Le dernier élément de la spirale en-
globe le déconditionnement, la dépression et l’incapacité.
Le déconditionnement se fait ressentir sur les plans phy-
siques, psychologiques et sociaux.9 L’ampleur est renforcée
par les relations causales qui existent entre ces trois types
de changements (figure 2).
efficacité de l’exercice
De nombreux travaux ont eu pour objectif de démontrer
l’efficacité de l’exercice dans la prévention et le traitement
de la lombalgie. Une récente revue générale de la littérature
sur le sujet a identifié vingt revues systématiques publiées
en dix ans (1997-2007).10 Dans la prévention de la lombal-
gie, il existe un niveau de preuve élevé que l’exercice est
un moyen efficace de préventions primaire (prévention des
nouveaux cas) et secondaire (diminution de la prévalence
et prévention de la chronicité) des lombalgies. L’exercice
est même souvent identifié comme la seule modalité pré-
ventive dont l’efficacité a pu être démontrée.11-13 Le sport
comme facteur de risque de la lombalgie a récemment fait
l’objet d’une revue de la littérature.14 Le principal facteur de
risque identifié était la pratique intensive d’un seul sport et
particulièrement chez un sujet jeune. Les sports incriminés
étaient la gymnastique, l’haltérophilie, le football, la lutte
et certaines disciplines de l’athlétisme.
Comme modalité de traitement, l’exercice diminue l’in-
capacité et la douleur et améliore la condition physique et
le statut professionnel des patients lombalgiques subaigus,
récurrents ou chroniques.10 L’exercice est jugé plus efficace
qu’un traitement placebo ou aucun traitement (niveau de
preuve modéré) et que le traitement habituel par un mé-
decin généraliste (niveau de preuve élevé). L’exercice n’est
cependant pas plus efficace que la physiothérapie (niveau
de preuve élevé), et moins efficace qu’un traitement multi-
disciplinaire (niveau de preuve contradictoire). Dans la prise
en charge de la lombalgie aiguë, l’inefficacité (mais pas la
nocivité) de l’exercice a pu être démontrée (niveau de preu-
ve élevé). Il est conseillé aux patients de poursuivre autant
Figure 1. Evolution naturelle de la lombalgie
(Adaptée de réf.3)
3 6 9 12 15 18 21 24 27
Durée d’invalidité (semaines)
100
80
60
40
20
0
Patients invalides (%)
aiguë subaiguë chronique
Figure 2. Chronicisation de la lombalgie illustrée
par le modèle de la peur liée à la douleur
(Adaptée de réf.7-9).
Changements physiques
Physiologiques
• Atrophie musculaire
• Chang. du métabolisme
• Ostéoporose
• Obésité
Fonctionnels
• Capacité CV
• Force
• Mobilité
• Coordination
Q
Q
Q
Q
Changements
psychologiques
• Détresse
• Dépression
• Anxiété
Changements
sociaux
• Restriction des activités
sociales
• Perte économique
Déconditionnement
Dépression
Incapacité
Evitement
Hypervigilance
Peur liée à
la douleur
Expérience
douloureuse
Catastrophisme
Blessure
Guérison
Confrontation
Faible peur
Détresse
Information inquiétante
en lien avec la maladie
44_48_35522.indd 2 10.03.11 09:24

que possible les activités quotidiennes plutôt que d’effec-
tuer un programme d’exercice.10
mécanismes d’action de l’exercice
Bien qu’il apparaisse maintenant évident que l’exercice
a des vertus dans la prise en charge de la lombalgie chroni-
que, les mécanismes d’action sont encore mal connus. Les
effets d’une pratique régulière d’exercice dans la population
saine sont nombreux et relativement bien détaillés.15 Nul
doute que ces bienfaits expliquent, au moins en partie, les
résultats positifs rapportés à la suite de programmes d’exer-
cice adaptés aux patients lombalgiques chroniques. Cer-
taines adaptations spécifiques à la lombalgie chronique
ont cependant été émises (tableau 1).
Des biopsies de la musculature spinale ont pu mettre
en évidence une atrophie sélective des fibres musculaires
de type II (fibres rapides), ainsi qu’une atténuation de cette
atrophie à la suite d’un programme d’exercice, en particu-
lier chez les hommes.16 Il a été suggéré que l’exercice
affecte l’architecture du lit capillaire à l’interface disque-os
avec un effet bénéfique sur la diffusion des éléments nu-
tritifs dans le disque.17 Certaines études ont démontré que
le mouvement améliore la guérison de l’ensemble des struc-
tures qui constituent le dos (muscles, ligaments, tendons,
cartilages, disques).18 Il faut cependant préciser que la lom-
balgie chronique a de nombreux facteurs de risque psycho-
social et ne se limite pas aux lésions structurelles. Dans
ce contexte, l’exercice engendre une augmentation du seuil
de perception de la douleur19 ainsi qu’une diminution de
la peur du mouvement (kinésiophobie),20 en particulier s’il
est une composante d’un programme multidisciplinaire.
Une diminution des symptômes dépressifs et anxieux ain-
si qu’une amélioration de l’humeur pourraient s’expliquer
par la diminution de la concentration plasmatique au repos
de bêta-endorphine21 et l’augmentation de la concentra-
tion plasmatique de sérotonine mesurée immédiatement
après une séance d’exercice.22 Enfin, l’exercice a un effet
anti-inflammatoire démontré par l’augmentation de la con-
centration plasmatique de citokines à effet anti-inflamma-
toire 23 et la diminution de la protéine C-réactive.24
quel est le programme d’exercice le plus
adapté ?
Dans le but de définir le type d’exercice optimal, la mé-
thode scientifique la plus rigoureuse semble de comparer
différentes caractéristiques de l’exercice. C’est la démarche
adoptée récemment dans une revue de littérature.10
Général versus spécifique
Les exercices de renforcement de la musculature du
tronc activent l’ensemble des muscles fléchisseurs et ex-
tenseurs du tronc et à une intensité relativement élevée.
Cependant, des exercices plus spécifiques et plus légers
ont été développés, activant préférentiellement les muscles
stabilisateurs locaux du rachis. Les études ayant comparé
ces deux types d’exercices de renforcement sont contra-
dictoires. La spécificité de l’exercice a été différemment
évaluée dans une étude longitudinale observationnelle.25
La quantité d’activités physiques de loisir pratiquée avait un
effet protecteur en termes de douleur et d’incapacité alors
que la quantité d’exercices de renforcement musculaire du
tronc pratiquée avait l’effet inverse. Les auteurs reconnais-
saient cependant des limites liées au
design
de l’étude.
Individuel versus en groupe
Le volume et l’intensité d’entraînement doivent être in-
dividualisés aux capacités individuelles du patient qui
peuvent être établies au moyen d’une évaluation initiale.
Lorsque l’exercice est réalisé en groupe, il est plus difficile
d’individualiser les paramètres du programme. En revanche,
Il est possible que la dynamique de groupe implique une
solidarité et une motivation supplémentaires. Les études
comparatives n’ont pas trouvé de différence significative en
termes de diminution de la douleur. Par contre, l’exercice
en groupe semble améliorer davantage l’incapacité pour
certains patients.
Supervisé versus à domicile
La plupart des études ayant évalué un programme d’exer-
cice chez des patients lombalgiques a été effectuée dans
le cadre d’une supervision par du personnel compétent.
Certaines investigations se sont néanmoins penchées sur
l’efficacité des programmes d’exercice effectués à domicile,
moins onéreux. Il existe un niveau de preuve élevé qu’un
programme d’exercice supervisé ou partiellement supervisé
est plus efficace qu’un programme d’exercice à domicile.
La supervision améliore l’adhésion des patients et accroît
la diminution de la douleur et de l’incapacité.
Motivation et préférences du patient
La motivation a fait l’objet d’un seul essai contrôlé ran-
domisé, qui montrait qu’un programme d’exercice était si-
gnificativement plus efficace pour diminuer la douleur et
l’incapacité à un et cinq ans de suivi s’il était combiné avec
des interventions visant à renforcer la motivation des pa-
tients.26 Les préférences du patient pour le traitement ont
également été très peu investiguées mais semblent égale-
ment mériter une considération lors de la mise en œuvre
d’un programme d’exercice.
recommandations de l’american college
of sports medicine
L’American college of sports medicine (ACSM) recom-
mande pour les patients lombalgiques une prescription de
614 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
16 mars 2011
Tableau 1. Mécanismes d’action de l’exercice dans
la lombalgie chronique
: diminution ; : augmentation.
Atrophie des fibres musculaires de type II16
Diffusion des éléments nutritifs dans les disques intervertébraux17
Guérison des structures du dos18
Seuil de perception de la douleur19
Kinésiophobie, comportement d’évitement20
Bêta-endorphine plasmatique au repos 21
Sérotonine plasmatique postexercice 22
Concentration plasmatique de citokines à effet anti-inflammatoire 23
Protéine C-réactive 24
Q
Q
Q
Q
Q
R
R
R
R
R
R
44_48_35522.indd 3 10.03.11 09:24

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
16 mars 2011 615
l’exercice similaire à la population générale,27 avec une ré-
duction de l’exercice en phase aiguë et quelques ajuste-
ments appropriés.28
Renforcement musculaire
Le renforcement de la musculature abdominale et lom-
baire doit se faire au minimum deux fois par semaine, à rai-
son d’une série de huit à douze répétitions maximales (âge
l 50 ans) ou de dix à quinze répétitions maximales (âge
L 50 ans). L’accent est mis sur l’endurance musculaire plu-
tôt que la force maximale pour les sujets plus âgés. Cette
recommandation est également préconisée par McGill mais
sans distinction d’âge.29
Endurance cardiovasculaire
Les ajustements préconisés par l’ACSM dans l’entraîne-
ment de l’endurance cardiovasculaire visent à augmenter
ou maintenir les activités de la vie quotidienne, à travers
des tâches fonctionnelles comme une marche rapide du-
rant cinq minutes, trois à cinq fois par semaine et assis-de-
bout devant une chaise durant une minute, deux à trois fois
par semaine, sans spécification plus précise quant à l’inten-
sité. Par ailleurs, l’ACSM recommande d’éviter les activités
incluant des impacts importants comme la course à pied.
Mobilité
L’ACSM recommande tous les exercices de mobilité qui
n’augmentent pas la douleur, et particulièrement ceux qui
concernent les muscles fléchisseurs et extenseurs du tronc
et des hanches. La mobilité doit être entraînée deux à trois
fois par semaine, à raison de trois répétitions par groupe
musculaire à chaque session. La technique statique est re-
commandée, avec une durée d’étirement de dix secondes.
activités sportives
Les activités sportives ont cet avantage sur les program-
mes d’exercice qu’elles sont généralement plus motivantes
et favorisent l’adhésion à long terme. Bon nombre de pa-
tients s’interrogent à juste titre sur d’éventuelles activités
à privilégier ou à déconseiller. La littérature scientifique à
ce sujet est encore peu éclairante. Il faut insister sur le fait
que toute activité physique pratiquée à dose modérée
n’augmente pas le risque d’aggravation ou de récidive de
la lombalgie.30 Il semble raisonnable de déconseiller les
sports impliquant des charges excessives à soulever, comme
l’haltérophilie, le judo ou la musculation lourde. Les blo-
cages brusques en rotation du tronc entraînent des forces
de cisaillement sur le disque intervertébral potentiellement
nocives. A ce titre, on déconseillera le squash ou le tennis,
bien que la terre battue semble plus favorable que les sur-
faces dures grâce à la possibilité de glisser lors des chan-
gements de direction.
Il est très répandu de conseiller aux patients lombal-
giques le vélo ou la natation. Ces activités sont sans doute
bénéfiques aux patients, notamment parce qu’elles occa-
sionnent une participation conséquente du système cardio-
respiratoire, mais présentent le désavantage de peu solli-
citer la musculature stabilisatrice du rachis en position de-
bout. Une autre recommandation très fréquente est de
déconseiller les sports asymétriques comme le golf. Il n’a
cependant jamais été prouvé que ce type d’activités pou-
vait engendrer des déséquilibres musculaires à l’origine de
maux de dos. Il semble tout de même plus approprié de
recommander des activités telles que la marche, le
Nordic
walking
ou encore les parcours VITA en été, et à la saison
froide, la randonnée à skis ou en raquettes et le ski de fond.
conclusion
L’exercice permet de prévenir l’incidence et la récurren-
ce de la lombalgie. Les programmes d’exercice sont recom-
mandés en cas de lombalgie subaiguë et chronique mais
pas aiguë. Dans tous les cas, il faut insister sur l’importance
de maintenir un quotidien aussi actif que possible. Les acti-
vités sportives à privilégier sont celles qui favorisent l’adhé-
sion à long terme en procurant du plaisir. Les sports jugés
dangereux doivent être déconseillés avec la plus grande
prudence car bien souvent les effets bénéfiques l’empor-
tent sur une éventuelle répercussion nocive.
Implications pratiques
L’exercice doit tenir une place importante dans la prévention
et la prise en charge de la lombalgie chronique
La recommandation d’une activité sportive à un patient doit
tenir compte en premier lieu de ses préférences
Les sports impliquant des charges importantes à soulever ou
des changements de direction brusques ne doivent pas être
encouragés
La recherche devrait davantage se pencher sur la pratique
des activités sportives
>
>
>
>
1 Bogduk N, McGuirk B. Medical management of
acute and chronic low back pain : An evidence-based
approach. 1st ed. Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2002.
2 Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J
Med 2001;344:363-70.
3 Andersson GB. Epidemiological features of chronic
low-back pain. Lancet 1999;354:581-5.
4 Loney PL, Stratford PW. The prevalence of low back
pain in adults : A methodological review of the literature.
Phys Ther 1999;79:384-96.
5 Enquête suisse sur la santé 2007. Neuchâtel : Office
fédéral de la statistique, 2008.
6 Hashemi L, Webster BS, Clancy EA, Volinn E. Length
of disability and cost of workers’ compensation low
back pain claims. J Occup Environ Med 1997;39:937-45.
7 Wieser S, Horisberger B, Schmidhauser S, et al.
Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J
Health Econ in press.
8 * Vlaeyen JW, Linton SJ. Fear-avoidance and its
consequences in chronic musculoskeletal pain : A state
of the art. Pain 2000;85:317-32.
9 Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, et al. Disuse
and deconditioning in chronic low back pain : Concepts
and hypotheses on contributing mechanisms. Eur J Pain
2003;7:9-21.
10 * Henchoz Y, Kai-Lik So A. Exercise and nonspecific
low back pain : A literature review. Joint Bone Spine
2008;75:533-9.
11 COST_B13. European guidelines for the manage-
ment of low back pain. Eur Spine J 2006;15(Suppl. 2):
Bibliographie
44_48_35522.indd 4 10.03.11 09:24

616 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
16 mars 2011
s125-300.
12 Bigos SJ, Holland J, Holland C, et al. High-quality
controlled trials on preventing episodes of back pro-
blems : Systematic literature review in working-age
adults. Spine J 2009;9:147-68.
13 Linton SJ, van Tulder MW. Preventive interven-
tions for back and neck pain problems : What is the
evidence ? Spine 2001;26:778-87.
14 Le Goff P. Le sport parmi les facteurs de risque de
la lombalgie. Rev Rhum Ed Fr 2007;74:573-80.
15 Grosclaude M, Ziltener JL. Benefits of physical ac-
tivity. Rev Med Suisse 2010;6:1495-8.
16 Ng JK, Richardson CA, Kippers V, Parnianpour M.
Relationship between muscle fiber composition and
functional capacity of back muscles in healthy subjects
and patients with back pain. J Orthop Sports Phys Ther
1998;27:389-402.
17 Raj PP. Intervertebral disc : Anatomy-physiology-
pathophysiology-treatment. Pain Pract 2008;8:18-44.
18 Nachemson A. Work for all. For those with low
back pain as well. Clin Orthop Relat Res 1983:77-85.
19 Droste C, Greenlee MW, Schreck M, Roskamm H.
Experimental pain thresholds and plasma beta-endor-
phin levels during exercise. Med Sci Sports Exerc 1991;
23:334-42.
20 Storheim K, Brox JI, Holm I, Koller AK, Bo K. In-
tensive group training versus cognitive intervention in
sub-acute low back pain : Short-term results of a single-
blind randomized controlled trial. J Rehabil Med 2003;
35:132-40.
21 Lobstein DD, Ismail AH, Rasmussen CL. Beta-en-
dorphin and components of emotionality discriminate
between physically active and sedentary men. Biol Psy-
chiatry 1989;26:3-14.
22 Sokunbi O, Watt P, Moore A. Changes in plasma
concentration of serotonin in response to spinal stabi-
lisation exercises in chronic low back pain patient. Nig
Q J Hosp Med 2007;17:108-11.
23 Petersen AM, Pedersen BK. The role of IL-6 in me-
diating the anti-inflammatory effects of exercise. J Phy-
siol Pharmacol 2006;57(Suppl. 10):43-51.
24 Kim SK, Jung I, Kim JH. Exercise reduces C-reac-
tive protein and improves physical function in automo-
tive workers with low back pain. J Occup Rehabil
2008;18:218-22.
25 Hurwitz EL, Morgenstern H, Chiao C. Effects of
recreational physical activity and back exercises on
low back pain and psychological distress : Findings from
the UCLA Low Back Pain Study. Am J Public Health
2005;95:1817-24.
26 Friedrich M, Gittler G, Arendasy M, Friedrich KM.
Long-term effect of a combined exercise and motiva-
tional program on the level of disability of patients with
chronic low back pain. Spine 2005;30:995-1000.
27 American college of sports medicine. Thompson
WR, Gordon NF, Pescatello LS. ACSM’s guidelines for
exercise testing and prescription. 8th ed. Philadelphia :
Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
28 Simmonds MJ, Derghazarian T. Lower Back Pain
Syndrome. ACSM’s exercise management for persons
with chronic diseases and disabilities. 3rd ed. Cham-
paign, IL : Human Kinetics, 2009;266-9.
29 * McGill SM. Low back exercises : Evidence for im-
proving exercise regimens. Phys Ther 1998;78:754-65.
30 ** Rainville J, Hartigan C, Martinez E, et al. Exer-
cise as a treatment for chronic low back pain. Spine J
2004;4:106-15.
* à lire
** à lire absolument
44_48_35522.indd 5 10.03.11 09:24
1
/
5
100%
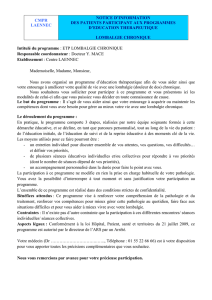

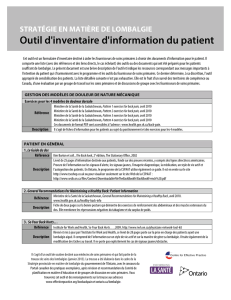
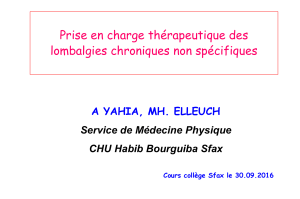
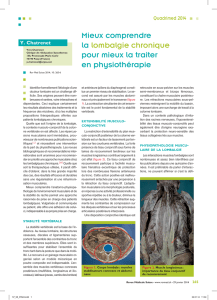
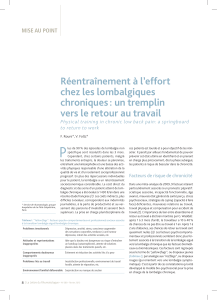
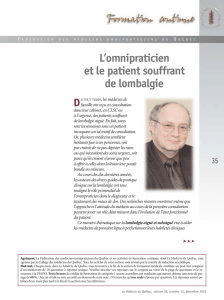
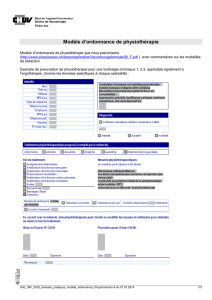
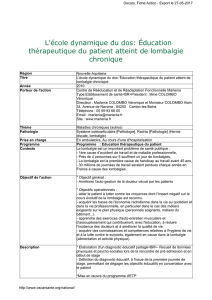


![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)