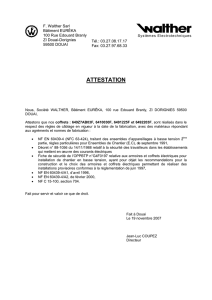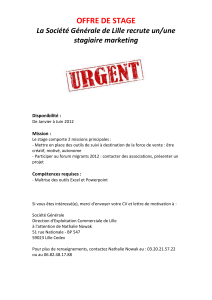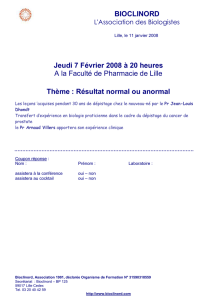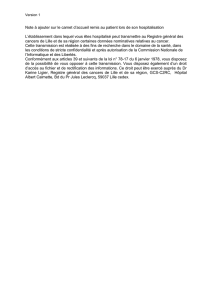Les fondements de la justice moderne

44
L«autorité judiciaire» remplace le «pouvoir judi-
ciaire» de 1791. La Justice ne forme pas un
troisième pouvoir : elle est plus puissante mais
ne jouit pas d’une pleine et entière indépendance.
Il y a une volonté de rétablir de «grands corps».
Avec les lois du 27 ventôse an VIII et du 20 avril
1810, l’organigramme judiciaire est plus hiérarchi-
sé et rationalisé. La grande innovation réside dans
les tribunaux d’appel — puis les Cours d’appel —,
pivots de l’ordre judiciaire. Le justiciable trouve en
appel une juridiction plus imposante et réunissant
davantage de lumières, ce qu’empêchait l’appel
circulaire révolutionnaire. Le Tribunal de cassation,
devenu Cour de cassation en 1804, reste le som-
met de l’organisation judiciaire.
Le personnel judiciaire subit également de
nombreux changements. Les magistrats acquiè-
rent un nouveau statut : ils ne sont plus élus mais
«nommés» par l’Empereur ; ils ne sont plus nom-
més à temps mais deviennent «inamovibles».
L’inamovibilité est conçue comme une garantie
indispensable de stabilité et d’indépendance. Pour
leur recrutement, seule une condition d’âge (trente
ans) est exigée, les connaissances juridiques sont
davantage présumées que prouvées, la moralité et
le civisme au-dessus de tout soupçon jouant un
plus grand rôle. La loi du 20 avril 1810 impose le
diplôme de licencié en droit complété par un stage
de deux années d’exercice passées au barreau.
Pour donner à la magistrature une dignité, le cos-
tume — toge et robe rouge — et les titres tradi-
tionnels sont rendus aux juges. Les termes de
«cour» et d’«arrêt s» ont réintroduits pour l’appel et
la cassation. La magistrature, entourée ainsi d’hon-
neurs et de respect, redevient sacerdoce et retrou-
ve son rang, au-dessus des justiciables.
Quant aux auxiliaires de justice, les avoués,
rétablis par la loi du 27 ventôse an VIII, sont nom-
més par le Premier Consul, ayant «exclusivement
le droit de postuler et de prendre des conclusions
dans le tribunal pour lequel ils seront établis». Une
Chambre des avoués, composée de membres
élus, assure la discipline et le respect des règles
de déontologie sous le contrôle des tribunaux, titu-
laires du pouvoir de suspension, et du ministre,
seul habilité à prononcer une destitution. Les bar-
reaux se reconstituent d’abord de façon officieuse
pendant le Consulat sous la forme de listes
d’hommes de loi reconnus devant une juridiction.
Ensuite, la loi du 22 ventôse an XII qui crée les
écoles de droit, institue le tableau des avocats
auprès de chaque tribunal. C’est le décret du 14
décembre 1810 qui va formellement rétablir l’Ordre
des avocats. Ce texte peut être vu comme un hom-
mage, une reconnaissance, mais aussi une mise
sous tutelle des avocats : le tableau est soumis à
l’approbation du Ministre de la justice qui peut
radier un avocat de sa seule autorité. Les greffiers
et les huissiers, d’abord nommés par l’exécutif,
deviennent officiers ministériels (les greffiers seront
en même temps fonctionnaires, statut qu’ils
acquièrent définitivement en 1965). [C.G.]
Les fondements de la justice moderne
Nouveau costume de juge au Tribunal criminel
(coll. privée).

45

46
L
a justice civile fut profondément modifiée par la
promulgation du Code civil des Français, le 21
mars 1804. Ce monument de droit fut une réus-
site majeure dont toute la gloire revint à Bonaparte
: dès 1807, il fut rebaptisé «Code Napoléon». Le
Code civil avait été préparé par une commission
composée de quatre éminents juristes nommés le
13 août 1800 : Portalis, Maleville, Tronchet et Bigot
de Préameneu. Portalis, méridional, avocat remar-
qué à Aix-en-Provence, fut chargé de la rédaction
du Discours préliminaire, un chef d’œuvre de la lit-
térature juridique. Le projet, accompagné des
observations des cours et tribunaux, fut ensuite dis-
cuté au Conseil d’Etat au cours de cent deux
séances, dont cinquante sept furent présidées per-
sonnellement par Bonaparte qui dirigea les débats
avec énergie et y imposa ses vues.
Le Code civil fut accompagné par un Code de
procédure civile, publié en 1806 et entré en vigueur
le 1er janvier 1807. Les travaux préparatoires furent
confiés à une commission de magistrats et de pra-
ticiens qui avaient tous commencé leur carrière
auprès des juridictions d’Ancien Régime, en parti-
culier Pigeau qui fut le principal artisan de ce Code
de procédure civile. Ces travaux préparatoires
n’ont guère passionné Napoléon : il n’a participé
qu’à une seule séance. Le Conseil d’Etat quant à lui
trouva «la matière trop aride et la plupart des
membres n’y entendaient rien». Le décret du 3
Brumaire an II qui préconisait une «procédure sans
formes» ayant démontré que l’extrême dépouille-
ment des règles de procédure constituait un dan-
ger pour les justiciables, la commission proposa
finalement une simple révision de l’Ordonnance
pour la réformation de la justice, premier véritable
code de procédure, promulguée par Louis XIV dès
1667. Notre procédure, comme celle de nombreux
pays européens, s’en inspire encore aujourd’hui.
Quant à l’organisation judiciaire, qui n’était
pas reprise dans le Code de 1806, ses grandes
lignes avaient déjà été fixées par la loi de 27
Ventôse an VIII et elle demeurera quasiment
inchangée jusqu’en 1919. Cette organisation repo-
se d’une part sur l’alignement des circonscriptions
judiciaires sur les circonscriptions administratives
(cantons, arrondissements, départements) et,
d’autre part, sur le principe de l’unité de la justice
criminelle et de la justice civile.
La justice se présente comme une structure
pyramidale avec à son sommet la Cour de cassa-
tion. A sa base, le juge de paix, siégeant au chef- l i e u
de canton (par exemple à Armentières, à Roubaix
ou à Tourcoing), est compétent pour les affaires
civiles d’importance mineure — qu’il juge en équité
— et il assure la conciliation préalable à tout procès
dans les autres contentieux civils. Les procès plus
importants, et notamment tous les litiges en matière
immobilière, relèvent du Tribunal civil de première
instance établi au chef-lieu d’arrondissement
(comme à Cambrai, à Dunkerque ou à
Valenciennes). La plupart des décisions rendues
par ces juridictions sont susceptibles d’appel
devant la Cour d’appel. En raison de l’héritage his-
torique, le siège de cette cour fut fixé à Douai, dans
les locaux de l’ancien Parlement de Flandre, et non
au chef-lieu de département : Lille. [R.M.]
Fauvel (1800-1824), président du Tribunal civil de première instance
de Lille (cabinet du Président du Tribunal de grande instance de Lille).
La justice civile

47

48
E
n l’an IX, Napoléon Bonaparte décide de la
création d’une nouvelle codification pénale. Une
commission de cinq membres composée de
Treilhard, Target, Oudart, Blondel et Viellart rédige un
projet de Code criminel, correctionnel et de police,
comprenant deux parties : une partie consacrée aux
délits et aux peines et une partie sur la procédure.
Après envoi du projet pour observations aux tribu-
naux de l’Empire, une discussion devant le Conseil
d’Etat et devant les assemblées (Tribunat et Corps
législatif), le Code d’instruction criminelle de 1808 et
le Code pénal de 1810 sont adoptés.
Des changements plus ou moins importants
apparaissent à divers niveaux de la procédure cri-
minelle. Durant la phase d’instruction, il y a dispari-
tion du jury d’accusation et apparition de la
Chambre des mises en accusation : le droit d’accu-
sation est rendu à des magistrats comme sous
l’Ancien Régime. Les témoins sont dorénavant
entendus séparément et hors la présence du préve-
nu ; ils ne comparaissent plus devant le jury d‘accu-
sation qui n’entend plus la partie plaignante. Il y a
restauration du Ministère public en la personne du
Commissaire du gouvernement, futur Procureur. Ce
dernier est assisté de substituts établis dans
chaque arrondissement ; ils deviennent les véri-
tables chefs de la police judiciaire. Le Procureur
général peut être concurrencé par le préfet investi
du pouvoir de faire constater les infractions et d’or-
donner perquisitions et arrestations. Il y a sépara-
tion des fonctions de poursuite et d’instruction.
C’est à un magistrat du siège, un «juge d’instruc-
tion», nommé pour trois ans, qu’est confiée l’ins-
truction préparatoire. Cette instruction est secrète et
écrite et l’inculpé ne peut pas se faire assister par
un conseil.
Durant la phase de jugement, le jury de juge-
ment est conservé in extremis : beaucoup de tribu-
naux, des conseillers d’Etat et Napoléon lui-même
voulaient pourtant le voir disparaître. Les jurés,
sélectionnés par le préfet, mais que l’accusé peut
dans certaines limites récuser, rendent leur verdict
selon leur conscience. Ils se prononcent à la simple
majorité sur une seule question. Les débats restent
publics, oraux — même si l’écrit a une plus grande
place qu’en 1791 — et contradictoires ; l’accusé est
défendu par un conseil. Enfin, il y a reconstitution du
Ministère public en la personne du Procureur.
Des juridictions d’exception font également
leur réapparition. Des tribunaux criminels spéciaux
sont institués par la loi du 18 pluviôse an IX et sont
chargés de juger, sans jury, les vagabonds, les
auteurs de brigandage, de vols sur les chemins,
etc. Des Cours prévôtales sont mises en place par
la loi du 20 décembre 1815 ; ces cours composées
uniquement de magistrats — un militaire et quatre
c i v i l s — sont chargées de juger les crimes de
rébellion armée, de réunion séditieuse, d’écrits et
de discours séditieux, les assassinats et vols avec
port d’armes ou violences, commis sur les grands
chemins, les vols commis par des militaires en
activité. [C.G.]
Les nouveautés du
Code d’instruction criminelle de 1808
Maître Escoffier plaidant, dessin à l’encre (A.M. de
Douai, 13 II 1).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%