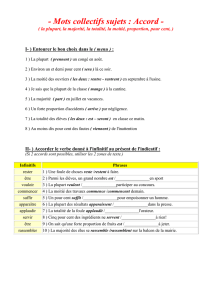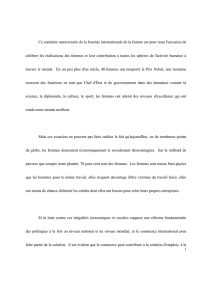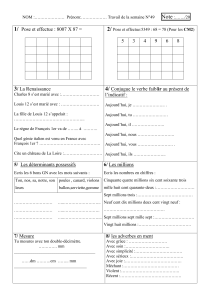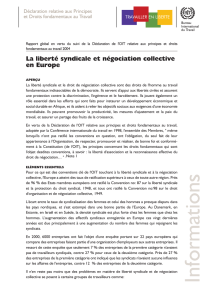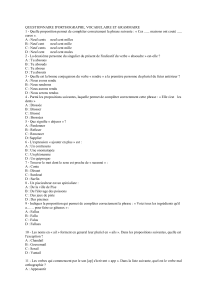Les stratégies syndicales face aux systèmes mondiaux de

Les stratégies syndicales
face aux systèmes
mondiaux de production
BUREAU INTERNATONAL DU TRAVAIL, GENÈVE

Mis en pages en Suisse WEI
Imprimé en Suisse GEN
Copyright © Organisation internationale du Travail 2009
Première édition 2009
Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit dauteur
en vertu du protocole n 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit dau-
teur. Toutefois, de courts passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que
leur source soit dûment mentionnée. Toute demande dautorisation de reproduction ou de tra-
duction devra être envoyée à ladresse suivante: Publications du BIT (Droits et licences), Bureau
international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel: pubdroit@ilo.org. Ces
demandes seront toujours les bienvenues.
Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès dun organisme de gestion des
droits de reproduction ne peuvent faire des copies quen accord avec les conditions et droits qui
leur ont été octroyés. Visitez le site www.ifrro.org an de trouver lorganisme responsable de la
gestion des droits de reproduction dans votre pays.
Journal international de recherche syndicale
Genève, Bureau international du Travail, 2009
syndicat / syndicat international / rôle du syndicat
13.06.3
ISBN 978-92-2-222309-1
Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des
Nations Unies, et la présentation des données qui y gurent nimpliquent de la part du Bureau
international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays,
zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
Les articles, études et autres textes signés nengagent que leurs auteurs et leur publication ne
signie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé
commercial nimplique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favo-
rable ou défavorable.
Les publications et les produits éléctroniques du Bureau international du Travail peuvent être
obtenus dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se
les procurer directement, de même quun catalogue ou une liste des nouvelles publications, à
ladresse suivante: Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22,
Suisse, ou par courriel: pubvente@ilo.org.
Visitez notre site Web: www.ilo.org/publns.
Données de catalogage du BIT

Table des matières
Avant-propos
Editorial
Pas de temps mort dans les aaires? Gérer la chaîne de production
danslevêtement après l’abolition de l’AMF. Le cas du Cambodge
Alimenter les marchés nanciers: Les entreprises agroalimentaires
etla nanciarisation des systèmes mondiaux de production
Industrie forestière. Les chaînes mondiales de production sont-elles
compatibles avec un développement durable?
Attirer à tout prix les investissements étrangers? Le cas des zones anches
d’exportation (ZFE) et de Ramatex en Namibie
Repenser l’action dans l’électronique
Organiser les ghettos high-tech de la mondialisation


Je suis heureux de vous présenter le premier numéro de la nouvelle Revue
internationale de recherche syndicale dACTRAV. Cette revue vise à
donner une vision densemble des récentes recherches sur les politiques du
travail et sociales menées dans le monde par les experts syndicaux et les uni-
versitaires. La Revue internationale de recherche syndicale est multidiscipli-
naire. Elle sadresse aux experts syndicaux, aux ministres du travail et aux
chercheurs du monde entier spécialisés dans toutes les disciplines correspon-
dantes – relations du travail, sociologie, droit, économie et sciences politiques.
Chaque numéro de la revue se centrera sur un thème spécique. La revue est
publiée en versions anglaise, française et espagnole.
Les personnes abonnées à Education ouvrière recevront cette nouvelle
revue. Education ouvrière continuera à être publiée et paraîtra une fois par
an. Cette publication sattachera à examiner les tendances et les stratégies en
matière déducation ouvrière. Elle sappuiera sur les connaissances des spécia-
listes de léducation ouvrière dACTRAV et sera publiée par le Programme
des activités pour les travailleurs du Centre de Turin.
Le lancement de la Revue internationale de recherche syndicale sappuie
sur une étude menée en - auprès des lecteurs dEducation ouvrière, qui
a révélé un réel intérêt pour une publication centrée sur léducation ouvrière
et la recherche.
Jespère que cette revue vous sera utile pour votre travail et jattends de
recevoir bientôt votre avis.
Avant-propos
Directeur
du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
1
/
108
100%