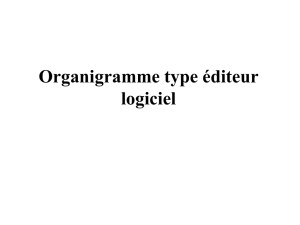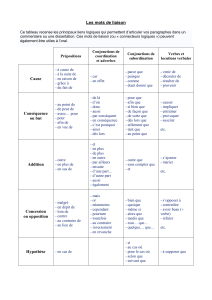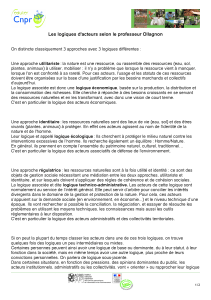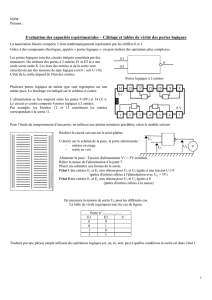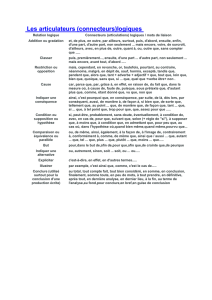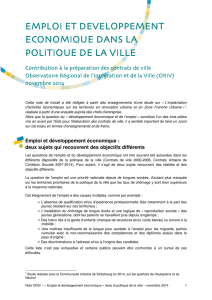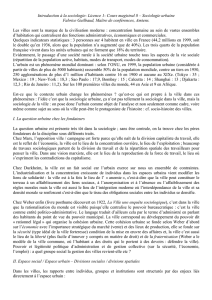Les acteurs publics et privés de la régulation urbaine se trouvent

Les acteurs publics et privés de la régulation urbaine se trouvent confontés à une
situation difficile qui tient tant aux évolutions urbaines elles-mêmes qu’aux
bouleversements récents des modalités de gestion des villes. Des phénomènes très
divers se conjuguent: explosion de la mobilité (sous toutes ses formes);
déréglementation desréseaux de servicespublics ; multiplication et "déhiérarchisation"
des acteurs; phénomènes d’exclusion socialeet spatiale...
L’espace urbain est marqué depuis longtemps par de multiples formes de
différenciation interne. Mais
il
semble bien que
l’on
observe une radicalisation de ces
processus, et que l’on puisse désormais parler d’éclatement urbain : les écarts se
creusent dramatiquement, au sein des agglomérations, entre des espaces qui
concentrent richesses et développement et d’autres pris dans des spirales de
dévalorisation ; plus encore, les dynamiques d’évolution de ces espaces semblent de
plusen plus dissociées les unes des autres.
Comment faire face à ces problèmes ?D’un coté,
il
semble souvent illusoire d’attendre
du développement des pôles dynamiques d’une ville des effets d’entraînement
spontanés sur les espaces dévalorisés ; d’un autre côté, des mesures trop particulières
en faveur de ces derniers risquent de renforcer lesprocessus d’éclatement urbain, alors
même que les démarches et les instruments traditionnels sont inefficaces dans ces
espaces dévalorisés. Ces difficultés ont suscité, au cours de la période récente,
l’émergence de pratiques et de politiques novatrices. Mais, en dépit de ces apports, les
acteurs de
la
ville sont aujourd’hui déstabilisés.
On assiste à l’émergence de logiques d’action
"à
géométrie territoriale variable", qui
correspondent à
la
multiplication des intervenants et des échelles spatiales, et qui sont
favorisées par la reconfiguration des rapports central/local et publics/privés. Ces
évolutions entraînent plus de souplesse, maisaussi
le
brouillage ou même
la
perte de
références communes susceptibles de guider l’action publique.
Dans ce contexte,
le
renouvellement des logiques et des modalités des systèmes de
régulation est un enjeu-clef non seulement pour l’avenir des villesmais aussi pour celui
de la société dans son ensemble. Ce renouvellement suppose une clarification des
référents fondée sur une meilleure compréhension des nouveaux processus en cours.
C’est pourquoi
la
DAEI et
la
DRAST ont décidé d’organiser un séminaire dans cette
perspective. Leur objectif est de susciter,ou de favoriser, une réflexion prospective sur
les modalités et les systèmes de régulation économique, sociale et territoriale mieux à
même de freiner ou d’enrayer lesprocessus d’éclatement urbain.
Ce séminaire s’adresse de façon privilégiée aux divers intervenants, centraux et locaux,
publics et privés, de
la
régulation urbaine.
La
réflexion sera menée à travers un
dialogue associant ces intervenants et des chercheurs travaillant sur ces questions.
Il
comprendra huit séances thématiques,
la
réflexion étant alimentée, pour chacune de
ces séances, par le jeu croisé de différents regards: apports, réflexions et
questionnements émanant des acteurs de la régulation urbaine; informations
provenant de travaux de terrain ou d’études de cas; éclairages plus distanciés et/ou
synthétiques de la part de chercheurs; analyses de situations observées dans d’autres
pays développés.
2
La documentation Française : La Ville éclatée : enjeux, logiques et modalités d’une régulation économique...

PRÉSENTATION DES
DIFFÉRENTES SÉANCES
3
La documentation Française : La Ville éclatée : enjeux, logiques et modalités d’une régulation économique...

programme
28
septembre 1995
Eclatement
urbain :
quels
référentiels
et
quels
enjeux
pour larégulationurbaine ?
9
novembre
1995
Del’équipement aux services :
la
régulation
face à
l’essor
des
logiquesde
réseaux
18 janvier
1996
Les
niveaux
territoriaux
de
la régulation :
questions posées parl’action à "géométrie
variable"
8
février
1996
Ville
à péage, ville éclatée ?
Usagers, bénéficiaires,
contribuables et solidarités
financières dans la
ville.
21
mars 1996
Nouvelles
formes
d’emploi
et
remise
en
cause du
rapport
salarial :
comment faire face
aux
précarisations
sociales
dans
les
espaces urbains ?
11
avril
1996
Agir
en
temps
réel
et
assurer
la
continuité de
l’action :
les
temporalités
de
la régulation urbaine
23
mai
1996
Egalité
ou équité :
Philosophie de
l’action
pour enrayer
les
processus d’éclatement
20 juin 1996
La
gouvemance urbaine :
frontières et partenariats publics/privés
La documentation Française : La Ville éclatée : enjeux, logiques et modalités d’une régulation économique...

La
ville éclatée
1 -
28
septembre
1995
éclatementurbain:
quels
référentiels
et
quels
enjeux
pourla
régulation
urbaine?
Cette première séance permettra de préciser
le
champ de
la
réflexion collective.
L’existence
de différenciations et de ségrégations au sein de
l’espace
urbain est un phénomène
ancien.
L’usage
de
la
notion d’éclatement urbain semble faire référence
à
un processus nouveau
par sa nature, son ampleur, et par
le
fait
qu’il
constitue aujourd’hui un enjeu central des
politiques de régulation urbaine.
Au
cours de
la
séance, nous ferons
le
point sur
les
évolutions qui ont marqué ces trente demières
années.
.
Comment ont évolué, au cours de cette période,
les
différenciations intra-urbaines et
les
référentiels permettant d’en rendre compte ?
.
Comment l’action publique s’est-elle saisie de cette notion ? Quand et comment l’a-t-elle
érigée en problème, et en a-t-elle fait un enjeu central des politiques de régulation ?
.
La
notion d’éclatement correspond-elle à une rupture par rapport à des phénomènes plus
anciens ?
Si
oui, comment cette rupture est-elle qualifiée ?
.
Comment
la
notion d’éclatement urbain vient-elle réinterroger
les
enjeux et les modalités de
la
régulation urbaine, et de quelle manière ?
Les
débats seront organisés autour des témoignages d’acteurs de
la
régulation urbaine, de
chercheurs et d’observateurs.
L’organisation de
la
séance est assurée par Edmond Preteceille (Centre de Sociologie Urbaine,
CNRS, IRESCO, Paris).
La documentation Française : La Ville éclatée : enjeux, logiques et modalités d’une régulation économique...

La
ville
éclatée
2 -
9
novembre 1995
la régulation
face
à l’essor des logiques de réseau
Au cours de
la
dernière décennie, divers facteurs,d’ailleurs interdépendants, ont bouleversé
le
contexte technologique, socio-économique et institutionnel dans lequel s’opère
la
régulation
des réseaux techniques.
En premier lieu,
la
déréglementation tend à dessaisir
la
puissance publique de certains
instruments de contrôle et d’intervention ; dans
le
même temps,elleinflue sur
le
comportement
des entreprises de réseau, en
les
amenant à accorder un poids plus important au critère
économique de profit.
Deuxièmement, des
réformes
institutionnelles de fond ont été menées dans divers pays
européens, dont
la
France. Ces réformes ont poursuivi des objectifs très différents. Ainsi,
la
décentralisation en France a accru les prérogatives des maires en matière de régulation
économique (et notamment pour l’ensemble des secteurs de réseau), alors que la réforme
réglementaire anglaise a privilégié
la
constitution d’instances de réglementation nationales
et indépendantes de
la
représentation politique.
La
construction de l’Union européenne participe également à
la
reconfiguration des
architectures institutionnelles.
En
troisième lieu,
la
"mise
en
réseau"
des
territoires
s’accentue.
Les
réseaux d’entreprise
modifient en profondeur
les
modèles d’organisation industrielle, et
le
sort des villes est de
plus en plus sensiblement
lié
à leur position dans
les
systèmes urbains. Réseaux d’entreprises
et "réseaux de villes" s’appuient de façon importante sur
les
réseaux de transports et de
télécommunications, notamment.
Les
relations entre entreprises (inter)nationales et
collectivités publiques territoriales revêtent dès lors une importance considérable.
A
l’intérieur même des villes, cette mise en réseau est potentiellement porteuse de ségrégations
spatiales.
Enfin,
la
diversification
des
entreprises
de réseau, accélérée par
la
déréglementation, conduit
à
la
disparition progressive de
la
distinction traditionnelle entre grands réseaux et
entreprises de services urbains.
Les implications de ces évolutions en termes de régulation de
la
"ville éclatée" sont
nombreuses
et
complexes.
.
La
régulation des services de réseau implique désormais des acteurs nombreux - locaux ou
nationaux (voire internationaux), privés ou publics - et met en
jeu
des rationalités et des
référents multiples. Dans
la
redistribution des rôles entre acteurs traditionnels et acteurs
nouveaux de
la
régulation des réseaux, quelles sont
les
modalités de gestion des disparités
économiques, sociales et territoriales ?
.
Quel peut être
le
rôle (ou
les
rôles) des entreprises de réseau dans
la
gestion de
la
"ville
éclatée" ?
La documentation Française : La Ville éclatée : enjeux, logiques et modalités d’une régulation économique...
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
1
/
161
100%