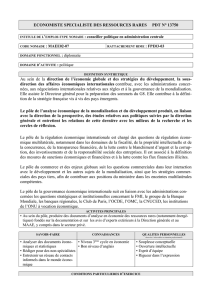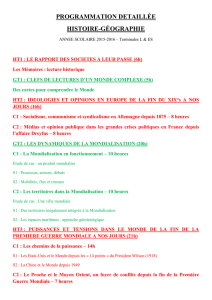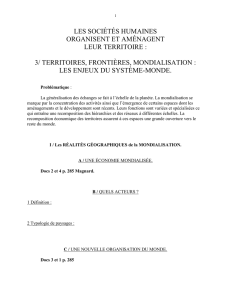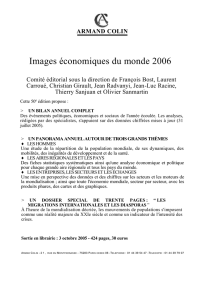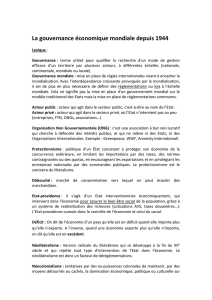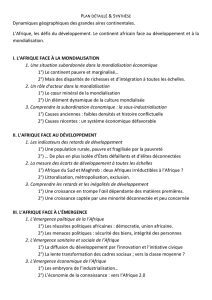Notes de lecture - Mon Petit Coin du Web: Accueil

Décoloniser l'imaginaire
La pensée créative contre l'économie de l'absurde
Serge Latouche, Editions Parangon, 2003
(Ce qui suit sont mes notes de lecture de l'ouvrage mentionné en en-tête. Elles sont forcément
biaisées par ma vision et mon interprétation des propos de Serge Latouche. Elles contiennent aussi
parfois mes réflexions personnelles. Ne les prenez donc pas comme un résumé précis du livre, ni
comme un écrit direct de Serge Latouche. Certaines phrases sont citées de Latouche in extenso,
d'autres sont des citations d'autres auteurs utilisées par Latouche, la plupart constitue ma propre
reformulation.)
Chapitre 1: La tyrannie de la rationalité
Le problème de l'économie actuelle n'est pas la mondialisation en soi (le commerce est mondial
depuis longtemps), mais la marchandisation globale, c'est-à-dire le fait que tout est à vendre et à
acheter, y compris le vivant, voire même les ressources fondamentales du monde dans lequel nous
vivons (l'eau, par exemple).
On peut retracer l'émergence du modèle économique actuel à Adam Smith, qui postula la séparation
de la sphère privée et de la sphère économique. Cette dernière était, selon Smith, forcément
vertueuse par le biais de la "main invisible", c'est-à-dire la redistribution des richesses. Ainsi,
l'économie ne peut jamais être immorale.
Par ailleurs, aux XIXe siècle, les économistes affirment que les ressources naturelles sont
remplaçables par le travail et le capital. Il n'y a donc pas besoin de s'en soucier. On aboutit ainsi à
une économie déconnectée des ressources naturelles. Cette notion des hommes séparés de la nature
est renforcée par la vision cartésienne de Francis Bacon:
"La nature est une femme publique; nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon
nos désirs."
Avec les Lumières, la raison prédomine. Descartes veut créer une philosophie mathématiquement
démontrable. Or, pour les Grecs, la raison prenait deux voies: la rationalité et la sagesse (ou le
raisonnable). Le capitalisme s'appuie sur un droit rationnel, sans mystique ni tradition. Ainsi, tout
devient calculable. On réduit le bonheur au plaisir, le plaisir aux besoins matériels et le besoin à la
quantité consommée.
La rationalité uniformise les goûts pour vendre le meilleur produit, mais il ne s'agit que d'un
message publicitaire. Il n'y a pas de réflexion sur le pourquoi du meilleur.
La disparition de la religion et des traditions laisse un vide, car tout n'est pas rationnel. L'homme a
besoin de retrouver une foi, mais pas une religion.
Chapitre 2: La banalité du mal et l'économie
Les sociétés industrielles deviennent des mégamachines où l'homme n'est plus qu'un rouage.

Certaines mégamachines, comme le socialisme soviétique, se sont effondrées, mais l'économie de
marché en établit une forme plus stable, plus insidieuse. Et sans objectifs: l'homme n'est qui rouage
qui fabrique d'autres rouages.
La fin des régulations nationales représente la disparition des derniers vestiges de l'esprit
communautaire. L'économie, émancipée de toute règle, se développe pour elle-même. Le social a
été vidé de toute substance.
Les progrès techniques permettent de produire toujours plus vite. La science peut mesure des
intervalles de temps de plus en plus courts. Le rythme de la société entière s'accélère. Nous vivons
en permanence dans l'urgence.
Les prémisses de la mondialisation remontent aux XIIe-XIIIe siècles, quand les grandes foires
étaient déjà internationales. La mondialisation s'est affirmée avec la découverte des Amériques et de
la rotondité de la Terre. On est passé désormais à la vitesse supérieure. Plutôt que de
"globalisation", qui peut laisser entendre des effets positifs, il vaut mieux parler de
"marchandisation". C'est un processus de domination et d'exploitation à l'échelle planétaire. Ses
visages sont le G8, le FMI, la Banque Mondiale, mais aussi diverses entités supranationales de
régulation (faible) et de normalisation (souhaitable pour les marchés globaux). Dans l'inconscient
collectif, alimenté par les discours politiques, le phénomène est généralement considéré comme
inéluctable.
La finance prédomine. Les états-nations se sont ruinés en titrisant leur dette. D'un bout à l'autre du
globe, les marchés financiers ne dorment jamais. Les sommes échangées quotidiennement sur ces
marchés sont très largement supérieures à la valeur globale de l'économie réelle. Le risque de bulle
spéculative (donc d'éclatement de cette dernière et de crise) est permanent.
On nous fait croire que la liberté est celle des marchés, que le bonheur vient de pouvoir tout vendre
et tout acheter.
Il ne s'agit pas de prôner le retour à l'âge de la pierre. Certaines avancées technologiques actuelles
n'ont rien à envier aux révolutions que furent le feu ou la roue. Par contre, ces technologies sont
maintenant développées par des entreprises dont le seul but est le profit, ou par des bureaucraties
qui ne recherchent qu'une efficacité sans âme.
Chapitre 3: L'hydre du développement
Le développement est avant tout celui de l'Occident. Il est centré sur l'économie. Il charrie les
valeurs de progrès, d'universalisme et de rationalisme. Le reste du monde a été converti par la
colonisation ou par le marketing.
La voie royale pour parvenir aux délices de l'Occident est l'industrialisation. Cette dernière détruit
les forces économiques antérieures, entraînant avec elles les croyances et les mythes fondateurs. Ne
reste plus qu'à remplir ce vide avec le crédo consumériste occidental. La plupart des tentatives
d'industrialisation échouent. On ne devient pas une société technicienne du jour au lendemain.
L'industrialisation est accompagnée par l'urbanisation, qui ne mène généralement qu'à plus de
pauvreté et de violence.
L'état du tiers-monde est souvent "nationalitaire" (contraction de nationaliste et totalitaire). Il n'est

pas le fruit d'une maturation historique et doit s'inventer une identité. Il est généralement le résultat
de la décolonisation.
Le développement, tel qu'il est conçu actuellement, ne peut pas être durable, car il implique une
croissance continue et s'appuie sur une économie déconnectée des ressources naturelles (voir
chapitre 1). Le PNB est la seule mesure reconnue, qui inclut toutes les productions et toutes les
dépenses, y compris celles qui sont nuisibles. Les tentatives de prendre en compte les coûts
environnementaux débouchent généralement sur une réduction du PNB plutôt qu'un accroissement.
Chaque culture a une vision de comment elle aimerait vivre, sa "civilisation". C'est cela dont nous
avons besoin et non de développement, fut-il durable.
Chapitre 4: La Machine infernale
Nous sommes tous des chercheurs d'or, désirant la satisfaction au meilleur prix. Le coût
environnemental n'entre pas en ligne de compte (si ce n'est un vague début de prise en compte sous
forme de coûts externes, telle l'énergie grise).
L'hégémonie de la société de consommation lamine la diversité culturelle de par le monde. Le vide
qui en résulte peut se traduire par des mouvements nationalistes, ethnocentriques, qui fleurissent de
partout.
Les gouvernements nationaux en sont réduits à l'état de préfectures par rapport à l'autorité
transnationale du jeu capitaliste. Les droits de l'homme ne peuvent pas se développer dans la
misère. Le morcellement des états sous les poussées "particularistes" rappelle le régime féodal.
Les élus sont otages du système, la politique est vidée de sens. Les gens renâclent à payer des
impôts, car l'Etat semble impuissant. Au final, c'est le social qui en pâtit. Il est privatisé, ce qui a un
impact négatif sur les plus pauvres.
L'employé n'étant plus qu'un rouage de la machine de production, il n'a plus l'énergie à consacrer à
autre chose. En particulier, à être un citoyen. La démocratie s'en trouve affectée.
L'humain reste le grain de sable dans la machine, il reste capable de lutter contre le système.
Malheureusement, il faut généralement des catastrophes pour déclencher un changement. Nous
devons lutter contre le système, mais aussi contre nous-mêmes, car notre imaginaire est colonisé par
la société de consommation.
Chapitre 5: La mondialisation et l'impérialisme de l'économie
L'économie est devenu le visage de la rationalité. Chacun se définit avant tout en termes
économiques, quelque soit sa position: salaire perçu, impôts payés, subventions reçues, etc.
La mondialisation exacerbe la concurrence. Elle pousse les pays du Nord à manipuler la nature de
façon incontrôlée et ceux du Sud à épuiser leurs ressources non renouvelables.
Le FMI, la Banque Mondiale et l'OMC sont les instruments de la pénétration du néo-libéralisme
dans les pays sous-développés. Leurs stratégies ne mènent qu'à plus de misère et d'exploitation.

Comme l'a si joliment dit Helmut Kohl:
"La morale est une chose, les affaires en sont une autre."
La transnationalisation de l'économie la détache des territoires. Les nations perdent ainsi leur
souveraineté économique et subissent la loi des marchés mondiaux et des entreprises
multinationales. Ceci induit aussi la dépolitisation des citoyens mentionnée précédemment.
Dans l'imaginaire de l'économie de marché, le triomphe de cette dernière aurait dû nous mener à
une ère de paix et de prospérité. Or, la discorde, la misère et l'exclusion vont croissantes. Il faut se
débarrasser de l'illusion qu'il existerait un "bon" universalisme qui s'opposerait à la "mauvaise"
mondialisation. La mondialisation a mené à la destruction des cultures locales, qui reviennent,
perverties, sous forme d'intégrisme et de repli sur soi. Le bon universalisme est un mirage
ethnocentrique occidental. On voit bien que la démocratie, les doits de l'homme et autres valeurs
des Lumières ne suivent pas dans le sillage de la mondialisation.
La mondialisation entraîne une guerre économique permanente, amplifiée par chaque progrès
technologique. Une guerre avec peu de vainqueurs, transformés en héros par les médias. Cette
chance de réussite, infime mais non nulle, entretient le mythe et continue ainsi à faire tourner la
mégamachine. La culture de la performance contient inévitablement une culture de l'échec. Une
culture doit normalement contribuer à bâtir une société. Au contraire, la culture de la mondialisation
entraîne une destruction de la société, de par les inégalités qu'elle engendre en masse.
La génération des Trente Glorieuses a connu un âge d'or. Hélas, cela s'est fait au prix d'une
domination de l'Occident sur le reste du monde et d'un massacre écologique. La gueule de bois est
là au réveil. Le marché a continué à s'imposer et à miner les Etats qui ne sont plus des contre-
pouvoirs.
Les structures alternatives (coopératives autogérées, communautés néo-rurales, SEL, etc.) sont
intéressantes comme forme de résistance à la marchandisation. Mais le danger est qu'elles
deviennent une niche, dans le sens écologique d'une structure qui évolue au sein d'un milieu
(hostile).
Au lieu de se battre pour conserver son créneau dans le marché, il faudrait définir cette niche, pour
pouvoir la protéger, la renforcer et la développer. Réussir à imposer des produits équitables dans les
supermarchés, par exemple, ne constitue pas un bon objectif. Il vaudrait mieux s'assurer du
caractère équitable de toute la filière, du producteur au consommateur. Ceci exclut d'emblée le
supermarché, mais élargit le champ d'effet de la rechercher d'équité.
Les relations entre toutes ces initiatives doivent être renforcées afin de créer un véritable tissu.
Atteindre une cohérence permettrait de propose une vraie alternative au système dominant. Il s'agit
de coordonner la protestation sociale avec la protestation écologique, avec la solidarité envers les
exclus du Nord et du Sud, avec toutes les initiatives associatives pour articuler résistance et
dissidence, et pour déboucher à terme sur une société autonome.

Chapitre 6: L'autre Afrique et la culture du don
L'Afrique semble être un continent en échec. Mais ce n'est que son occidentalisation qui a échoué.
Les Africains ont une forte vie sociale, qui permet de s'entraider et de survivre hors de la logique du
marché. C'est un peu comme une famille, très étendue. Ces "familles" se structurent souvent autour
d'un clan, d'une ethnie, d'une religion.
La mémoire est très importante dans ces familles. Il faut connaître tout le monde et savoir surtout à
qui l'on est redevable. Il y a des endroits en Afrique où l'activité économique est officiellement
quasi-nulle, mais où se passent pourtant beaucoup de production et de transactions.
La pauvreté n'est pas de manquer d'argent, mais de ne connaître personne.
Sans forcément travailler, les gens passent beaucoup de temps à se rencontrer, discuter, échanger,
bref entretenir leur réseau. Les fêtes peuvent paraître disproportionnées par rapport aux moyens
économiques, mais elles sont essentielles au réseau.
L'argent est très concret en Afrique, pas des chèques ou des cartes de crédit. Il est facilement mis en
commun dans les tontines, car chacun sait que lui-même peut en bénéficier à tout moment. Il y a
une grande responsabilité, car personne ne veut dilapider l'argent de la tontine. Tout le monde se
connaît. Ce n'est pas comme un prêt provenant d'une entité étrangère comme une banque (ni même
le micro-crédit).
Ce genre de relation a été qualifié d'économie informelle, mais c'est très réducteur de considérer
cela d'un point de vue uniquement économique. L'aspect social est plus important, d'où l'échec des
programmes d'ONG, de la Banque Mondiale ou du FMI tentant de transformer tous ces petits
artisans en entrepreneurs. Leur but n'est pas de maximiser leurs gains, mais de vivre et survivre, et
d'être utiles à leur réseau. Toute cette activité est organisée par les femmes.
On est dans une logique de don. Il faut savoir donner, recevoir et rendre, sans considération directe
de la valeur marchande, ni échange monétaire. Dans cette culture du don, le lien remplace le bien
(note personnelle: on retrouve cette philosophie dans l'open source). Les méfaits des rapports
marchands s'en trouvent minimisés, assurant une garantie minimale contre l'exclusion économique
et sociale.
Une étude de 1992 au Canada, évalue l'importance du travail non rémunéré à 34% du PIB.
Ces échanges peuvent être structurés dans les SEL, où l'aspect relationnel est aussi important. Par
contre, en Occident, il faut quantifier, contrairement à la culture d'entraide des sociétés
vernaculaires. La pression sociale décourage les abus. Nous redécouvrons ce qui est au coeur des
réseaux informels africains. Les SEL encouragent l'économie locale.
La théorie du libre marché veut que tout produit tende vers le prix juste. On voit que ce n'est pas
forcément le prix juste d'un point de vue social, car certains travailleurs ne sont pas rémunérés
suffisamment. La charité est censée y pallier. Elle est encouragée sous les régimes néo-libéraux
pour faciliter le démantèlement de l'état social.
Un problème des SEL est la détermination de la valeur du travail selon les qualifications de chacun.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%