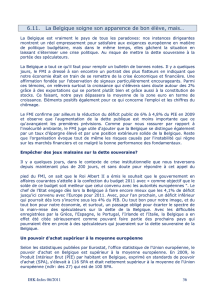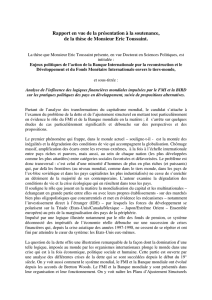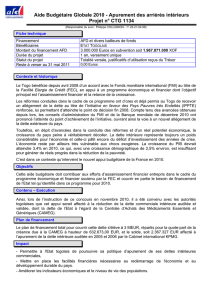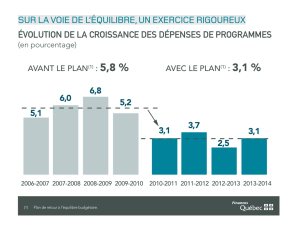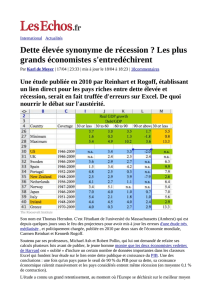topo sur la dette argentine

Topo de Sylvain Chardon sur :
Le cas Argentin de la dette
- La Dictature et la constitution de la dette (1976-1982),
- La démocratie victime de la dette et l’hyperinflation (1985-1990),
- L’Argentine étranglée par le libéralisme et le FMI (1991-2001),
- La crise révolutionnaire de 2001 et la cessation de paiement de la dette,
- L’Argentine, en définitive, accepte de rembourser 35% du solde de sa dette en 2005 ; 25%
ayant été annulé.
En introduction, je dirai que l’exemple argentin nous dicte cette règle:
-La dette n’est pas qu’un phénomène économique, elle résulte surtout de l’expression d’un rapport
de forces entre les classes à une période!
1. GRECE et ARGENTINE : Ressemblances et
dissemblances.
La dette de l’Argentine pesait 150% du
Produit Intérieur Brut en 2001 (180 milliards de
$), le déficit budgétaire était de 15% en 2001,
l’Etat était en miettes et ne pouvait plus prélever
les impôts mais les USA, le FMI, après avoir fait
privatiser même les bijoux des grands-mères
argentines insistaient toujours plus pour que
l’Argentine honore ses créances ! Nous parlerons
plus tard de l’explosion sociale qui en résulta.
La dette de la Grèce pèse aujourd’hui environ
120% du PIB (300 milliards de $), son déficit
budgétaire est de 13%, l’Etat ne fonctionne plus et
ne peut plus prélever l’impôt.
La Grèce comme l’Argentine à l’époque ont
subi les diktats du FMI et des grandes banques
internationales.
Comme en Argentine, les investisseurs
institutionnels ont trafiqué les comptes. La banque
d’investissement Goldman Sachs au premier plan
en Grèce.
Les ressemblances sont donc fortes mais les
dissemblances aussi. L’Argentine (heureusement
pour elle in fine) était seule et n’avait pas de
prêteur comme peut l’être l’Europe pour la Grèce.
L’Argentine dispose de ressources naturelles
importantes pas la Grèce. L’Argentine est forte
d’un puissant mouvement ouvrier anticapitaliste
pas la Grèce.
Ces 3 facteurs sont essentiels pour comprendre
les enchaînements politico-économiques.
2. La constitution frauduleuse de la dette
argentine.
La crise de la dette argentine a pour origine un
mécanisme de dilapidation et de détournements de
fonds organisé par la Dictature militaire
génocidaire en alliance avec le FMI, les banques
et la Fédéral Réserve américaine.
En 1976, la dictature s’installe. Le pays est peu
endetté et sa croissance est importante. En 1983, à
la chute de la Dictature, la dette représente 60 %
du PIB. Une partie des prêts bancaires octroyés à
l’Argentine auront profité à de grands groupes
privés soutenant la dictature ou n’auront jamais
transité par le pays mais auront été directement
détournés par les banques dans des paradis fiscaux
au nom de sociétés écrans.
Ce scandale qui n’est pas spécifique à
l’Argentine aura au moins été mis à découvert
publiquement. La Cour Fédérale de Justice
Argentine aura déclarée la dette illégitime et ses
principaux responsables militaires et civils jetés
en prison lors de la crise révolutionnaire de 1983,
relaxés par Menem puis remis en prison après la
crise révolutionnaire de 2001.

3. La dette contre la démocratie.
Après la chute des militaires et grâce à la
mobilisation révolutionnaire des travailleurs, une
assemblée est élue et un gouvernement de centre-
gauche dirigé par Alfonsin s’installe. Le service
de la dette et la corruption généralisée
l’empêchera de gouverner.
A l’époque, seuls les révolutionnaires du
Movimiento AL Socialismo (MAS) mettent au
centre de leur politique l’annulation de la dette. Le
Peso argentin est remplacé par l’Austral mais rien
n’y fait l’inflation approche les 5.000 % en 1989.
Le péroniste Menem succède à Alfonsin en
1989. Rapidement surnommé « La grenouille »,
Menem va appliquer les recettes de
l’ultralibéralisme dès 1990. Il va privatiser toutes
les entreprises publiques même celles qui assurent
une véritable rente à l’Etat comme le pétrole. Ils
lèvent toutes les taxes qui protégeaient l’industrie
locale et réinstaure le peso mais lié au dollar
américain (1 peso = 1 dollar) par un système de
convertibilité garanti par l’état argentin via les
réserves de la Banque Centrale Argentine.
4. L’Argentine étranglée par la dette, le
libéralisme et le FMI (1991-2001),
Ces réformes ont raison de l’inflation et attirent
des investisseurs étrangers qui rachètent les
entreprises nationales et qui grâce à la
convertibilité du peso peuvent rapatrier des
bénéfices mirobolants. Des économistes peu
regardant parleront de miracle argentin.
La réalité est tout autre. L’industrie argentine
connaît une récession importante, les exportations
agro-alimentaires souffrent du taux de change. Le
déficit budgétaire se creuse, le service de la dette
augmente chaque année. Il est multiplié par 3. (25
milliards en 1995. Les multinationales rapatrient
leurs bénéfices et n’investissent pas dans le pays,
les riches argentins sous le conseil des américains
pratiquent l’évasion fiscale et ne payent plus leurs
impôts. Les populations pauvres doivent payer
pour les riches et la TVA passe de 14 à 21%.
Dans le même temps éclate la crise asiatique.
Le Brésil, premier importateur des produits
argentins (30%) entre en crise. En 1999, plus d’un
argentin sur 3 vit en dessous le seuil de pauvreté.
Un gouvernement de centre-gauche dirigé par
De La Rua succède à Menem. Il ne prend aucune
mesure et continue à tenter de maintenir le lien
fixe entre dollar et peso. Il épuise les dernières
réserves de la Banque Centrale mais le FMI
continue à encourager cette politique suicidaire en
accordant des lignes de crédit à condition que le
gouvernement baisse les salaires des
fonctionnaires et annule la sécurité sociale.
En raison de la convertibilité peso-dollar qui ne
favorise que les multinationales, l’économie
connaît un déficit toujours plus grand le poids de
la dette est toujours plus lourd. Le FMI et la
Fédérale Reserve Américaine accentuent leur
pression. Mais la coupe est pleine pour les
travailleurs et les chômeurs argentins qui se
mobilisent sans discontinuer depuis 1996 et une
profonde crise révolutionnaire va éclater fin 2001.
5. La crise révolutionnaire de 2001 et la
cessation de paiement de la dette.
Avant d’évoquer la crise de 2001, rappelons
que:
- la dette n’est pas qu’un phénomène
économique, elle résulte surtout de l’expression
d’un rapport de forces entre les classes en une
période!
La dette a été organisée par l’impérialisme
grâce à une dictature militaire génocidaire puis,
des années plus tard, les recettes ultralibérales de
l’impérialisme ont provoqué un nouveau séisme
dans le mouvement ouvrier argentin.
En effet, les Directions des puissants syndicats
argentins soutenaient Menem et son
gouvernement ultralibéral et pour pouvoir résister
les travailleurs ont dû, à partir de 1995
essentiellement, s’affranchir de cette bureaucratie
par un triple mouvement :
- Auto-organisation des chômeurs à travers les
« piqueteros »,
- Création d’une nouvelle centrale syndicale, la

CTA (Central de los Trabajadores de Argentina,
- Remplacement des Directions gorilles des
vieux appareils syndicaux par des dirigeants plus
combattifs.
Ce ne sont donc pas les conseillers
économiques du couple Kirchner qui gouverne
l’Argentine depuis 2002 qui ont poussé à la
déclaration de cessation de paiement de la dette et
à renationaliser les secteurs clés de l’économie
mais bien la mobilisation des classes populaires.
C’est là une leçon essentielle pour la crise
actuelle. C’est la mobilisation ouvrière qui en
finira avec la dette. A cet égard, l’Argentine a
montré un moment la voie.
Mais revenons à cette crise révolutionnaire :
-Les chômeurs sont sortis de leur isolement
et se sont auto-organisés en piqueteros. Il est
impossible de faire un décompte du nombre de
barrage de routes, de manifestations spectaculaires
dans la capitale et dans toutes les provinces. Ces
piquets étaient quasi invincibles et au bord de
s’armer si la crise avait perduré,
- Les travailleurs du secteur public, les
enseignants au premier rang se sont mobilisés sans
discontinuer et ont donné l’exemple aux autres
travailleurs en créant un nouveau syndicat. Ils ont
été suivis par les cheminots, les employés de
banque etc.…
-Les travailleurs de l’industrie frappés par
des plans massifs destruction ont réussi à virer les
gorilles syndicaux et à rejoindre les mobilisations.
-Les classes moyennes paupérisées se sont
aussi massivement mobilisées auprès des salariés
et dans leurs quartiers.
Peu à peu, bien avant Facebook et Twitter, les
manifestants s’autoconvoquaient et les menaces
du FMI et du gouvernement de la mi-décembre
allaient provoquer les manifestations
révolutionnaires des 19 et 20 décembre 2001.
Le ministre de l’économie ne dut alors la vie
sauve qu’à un miracle et le président dut s’enfuir
depuis les toits de la « Casa Rosada » (l’Elysée
argentin) en hélicoptère car les manifestants
avaient réussi à envahir le palais présidentiel !
La bourgeoisie oligarchique prit peur et
s’enfuit, les travailleurs ont transformé leurs
entreprises en coopérative ouvrière.
Les travailleurs et les classes moyennes ont
également pris d’assaut les banques avec la
complicité des employés pour récupérer leur
argent bloqué en raison du Corralito (250 dollars
par semaine).
Une économie parallèle s’est rapidement mise
en place basée sur des échanges en monnaie
frappée par une ville ou un quartier.
Ceux d’en bas ne voulaient plus de ceux d’en
haut et s’en donnaient les moyens. Ceux d’en haut
ne pouvaient plus diriger.
Il s’agissait bien d’une crise révolutionnaire
classique.
Les assemblées générales étaient quotidiennes
et les questions politiques et économiques étaient
débattues sur les lieux de travail, dans tous les
quartiers avec au centre l’exigence de
l’annulation totale de la dette et le renvoi de
tous les politiciens et dirigeants d’entreprise
corrompus : « que se vayan todos » .
Cependant, il manqua à ce formidable
mouvement une coordination générale
principalement dans la capitale Buenos Aires. Une
coordination des piqueteros, des délégués
d’assemblées qui auraient construire le pouvoir
populaire et prendre un pouvoir qui était vacant et
à prendre.
La nature et les rapports de classe ayant
horreur du vide, une alternative politique se
dessina rapidement en provenance du vieil
appareil péroniste autour de Nestor Kirchner
ancien montenero (aile gauche anti-impérialiste du
péronisme dans les années 70).
Situé politiquement entre Lula le modéré et
Chavez plus radical, Kirchner fut aidé par les deux
dirigeants latino-américains. Kirchner allait
d’abord parvenir à prendre le contrôle du principal
mouvement auto-organisé: les « piqueteros » avec
une politique intelligente combinant l’assistance
concrète en aliments et argent et un certain
radicalisme.
Puis sous la pression des travailleurs, il
renationalisa des secteurs clés de l’économie et
prit le contrôle des exportations de matières
premières et de produits agro-alimentaires (le
fameux soja malheureusement transgénique).
Il gagna le cœur d’une partie des vieux
opposants (« Les mères de la playa Mayo »
notamment) en remettant en prison les militaires
de la dictature, le président corrompu Menem,
Cavallo et compagnie.
Kirchner parvint donc à se faire reconnaître et
à reconstruire l’autorité de l’état bourgeois
argentin.
La situation se normalisa dans un contexte de
mobilisation qui permit au gouvernement de
négocier dans une position de force avec ses
créanciers, FMI en tête. Moi ou la révolution,
vous devez choisir ! Par peur de tout perdre, les

financiers internationaux acceptèrent ce qu’ils
refusaient avant la crise révolutionnaire.
Certaines créances illégitimes allaient être
effacées et le reste de la dette divisé par 3.
Le peso en ne pesant plus qu’un cinquième de
dollar, certains secteurs industriels ont pu repartir,
y compris les entreprises expropriées par les
travailleurs (ex du sous-traitant de Levis).
Du côté des travailleurs, les dirigeants de la
nouvelle centrale syndicale CTA collaborèrent
directement avec le gouvernement de Nestor
Kirchner et, en échange de concessions, freinèrent
les mobilisations les plus radicales comme dans
les chemins de fer.
Dans ce syndicat, des directions indépendantes
et combattives ont à nouveau surgi sur un fond de
sensibilité anti-impérialiste très fort. Les
entreprises n’ont pas été rendues à leurs patrons et
les chômeurs sont toujours organisés.
Les braises sont donc encore chaudes et le feu
peut repartir très vite.
Nous ne sommes plus à la sortie de la dictature
militaire où plus de la moitié des dirigeants
ouvriers et intellectuels avaient été massacrée. Des
dizaines de milliers de jeunes et de syndicalistes
sont mobilisés. Reste à les organiser autour d’une
nouvelle alternative politique. Mais c’est une autre
discussion !
Sylvain Chardon
Que lire ? :
-les carnets du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde,
-les bonnes feuilles du « Monde Dipomatique »
-les bonnes feuilles des publications du MST-Proyecto Sur consultables sur Internet via Yahoo.ar
Annexe :
Rappel pour mémoire de la dette de la France :
La dette publique, « au sens de Maastricht » estimée par l'Insee, a été évaluée pour la fin du premier
trimestre 2011 à 1 646,1 milliards d'euros, 2.150 milliards de dollars soit environ 84,5 % du PIB. La
croissance de la France serait de 1% en 2011.
Le produit intérieur brut, abrégé en PIB, est un indicateur économique utilisé pour mesurer la
production dans un pays donné. Il est défini comme la valeur totale de la production de richesses (valeur
des biens et services créés - valeur des biens et services détruits ou transformés durant le processus de
production) dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents économiques résidant à
l’intérieur du territoire national. C'est aussi la mesure du revenu provenant de la production dans un pays
donné. On parle parfois de production économique annuelle ou simplement de production.
Il s'agit d'un agrégat des comptes nationaux, obtenu en additionnant des grandeurs mesurées par
catégories d’agents économiques (ménages, entreprises, administrations publiques). Afin d'éviter que la
même production entre plus d'une fois dans le calcul, ne font partie du PIB que les biens et services
finaux (c’est-à-dire la valeur ajoutée, soit les biens et services de consommation et les biens
d'équipement), les biens intermédiaires de production étant exclus. Par exemple, la farine avec laquelle
on fait le pain est exclu (car étant une consommation intermédiaire du calcul de la richesse produite par
le boulanger).
Il sert souvent d'indicateur de l'activité économique d'un pays ; le PIB par habitant, quant à lui, sert
d'indicateur du niveau de vie en donnant une valeur indicative du pouvoir d'achat. La variation du PIB
est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance économique.
Le PNB est le même indicateur mais sans annulation des échanges, il est donc moins utilisé.
1
/
4
100%