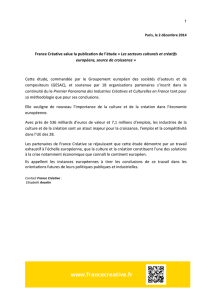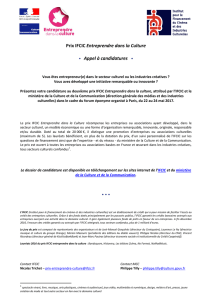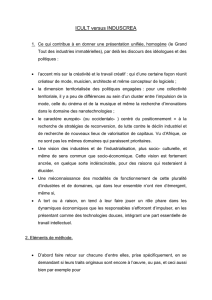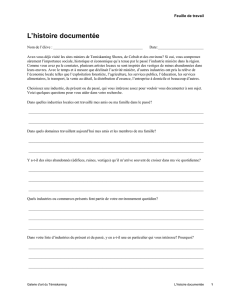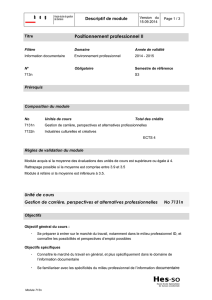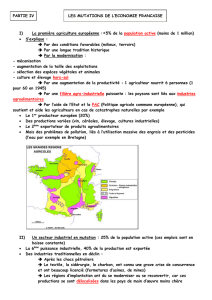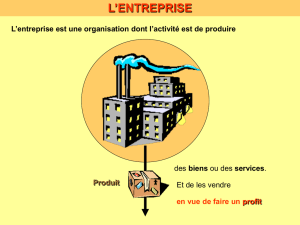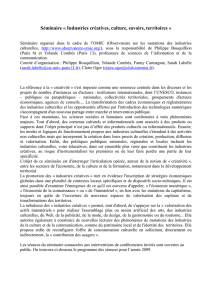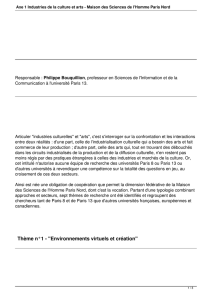Industries, économie créatives et technologies d`information et de

tic&société
Vol. 4, n° 2 | 2010
Industries créatives avec ou sans TIC ?
Industries, économie créatives et technologies
d’information et de communication
Philippe Bouquillion
Édition électronique
URL : http://ticetsociete.revues.org/876
DOI : 10.4000/ticetsociete.876
Éditeur
Association ARTIC
Référence électronique
Philippe Bouquillion, « Industries, économie créatives et technologies d’information et de
communication », tic&société [En ligne], Vol. 4, n° 2 | 2010, mis en ligne le 21 mars 2011, consulté le
30 septembre 2016. URL : http://ticetsociete.revues.org/876 ; DOI : 10.4000/ticetsociete.876
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Licence Creative Commons

tic&société – 4 (2), 2010
Industries, économie créatives
et technologies d’information et de
communication
Philippe BOUQUILLION
Université Paris 8
CEMTI
p.bouquillion@free.fr
Philippe Bouquillon est professeur à l’Université Paris 8. Il est responsable
du programme « Les industries créatives : Pour une théorie critique »,
financé par l’Agence nationale la recherche, ainsi que du programme « Les
groupes industriels de la culture et de la communication en Europe et en
Amérique du Nord », programme financé par le ministère de la Culture et de
la Communication. Il co-dirige la série « Les industries de la culture et de la
communication », dans la collection « Questions contemporaines »,
L’Harmattan.

Industries, économie créatives
et technologies d’information et de communication
8
Industries, économie créatives
et technologies d’information et de
communication
Résumé
Cet article vise à questionner les relations complexes entre les industries et
l’économie créatives, d’un côté, et les Tic, de l’autre. L’interrogation porte
également sur les notions. En quoi les débats et les enjeux que suscitent ces
notions sont-ils liés, complémentaires ou concurrents? En somme, face aux
Tic, de quelles nouveautés – ou continuités- sont porteuses les thématiques
des industries et de l’économie créatives? Premièrement, si ces thématiques
apparaissent dans les années 1990 au Royaume-Uni en continuité avec les
enjeux soulevés par les Tic, elles mettent l’accent sur la défense des droits
de la propriété intellectuelle et le rôle central de ces derniers dans l’économie
des anciens pays industriels. Deuxièmement, l’analyse des discours sociaux
sur les industries et à l’économie créatives montre qu’ils sont porteurs d’une
analyse spécifique sur les enjeux de la créativité dans les sociétés et les
économiques contemporaines. Troisièmement, la notion d’industries
créatives interroge de manière originale les processus de marchandisation et
d’industrialisation à l’œuvre au sein des industries de la culture.
Mots-clés : Industries créatives, économie créatives, industries culturelles,
industries de la communication, technologies d’information et de
communication.
Abstract
This article aims at questioning the complex relations between the creative
industries and the creative economy, on one side, and ICT, of the other one.
The interrogation also concerns the notions. In what the debates and the
stakes, which arouse these notions, are they connected, complementary or
rival? As a matter of fact, of what novelties - or continuities are carriers the
themes of the creative industries and economy? In the first place, if these
themes appear in the 1990s in the United Kingdom in continuity with the
stakes raised by ICT, they emphasize the promotion of intellectual property
rights and their central role in the economy of the old industrial nations.
Secondly, the analysis of the social speeches on the creative industries
shows that they are carriers of a specific analysis on the stakes in the
creativity in contemporary societies and economic. Thirdly, the notion of

Philippe BOUQUILLION
tic&société – 4 (1), 2010 9
creative industries questions, in a original way, the processes of
industrialization within the cultural industries.
Keywords: Creative industries, creative economy, cultural industries,
communication industries, information technology and communication.
Resumen
Este artículo pretende interrogar las relaciones complejas entre las industrias
creativas y la economía creativa, de un lado, y Tecnología de Información y
de Comunicación, de la otra. La interrogación también se refiere en las
nociones. ¿ En qué los debates y las puestas que suscitan estas nociones
son complementarios o competidores? ¿ En suma, frente a Tic, de cuáles
novedades - o continuidades son portadoras las temáticas de las industrias
creativas y de la economía creativa? Primero, si estas temáticas aparecen
en los años 1990 en el Reino unido en continuidad con las puestas
indignadas por Tic, ponen el énfasis en la defensa de los derechos de la
propiedad intelectual y el papel central de estos últimos en la economía de
los antiguos países industriales. En segundo lugar, el análisis de los
discursos sociales las industrias creativas y a la economía creativa muestra
que son portadores de un análisis específico sobre las puestas de la
creatividad en las sociedades y económicos contemporáneas. En tercer
lugar, la noción de industrias creativas interroga los procesos de
industrialización quiénes están en proceso en el seno de las industrias
cultural.
Palabras clave: Las industrias creativas, la economía creativa, las industrias
culturales, industrias de la comunicación, tecnologías de la información y la
comunicación.

Industries, économie créatives
et technologies d’information et de communication
10
Introduction
Les notions d’industries créatives et d’économie créatives sont encore peu
présentes en France dans les discours officiels. En revanche, ces thématiques
connaissent un succès certain en dehors de l’hexagone, en Europe ou en
Australie, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, en Amérique du Nord,
ainsi que dans des pays dits émergents, notamment en Chine et en Inde.
Différentes institutions internationales, en particulier l’United Nation Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ou la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement (CNUCED s’en sont emparées. Ces
activités sont alors décrites comme des axes importants de développement. De
même, dans les anciens pays industrialisés, pays où le coût de la main d’œuvre
est élevé, les industries créatives sont envisagées comme un vecteur essentiel
de « sortie de crise ». Elles constitueraient un nouveau domaine de
spécialisation économique dans le cadre d’une économie mondialisée. Alors
que les activités manufacturières issues de la première et de la seconde
révolutions industrielles se délocaliseraient en direction des pays émergents, les
activités qui reposent sur l’« intelligence », les « idées » et la « créativité »
pourraient rester l’apanage des anciens pays industrialisés.
Les notions d’industries créatives et d’économie créatives sont difficiles à
cerner. Il est généralement affirmé que diverses activités pourraient être
regroupées dans la même catégorie, les « industries créatives », au motif que la
création jouerait un rôle central dans leur production et leur valorisation. Liées à
des savoirs et des savoir-faire complexes, supposément spécifiques à un
territoire donné, ces activités présenteraient un fort ancrage territorial,
produiraient une importante valeur ajoutée et, enfin, seraient hautement
créatrices d’emplois. Telle est, schématiquement résumée, la proposition
centrale sur laquelle repose la notion d’industries créatives.
La notion d’économie créative, quant à elle, désigne l’extension, à la quasi
totalité de l’économie, des procès socio-économiques à l’œuvre, notamment
d’organisation du travail ou des modalités de création, dans les industries
créatives. David Throsby (2001), un économiste, va ainsi décrire l’économie
créative comme une suite de cerces concentriques. Au cœur se trouvent les arts
et les industries créatives puis, dans les cercles qui suivent, sont placées les
autres activités en fonction du rapport, plus ou mois important, qu’elles
entretiennent avec la créativité. Cette représentation va connaître un très grand
succès, en particulier dans les définitions officielles des industries créatives qui
se succèdent depuis le début des années 2000.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%