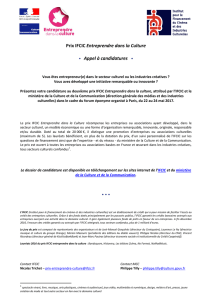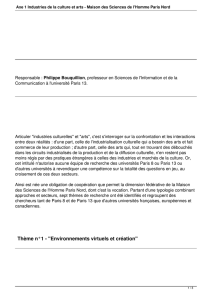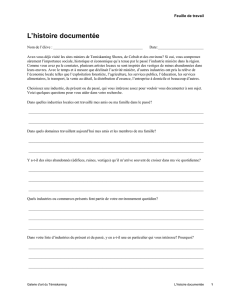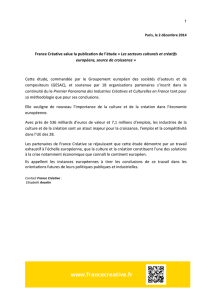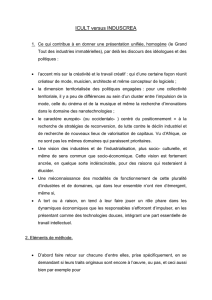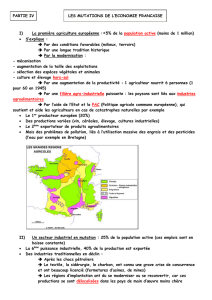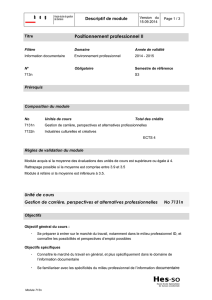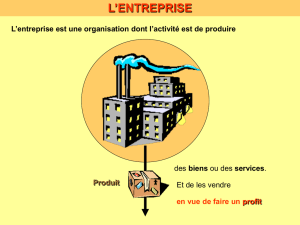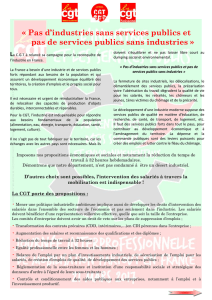Téléchargez le texte de présentation du séminaire, le

Séminaire « Industries créatives, culture, savoirs, territoires »
Séminaire organisé dans le cadre de l’OMIC (Observatoire sur les mutations des industries
culturelles, http://www.observatoire-omic.org/), sous la responsabilité de Philippe Bouquillion
(Paris 8) et Yolande Combès (Paris 13), professeurs de sciences de l’information et de la
communication.
Comité d’organisation : Philippe Bouquillion, Yolande Combès, Fanny Carmagnat, Sarah Labelle
La référence à la « créativité » s'est imposée comme une ressource centrale dans les discours et les
projets de nombre d'instances ou d'acteurs : institutions internationales, dont l’UNESCO, instances
– publiques ou parapubliques – nationales, collectivités territoriales, groupements d'acteurs
économiques, agences de conseils.... La transformation des cadres économiques et réglementaires
des industries culturelles et les opportunités offertes par l'introduction des technologies numériques
s'accompagnent d'un nouveau partage entre marché et intervention publique.
Face à ces mutations, les sciences sociales et humaines sont confrontées à trois phénomènes
majeurs. Tout d’abord, des contenus culturels et informationnels sont associés à des produits ou
supports dont l’objet principal n’est pas d’offrir des produits culturels ou informationnels. Ensuite,
les modes et logiques de fonctionnement propres aux industries culturelles s'étendent à des activités
non culturelles mais qui incorporent la création dans leurs procès de création, production, diffusion
et valorisation. Enfin, des politiques publiques nationales, régionales et locales incluent les
industries culturelles, voire éducatives, dans cet ensemble plus vaste que constituent les industries
créatives, au risque d'instrumentaliser les premières ou de leur faire perdre une partie de leur
spécificité.
L'objet de ce séminaire est d'interroger l'articulation opérée, autour de la notion de « créativité »,
entre les secteurs de l'économie, de la culture et de la formation, notamment dans le développement
territorial.
La promotion des « industries créatives » met en évidence l'inscription de stratégies économiques
globales dans une pluralité de contextes locaux spécifiques et de dispositifs socio-techniques. Il est
ainsi possible d'examiner l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler, « l'économie numérique »,
« l'économie de la connaissance » ou « de l'immatériel », en lien avec les mutations du capitalisme,
toujours en quête de l’ouverture de nouveaux espaces de valorisation des capitaux et de
transformations des territoires.
La nébuleuse des « industries créatives » permet, tout d'abord, de s'appuyer sur la « valorisation des
actifs immatériels » pour réaliser l'assemblage plus ou moins artificiel des arts, des industries
culturelles, du Web, de la publicité, de la mode, du design, de la gastronomie ou du tourisme... Elle
autorise également à construire de nouvelles lectures des phénomènes de mutations des industries
de la culture et de la communication, comme du patrimoine local et de l'identité des territoires. Elle
propose enfin de reconfigurer l'offre de consommation culturelle en sollicitant, directement ou
indirectement, la « contribution des usagers ».
Les séances du séminaire consacrées aux interventions de conférenciers invités sont ouvertes au
public. On trouvera ci-dessous le programme des séances pour l’année 2009.

Programme 2009-2010
Les séances ont lieu à la MSH-Paris Nord
(plan et indications sur le site : http://www.mshparisnord.org/acces.htm),
en visio-conférence avec l’Institut de la communication et des Médias,
(Université Grenoble 3, Echirolles)
Vendredi 16 octobre 2009, 14 h
- Laure Gaertner, docteure en sociologie, Université Paris X Nanterre, IDHE
« Les créatifs de la publicité et la construction de la valeur socio-économique des services
publicitaires ».
- Sarah Labelle et Claire Oger, maîtres de conférences en SIC, Université Paris 13, LabSic.
« Hybridation et traces de tension dans le discours de l’Unesco sur la culture et la créativité ».
Vendredi 27 novembre 2009, 14 h
- Christian Le Bart, professeur de science politique, Rennes 1, CRAPE, auteur de
L’individualisation (Paris, Presses de Sciences Po, coll. Références, 2008).
« La création comme accomplissement de soi ? »
- Jacob Matthews, maître de conférences en SIC, Université Paris 8, CEMTI.
« Les industries créatives : perspectives critiques »
Vendredi 29 janvier 2010, 14 h
- Stéphane Vincent, Directeur du programme « 27ème région », FING
« Territoires en résidences: créativité et co-conception des politiques publiques »
- Vincent Bullich, maître de conférences en SIC, Université Paris 13, LabSic.
« Développement des industries créatives et l’enjeu de la propriété intellectuelle »
Vendredi 26 mars 2010, 14 h
- Philippe Bouquillion, professeur de science de l’information et de la communication, Université
Paris 8, CEMTI.
« Les industries créatives dans les rapports officiels en Europe »
- Discussion : Retour sur les séances précédentes : apports du séminaire, problématiques
émergentes…
Dates ultérieures :
Deux autres séances sont prévues pour l’année 2009-2010, les dates précises et le programme en
seront fixés ultérieurement.
A titre indicatif, les dates prévues sont les suivantes :
Mai : le 7 ou le 28
Juin : le 11 ou le 18.

Rappel des séances organisées en 2008-2009 :
Vendredi 3 avril 2009, 13 h
- Emilie Dalage et François Debruyne :
Maîtres de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de
Lille 3
« Le développement paradoxal de la figure de l’amateur « créatif » sur internet : simple
asymétrie relationnelle ou processus de réification ?
ou quand la publicité du goût est prise dans l’obligation de la publicité de soi : les risques
potentiels d’attitudes réifiantes »
- Fanny Carmagnat :
« L’innovation ascendante mise en pratique chez Orange Lab »
Mercredi 13 mai 2009,
- 14 h, Pierre Jean Benghozi,
Directeur de recherches CNRS, Directeur du Pole de Recherche en Economie et Gestion de
l’Ecole polytechnique :
« Les modèles d’affaires : cœur des stratégies dans les industries de contenu »
- 16 h, Tristan Mattelart,
Maître de conférences à l’Institut Français de Presse (Paris 2) :
« Nouveaux regards sur les industries culturelles. A propos de "Global Culture Industry"
(Scott Lash et Celia Lury, Polity, 2007) »
Mercredi 10 juin 2009 :
- 10 h30, Marie-Anne Dujarier,
Maître de conférences à l’Université Paris 3 :
« Le travail du consommateur, de Mac Do à E-Bay »
- 14 h, Guy Saez,
Directeur de recherches CNRS, directeur de l’UMR PACTE,
« La recomposition territoriale des politiques culturelles : villes créatives et villes
participatives ».
1
/
3
100%