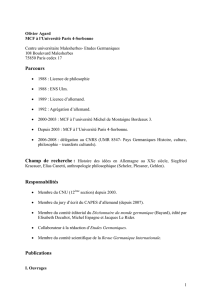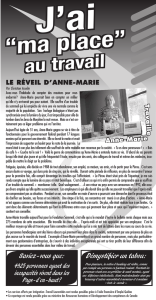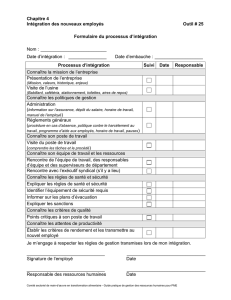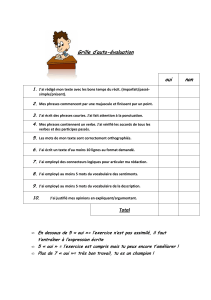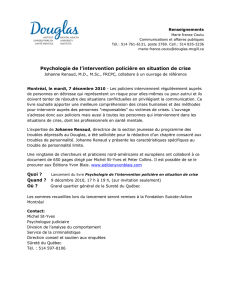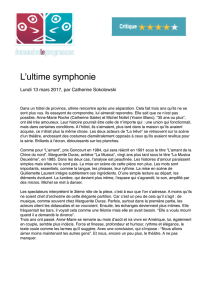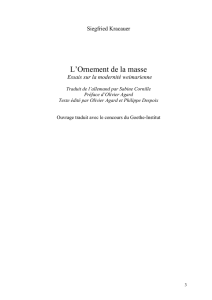Texte intégral du mémoire


Université de Montréal
Les employés
Excursion sociologique dans le monde de la gestion des ressources humaines
par
Élise Dumont-Lagacé
Département de sociologie
Faculté des Arts et des Sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l’obtention du grade Maître ès sciences (M.Sc)
en sociologie
Décembre 2013
© Élise Dumont-Lagacé, 2013

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Ce mémoire intitulé :
Les employés
Excursion sociologique dans le monde de la gestion des ressources humaines
Présenté par :
Élise Dumont-Lagacé
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Yanick Noiseux
président du jury
Barbara Thériault
directrice de recherche
Rolande Pinard
membre du jury

i
Résumé
Manifestation du processus de rationalisation capitaliste contemporain, la gestion des
ressources humaines s’est largement développée et diffusée comme paradigme
d’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise, mais aussi à l’extérieur de
celle-ci. En m’appuyant sur l’étude Les employés de Siegfried Kracauer (2004 [1931])
ayant mis en lumière les effets de la rationalisation de l’entreprise moderne sur les traits
de mentalités des employés dans les années 1920, je propose de me pencher sur les
employés en gestion des ressources humaines aujourd’hui. Plus précisément, c’est la
tension dont ils sont à la fois les porteurs et les objets qui constitue le coeur de ce
mémoire. Cette tension lie la fonction particulière que ces employés sont appelés à jouer
dans l’entreprise et leur propre condition comme employé. Ainsi, c’est par la constitution
de rapports à la tension sous une forme idéaltypique — propre à l’approche
wébérienne — que ce mémoire propose d’appréhender la condition des employés en
gestion des ressources humaines. L’interprétation des rapports à la tension et à la pratique
professionnelle de ces employés, à l’aune de quatre idéaltypes construits à cette fin (le
sous-officier comptable, le sous-officier sportif, celle qui prend sur soi et le synthétique),
permet de mettre en lumière des dilemmes qu’ils sont enclins à vivre, dilemmes inhérents
à leur condition d’employés dans le monde rationalisé.
Mots-clés : employés; gestion des ressources humaines; rationalisation; pratique
professionnelle; idéaltypes; Siegfried Kracauer; Max Weber.

ii
Abstract
As a form of the contemporary process of rationalization, human resources management
developed itself as a paradigm to organize social relations not only within the business
industry, but also outside. This master thesis is based on the work of Siegfried Kracauer
“The Salaried Masses” (1998 [1931]) that reveals the effects of the rationalized modern
business industry on the mentality of the employees in the 1920’s. I propose to investigate
the tension that the human resources management employees bear as they are, nowadays,
both its carriers and objects. This tension, that binds the particular function of these
employees within the business industry and their own condition as employees, forms the
object of this master thesis. It is through the construction of relations toward the tension
in an idealtypical form — specific to the Weberian approach – that this master thesis
proposes to understand the employees’ condition in human resources management. By
interpreting the relations toward the tension underpinned in this professional field with the
four idealtypes constructed for this purpose (the accountant sergeant, the sport sergeant,
she who takes upon herself and the synthetic), I bring to light the dilemmas that are likely
to be experienced by these employees; dilemmas inherent to their condition in the
rationalized world.
Keywords: employees; human resources management; professional practice; idealtype;
Siegfried Kracauer; Max Weber.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
1
/
122
100%