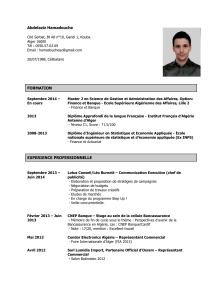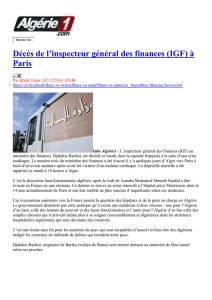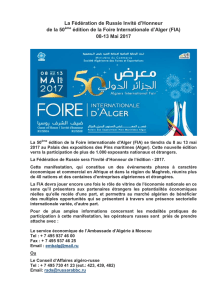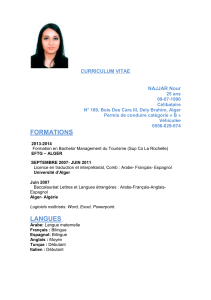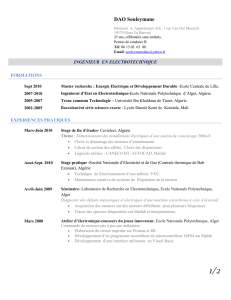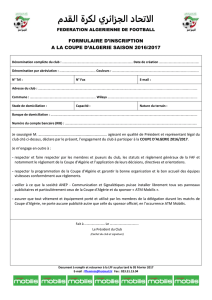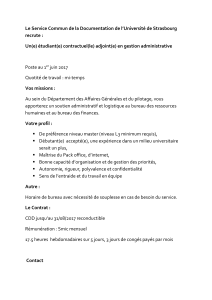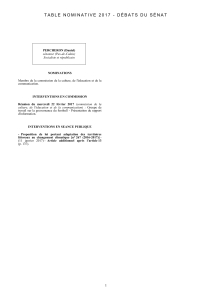Pour quelques dinars de plus

www.jobnewsalgeria.com Semaine du 5 au 11 février 2017 - Prix 20 DA # 03
FORMATION
L’ITMAS au service
de l’agriculture
de montagne
PROGRAMME MEILLEURS
EMPLOYEURS EN ALGÉRIE
DHL succède
à Bayer
AWEM
15 360
placements
réalisés
à Tizi Ouzou
en 2016
EDF
Jusqu'à
7 000 postes
supprimés
en 4 ans
SALAIRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ
Pour quelques
dinars de plus
P19
P7
P5P4
Lire notre dossier en pages 2 et 3
AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE SANTÉ...
Ces métiers au service de la vie
Lire article et entretiens en pages P12-13

nPAR JUBA D.
Le marché de l’emploi n’est plus
à présent celui qu’on connais-
sait il y a quelques années.
Avec l’évolution des mœurs au
niveau des entreprises qui,
dans un environnement où la
concurrence est féroce, s’eorcent à s’allier
les meilleures compétences, la ressource
humaine ne cesse de retenir l’attention des
managers. Ceci dit, si les employeurs ont
évolué dans leurs exigences, les employés
ne sont pas en laisse. Les demandeurs
d’emploi ne sont plus, comme on pourrait
l’imaginer, des chômeurs en quête d’occu-
pation moyennant juste une rémunération.
En eet, dans le gotha des postulants aux
diérents emplois oerts, il y a de toutes les
catégories, du simple ouvrier au cadre diri-
geant bardé de diplômes. Il y en a égale-
ment du nouveau diplômé en quête d’une
première expérience, aux salariés d’entre-
prises qui ont pourtant pignon sur rue !
Nous sommes bien à l’ère où les carriéristes
se font de plus en plus rares. Les employés,
quel que soit leur catégorie ou niveau d’ins-
truction et/ou de compétence, évoluent au
gré des opportunités qui s’orent à eux.
Quant à la question salariale, elle demeure
toutefois importante, même si d’autres
paramètres interviennent dans le choix. Et
là, toutes les entreprises, qu’elles soient
publiques ou privées, se rejoignent. Tout
dépend de l’attrait de chacune pour attirer
les meilleurs. C’est pour cela d’ailleurs que
les statistiques, du moins celles ocielles,
prouvent l’existence de cette tendance à
mettre sur la balance les diérents avan-
tages que peut orir une entreprise, indé-
pendamment du fait qu’elle soit du secteur
public ou privé. Les autres avantages au-
delà du salaire, sont entre autres la forma-
tion dispensée aux travailleurs, la gestion
de carrière, les conditions de travail, mais
aussi les avantages sociaux dont bénécient
les salariés.
Pour l’expert économiste, Ferhat Aït Ali,
«les Algériens ont tendance à prendre les
postes d'emplois pour des sources de revenus
exigibles pour chaque citoyen, alors que c'est
une marchandise qui obéit à la loi de l'offre
et de la demande, elle même tributaire des
capacités de paiement et des chiffres d'af-
faires eux même tributaires des capacités de
consommation de produits locaux quasi
inexistants faute de clients au départ et
faute de production à la n». Évoquant
dans le même sens l’absence de visibilité,
l’expert note que «les statistiques sont faus-
sées au départ, dans la mesure où la lll
SALAIRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ
Pour quelques dinars
en plus
Est-il mieux de travailler chez le public ou le privé ? Voilà une question que les Algériens en quête
d’emploi se posent souvent. Toutefois, si pour une majeure partie des prétendants à l’emploi, la question
du salaire est primordiale, pour d’autres non !
Semaine du 5 au 11 février 2017
2DOSSIER
nEntretien réalisé par JUBA D.
Job News : Les statistiques de l'ONS pour
2015 font état d'une meilleure rétribution
des salariés du public, comparativement à
ceux du privé, quelle lecture faites vous de
ces statistiques ?
Ferhat Aït Ali : Les statistiques de l'ONS,
comme toutes les statistiques du monde,
peuvent être lues de diérentes manières,
en fonction de l'angle d'élaboration choisi
et des agrégats qui y sont regroupés pour
tirer les moyennes et les ratios.
Ce qui peut être lu, du point de vue de
l'ONS, comme un bon point pour le secteur
public économique et la Fonction publique,
et à l'encontre du secteur privé, peut aussi,
une fois que toutes les données statistiques
détaillées et lues d'un autre point de vue,
plus réaliste, être l'indice d'une défaillance
économique grave, qui éclaire tout simple-
ment sur le fait que les secteurs improduc-
tifs de la société arrivent à capter le gros des
revenus par la grâce d'une décision poli-
tique idéologiquement orientée, qui
empêche toute relève d'un secteur écono-
mique réellement productif.
En y regardant de plus près dans ces
salaires, on peut y déceler les éléments sui-
vants que les ratios et autres moyennes ne
révèlent pas :
- Les salaires de la Fonction publique sont
en moyenne supérieurs à ceux du secteur
économique publics, qui à leur tour sont
supérieurs à ceux du secteur privé.
Ce qui démontre que l'administration, qui
de part un système scal et son pouvoir de
décision attire 70% de l'unique richesse
nationale digne d'être citée, l'oriente en
premier vers elle-même, avant d'en laisser
passer une autre partie moins importante
vers le secteur public assimilé à une sorte
de fonctionnariat de deuxième collège, sans
aucune contrainte majeure en termes de
rendement ou de pérennité tant que la
rente est disponible.
Dans cette même catégorie privilégiée de
fonctionnaires et assimilés du secteur éco-
nomique, les moyennes salariales sont cal-
cullées sur la base de salaires de cadres cen-
traux et dirigeants des administrations et
des entreprises qui dépassent 20 fois le
salaire le plus bas de la même structure ou
entreprise.
Ce qui permet avec un seul salaire de 300
000 DA et 19 salaires de 20 000 DA d’avoir
la moyenne salariale de 30 000 DA, alors
que dans le secteur privé, essentiellement
constitué de Sarl et de petites entreprises,
les hauts salaires sont rares ou perçus en
dividendes par les associés ; ce qui ne per-
met pas de tirer les moyennes vers le haut
par le truchement des salaires des cadres.
Les cotisations sociales de 34% sur les
salaires, dont 25% à la charge des
employeurs, sont supportées par le Trésor
public pour les fonctionnaires, et par les
banques en attenant le Trésor pour les
employés du secteur public, et même par-
fois passées à la trappe en termes de recou-
vrement par assainissements à la limite de
l'illégalité. Alors que pour le secteur privé,
elles sont supportées par les chires d'aai-
re des entreprises, qui elles-mêmes sont
laminées par la jonction entre les hauts
revenus des secteurs publics et les activités
d'achat revente de produits importés qui,
elles, ne nécessitent ni emplois permanents
et qualiés ni marges conséquentes pour 2
FERHAT AÏT ALI, ÉCONOMISTE
“En Algérie, l'emploi n'est pas
considéré comme un produit”
Analysant la situation de l’emploi dans le pays, à la lumière des dernières statistiques de l’ONS, l’expert économiste, Ferhat Aït Ali, livre dans cet entretien qu’il nous a
accordé sa lecture, en démontrant comment les chiffres communiqués ne peuvent être considérés comme une référence pour avoir une meilleure appréhension de
l’emploi en Algérie. Entretien.

Semaine du 5 au 11 février 2017 3
DOSSIER
Rémunération, paye,
appointment, rétribution,
solde, traitement, gain, reve-
nu, dividende, mensualité,
émolument, honoraire,
cachet, pige,… quelque soit
l’appellation qu’on lui attri-
but, le salaire restera tou-
jours la préoccupation fon-
damentale des travailleurs, il
constitue l’existence même
de l’individu et de sa famille,
il est essentiel à la bonne
marche de l’entreprise et
nécessaire à l’équilibre géné-
ral de l’économie d’un pays.
Une question très cruciale
vient d’être traitée dans cet
ouvrage : combien d'argents
perdus pour cause d'arrêts
de travail ou de journées de
grève ayant pour principale
revendication la révision des
salaires. La question ne
cesse de susciter l'intérêt
des pouvoirs publics, d'aigui-
ser les revendications chez
les organisations syndicales
et l'insatisfaction permanen-
te des travailleurs qui ne
cessent de clamer un salaire
toujours plus élevé. En
somme c'est le combat
continu afin de garantir un
pouvoir d'achat décent et
par conséquent une vie
meilleure.
L’ouvrage en question est
une référence en matière
de pratique et de législation
salariale en Algérie, parfaite-
ment à jour des dernières
évolutions législatives et
réglementaires. Il comporte
trois parties essentielles, il
s’agit de :
1re partie : le salaire
Cette partie comporte
d’abord un aperçu histo-
rique sur l’évolution des
salaires en Algérie depuis
1909 à ce jour mettant en
exergue toutes les disposi-
tions adoptées par le législa-
teur en matière de salaires.
En plus de la notion du
salaire et son importance,
depuis la naissance de la
relation contractuelle en
passant par la période d’es-
sai et les différentes situa-
tions dues à l’évolution de la
relation du travail, l’ouvrage
en question réponds princi-
palement aux questions de
la composante des salaires,
variation et modification de
la rémunération, les formes
du salaire et son mode de
paiement. Quelles sont les
justifications du paiement
des salaires. Comment
déchiffrer un bulletin de
salaire ? Quelles garanties
de versement du salaire
lorsque l’entreprise est en
difficulté ? Des règles de
fixation du salaire à ses
modalités de paiement, du
régime des heures supplé-
mentaires et les différentes
positions du salarié, le
recours de ce dernier en
cas de non-paiement du
salaire aux limites des saisies
du salaire, etc., les
employeurs comme les sala-
riés trouveront dans cet
ouvrage toutes les règles à
connaître pour maîtriser la
législation liée à la rémuné-
ration du travail.
2epartie : le salaire natio-
nal minimum garanti
En plus d’un aperçu histo-
rique sur l’évolution du
salaire national minimum
garanti en Algérie depuis le
siècle dernier, l’ouvrage trai-
te de la notion du salaire
national minimum, son
mode de fixation, sa signifi-
cation, son importance.
Quels sont les mécanismes
de sa fixation ? Quels sont
ses éléments constitutifs?
Comment est-il calculé ?, et
enfin le salaire national mini-
mum garanti comme réfé-
rence.
3epartie : les régimes
indemnitaires
Cette partie traite d’un des
éléments aussi important de
la rémunération, il s’agit des
régimes indemnitaires appli-
cables. Dans cette partie
une large place a été consa-
crée à sa signification…
Quelle est sa composition ?
Son mode d’attribution ?
Quelles sont les différentes
retenues et fiscalité appli-
cables au régime indemnitai-
re? Quelles sont les primes
et indemnités les plus cou-
rantes ?, et enfin les régimes
indemnitaires des fonction-
naires appartenant aux insti-
tutions et administrations
publiques.
En conclusion, ce guide per-
mettra à chacun de mieux
appréhender une des
notions clés de la relation
de travail. L'utilisateur trou-
vera toutes les facettes
d'une question qui intéresse
aussi bien les chercheurs et
consultants dans le domaine
social, sociologues et spécia-
listes en matière sociale, les
formateurs, juristes et ins-
pecteurs du travail, diri-
geants d’entreprises et ges-
tionnaires des ressources
humaines et des finances, les
institutions et entreprises
nationales et internationales,
les associations profession-
nelles, les organisations syn-
dicales et patronales, et
enfin les travailleuses et tra-
vailleurs nationaux et ceux
de nationalité étrangère
exerçants en Algérie.
Présentation du
“GUIDE
PRATIQUE SUR
LES SALAIRES”
lll moyenne des salaires publics et
privés est faussée par les salaires des
cadres dirigeants qui chez le public sont
une pléthore surpayée et chez le privé une
minorité dont beaucoup sont associés et
de ce fait, pas salariés». «Il se trouve aussi
que le privé a une masse salariale plus
importante et une population occupée
plus grande dans le secteur productif
déclarant, que le secteur public, sans
avoir les capacités de renancement du
public», ajoute-t-il.
Les cadres mieux payés chez le privé
Puisqu’on parle de statistiques, il est éta-
blis que si les salaires, du moins pour les
moyennes catégories, sont meilleurs chez
le public que chez le privé, mais le privé
gagne par contre en nombre en orant le
plus d’opportunités d’emploi. Mieux
encore, et toujours question salaire, les
cadre et les techniciens sont mieux valo-
risés chez le privé que chez le public où
les grilles de salaires sont gées sans
tenir compte de la plus value que peut
apporter un salarié par rapport à un
autre.
Les dernières statistiques de l'Oce
national des statistiques (ONS) qui révè-
lent que le salaire net moyen mensuel en
Algérie est estimé à 39 200 DA en 2015,
à raison de 54 700 DA dans le secteur
public, contre 32 100 DA seulement
dans le privé, ne révèle pas pour autant
le fond de la problématique. Ces chires
issus d'une enquête annuelle sur les
salaires menée par l'ONS auprès de 581
entreprises publiques et de 252 entre-
prises privées de 20 salariés et plus (hors
administration et agriculture), s’intéres-
sent aux salaires attribué, faisant ainsi
que les employés du secteur public se
trouvent mieux rémunéré, notamment
en ce qui concerne le salaire de base qui
représente 60% du net à payer chez le
public et de 50,8% chez le privé. Le reste
est versé sous forme d’indemnités
diverses, généralement non imposables.
Toutefois, pour les cadres, les salaires
sont beaucoup plus importants chez le
privé, notamment dans le domaine de
l’industrie et du commerce. Les ingé-
nieurs sont également mieux rémunérés
par le privé que par l’État. Une exception
seulement fait la diérence au niveau du
secteur public. Il s’agit essentiellement
des régimes appliqués dans la Fonction
publique (administrations notamment)
et les entreprises publiques à caractère
commercial et/ou économique (Epic,
EPE…). À ce niveau, il faut dire que la
diérence est de taille, étant donné
qu’on trouve de meilleurs salaires auprès
des entreprises économiques, au
moment où les salaires de la Fonction
publiques restent parfois très loin en
arrière.
L’ONS conrme cette donne, en indi-
quant que les activités dans les «indus-
tries extractives» (production et services
d'hydrocarbures essentiellement) et les
«activités nancières» (banques et assu-
rances) demeurent les secteurs qui
payent le mieux : salaire net moyen de
100 500 DA/mois dans les «industries
extractives» et 59 200 DA/mois dans le
«secteur nancier».
Il n’y a pas que le salaire qui compte…
En revanche, et toujours selon la même
étude, le salaire net moyen dans le sec-
teur «construction» est le plus faible avec
29 900 DA/mois.
En eet, si le salaire des agents d'exécu-
tion dans les activités liées aux hydrocar-
bures est de 68 700 DA, il est à seule-
ment 23 400 DA au niveau du secteur de
la santé, par exemple.
«La qualication du salarié, le secteur
juridique, la taille de l'entreprise ainsi
que les spécicités de rémunération secto-
rielles des entreprises de certains secteurs
sont les éléments les plus discriminants
du niveau des salaires», relève la même
l’ONS qui note que le niveau relative-
ment élevé du salaire dans le public est
dû en partie à «l'existence de certaines
entreprises publiques importantes en
termes d'effectifs avec un système de
rémunération avantageux».
D’autre part, on relève que le salaire
n’est pas la seule motivation des
employés, puisque l’on trouve de plus en
plus de personnes en activité, même
moyennant un très bon salaire, mais qui
cherchent de nouveaux challenges. Cette
tendance est de plus en plus importante
chez les jeunes cadres notamment, pour
qui les conditions de travail, l’évolution
de la carrière et la formation sont égale-
ment des atouts à ne pas négliger.
J. D.
2 assumer les salaires et les charges.
Les limites de versement de retraites à
2,4 millions de dinars annuellement,
pour les cotisants Casnos, limitent aussi
les cotisations à cette base précise, pour
le secteur privé, alors que dans les
sphères dirigeants des deux autres sec-
teurs, le FSR prend le relais à partir
d'une certaine catégorie de salariés, qui a
tout intérêt à déclarer de hauts salaires,
surtout que la cotisation incombe à la
nation et pas aux intéressés.
Le secteur privé productif et employeur,
étant laminé par les facteurs précédents,
et une scalité que lui paie sous peine de
saisie ou de mesures pénales, ne peut
être appelé à s’aligner sur des secteurs
qui, dans les faits, disparaîtront quelques
jours après le tarissement des puits au
Sud, et appuient toutes leurs largesses
sur cette unique richesse non pérenne
du pays.
Le grand décalage des salaires et des
autres privilèges dont bénécient les
employés se trouve notamment chez les
cadres, au moment où le personnels
exécutants continuent à percevoir des
salaires minables, quelle est la raison
selon-vous ?
Ce grand décalage, qui apparaît surtout
chez les secteurs étatiques, renseigne sur
la vision de la productivité dans ces
sphères bureaucratiques ou l'individua-
lisme des cadres dirigeants est appuyé
sur la position du moment, et une fausse
certitude de pérennité induite par le
prolongement de la rente depuis les
années 1980, mais aussi par leur qualité
de législateurs, de décideurs et d'exécu-
teurs rassemblées dans la même sphère à
plusieurs casquettes.
Dans une entreprise privée, le personnel
qualié sur le terrain est mieux rétribué
que le personnel administratif tous
grades confondus, et la grille est souple ;
elle obéit aux impératifs de rentabilité de
l'entreprise. Ainsi vous trouverez un
enginiste dans une entreprise privée qui
touche le salaire de 3 administratifs.
Dans le secteur public, où la grille des
salaires a été élaborée par des person-
nages déconnectés de la réalité écono-
mique et connectés sur leur intérêts de
caste, on trouve un fondeur rétribué à
un salaire inférieur à celui d'une secré-
taire de département, avec un chef de
département sous qualié pour cette
tâche mais ayant quand même la qualité
de cadre dirigeant d'une entreprise tou-
jours au bord de la faillite après une
dizaine d'eacements de dettes et de re-
nancements avec les cotisations des
autres. Et là où l'obligation de résultats
est remplacée par celle de l'allégeance,
on trouve ce résultat, qui ne dure que le
temps des rentes qui le maintiennent en
vie.
Sinon comment expliquer qu'un secteur
public, sous employeur, et sous payeur
pour les catégories exécutantes même
qualiées, nous soit revenu à 80 mil-
liards de dollars d'assainissements
depuis 30 ans, sans aucune contribution
à la scalité ordinaire du pays, n'emploie
que 04% de la masse employée du sec-
teur privé ? avec une masse salariale
intégralement couverte par les eorts du
reste de la nation ?
Mettons les deux secteurs au diapason
des nouvelles dispositions constitution-
nelles, et nous verrons combien de jours
ce secteur résistera nancièrement à ses
largesses mal orientées.
Le marché de l'emploi en Algérie est
totalement déstructuré, ne pensez-vous
pas qu'il est temps d'opérer des réajus-
tements à même de mettre un peu
d'ordre et de permettre une vraie
concurrence qui mettra en valeur les
compétences ?
Il n'existe aucune raison de parler d'un
marché de l'emploi, tant que l'emploi en
lui-même n'est pas considéré comme un
produit, rétribuable en fonction de sa
qualité et de son utilité. Il existe des sec-
teurs qui, en s'accaparant une masse
salariale globale de 30 milliards de dol-
lars en amont de tout revenu national,
n’ont aucune obligation de résultats ni
risque d'échec à assumer.
Nous pourrons parler de marché de
l'emploi, quand ces deux critères clé de
toute pérennité économique ou même
politique seront pris en charge.
J. D.
Biographie
Zahir Battache, né le 28 juin 1969 à
Seddouk dans la Willaya de Béjaia.
Diplômé en sciences de l’information et
de la communication. Journaliste colla-
borateur à l’hebdomadaire Révolution
et Travail, organe central de la centrale
syndicale (UGTA), journaliste, auteur et
producteur d’émissions radiophoniques
traitant des questions liées au monde
du travail sur les ondes de la radio
nationale, avant d’entamer une longue
carrière dans le secteur du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle
et la protection et sécurité sociale.
Une large carrière à l’Inspection du
Travail (IGT), consultant à l’Institut
National du Travail (INT). Conseiller en
droit du travail et en communication
pour plusieurs entreprises publiques et
privées.

Semaine du 5 au 11 février 2017
4FORMATION
nPAR DAMIYA WISSALE
L’Itmas fait partie des
13 établissements
sous tutelle du minis-
tère de l’Agriculture
du Développement
rural et de la Pêche.
À sa création en 1958, cet établis-
sement s’appelait École pratique
d’agriculture chargée de la forma-
tion des agents techniques»,
autrement dit, de la main-
d’œuvre prête et corvéable pour
les colons.
En 1969, il a été érigé en école
régionale d'agriculture (ERA).
En 1973 , en exécution des ordon-
nances n°69-106 du 26/12/1969 et
n°70-78 du 10/11/1970, portant
création des instituts de technolo-
gie moyens agricoles et de centres
de formation d’agents techniques,
l'école régionale acquiert le statut
d'Institut de technologie moyen
agricole (Itma) avec pour objectif
de former des cadres moyens de
niveau de technicien de l'agricul-
ture, spécialisés en économie-ges-
tion, an de répondre aux besoins
du secteur autogéré. Puis en 1995,
Institut de technologie moyen
agricole spécialisé en agriculture
de montagne (Itmas continue à
former des cadres de niveau
moyen.
Cette institut est implanté dans la
localité de Boukhalfa, situé à 5 km
au nord-ouest de la ville de Tizi
ouzou. Le site d’implantation est
une zone agricole et boisée faisant
piémont à l’oued Sébaou (le plus
important du département).
Diffusion de progrès technique
L’Itmas de Boukhalfa a toujours
été un acteur actif du développe-
ment de sa région, son histoire le
conrme mais également le fait
qu'il soit au centre de l'ensemble
des activités à caractère agricole
relevant de la mise en œuvre de
programme de vulgarisation local
(journées d'information, journées
techniques de démonstration,
journées d'études…). C'est, par
ailleurs, un lieu incontournable
pour les réunions et rencontres de
professionnels.
L’établissement entretient des
relations permanentes avec ces
institutions quand à l'élaboration
et la mise en œuvre des pro-
grammes de formation, de perfec-
tionnement et de vulgarisation.
Des liens privilégiés sont établis
avec les stations régionales des
instituts techniques de dévelop-
pement (ITELV- ITAFV- INPV-
ITCMI –INMV) qui participant
avec l’établissement, par le biais
de leurs cadres à l'encadrement
des sessions de formation conti-
nue. Il y a également d’autres rela-
tions à considérer, avec différentes
structures et opérateurs écono-
miques du secteur telles que
CCLS, coopératives et associations
professionnelles.
L’établissement entretient égale-
ment des relations de collabora-
tion avec l’université de Mouloud-
Mâamri à Tizi ouzou, en particu-
lier le département de l’agrono-
mie. Ces liens sont matérialisés
par des échanges à plusieurs
niveaux (enseignants, étudiants et
conventions de partenariat (expé-
rimentation) dans les domaines
de l’élevage cunicole et valorisa-
tion des sous produits de l’oli-
vier).
Aujourd’hui, l’enjeu pour l’éta-
blissement est d’adapter leur orga-
nisation et leur fonctionnement à
la demande en formation du terri-
toire, il ne reste qu’aux autorités
compétentes (MADRP) d’accélé-
rer le processus pour aboutir à un
nouveau statut, qui permettra à
notre institut de s’adapter à la
nouvelle réalité du marché de
l’emploi par d’élargissement de
son périmètre d’offre de forma-
tion initiale pour répondre au
mieux aux besoins de l’agricultu-
re, de l’agroalimentaire, du niveau
ouvrier qualié au niveau cadre
moyen technicien – technicien
supérieur, d’aider les agriculteurs
à développer leurs exploitations
pour leurs permettre de produire
mieux et de se mettre aux normes
par un appui conséquent en
apportant les innovations tech-
niques et technologiques néces-
saires.
D. W.
FORMATION
L’ITMAS au service de
l’agriculture de montagne
L’Institut de technologie moyen agricole spécialisé de Boukhalfa (Itmas) constitue un point d’ancrage
territorial essentiel pour la mise en œuvre de la politique de formation initiale des jeunes au métier de
l’agriculture de montagne et la formation continue des agriculteurs et des cadres du secteur des quatre
wilayas rattachées à l’établissement.
nEntretien rèalisé par
DAMIYA WISSAL
Job News : L’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (Itmas) de
Boukhalfa est l’unique structure de forma-
tion qui couvre quatre wilayas à savoir
Tizi ouzou, Béjaïa, Bouira et Boumerdès.
Pouvez-vous nous présenter votre institut
en quelques mots ?
Saïd Tamen : L'itmas de Tizi Ouzou est
l’unique établissement de formation sous
tutelle de ministère de l'Agriculture et de
Développement rural et de la Pèche qui
couvre la région de la Kabylie. Son domai-
ne de spécialisation en agriculture de mon-
tagne requiert une compétence nationale
mais sa zone de recrutement potentielle
s'étale sur la wilaya de Tizi Ouzou et les
wilayas limitrophes : Béjaïa, Bouira et
Boumerdès.
Le champ d'intervention de notre établisse-
ment est limité à sa wilaya d'implantation
et aux trois willayas limitrophes (Béjaïa,
Boumerdès et Bouira), conformément au
découpage xé à titre indicatif par la tutel-
le. Avec pour objectif l'amélioration de
leurs savoirs et savoir-faire (appui à l’ex-
ploitation), la formation est organisée sous
forme de cycles de courte durée (2 à 4
jours).
Elle est actuellement orientée vers les
domaines inscrits dans la stratégie de déve-
loppement agricole dans ces quatre wilayas
(développement des lières) mais égale-
ment les besoins réels exprimés par ces
acteurs.
à travers des sessions de formation ou sous
forme de séminaires périodiques, touchent
divers domaines prioritaires : économie-
gestion, pratiques culturales performantes,
développement rural, techniques de com-
munication et gestion des projets…, et
visent la consolidation des acquis et l'amé-
lioration des capacités techniques des parti-
cipants.
L'établissement a toujours été un acteur
actif du développement de sa région, son
histoire le conrme mais également le fait
qu'il soit au centre de l'ensemble des activi-
tés à caractère agricole relevant de la mise
en œuvre de programme de vulgarisation
local (journées d'information, journées
techniques de démonstration, journées
d'études…). C'est par ailleurs un lieu
incontournable pour les réunions et ren-
contres de professionnels.
Peut-on savoir le nombre d’agriculteurs et
cadre qui seront formés pour cette année ?
Quelles sont les lières qui suscitent plus
d’intérêt des agriculteurs en quête de for-
mation ?
Au titre de la saison 2015-2016, le nombre
de formé est estimé à 1 219 dont 416 cadres
du secteur et 803 agriculteurs et porteurs
de projets. Concernant l’année scolaire
2016/2017, le total des formés est de 2 283
dont 1 638 agriculteurs et porteurs de pro-
jet et 600 cadre du secteur. Les agriculteurs
s’intéressent beaucoup plus à la lière d’ar-
boriculture, l’élevage et l’apiculture.
L’engouement des agriculteurs vers les ses-
sions de formation consacrées aux tech-
niques à l’arboriculture, l’élevages (gros et
petits) et l’apiculture s’explique par le fait
que ces trois lières stratégiques sont les
plus développées dans la région et ne
nécessitant pas de grande surface agricole
utile (SAU). La formation pour ces produc-
teurs est un impératif quant à la pérennité
de ce type d’agriculture.
Quel sont les obstacles qui freinent le
développement de la formation et l’enca-
drement au niveau de votre Institut ?
En dépit des contraintes rencontrées, liées à
l’organisation et le fonctionnement de l’éta-
blissement notamment le budget de fonc-
tionnement exclusivement octroyé par
l’état demeure très insuffisant car plus de
80% sont consacrés aux seuls salaires des
employés. Aussi, l’Itmas ne peut assurer le
rayonnement dans sa région d’implanta-
tion, ni constituer un pôle de référence au
vu des moyens limités dont il dispose
(communication, transport, personnel
adapté…) Par ailleurs, l’établissement fonc-
tionne sur des textes dépassés, inadaptés
aux missions actuelles xées par la tutelle et
aux attentes de la profession et ne lui per-
met pas la mise en place de nouveaux cur-
sus de formation initiale plus adaptés. Le
manque de moyens limite les prestations et
activités de l’exploitation agricole annéxée
à l’établissement, ce qui ne leur permet pas
de constituer un modèles pour les agricul-
teurs et les cadres techniques, ni servir de
véritable appui pédagogique pour l’appren-
tissage de savoir-faire et pour la diffusion
du progrès technique.
Enn, l’absence d’une institution spéciali-
sée pour assurer une amélioration du
potentiel scientique, technique et pédago-
gique des formateurs par des formations
continues obligatoires.
Un mot à la n aux jeunes agriculteurs...
La formation des jeunes constitue un enjeu
majeur pour leur permettre d’acquérir un
métier, d’accéder à un niveau supérieur
(plus élevé) an de s’insérer dans le marché
du travail mais aussi pour réaliser des ajus-
tements de carrières, s’il y a lieu.
Le renouvellement des générations au sein
des exploitations familiales ou le retour des
jeunes vers l’agriculture, l’aide à l’installa-
tion des jeunes ainsi que l’insertion des
diplômés constituent autant de motifs pour
former massivement les jeunes. Cependant,
cette formation des jeunes doit être territo-
rialisée car c’est seulement cela qui va assu-
rer l’insertion des jeunes dans les terri-
toires. En n, une formation c’est bien…
Une formation qui débouche sur un
métier, c’est mieux.
D. W.
SAÏD TAMEN, DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE MOYEN AGRICOLE SPÉCIALISÉ EN AGRICULTURE
DE MONTAGNE (ITMAS) DE BOUKHALFA
“Une formation c’est bien… une formation
qui débouche sur un métier, c’est mieux”

nPar BILEL BOUDJ
Le programme en question se
base sur l’évaluation interne de
l’entreprise eectuée par ses
employés et collaborateurs. “Il
y a pas mal d’entreprises algé-
riennes qui sont aujourd’hui
intéressées par développer leur marque
employeur, de se faire connaître et de pou-
voir développer leur pratique en ressources
humaines, mais aussi de se mesurer aux
multinationales”, nous cone Hamza
Idrissi, program manager de Best Places to
Work Algeria.
Pour cette seconde édition, 21 entreprises,
comprenant des multinationales, ainsi que
des entreprises algériennes, se sont inscrites
au programme. Il est à noter que les multi-
nationales restent majoritaires au niveau de
la participation, comme nous le fait remar-
quer M. Idrissi : “Le rapport est de 60%
d’entreprises étrangères et 40% d’entreprises
algériennes.”
Une certaine réticence de la part des entre-
prises algériennes vis-à-vis de cette opéra-
tiona été conrmée par notre interlocuteur
: “Aujourd’hui, les entreprises algériennes
n’osent pas encore demander à leurs collabo-
rateurs leurs avis. Il y a donc une réticence
de leur part. Souvent, ils sont orientés vers le
travail et la performance. Ils ne font pas le
point pour oser demander aux collabora-
teurs ce qu’ils pensent de l’environnement de
travail, et ce qui pourrait être amélioré.
C’est cette réticence là qui fait que les multi-
nationales sont de plus en plus ouvertes vu
qu’ils font partie d’organismes internatio-
naux où il y a une forte culture de l’entrepri-
se.”
Un moyen d’optimiser les ressources
humaines
Le but du programme se base sur dix
points essentiels dont l’évaluation et la
comparaison avec d’autres entreprises an
d’améliorer les pratiques de gestion du
capital humain, mesurer le degré de satis-
faction et le niveau d’engagements et de
bien-être des employés, l’accroissement de
la motivation des employés et leur senti-
ment d’appartenance à l’égard de l’organi-
sation mais aussi l’optimisation du lien qui
existe entre l’engagements des employés et
les résultats nanciers.
AD Display, première entreprise algérien-
ne dans le classement
Le palmarès 2017 n’a pas réellement oert
de surprise à part la 6eplace de l’entreprise
spécialisée dans l’achage, AD Display.
En 15 ans d’existence, l’acheur s’est fait
une belle place dans le domaine de l’a-
chage urbain et ore un environnement de
travail agréable, en atteste son classement.
Participant à la première édition, Novo
Nordisk, entreprise pharmaceutique spécia-
lisée dans le traitement du diabète, s’est his-
sée à la seconde position, deux places de
mieux par rapport à l’édition précédente.
Un classement considéré comme un plus
par le directeur des ressources humaines de
cette entreprise, Malek Touhami. “C’est
important pour nous de participer à ce type
de cérémonie et de classement, c’est pour
avoir une image de l’entreprise de la part
des employés et des collaborateurs qui
constituent la force de l’entreprise, donc ça
nous permet d’avoir une information et une
images vraies de notre entreprise à travers
un organisme externe qui va reéter la réali-
té de l’entreprise. L’an dernier, nous étions
quatrième, et cette année nous sommes
second ; ce qui veut dire qu’on a mis en
place des choses qui ont parlé aux collabora-
teurs et qui ont été utiles outre qu’elles ont
permis un meilleur environnement et climat
de travail au sein de l’entreprise.”
L’image d’une entreprise est aussi la per-
ception de ses collaborateurs, un plus que
nous fait remarquer notre interlocuteur.
“Cela nous permet d’avoir une image de
l’entreprise, de savoir ce que pensent les col-
laborateurs, de mettre des plans d’action, et
de savoir où est-ce que l’on se situe dans une
industrie et si on est bien classés… Cela
nous encourage à aller encore de l’avant,
c’est la voix des employés, des collabora-
teurs, ce qui permet d’avoir une réelle image
de l’entreprise aujourd’hui. À Novo Nordisk
en Algérie, on a toujours investi depuis des
années dans le développement des ressources
humaines et des compétences, dans la pro-
motion interne et que que cela soit en
Algérie ou à l’étranger, nous sommes une
des rares entreprises à envoyer beaucoup de
collaborateurs à l’international grâce à une
politique de développement des ressources
humaines.”
Les inscriptions au programme 2018 vont
bientôt commencer et on ne doute pas qu’il
y aura plus de participants.
B. B.
PROGRAMME MEILLEURS EMPLOYEURS EN ALGÉRIE
DHL succède à Bayer
Avec ces nouveaux dossiers de blan-
chiment d'argent dont «le soupçon
est avér», le nombre global des dos-
siers portant sur cette catégorie de délit
nancier a atteint 154 aaires transmises à
la justice depuis l'entrée en activité, en
2005, de la CTRF qui est placée auprès du
ministère des Finances.
La grande majorité de ces dossiers provient
des déclarations de soupçon adressées par
les banques à la CTRF, tandis que le reste
émane d'autres administrations comme les
douanes et la Banque d'Algérie sachant que
cette cellule n'est pas habilitée à procéder
par auto-saisine.
En somme, la CTRF a reçu 1 240 déclara-
tions de soupçon de la part des banques en
2016 (contre 1 292 déclarations en 2015) et
168 rapports condentiels de certaines
administrations (contre 159 rapports en
2015).
Les rapports envoyés par les banques et
établissements nanciers sont appelés
«déclarations de soupçon» alors que ceux
transmis par la Banque d'Algérie, les
douanes et la Direction générale des impôts
(DGI) sont intitulés «rapports conden-
tiels».
L'écart important entre le nombre de décla-
rations de soupçons transmises annuelle-
ment à la CTRF et celui des dossiers sou-
mis à la justice suite à ces rapports, s'ex-
plique par le fait que les banques déclarent,
souvent, les dépôts nanciers importants
qu'elles jugent suspects, alors que la CTRF
se prononce uniquement sur les aaires de
blanchiment avéré, en coordination avec
d'autres institutions nationales concernées.
D'autre part, la CTRF a signalé, dans le
cadre du partage d'informations et de la
coordination nationale, certaines aaires
aux institutions nationales concernées. Le
nombre de ces transmissions a avoisiné les
2 000 communications à la n 2016. 21
accords d'échange d'informations conclus
avec ses homologues étrangers.
Au plan international, la CTRF continue à
développer une politique de négociation
d'accords administratifs de coopération
bilatérale facilitant les échanges d'informa-
tions nancières entre les cellules de rensei-
gnements nanciers.
Dans ce cadre, elle a conclu à ce jour 21
mémorandums d'entente et d'échanges
d'informations avec des cellules homo-
logues d'Afrique, du Moyen-Orient,
d'Europe et d'Asie, indique-t-on de même
source.
Des informations sont également partagées
avec des cellules homologues dans le cadre
des demandes d'assistance internationale,
selon la CTRF qui a reçu, à ce jour, 79
demandes d'assistance internationale et
émis 129 demandes à ses partenaires étran-
gers.
Pour rappel, l'Algérie a été retirée en 2016
de la liste des pays et territoires non coopé-
ratifs du Ga (Groupe d'action nancière)
suite aux diérentes mesures prises, au
plan législatif et réglementaire, pour l'adap-
tation de son dispositif aux normes inter-
nationales en la matière.
En plus de la CTRF, d'autres aaires de
blanchiment d'argent et infractions sousja-
centes sont régulièrement traitées par
d'autres institutions nationales compé-
tentes en la matière que sont les pôles
pénaux spécialisés, la Police judiciaire sur
réquisition du parquet, les services du com-
merce, les administrations scale et doua-
nière ainsi que la Banque d'Algérie pour les
infractions à la législation des changes.
R. N.
La Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) a transmis, en 2016, à la justice une trentaine de dossiers de blanchiment
d'argent, a appris l'APS auprès d'un responsable de cet organisme spécialisé.
Semaine du 5 au 11 février 2017 5
ACTUALITÉ
RENSEIGNEMENT FINANCIER
Une trentaine de dossiers de blanchiment d'argent transmis
à la justice en 2016
Le mardi 1er février s’est tenue la deuxième édition de la cérémonie du programme
“Meilleurs
employeurs en Algérie”
, à l’hôtel Sofitel d’Alger. Le premier prix est allé à DHL, qui a été second en
2016, l’entreprise succède ainsi à Bayer.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%