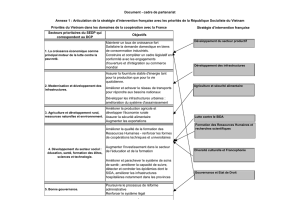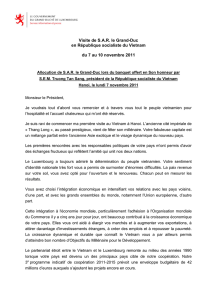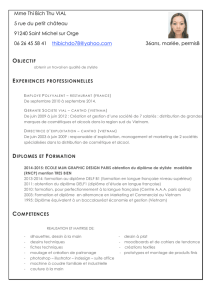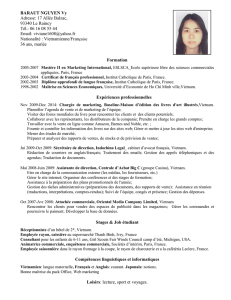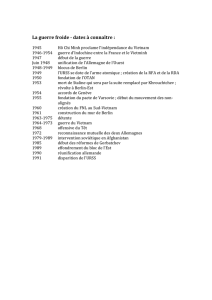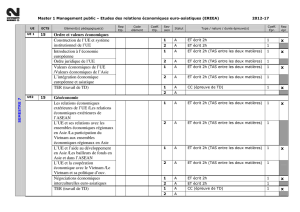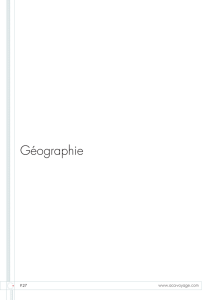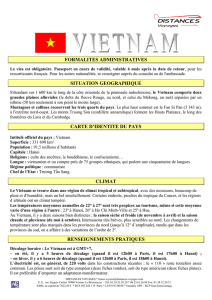Le Vietnam, dragon en puissance

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008
1
47 rue de Babylone • 75007 Paris • France
Tél. : 33 (0)1 53 63 37 70 • Fax : 33 (0)1 42 22 65 54
forum@futuribles.com • www.futuribles.com
Le Vietnam, dragon en puissance ?
COMPTE RENDU
DE LA TABLE RONDE DU 20 MARS 2008
Philippe Delalande : économiste, ancien directeur du bureau de la francophonie de Hanoi,
membre du groupe Asie 21, auteur de l’ouvrage Le Vietnam, dragon en puissance (Paris :
L’Harmattan, octobre 2007).
François Raillon : directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre Asie du Sud-Est à
l’EHESS, membre du groupe Asie 21.
Jean-Raphaël Chaponnière : économiste à l’Agence française pour le développement
(AFD), membre du groupe Asie 21.
Intervention de Philippe Delalande
Le Vietnam est un pays dont on a beaucoup
parlé par le passé pour des raisons
historiques mais que l’on mentionne peu
actuellement. En effet, c’est un pays très
pauvre, au PIB (produit intérieur brut) de
63 milliards de dollars US, soit 3 % du PIB
français, mais dont la croissance écono-
mique est forte et régulière puisqu’elle
atteint depuis plus de 15 ans 7,5 % par an
en moyenne. Ce pays est donc loin d’être
déjà un « dragon » comme le sont devenus
la Corée du Sud, Taiwan et Singapour, mais
il est clair qu’il peut le devenir à deux
conditions : qu’il parvienne, d’une part, à
s’insérer dans son environnement géopo-
litique et à tirer parti de ses avantages
comparatifs ; d’autre part, que la coexis-
tence d’un système de parti unique (le parti
communiste vietnamien) et d’une économie
de marché continue à être possible.
L’insertion dans son environnement géo-
politique est le premier défi que le Vietnam
se doit de relever. De fait, en 1990, le pays
était totalement isolé : l’occupation du
Cambodge par le Vietnam entre 1979 et
1989 avait mis le Vietnam au ban des
nations. L’embargo américain était rigou-
reux depuis la chute de Saigon en 1975. Par
ailleurs, la rupture avec la Chine en 1979 et
la fin de la coopération avec l’URSS en
1991 sont venus renforcer l’isolement
diplomatique et économique vietnamien.
Cependant, en l’espace de 10 années, le
Vietnam est parvenu à rompre son isole-
ment selon la chronologie suivante :
- 1991 : reprise des relations avec la Chine
- 1994 : levée de l’embargo américain
- 1995 : entrée dans l’ASEAN (Association
des nations d’Asie du Sud-Est)
- 1997 : sommet de la francophonie à Hanoi
- 2001 : accord commercial avec les États-
Unis
- 2006 : visite du président Bush à Hanoi
- 2007 : entrée à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).

2 Table ronde Futuribles du 20 mars 2008
En 2008, on peut dire que le Vietnam est
très bien inséré dans son environnement,
notamment depuis que l’ASEAN a instauré
une véritable zone de libre-échange. En
2005, a eu lieu le premier sommet de l’Asie
orientale qui prélude à l’organisation d’une
communauté intégrée réunissant les pays de
cette région du monde. Le Vietnam semble
avoir trouvé pour le moment un équilibre
dans ses relations avec la Chine d’un côté et
les États-Unis de l’autre, et a priori rien ne
peut venir ralentir cette intégration du
Vietnam dans l’aire de puissance qu’est
dorénavant l’Asie orientale.
En effet, le Vietnam présente de nombreux
atouts. Son poids démographique tout
d’abord, de 85 millions d’habitants, en fait
le deuxième pays le plus peuplé de la
région après l’Indonésie, au même rang que
les Philippines. En outre, sa population est
ethniquement homogène (87 % de Kinh),
ce qui est très rare dans cette région du
monde et renforce la cohésion nationale.
L’absence de musulmans dans la
population vietnamienne est également
actuellement un avantage, surtout aux yeux
des États-Unis et dans une période où
l’Islam asiatique se raidit dans les pays
voisins comme la Malaisie, l’Indonésie ou
encore la Thaïlande. Enfin, l’absence de
minorité chinoise au Vietnam due au départ
des Chinois à la fin des années 1970 (lors
de l’attaque de la Chine contre le Vietnam)
peut aussi être considérée comme un atout.
On observe dans tout le reste de l’Asie du
Sud-Est que les communautés chinoises,
souvent importantes en nombre, sont très
dynamiques et contrôlent des pans entiers
de l’économie de leur pays d’accueil. Ce
sont ces communautés qui servent
d’intermédiaires privilégiés dans les
relations avec la Chine, et qui font pro-
gresser les intérêts chinois dans les écono-
mies asiatiques en poussant à une inté-
gration dans l’aire d’influence chinoise.
Face à un tel phénomène, le Vietnam sans
diaspora chinoise paraît bien être le seul
pays capable de résister.
L’un des autres atouts clés du Vietnam est
sa stabilité sociopolitique garantie jusqu’à
présent par la toute-puissance du parti
communiste vietnamien. Cette caractéris-
tique est particulièrement enviable dans une
Asie du Sud-Est où les autres régimes
semblent d’une grande vulnérabilité. De
fait, dans les autres pays de la région, le
pouvoir se partage entre trois pôles : le
monde politique proprement dit, l’armée et
le milieu des affaires. Une telle organi-
sation du pouvoir repose sur des alliances
souvent éphémères, peu stables et qui sont
amenées à changer régulièrement. À l’in-
verse, le système de parti unique vietna-
mien élimine tout pouvoir autonome ;
l’armée, même si elle est très respectée, n’a
pas de marge de manœuvre propre. La
hiérarchie opérationnelle traditionnelle y est
doublée d’une hiérarchie politique parallèle
(les commissaires politiques aux armées)
qui a pour mission, entre autres, de
contrôler étroitement les militaires. De la
même façon, la vie économique et les
milieux d’affaires demeurent sous le
contrôle du parti communiste. En ce sens,
selon la diplomatie américaine, le Vietnam
est le pays le plus stable de la région, c’est
pourquoi il est l’enfant choyé des États-
Unis en Asie du Sud-Est.
Par ailleurs, la situation géographique du
Vietnam peut en faire un point stratégique
de première importance. Passage obligé sur
la route vers le détroit de Malacca, les côtes
du Vietnam sont pour le moment mal
aménagées. Toutefois, un port est actuelle-
ment en construction à Dung Quât, qui
pourrait devenir le seul port en eau pro-
fonde entre Hong Kong et Singapour, et
occuper ainsi une place de premier rang
dans cette zone où le commerce maritime
est l’un des plus denses au monde.
Tous ces atouts ont cependant quelques
limites. La construction de ce port ne peut
avoir de sens que si ce dernier est relié
efficacement à l’arrière-pays vietnamien et
indochinois. À l’heure actuelle, cela reste
peu probable dans la mesure où le réseau de

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008
3
routes et de voies ferrées vietnamien est
isolé et peu adapté aux standards inter-
nationaux (contrairement, par exemple, au
réseau chinois).
L’autre grande faiblesse du Vietnam est la
grande pauvreté de sa population. Le PIB
par habitant est en 2007 de 750 dollars US
seulement alors qu’il atteint 29 500 dollars
US à Singapour. Une telle différence est
notamment due à l’histoire du Vietnam qui
a vu aux 30 années de guerre succéder une
période de collectivisation qui n’a pris fin
qu’en 1986.
L’autre variable centrale, si l’on s’intéresse
à l’avenir du Vietnam, est le devenir de la
coexistence entre un système politique de
parti unique et le développement d’une
économie capitaliste. Jusqu’à présent, cette
coexistence a été bénéfique à la fois à
l’économie vietnamienne et au régime
communiste. En un sens, on pourrait même
affirmer que le parti communiste vietna-
mien a été sauvé par la mise en place d’une
économie de marché et par la croissance
économique qui s’en est suivie. De fait,
alors que l’économie était au bord de
l’asphyxie en 1986, le lancement des
réformes a permis au PC de rebondir. Quant
aux entreprises privées et aux investisseurs
étrangers, ils ont tiré parti d’une politique
stable depuis 1991 et structurée sur
quelques axes clairs.
Le premier principe appliqué par le PC
vietnamien a été de libérer les énergies et
de promouvoir un secteur privé important
tant dans l’agriculture que dans les secteurs
qui ne nécessitaient pas de lourd capital de
départ. Par ailleurs, un secteur public non
négligeable a été maintenu qui assure
toujours actuellement un tiers du PIB
vietnamien : il n’y a donc pas eu au
Vietnam de « Big Bang » libéral entraînant
une désorganisation totale de l’économie
comme cela a pu être le cas dans l’ex-
URSS par exemple. Néanmoins, le nombre
d’entreprises publiques est passé de 12 000
en 1991 à 30 00 actuellement. Le Vietnam
a dû réformer profondément le secteur
public.
Cette ouverture très prudente à l’économie
de marché s’est accompagnée du maintien
de nombreuses protections vis-à-vis de
l’étranger. Les investissements directs
étrangers doivent obtenir un agrément. Des
licences d’importations sont imposées alors
que le dong vietnamien n’est toujours pas
convertible, que le marché des changes est
très contrôlé et que le taux de change est, en
dernier ressort, fixé par le pouvoir
politique.
L’accueil des investisseurs étrangers a été
grandement amélioré et, depuis 2001, les
investissements étrangers sont en forte
progression.
La politique macroéconomique menée par
le gouvernement vietnamien est très clas-
sique : elle a visé à lutter contre l’inflation
(qui dépassait 700 % en 1988) et à atteindre
l’équilibre budgétaire.
L’ensemble de cette politique d’ouverture à
l’économie de marché fait l’objet d’un large
consensus au sein du parti communiste
vietnamien. Alors qu’en 2001 la fraction
libérale du parti réclamait une accélération
de l’ouverture au capitalisme, ces
revendications ont disparu au dernier
congrès du parti qui s’est tenu en 2006. En
effet, les responsables communistes vietna-
miens se sont rendu compte, notamment à
la suite des difficultés d’application de
l’accord commercial avec les États-Unis
(qui ont limité autoritairement les impor-
tations de textile et de crevettes du Vietnam
sur le marché américain), que la mon-
dialisation pouvait avoir des conséquences
désastreuses pour leur économie s’ils ne
continuaient pas à protéger leur marché
national et s’ils ne conservaient pas un
noyau dur d’entreprises publiques.
Les résultats de cette politique ont été
particulièrement positifs pour l’économie
vietnamienne. Le taux de croissance annuel

4 Table ronde Futuribles du 20 mars 2008
du PIB a été régulier, 7,5 % depuis 1991,
même s’il a été ralenti par les effets de la
crise asiatique entre 1998 et 2000. Le
développement économique et la dimi-
nution de la pauvreté, de 60 % en 1990 à
17 % en 2007 selon la Banque mondiale,
ont renouvelé la légitimité politique du parti
communiste. Ce dernier a élargi sa base :
depuis la réforme de 2006, le parti
communiste accueille des chefs d’entreprise
et des cadres du secteur privé. Le milieu des
affaires, loin de se sentir exclu du système,
parvient à des positions de pouvoir au sein
du parti unique et s’en fait donc le
défenseur.
Quelques bémols sont cependant à souli-
gner. Les prises de décision sur des
problèmes essentiels restent très lentes dans
la mesure où, pour éviter l’apparition d’une
minorité permanente qui pourrait se
structurer en force d’opposition, un large
consensus est toujours recherché. En outre,
l’entrée au PC de cette nouvelle catégorie
de cadres du privé a eu pour conséquence
de faire entrer les conflits de société au sein
du parti. Les restrictions aux libertés restent
très importantes : répression de
l’opposition, contrôle des moyens d’infor-
mation, absence d’indépendance de la
justice. La corruption et les abus de pouvoir
sont très répandus. Les écarts sociaux
s’accroissent. La société vietnamienne
semble accepter cependant ces contraintes
pour différentes raisons. Le fond culturel
chinois, très présent dans la société viet-
namienne, fonde la légitimité du pouvoir
non sur l’origine du pouvoir mais sur
l’efficacité de ce même pouvoir. Le
désordre est considéré comme le mal absolu
et l’harmonie sociale se gagne par le
consensus progressif. Il y a là un terreau
propice au parti unique.
Un autre problème auquel le Vietnam est
confronté est sa vulnérabilité économique.
L’économie vietnamienne reste trop dépen-
dante des marchés extérieurs ; le marché
intérieur est peu important et les produits
chinois y gagnent de plus en plus de terrain.
Par ailleurs, l’inflation a tendance à
reprendre sous la double influence de la
surchauffe économique nationale et de la
conjoncture mondiale. On prévoit 17 %
d’inflation en 2008.
Malgré ces quelques réserves, on peut être
assez optimiste pour l’avenir de l’économie
vietnamienne. L’alliance, a priori contre
nature, entre le parti communiste et l’éco-
nomie de marché peut fonctionner encore
longtemps, le temps en tout cas nécessaire
pour que le Vietnam devienne un vrai
« dragon », d’ici 10 à 20 ans.
L’intervention de Philippe Delalande a été
complétée par deux interventions de cher-
cheurs connaissant également bien le pays.
Intervention de François Raillon
La première remarque de François Raillon
porte sur la qualité de l’ouvrage de Philippe
Delalande, très clair et très nuancé.
Toutefois, il émet quelques réserves sur
l’optimisme exprimé dans le livre quant à la
stabilité intérieure future du Vietnam. En
effet, on assiste à l’émergence d’une classe
moyenne qui risque, tôt ou tard, de récla-
mer des libertés politiques. Par ailleurs,
certains handicaps du Vietnam lui semblent
avoir été sous-estimés. Le Vietnam ne
possède pas de flotte commerciale ni
militaire, ce qui est une faiblesse impor-
tante ; de même, sa capacité de projection
est quasi nulle. Dans une Asie du Sud-Est
en pleine expansion, le leadership de
l’ASEAN est fortement disputé et l’Indo-
nésie paraît être en meilleure position que le
Vietnam pour s’en saisir. Enfin, la stratégie
économique du Vietnam, tourné vers les
exportations, peut fragiliser le pays alors
que le marché intérieur, contrairement à
celui de la Chine, ne peut guère prendre le
relais en cas de difficultés extérieures.
Intervention
de Jean-Raphaël Chaponnière
Le Vietnam parvient à relever le défi
chinois avec plus de succès qu’on ne le

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008
5
pense généralement. Certes, les produits
chinois sont très présents au Vietnam (deux
millions de motos chinoises y sont vendues
chaque année par exemple) mais c’est le cas
dans la plupart des pays du monde. L’éco-
nomie vietnamienne parvient en réalité à se
défendre face à la toute-puissance chinoise :
elle prend des parts de marché à la Chine
sur le marché américain ainsi qu’en Europe
et la vente de produits vietnamiens pro-
gresse fortement (même s’il est vrai qu’elle
est partie de très bas) : de 35 % par an aux
États-Unis par exemple. Les investisseurs
taiwanais, coréens et japonais se tournent
de plus en plus vers le Vietnam.
En outre, la nécessité d’une insertion
régionale du Vietnam peut être discutée
dans la mesure où ce ne sont pas les
exportations qui sont le moteur de la
croissance vietnamienne mais les investis-
sements qui représentent 37 % du PIB, et la
consommation.
Une troisième question importante est celle
de la voie de développement qui sera
choisie par le Vietnam. Sur 85 millions
d’habitants, 75 % sont encore des ruraux.
Le Vietnam va-t-il avoir une évolution
proche de celle de la Thaïlande, qui, trois
fois plus riche que le Vietnam, a encore
60 % de ruraux dans sa population ? Ou
bien va-t-il suivre le modèle taiwanais où
l’on est passé de 60 % de ruraux en 1960 à
30 % en 1980 ? Actuellement, le Vietnam
tente, de la même façon que la Chine, de
réguler les flux migratoires intérieurs par un
système de passeports, mais le peu de
disponibilité en terres agricoles est un
problème majeur.
Extraits des débats
Quid de l’évolution démographique du
Vietnam et du fait qu’il n’y aurait pas
eu de limitation des naissances dans ce
pays ?
Ph.D. : En réalité, des efforts considérables
ont été faits pour limiter les naissances,
même s’il est vrai que les sanctions pour
les contrevenants ont été moins fortes
qu’en Chine. Le taux de fécondité au
Vietnam est actuellement de deux enfants
par femme ; le taux de croissance de la
population vietnamienne est inférieur à
celui des Philippines et de l’Indonésie. On
prévoit donc une population de 100 mil-
lions d’habitants d’ici 15 ans.
F.R. : Un ajout peut être fait concernant
l’absence de terres agricoles disponibles.
Dans un contexte de rareté de la terre, les
territoires montagneux du Vietnam, situés
dans des zones frontières, prennent toute
leur importance. Ces territoires des mino-
rités ethniques, sous-peuplés, peuvent faire
l’objet de toutes les convoitises.
J.-R.C. : Le problème démographique n’en
est pas réellement un. Dans les 10 pro-
chaines années, les dernières cohortes les
plus nombreuses vont arriver sur le marché
du travail, puis le nombre de nouveaux
actifs va se réduire. Par ailleurs, le taux de
mortalité reste élevé au Vietnam et le
nombre d’avortements est également l’un
des plus élevés au monde.
Qu’en est-il de la qualification de la
main-d’œuvre vietnamienne et des poli-
tiques éducatives lancées par le gouver-
nement vietnamien ?
Ph.D. : Après 1986, une politique de
rigueur a été mise en place, qui a eu pour
conséquences une diminution drastique des
moyens pour l’éducation, la santé et la
défense, et donc une forte dégradation des
services publics. Depuis 2000, les
ressources budgétaires ont augmenté et le
gouvernement vietnamien a de nouveau
investi dans le domaine de l’éducation,
souvent au bénéfice des universités privées
 6
6
1
/
6
100%