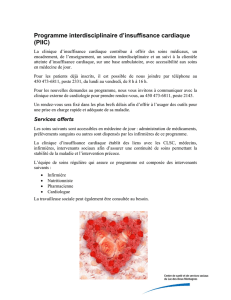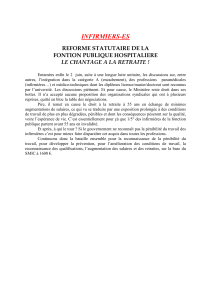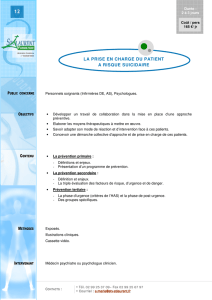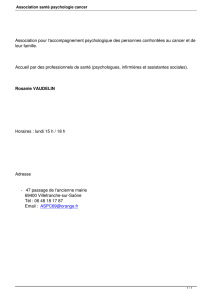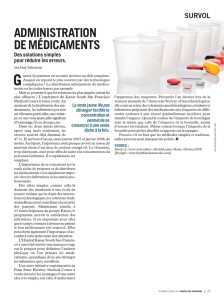Plan cancer : Quelles implications pour les infirmières ?

Les nouvelles de l’AFIC
3
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.6-n°2-avril-mai-juin 2006
Aujourd’hui en France, plus d’un cancer sur
deux est guéri chez la femme et environ trois
sur quatre chez l’enfant. Pourtant, chaque
année, le cancer tue 150 000 personnes et 280 000 nou-
veaux cas sont diagnostiqués. En 10 ans, il aura tué
autant que la première guerre mondiale.
C’est pourquoi, le 14 juillet 2002, le Président de la
République, Jacques Chirac, a lancé en France le plan
Cancer. Ce programme s’étale sur cinq années et com-
porte six grands axes : la prévention, le dépistage, les
soins, l’accompagnement social, la formation et la
recherche. Il prévoit également la création d’un Institut
national du cancer dont la fonction principale est de
coordonner l’ensemble des actions menées dans la lutte
contre le cancer. Son objectif est de diminuer, d’ici 2007,
la mortalité par cancer de 20 %.
Pour se faire, 70 mesures ont été adoptées. Certaines
ont un impact direct sur les infirmières. Afin de com-
prendre quelles implications ce plan a au niveau infir-
mier, il convient de reprendre chacun des six grands
chapitres qui le composent.
La prévention
Ce chapitre comprend quatre volets : la lutte contre
le tabagisme, la lutte contre l’alcoolisme, la promotion
de l’hygiène alimentaire et la prévention du mélanome.
La lutte contre le tabagisme
Toutes les infirmières ont un rôle à jouer dans la
lutte contre le tabac afin de faire respecter l’interdic-
tion de fumer à l’hôpital, d’encourager les patients à
arrêter de fumer et d’orienter vers les consultations
antitabac ceux qui le souhaitent. Désormais un cha-
pitre tabac sera inclus dans le programme de forma-
tion des soignants.
Un rôle plus spécifique est attribué aux infirmières
de médecine du travail (en matière d’information), aux
infirmières de maternité (pour les futurs parents pen-
dant la grossesse et après l’accouchement) et aux infir-
mières scolaires (pour les campagnes de prévention
et la délivrance de substituts nicotiniques puisqu’elles
sont habilitées à le faire).
Plan cancer :
Quelles implications
pour les infirmières ?
Olivia RIBARDIÈRE
Cadre de santé, AFIC
96763 03-6 6/12/06 21:21 Page 3
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Les nouvelles de l’AFIC
4
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.6-n°2-avril-mai-juin 2006
La lutte contre l’alcoolisme
Toutes les infirmières se doivent désormais de repé-
rer les buveurs excessifs et d’avoir une démarche de
conseil, d’information et d’orientation à leur égard. Pour
cela, une formation aux repérages précoces de ces per-
sonnes sera incluse dans le cursus de formation du per-
sonnel soignant.
La promotion de l’hygiène alimentaire
Ce point concerne principalement les infirmières sco-
laires ou celles travaillant auprès des enfants (crèches,
protection maternelle et infantile…) afin qu’elles parti-
cipent aux campagnes de sensibilisation, d’information
et de conseil auprès des enfants et des parents. Cela peut
passer, par exemple, par l’implantation de fontaines à
eau dans les écoles.
La prévention du mélanome
Ce point concerne également toutes les infirmières
qui se doivent d’assurer un repérage lors des soins, une
information, des conseils et de la prévention auprès des
enfants et des adultes.
Le dépistage
Le plan prévoit une sensibilisation de toutes les
infirmières au dépistage du mélanome et à l’informa-
tion spécifique des femmes à propos de l’importance
du suivi gynécologique.
Les infirmières les plus concernées par cette mesure
sont surtout celles de la médecine du travail, du plan-
ning familial et des maternités parce que leur lieu
d’exercice est plus favorable à la circulation des infor-
mations sur le dépistage.
Les soins
Ce plan implique que les infirmières apprennent à
travailler davantage en équipe et en réseau avec les
infirmières d’un même établissement, d’unités mobiles
de douleurs ou de soins palliatifs, par exemple les infir-
mières d’autres établissements et les infirmières
libérales
Mais les infirmières doivent aussi développer leur
capacité de travail en partenariat, que ce soit à l’hô-
pital ou en ville, avec les médecins, les psychologues,
les kinésithérapeutes, les assistantes sociales, les béné-
voles, les associations…
Toutes les infirmières se doivent d’avoir une impli-
cation plus importante dans la prise en charge de la
douleur, de la fatigue, de la qualité de vie, de la psy-
chologie du patient et de ses proches. Cela passe par
la création d’unités mobiles douleur ou soins pallia-
tifs dans les établissements, par la formation du per-
sonnel à la psychosociologie ou encore par l’obten-
tion de diplômes universitaires de soins palliatifs, de
douleur, d’éthique, etc. Il convient toutefois de pré-
ciser que tout cela existait déjà avant le plan Cancer
mais que, depuis la mise en œuvre de ce plan, ces
diplômes et formations n’ont toujours pas été recon-
nus financièrement et statutairement.
Pour ce qui est des infirmières à domicile, le plan
prévoit le développement de l’hospitalisation et de la
chimiothérapie à domicile ainsi que de la surveillance
en postcure. Pour se faire, il suggère une revalorisa-
tion de la nomenclature des actes libéraux, ce qui sera
une réelle démarche incitative à l’égard des infirmières
libérales. En revanche, en ce qui concerne la forma-
tion des infirmières libérales par rapport aux chimio-
thérapies, à la prise en charge des effets secondaires
ou à l’utilisation du matériel spécifique comme les
pompes ou les diffuseurs par exemple, rien n’est orga-
nisé. À ce jour, la formation des infirmières libérales se
fait gracieusement par le biais des prestataires pour ce
qui est du matériel ; pour le reste, c’est à l’initiative des
infirmières, sur leurs deniers et leur temps personnel.
Par ailleurs, le plan Cancer insiste beaucoup sur
l’information du patient. Dans ce contexte, les infir-
mières vont être amenées, à terme, à participer aux
programmes personnalisés de soins (PPS) qui corres-
pondent à une sorte de parcours fléché du patient du
début à la fin de sa prise en charge. Elles devront éga-
lement prendre part au dossier communicant du
patient qui circule auprès de tous les professionnels
devant intervenir dans la prise en charge de celui-ci,
que ce soit à l’hôpital ou au domicile. Pour le moment,
les infirmières n’y ont pas accès mais cela devrait se
faire de façon progressive, notamment à travers les
consultations infirmières dont elles devront rendre
compte dans ces documents. Ces différents points sont
abordés dans les mesures 39 et 40 du chapitre III sur
les soins.
Ensuite, pour répondre à la surcharge des struc-
tures de soins, le plan Cancer prévoit de développer
davantage les réseaux, de rendre la spécialité plus
attractive et de redonner du temps aux soignants en
augmentant le personnel proportionnellement aux
96763 03-6 6/12/06 21:21 Page 4
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Les nouvelles de l’AFIC
5
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.6-n°2-avril-mai-juin 2006
extensions d’activité. À l’heure actuelle, peu de chose
a été entrepris pour rendre la spécialité plus attractive.
En effet, la spécialisation en cancérologie n’est tou-
jours pas reconnue. Par ailleurs, l’idée d’octroyer
davantage de personnel pour redonner du temps aux
soignants est tout à fait louable ; cependant, la pénu-
rie de personnel, toutes catégories professionnelles
confondues, dans le domaine de la santé est telle que
les quelques mesures prises en ce sens risquent de ne
pas suffire.
Par ailleurs, le plan Cancer a impliqué le dévelop-
pement de nouvelles structures d’accueil pour le
patient : hôpital de jour, hôpital de semaine, hospita-
lisation à domicile. Ces nouveaux modes de prise en
charge permettent d’améliorer la qualité de vie et le
maintien au domicile des patients. Pour les infirmières,
il induit de nouveaux modes de prise en charge en
termes de gestion du temps, de travail en réseau, de
mutualisation des moyens, de partage des informa-
tions, etc. Cela est bénéfique pour tous les acteurs :
pour les patients parce que la prise en charge est plus
adaptée à leurs besoins et pour les infirmières qui ont
ainsi eu l’occasion de repenser leur organisation et de
faire évoluer leurs pratiques.
En outre, les consultations infirmières, les consul-
tations psychologiques et les consultations d’annonce
de diagnostic prévues par le plan Cancer favorisent
l’installation d’une relation de confiance entre le patient
et les soignants. En effet, grâce à ces différentes consul-
tations qui ont lieu en amont, lorsque le patient vient
pour son traitement, il est déjà informé des grandes
lignes de sa prise en charge. Ses questions portent
donc sur des points plus précis et plus personnels.
L’information et la prise en charge psychologique du
patient et de ses proches sont donc de meilleure qua-
lité et cela contribue à dégager du temps utile dans
l’installation d’une relation de confiance entre soi-
gnants et soignés.
Grâce à ce plan et aux propos tenus par M. Douste
Blazy en avril 2005, lors de la conférence des ministres
européens de la Santé à Paris, au sujet d’une éven-
tuelle alliance européenne contre le cancer, il est pos-
sible d’espérer que, d’ici quelques années (voire
quelques décennies), les infirmières soient amenées
à participer à la rédaction de bonnes pratiques de soins
au niveau européen. Pour cela, il faudrait que l’ho-
mogénéisation des pratiques de soins se généralise au
plan local, régional et national.
L’accompagnement social
Grâce au plan Cancer, les bénévoles et les associa-
tions ont accès aux formations professionnelles. Ils
deviennent donc de réels partenaires dans la prise en
charge des patients. Cela devrait non seulement amé-
liorer la qualité de la prise en charge, mais également
faciliter le travail des soignants dans le sens où leur par-
ticipation peut permettre de dégager du temps aux pro-
fessionnels de santé. L’accompagnement social passe
donc par la mutualisation des connaissances et le par-
tage avec les bénévoles.
Par ailleurs, les infirmières se doivent d’informer les
patients et leurs proches sur des sujets tels que les arrêts
maladie, les remboursements, la prise en charge de cer-
tains dispositifs médicaux et esthétiques comme les per-
ruques, par exemple, ou encore les droits sociaux aux-
quels les parents d’enfants malades peuvent prétendre
afin de pouvoir être présents auprès de leur enfant
malade durant les traitements.
Le dernier point de ce chapitre concerne la présence
plus régulière des infirmières au domicile avec, à venir,
une réglementation précise en matière de chimiothéra-
pie à domicile (l’Afic participe d’ailleurs activement à
cette démarche).
La formation
Toutes les infirmières recevront au moment de la for-
mation initiale un apport obligatoire sur la prise en
charge du patient atteint de cancer, ce qui sera peut-être
un moyen de rendre la spécialité plus attractive.
Pour les infirmières concernées par la prise en charge
du cancer, le plan prévoit une meilleure accessibilité à
la formation continue en cancérologie. Mais, à l’heure
actuelle, rien de précis ni de concret n’a été entrepris en
ce sens.
Un projet est actuellement à l’étude. Il consiste à juger
de l’opportunité de développer une spécialisation soi-
gnante en cancérologie, avec un niveau master, une valo-
risation et une évaluation des acquis professionnels.
Cela, dans le but de « répondre à la surcharge des méde-
cins par une extension des compétences soignantes ».
L’idée semble bonne mais l’intention est peu valorisante
pour la profession. En effet, il aurait été plus intéressant
que ce projet soit tenu dans le but de proposer une évo-
lution professionnelle intéressante et enrichissante aux
infirmières.
96763 03-6 6/12/06 21:21 Page 5
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Les nouvelles de l’AFIC
6
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.6-n°2-avril-mai-juin 2006
La recherche
Même s’il n’est pas fait mention d’elles dans ce cha-
pitre de la recherche, les infirmières ont un rôle impor-
tant à y jouer. En effet, il est prévu que, d’ici 2007, au
moins 10 % des patients bénéficient d’essais cliniques.
Mais, qui dit essais cliniques, dit également surveillance,
participation à la rédaction et à l’application des proto-
coles, etc. Or, qui assure ce rôle, si ce n’est l’infirmière ?
Il est également question dans ce chapitre de déve-
lopper la recherche en sciences sociales et la recherche
sur l’éducation à la santé. Pour le moment, c’est le parent
pauvre de la recherche, dans le sens où très peu de chose
est fait dans ce domaine. Mais, là encore, les infirmières
n’auraient-elles pas à un rôle à jouer ? Puisqu’il sera
question de qualité de vie et d’éducation à la santé, ne
serait-il pas intéressant de faire appel à des profession-
nels dont c’est le souci quotidien ?
La non-mention des infirmières dans ce dernier cha-
pitre est pour le moins curieuse : maladresse du légis-
lateur ou intention délibérée ?
Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble, ce plan accorde
assez peu de place aux infirmières, comme s’il n’osait
ou ne savait pas exploiter leur potentiel. En tout état de
cause, il ne les implique pas suffisamment. Il suffit de
demander à ces dernières ce qu’elles ont constaté comme
changements dans leur activité professionnelle depuis
la mise en place de ce plan, pour constater le faible
impact de ces mesures sur leur quotidien.
Cela dit, ce plan a tout de même le mérite de mettre
en évidence la difficulté que représente la prise en charge
globale du patient :
- sur le plan social (regard de la société sur le cancer,
accès des malades aux assurances et aux emprunts ban-
caires…) ;
- sur le plan professionnel (notamment en matière
de maintien dans l’emploi) ;
- sur le plan familial (aujourd’hui les crèches muni-
cipales organisent la garde des enfants pendant le trai-
tement des parents, des établissements comme l’institut
Gustave-Roussy, de Villejuif, proposent des groupes de
paroles pour expliquer aux enfants la maladie de leurs
parents…) ;
- sur le plan psychologique (avec une réelle prise en
charge de cette dimension) ;
- et enfin sur le plan clinique (avec une volonté de
personnaliser les soins et d’améliorer la qualité des pres-
tations).
Tout cela permet, également, une certaine recon-
naissance des professionnels qui, il faut le dire, en man-
quent de plus en plus.
Par ailleurs, ce plan propose de belles opportunités
de partage et d’échange avec différents acteurs.
Mais, surtout, il place le patient au cœur de sa prise
en charge. Il faut savoir que cela correspond à une réelle
volonté politique en France puisque, indépendamment
de ce plan Cancer, un certain nombre de textes de lois
(lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005) vont justement
en ce sens et octroient aux patients des droits qu’ils
n’avaient pas avant, notamment en matière d’accès à l’in-
formation et de pouvoir décisionnel sur les thérapeu-
tiques les concernant.
Ce plan, même s’il est perfectible, représente donc
une belle avancée dans la lutte contre le cancer. ■
96763 03-6 6/12/06 21:21 Page 6
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
1
/
4
100%