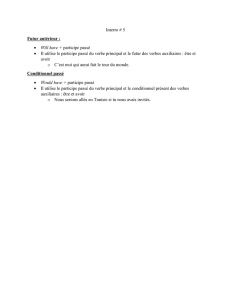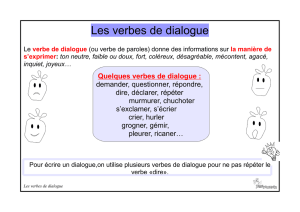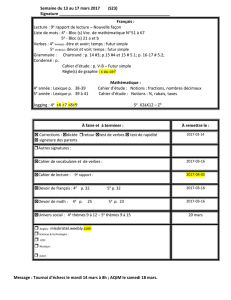1 Auxiliaires, langues romanes et grammaticalisation Béatrice

1
Auxiliaires, langues romanes et grammaticalisation
Béatrice Lamiroy
KULeuven
The moment a verb is given an infinitival
complement, that verb starts down the road of
auxiliariness. It may make no more than a start
or travel all the way (Bolinger 1980:297)
1. Introduction.
Cet article a pour but d’examiner les auxiliaires de temps, d’aspect et de mode dans trois
langues romanes, à savoir le français, l’espagnol et l’italien
1
à la lumière du modèle de la
grammaticalisation. Plus particulièrement, l’hypothèse que j’aimerais défendre ici est que
certaines des propriétés qui opposent les structures à auxiliaire dans les trois langues ne
s’expliquent de façon satisfaisante que si on adopte ce cadre théorique.
Il est évident que les trois langues présentent de nombreux cas, aussi bien du point de vue
lexical que syntaxique, tout à fait analogues, voire identiques:
(1) F Jean (termine de + commence à) manger
E Juan (termina de + comienza a) comer
I Gianni (termina di + comincia a) mangiare
Il est évident également que les différences caractérisant les trois langues correspondent
parfois à des idiosyncrasies lexicales (2-3). Par ailleurs, certains traits qui opposent les
langues n’affectent que deux langues sur trois, les paires de langues n’étant d’ailleurs pas les
mêmes dans tous les cas. Ainsi, le français et l’espagnol ont développé un futur périphrastique
et un passé “récent” à l’aide des verbes F aller, venir et E ir, acabar que l’italien ne connaît
pas (4). D’autre part, l’italien et l’espagnol font toujours usage des verbes stare, andare,
venire vs estar, andar, venir suivis du gérondif V-ndo pour exprimer l’aspect duratif, alors que
ce tour appartient à la langue littéraire en français (5). Et finalement, si le français et l’italien
font alterner les auxiliaires F être et avoir, I essere et avere pour les temps composés du
passé, l’espagnol actuel ne connaît que l’auxiliaire haber
2
pour former ses temps composés
(6):
(2) E Olivia se echó a reir
F * Olivia s’est jetée à rire
(3) I Presero a conversare una sera, sul treno che li riportava, in fine
settimana, a casa (N. Ginzburg, cité Moretti & Orvieto 1984:104)
F * Ils prirent à converser un soir, dans le train qui les ramenait le
week-end à la maison
‘Ils se mirent à converser ..’
(4) F Antoine (va + vient de) tomber
E Antonio (va a + acaba de) caer
I Antonio (*va a + * viene da) cadere
1
Je tiens à remercier chaleureusement Dieter Vermandere pour ses jugements concernant l’italien.
2
L’espagnol ancien a connu l’alternance des deux auxiliaires, ser y haber, pour ne retenir finalement que haber,
après une longue période de flottement (Benzing 1931).

2
(5) E Va diciendo por ahi que le maltratan
Il va disant par là qu’on le maltraite
‘Il raconte partout qu’on le maltraite’
I Va gridando tutto il giorno
Il va criant toute la journee
‘Il crie toute la journée’
F Le canal allait se perdant (Camus, cité Grevisse 1994:1194)
(6) F Il est mort/ il a dormi
I È morto/ha dormito
S Ha muerto/ha dormido
Dans ce qui suit, je n’examinerai que les structures à auxiliaire où le verbe se fuit suivre d’un
infinitif, introduit ou non par une préposition. J’exclus donc de mon analyse les tours
construits à l’aide du gérondif, illustrés en (5), et les temps composés construits à l’aide d’un
auxiliaire plus participe passé, tels les exemples de (6).
Avant d’aborder les données empiriques devant justifier mon hypothèse, j’esquisserai, en
m’inspirant essentiellement des travaux de Heine et al. (1991), Heine (1993), Hopper &
Traugott (1993) et Traugott & Heine (1991), les grands principes de la théorie de la
grammaticalisation. Si ces travaux se fondent pour la plupart sur des données empruntées à
des langues typologiquement très éloignées des langues romanes,
3
on verra que les
généralisations auxquelles ils aboutissent s’appliquent de façon remarquable aux faits romans
(& 2).
Comme les auxiliaires correspondent à une classe difficile à définir, je rappellerai rapidement
un certain nombre de caractéristiques que je retiendrai comme essentielles. Ce faisant,
j’établirai un lien avec le concept de grammaticalisation tel qu’il aura été défini au préalable.
Je renverrai ici surtout à des faits appartenant au français (& 3).
Finalement, je passerai en revue une série de données appartenant aux autres langues romanes
pour montrer que le français est, des trois, celle qui s’est grammaticalisée le plus, l’espagnol le
moins (& 4).
2. Le concept de grammaticalisation.
Par grammaticalisation, terme forgé par Kurylowicz (1965), on entend le processus qui
consiste à convertir graduellement des entrées lexicales pleines en éléments grammaticaux,
voire en morphèmes. Il s’agit donc d’un phénomène essentiellement dynamique, ou encore,
comme dit Hopper (1987:148), de ‘grammaire émergente’ (emergent grammar), notion qu’il
définit comme ‘un mouvement vers une structure’ (movement toward a pattern).
On peut associer la grammaticalisation à quatre paramètres qui sont révélateurs du processus.
S’ils contribuent tous un à un à détecter qu’un phénomène de grammaticalisation est en train
de se mettre en place ou de s’accomplir (selon le stade auquel on se trouve sur la chaîne), ils
sont en même temps corollaires l’un de l’autre, bien qu’ils ne doivent pas - c’est important de
le souligner - coïncider chronologiquement. Ces quatre paramètres sont de nature sémantique,
morphosyntaxique, morphophonologique et phonétique respectivement.
Quant au paramètre sémantique, la grammaticalisation implique une désémantisation
(Damourette & Pichon 1911-1936) ou, pour calquer le terme de Lehmann (1982), une
‘javellisation’ (semantic bleaching), c’est-à-dire que l’entrée lexicale se vide progressivement
de son sens plein pour acquérir en revanche un sens fonctionnel, grammatical.
3
Ainsi, B. Heine et son équipe travaillent essentiellement sur des langues africaines.

3
La notion de désémantisation appelle une double mise en garde. D’une part, comme l’a fait
remarquer à juste titre Traugott (1980: 47), l’appauvrissement sémantique n’est pas à
concevoir en terme de pure perte, dans la mesure où il permet de passer d’un sens plus
référentiel à un sens moins référentiel ou plus abstrait: d’une certaine façon, on gagne au
change puisque la langue acquiert ainsi de nouveaux moyens linguistiques, qui renvoient
moins au monde concret dont on parle qu’à l’organisation de celui-ci par les locuteurs,
4
en
termes de modalité ou de temps, par exemple.
D’autre part, la désémantisation d’un élément linguistique entraîne un changement du point de
vue de la distribution, qui peut également être considéré comme un élargissement plutôt qu’un
appauvrissement (Heine 1993:54). Si la désémantisation implique bel et bien un
rétrécissement sémantique dans la mesure où il y a perte de traits sémantiques originaux, elle
signifie en même temps un enrichissement, car l’élément linguistique qui se grammaticalise
peut être utilisé dans plus de contextes au fur et à mesure que ses restrictions
distributionnelles se diluent. Dans la mesure où il y a disparition progressive de la
proéminence distributionnelle (et peut-être cognitive) de sujets humains, l’élément
grammaticalisé se prête à renvoyer à des situations dont il pourra spécifier, par exemple, le
rapport avec le moment de l’énonciation (le temps), les limites initiale ou finale, la durée ou la
vitesse
5
(l’aspect) ou encore, la façon dont le rapport avec la réalité est envisagé (la
modalité).
6
En ce qui concerne le paramètre morphosyntaxique, la grammaticalisation implique une
décatégorialisation, pour employer la terminologie de Hopper & Thompson (1984). En effet,
si un verbe se situe sur une chaîne de grammaticalisation, il tend à neutraliser ou à perdre
même complètement ses privilèges syntaxiques de catégorie lexicale majeure (N et V) pour
adopter un comportement qui ressemble plus à celui des catégories lexicales secondaires,
telles que l’adjectif, la préposition ou l’adverbe. En l’occurrence, le verbe perd en capacité de
sélection: sa valence ou sa force de subcatégorisation diminue ou finit même par disparaître.
Un symptôme particulier mentionné par Heine (1993: 75), pertinent pour la suite de notre
propos, consisterait dans le fait que le verbe tend de moins en moins à sélectionner des
syntagmes nominaux pour s’associer de plus en plus à des types de verbe non finis ou non
tensés, tel l’infinitif. En outre, si au stade source, un verbe sélectionne typiquement un
complément renvoyant à un référent concret, une fois que le processus de grammaticalisation
est entamé, il aura davantage tendance à se joindre à des compléments renvoyant à des
situations. Le rapport avec ce que nous venons d’observer du point de vue sémantique est bien
sûr évident.
Notons que si l’affaiblissement de la capacité de sélection est un élément-clé de la
décatégorialisation, il n’en est toutefois pas le seul symptôme. Dans le cas des verbes par
4
C’et la raison pour laquelle Traugott (1980) dit que les marqueurs grammaticaux acquièrent un sens
pragmatique.
5
Les données sur lesquelles les travaux de Heine et son équipe se basent sont surtout empruntées aux langues
africaines. Il est intéressant de noter que la vitesse est considérée comme un concept aspectuel, ce qui n’est pas
souvent le cas dans la tradition des langues romanes. On verra toutefois que la question mérite d’être posée, en
particulier pour l’espagnol et l’italien.
6
Lorsque le stade “source” est un verbe lexical et le stade “cible” un verbe TAM, c’est-à-dire une expression de
type temps-aspect-mode, il y aurait parmi ces trois catégories un certain ordre sur la chaîne de
grammaticalisation: ainsi le temps serait plus près de la cible que l’aspect (Lamiroy 1987; Traugott 1989), les
modaux occupant une position intermédiaire. Pour ces derniers, on devrait encore distinguer entre les
épistémiques qui se rapprochent davantage du stade “cible” et les déontiques, qui sont plus proches en termes
relatifs du stade “source” (Kronning 1995). On peut donc schématiser comme suit:
(i) verbe lexical > aspect > m. déontiques > m. épistémiques > temps > affixe

4
exemple, qui est la catégorie qui nous intéresse ici, on observe que d’autres propriétés, tenues
pour essentielles de la catégorie, disparaissent aussi graduellement, telle la capacité d’être nié
séparément, ou de pouvoir se mettre à l’impératif ou au passif. Un verbe peut même aller
jusqu’à perdre une de ses propriétés essentielles, à savoir sa capacité de flexion.
7
On observe souvent, corollairement, que c’est le complément verbal qui récupère alors
certaines des propriétés majeures que le premier verbe a perdu, telle la capacité de sélection, la
passivation, etc. Un exemple frappant de ce phénomène se trouve en italien où c’est le second
verbe qui impose jusqu’à son auxiliaire au premier verbe:
8
(7) a. Gianni ha lavorato molto
Jean ha beaucoup travaillé
b. Gianni ha cominciato a lavorare
Jean a commencé à travailler
c. È caduta la pioggia
Est tombée la pluie
‘La pluie est tombée’
d. È cominciata a cadere la poggia
Est commencée à tomber la pluie
‘La pluie a commencé à tomber’
Le paramètre morphophonologique renvoie au fait qu’un élément qui se grammaticalise tend à
se transformer en un opérateur par rapport à ce qui au départ était son complément, pouvant
devenir ainsi un appendice morphophonologique de celui-ci. La cohésion syntaxique de
l’unité constituée par les deux éléments peut ainsi devenir étroite au point où l’élément
grammaticalisé finit par perdre son statut de morphème libre pour se souder en tant que
morphème lié à ce qui fut autrefois son complément. Autrement dit, le mot se convertit en
affixe, et le complément devient radical.
L’histoire des langues romanes fournit une série d’exemples de ce phénomène, notamment la
formation des adverbes en -ment, la formation du futur synthétique chanterai, issu de la
structure périphrastique cantare habeo.
Le paramètre phonétique, enfin, renvoie au fait que l’élément qui se grammaticalise peut finir
par s’éroder phonétiquement.
9
On voit le rapport entre ce dernier paramètre et les précédents: plus un verbe se désémantise,
plus sa valeur informative diminue, ce qui revient à dire qu’il est apte à s’employer dans un
plus grand nombre de contextes. Par conséquent, sa fréquence risque d’augmenter. Comme
cela a souvent été remarqué (Bybee et al. 1992, Croft 1990), il y a une double corrélation entre
valeur informative et fréquence, d’une part - les marqueurs grammaticaux s’emploient plus
fréquemment que les lexèmes pleins - et entre fréquence d’usage et volume phonétique,
d’autre part - les mots les plus fréquents étant en général les mots les plus courts. Fréquence et
érosion phonétique vont donc de pair .
7
On observe le phénomène en anglais, par exemple, pour certains auxiliaires, notamment may ou must.
8
Cette règle connaît toutefois des exceptions (voir Renzi & Salvi 1991: 517):
(i) a. Ci sono saputo andare da solo
Y (je) suis su aller seul
‘J’ai su y aller tout seul’
b. Ho/*sono saputo andare da solo a casa
(J’) ai/ suis su aller seul à la maison
‘J’ai su aller tout seul à la maison’
9
On en trouve une série d’exemples en anglais actuel, ainsi la forme gonna < going to, I’ll < I will, you’re < you
are, he’s gone
<
he is gone, etc.

5
Quant à la question de savoir quel type de verbes ont le plus de chances de se grammaticaliser,
il apparaît (Heine 1993: 29) que ce sont en général des verbes qui du point de vue sémantique
s’approprient à un grand nombre de contextes, c’est-à-dire des verbes qui ont un degré
relativement élevé de généralité. Ainsi, un verbe comme aller aura une plus grande probabilité
de grammaticalisation que nager ou flâner. Et si un verbe de position
10
se grammaticalise, il y
a plus de chances que ce soit le verbe être assis que être assis à califourchon, etc. En
particulier, les auxilaires semblent dériver très souvent d’un nombre limité de concepts
concrets qui figurent ici sous a-g. A chaque type de concept correspond un type de verbe que
j’illustre avec des exemples empruntés aux langues romanes:
(8) a. la position : F être, rester E quedarse (rester);
b. le mouvement: F aller, venir E volver (retourner) I tornare
(retourner);
c. l’activité (ou une de ses phases): F commencer, terminer I finire
(finir)
d. le désir: E morirse (mourir d’envie) I agognare (brûler d’envie),
ambire (avoir l’ambition);
e. la position: E estar I stare
f. la relation: F sembler E parecer
g. la possession F avoir E tener.
Si un très grand nombre de langues semblent puiser dans ce petit stock de concepts concrets
pour forger leurs auxiliaires, il est évident que toutes ne font pas appel avec la même intensité
à toutes les catégories. C’est ce que nous observons également pour les trois langues romanes
en question: toutes trois font appel, en gros, à ces sept types de verbes, mais le type d, par
exemple, est bien plus productif en espagnol et en italien qu’en français, comme je le
montrerai dans § 4.
3. La catégorie AUX
Je n’aborderai pas ici les problèmes de définition que posent les auxiliaires (Lamiroy 1994
11
,
1995, 1997), je me contenterai de rappeler la définition universelle de Steele et al. (1981) ainsi
que les arguments majeurs qui plaident en faveur d’une analyse des auxiliaires en termes de
grammaticalisation.
D’après la définition de Steele et al. (1981), tous les membres de la catégorie AUX partagent
les trois traits suivants: 1° ce sont des constituants 2° ils ont un comportement syntaxique
particulier qui les distingue de toutes les autres catégories et 3° ils situent la proposition
entière soit sur l’axe chronologique du temps, soit du point de vue du contour temporel interne
(l’aspect) soit du point de vue du degré de réalité (la modalité).
En l’occurrence, pour les langues romanes, le constituant AUX est de nature verbale. Bien
qu’appartenant au lexique,
12
les auxilaires sont moins autosémantiques (Heine 1991:28) que
les entrées lexicales pleines: alors que les entrées lexicales pleines ont leur propre contenu
sémantique, les auxiliaires auront tendance à constituer un sens en combinaison avec un autre
élément.
10
C’est le cas en néerlandais, où le verbe zitten suivi de te V-inf peut exprimer l’aspect progressif.
11
On trouve dans Lamiroy (1994) un résumé des différents critères qui ont pu être proposés dans la littérature
pour définir les auxiliaires: j’en ai relevé une quinzaine, mais la liste n’est peut-être pas complète.
12
Ce n’est pas le cas pour toutes les langues de l’échantillon étudié par Steele et al. (1981): plusieurs cas se
présentent où la catégorie AUX correspond à des affixes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%