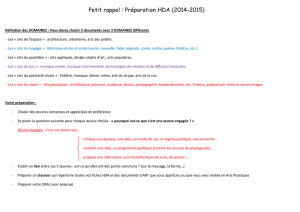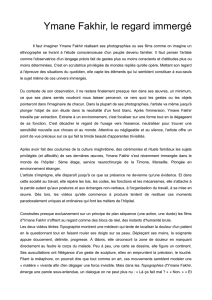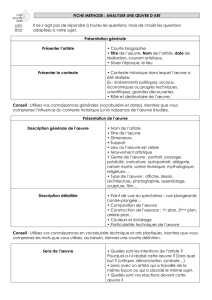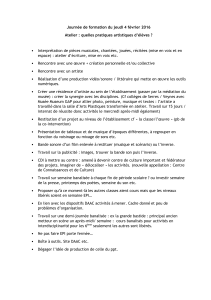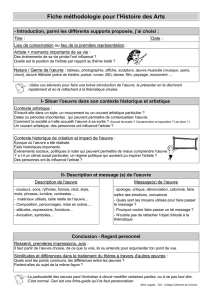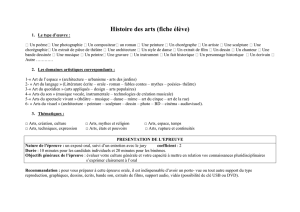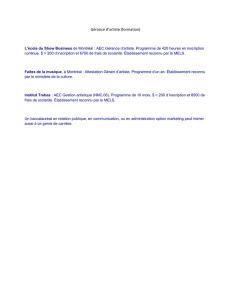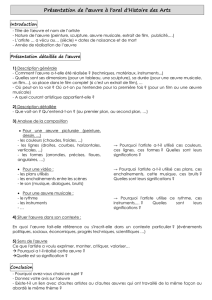Faites vos jeux dans l`art contemporain - HiCSA

« Faites vos jeux dans l’art contemporain »
Danielle Orhan
L’art actuel mobilise largement le jeu et, plus encore, les jeux. Ces dernières années, des
expositions thématiques telles que Playtimes, Let’s entertain, Le ludique, Game show, Artgames ou
encore Play !1 ont abondamment illustré cette orientation de la création contemporaine. Cependant, en
rassemblant des œuvres sous la seule bannière du divertissement tous azimuts, elles ont bien souvent
conduit à en araser le propos, voire à les instrumentaliser dans de véritables entreprises de séduction.
Or, ainsi que le rappelait récemment Joëlle Zask dans Art et démocratie, une œuvre d’art se définit
toujours par une pluralité de perspectives2. Caractéristique particulière qu’il convient de garder en
mémoire face à des œuvres qui détournent allègrement des jeux spécifiques de leurs usages habituels,
mais en conservent la propension à figurer métaphoriquement les mécanismes du réel.
Les exemples ici retenus s’intéressent aux implications métaphoriques et satiriques des jeux de
compétition, pensées du point de vue des rapports sociopolitiques et allant, ce faisant, à l’encontre
d’une vision expressément ludique de l’art, corollaire à la mise en scène spectaculaire de la réalité. En
soi, le jeu représente déjà un dispositif critique, tant il se fait l’écho des fonctionnements de la vie
sociale. Aussi, pour aborder des sujets politiques, les artistes s’emparent de jeux existants et les
réajustent à l’aune de leurs questionnements. Jeu et satire partagent la caractéristique de dédoublement
et, ce faisant, assurent une certaine continuité avec leurs modèles ou leurs cibles, mais une continuité
légèrement biaisée. Aussi, en procédant à un détournement de la métaphore ludique, ces œuvres
embrassent les qualités critiques de la satire, poussent les représentations sociales et politiques à leur
paroxysme, que ce soit le conflit israélo-palestinien, la question du racisme en Italie ou, plus
généralement, les oppositions qui gouvernent l’administration des territoires.
La force structurelle de la compétition ludique que Johannes Huizinga3 plaçait à la naissance
de nombreuses institutions humaines et que Roger Caillois4 érigeait en modèle idéal d’une saine et
loyale rivalité devient pour les artistes un moyen de reconfigurer la réalité. Et, en participant à ces
dispositifs ludiques réinventés, le joueur re-joue, en toute liberté, sa partie avec le monde. Aussi, la
juxtaposition d’œuvres sous couvert d’une communauté ludique tend à annihiler les virtualités de
développements qui leur sont constitutives. Elle réduit, en particulier, leur capacité à perturber les
1 Playtimes, Grenoble, Centre national d’art contemporain, 1999 ; Let’s entertain : life’s guilty pleasures,
Minneapolis, Walker Art Center, 12 février-30 avril 2000 ; Le ludique, Musée du Québec, 27 septembre-25
novembre 2001 ; Game Show, Massachusetts Museum of Contemporary Art, 27 mai 2001-avril 2002 ; Artgames.
Analogien zwischen Kunst und Spiel, Aachen, Ludwig Forum für Internationale Kunst, 17 décembre 2005-19
mars 2006 ; Play ! The Art of the Game, Amsterdam, Cobra Museum voor Moderne Kunst, 17 juin-24 septembre
2006. Nous proposons ici les expositions aux titres les plus emblématiques.
2 Joëlle Zask, Art et démocratie. Peuples de l’art, Paris, PUF, 2003.
3 Johannes Huizinga Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu [1938], traduit du néerlandais par Cécile
Seresia, Paris, Gallimard, 1951.
4 Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige [1958], Paris, Gallimard, 1967.

règles d’une réalité perçue comme irrécusable ainsi que leur force de proposition. L’évidence de la
finalité satirique de certains travaux laisse à penser que, s’il y a jeu, ce jeu n’en est pas moins sérieux.
Ainsi de Pingpong, œuvre que Belu-Simion Fainaru réalise en 20045. Une carte géographique des
territoires israélo-palestiniens tapisse le plateau horizontal d’une table de ping-pong, sur laquelle se
distinguent les frontières entre Israël, la Jordanie, l’Egypte, la Syrie et le Liban. La table, lexique de la
table ronde des pourparlers, se voit, dans le jeu, agencée sur une dualité fondatrice, énonçant
l’impossibilité d’un accord de paix. Le filet insiste sur la notion de frontière, de limite, question
cruciale du conflit. Cette lisière apparaît cependant transparente, vulnérable, elle peut être franchie
facilement. La table de ping-pong devient un véritable champ de bataille. Une métaphore de la guerre,
jeu sérieux s’il en est. Sous la bonhomie d’un match de tennis de table, s’exerce une brutalité
calculée : le rebondissement de la balle, son choc sur la table, le retentissement sonore de ses impacts.
La question soulevée par le jeu reflète celle, bien réelle, de la domination des territoires. Mais,
choisissant le jeu, Fainaru instaure une distance avec la gravité de son sujet, susceptible de faire de
l’œuvre le lieu d’émergence de la satire. En dégradant en effet la réalité du conflit, il la simplifie, au
point d’en exacerber le ressort fondamental. En modélisant les relations sociopolitiques sous la forme
d’un jeu, il les projette dans l’univers de l’inanité, de la gratuité, mais aussi de l’honneur et, ce faisant,
instruit leur futilité même. Or, ainsi à même de moquer les antinomies, le jeu peut aussi les suspendre
et les rejouer. Car l’œuvre, travaillée par une ambiguïté intrinsèque, suppose à la fois distance et
engagement, s’avère également terrain d’expérimentation, tant le jeu autorise potentiellement le
dépassement du point de vue partisan. Exposée, Pingpong sollicite la participation du spectateur. Or,
jouer le jeu, c’est reconnaître l’œuvre comme le champ possible d’une épreuve. Opportunité est offerte
d’expérimenter le conflit, dans le cadre d’une activité délestée de sanctions véritables. Conduite
ludique discernée par Caillois dans sa classification des jeux, l’agôn correspond à « l’ambition de
triompher grâce au seul mérite dans une compétition réglée »6. Il engage l’affrontement entre joueurs
ou équipes sur un mode dual et commande de développer une supériorité personnelle. Celle-ci
équivaudrait dans l’expérience de l’œuvre à une prise en charge individuelle des possibilités qu’elle
induit. Les jeux supposent un certain nombre de comportements dissociés de la vie courante. Ils
contraignent l’individu à opérer des choix et à jouer un rôle l’empêchant de se retrancher derrière des
attitudes préétablies. Lieu de l’incertitude, la situation de jeu reconstruit les identités et reste
susceptible d’amener le joueur à réviser une opinion préconçue. Mobilisant l’agôn mais aussi la
latitude autorisée par tout dispositif ludique, l’œuvre de Fainaru proposerait des occasions
d’individuation7, permettant une appréhension du conflit qui ne soit plus soumise au marquage
effectué par le groupe, sa loi et ses représentations. D’expérimentation, le jeu devient terrain
d’individuation : il laisse certes entrevoir une pluralité d’usages mais encourage plus encore l’action
personnelle. Le participant s’engage et, en s’engageant, change. Et, en effet, lors de l’exposition
Spielräume à Duisburg en 2005, deux joueurs, un Juif israélien d’Haifa et un Palestinien de Ramallah
ont joué l’un contre l’autre sur la table de Fainaru8. Ils ont simplement joué, ne visant aucunement la
victoire. Après le jeu, les deux participants se sont liés d’amitié et ont échangé leurs adresses. Jouer, ce
n’est plus être palestinien ou israélien, soit représenter un ensemble, mais être un face à un.
5 Belu-Simion Fainaru, Pingpong, 2004. Table de ping-pong, filet, deux raquettes, balle, photographie. Duisburg,
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Zentrum Internationaler Skulptur.
6 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, op. cit., p. 102.
7 Nous reprenons ici le terme de Jung suivant l’analyse de Joëlle Zask, op. cit.
8 Cf. cat. Spielräume, Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum Internationaler Skulptur, 5
juin-4 septembre 2005, p. 35.

Si le jeu peut manifester des antagonismes refoulés en temps ordinaires, il peut, à l’inverse,
tout autant les réprimer. Ses caractéristiques agonales recèlent la possibilité de se retourner contre
elles-mêmes. Un autre engagement, celui de la responsabilité proprement individuelle, s’établit de la
sorte lors de l’expérience de l’œuvre d’art. Une œuvre n’est œuvre que quand elle inclut toutes ses
possibilités, y compris celle d’une nouvelle proposition. Dans Pingpong de Fainaru, la pulsion
agressive se dénoue dans le jeu, comme espace structuré par un système de règles et, en même temps,
puits de possibilités. Loin d’opposer le jeu au sérieux, l’artiste organise les conditions d’une
responsabilité personnelle. Dans ce dispositif, le spectateur peut agir et cette action de potentiellement
l’affecter en retour. L’œuvre devient ainsi force de proposition, alternative face à l’ordre social,
incluse d’emblée à la fois dans son processus d’élaboration et dans son énonciation. Alors que le
plaisir ludique évince l’âpreté du désir de l’emporter, s’établit un rapport plus ouvert au politique, déjà
ancré dans la genèse de l’œuvre et déployé dans son mode d’exposition. Le jeu renvoie à un au-delà de
lui-même et devient la grille de lecture d’une réalité complexe.
Si, agonal, le jeu apparaît éminemment métaphorique, calquant ses ressorts sur la nature
conflictuelle des rapports socio-politiques, il peut tout autant développer de nouvelles modalités
d’échange. Lorsqu’il s’applique à en déstructurer la forme, par le dédoublement, par exemple, de ses
terrains, l’artiste aménage un champ d’interactions dynamiques, susceptibles d’enrayer toute dualité.
En 1998, Ping Pond Table de Gabriel Orozco9 désorganise de différentes manières le jeu auquel elle
se réfère. L’artiste substitue au rectangle de la table de ping-pong traditionnelle une structure
cruciforme aux bords arrondis. En son centre, au lieu du filet qui départage les terrains du jeu, s’étend
une petite mare quadrangulaire, recouverte de nénuphars, en écho au jeu de mots formulé dans le titre
de l’œuvre, le terme anglais pond signifiant mare. Quant à la ligne qui scinde habituellement la table
dans sa longueur, elle se fragmente ici au point de former un carré qui oblige les quatre joueurs, non
plus à se confronter en un face à face, mais à organiser la partie suivant un but commun : éviter, par
exemple, que la balle échoue dans la mare. En divisant les plans du plateau de jeu initial, la partie
s’effectue suivant un mouvement circulaire, qui trouble la dualité intrinsèque du tennis sur table.
L’œuvre ruine les possibilités d’exercice de l’agôn. Ainsi mis en échec, celui-ci ne peut avoir lieu. En
altérant la forme du jeu, Orozco en corrompt les règles, oblige le joueur à en réinventer de nouvelles,
qui ne soient plus structurées, à l’image des rapports qui régissent la vie courante, sur une opposition
fondatrice. A première vue, un tel jeu semble absurde et injouable. Mais Orozco ouvre au contraire
l’espace de l’œuvre et propose aux visiteurs de découvrir de nouvelles manières de jouer, en les
encourageant à reconnaître que les règles que l’on accepte comme fixées peuvent faire l’objet de
négociations, de remises en cause. Lieu possible d’une entente collective, le jeu invite à l’instauration
et à l’expérimentation commune de règles nouvelles.
Cette force de proposition intervient également dans une œuvre de 1996 d’Uri Tzaig,
Universal Square. L’artiste invite deux équipes de football israéliennes, l’une juive, l’autre arabe, à
jouer un match de football à Lod, en Israël. Si les joueurs doivent observer les règles traditionnelles de
ce sport, Tzaig introduit sur le terrain un second ballon qui vient déstabiliser le cours du jeu. Les
joueurs se retrouvent dans l’obligation de développer de nouvelles ressources et d’inventer sur le
champ d’autres règles du jeu. Les deux équipes ne doivent plus entrer en compétition l’une contre
l’autre mais s’unir dans l’édification de décisions. Et il doit y avoir pluralité dans l’accord. Jouant sur
9 Gabriel Orozco, Ping Pond Table, 1998. Tables de ping-pong modifiées, eau, matériaux divers. Paris, Galerie
Marian Goodman.

le décalage et le décentrement, l’artiste crée une situation qui désamorce la dualité, oblige des équipes
rôdées à appliquer des règles irréfragables à repenser la nature de leur activité. Ce faisant, il
transforme le rituel sportif en événement, lors duquel le jeu se joue du joueur. Le simple ajout d’un
ballon jette la confusion, perturbe les repères du terrain, dédouble le point de fixation du regard des
spectateurs et exige un réajustement de la vision. Tzaig satirise les conventions du jeu comme celles de
sa perception. Dans une vidéo éponyme, cette performance a été filmée par une caméra simplement
fixée sur l’action dispersée des joueurs et ignorant les nouvelles règles établies, nécessaires à la
compréhension du jeu. Le visionnage du match contrevient ainsi aux habitudes de lecture imposées
par la transmission télévisée du football. D’autant que Tzaig invite également sur le terrain non
seulement deux arbitres mais également deux commentateurs, entrelaçant leurs narrations, comme les
deux peuples aux histoires différentes partagent un même terrain dans le jeu, métonymie du territoire
plus vaste d’Israël. Le dédoublement disperse l’attention des spectateurs, inhibe toute médiatisation
surplombante et univoque du jeu. Au désordre sur le terrain correspond un éclatement de l’image. Le
lien entre sport et spectacle – dont les impératifs sont venus parfois transformer les règles des jeux – se
défait, les joueurs obéissant, sur le terrain, à des contraintes qu’ils sont désormais seuls à connaître,
puisque établies de façon performative, et qu’une caméra neutre ne peut révéler. La multitude des
points de vue possibles se réfère aux différents intérêts des partis qui règlent la politique israélienne.
Tzaig entend ainsi déstabiliser toute vision univoque. L’arrière-plan satiriste de cette œuvre réside
également dans son titre. Le carré universel incarnerait un terrain de jeu idéal, un microcosme, une
réplique en miniature du monde, à l’instar de Ping Pond Table d’Orozco, où la mare centrale reflète
les eaux primordiales, masse chaotique autour de laquelle s’organisent les régions circulaires du
monde, mais en une unité éclatée, à l’image des conflits. Or, terrains ludiques multidirectionnels, ces
dispositifs sont susceptibles de devenir le lieu d’interactions dynamiques, où puissent être
expérimentées, dans le cadre d’un jeu, des possibilités d’accords, évalués depuis plusieurs points de
vue et décidés de concert par les partis en présence. Par un gauchissement symbolique des règles et la
neutralisation de la vision, le jeu de Tzaig permet l’individuation, tandis que l’espace ludique devient
un champ de négociations, que nulle compétition ne gouverne plus.
Les jeux réinventés par les artistes provoquent ainsi des situations expérimentales,
imprévisibles, mais potentiellement réactualisables. Surtout, ils se retournent contre des règles
préétablies, montrent que jeu et entertainment ne se superposent pas l’un à l’autre. S’il peut amuser ou
divertir, le jeu contient une propension à la subversion, à la désintégration des règles entretenues par le
divertissement. Il permet d’un même allant de reconsidérer les rapports de la vie courante et de
remettre en cause les perceptions convenues. L’artiste emprunte au divertissement des structures, qu’il
s’applique à détourner de leurs buts initiaux, à vider de leur contenu et à recharger à des fins
satiriques. Ce faisant, il en révèle l’idéologie sous-jacente, alimentée par les médias. Le geste satirique
attaque non point l’objet mais le symbole qu’il incarne, les modalités de la compétition ainsi que leur
mise en scène. En s’emparant du potentiel métaphorique du jeu et des possibilités qu’il offre à la
participation active, il instruit également le procès d’une médiatisation à outrance. Le jeu met en
exergue le fonctionnement de la société, se fait miroir grossissant autant que déformant, avant de
devenir le lieu d’une conversion. L’artiste se saisit de dispositifs familiers, non pour s’en réclamer
mais pour s’en moquer, révélant par ce biais des réalités à dévoyer. La référence au sport en particulier
agit comme un détonateur émotionnel.

Avec Stadium10 en 1991, Maurizio Cattelan aborde de front le problème de l’immigration par
le biais d’une obsession nationale et populaire en Italie : le football. Sport qui, par excellence, dans les
processus d’identification qu’il opère, manifeste les appartenances nationales. Cattelan s’attache à en
exacerber la dimension agonale mais la déplace en usant d’une métaphore explicite de ce sport : le
baby-foot. Précisément parce qu’il est jeu et non un sport dit de masse comme son modèle, celui-ci
permet d’exprimer plus clairement les conflits comme d’expérimenter d’autres possibilités,
indépendamment des enjeux qui affectent son double élargi. Cattelan joue de la trivialité de ce
succédané, généralement pratiqué dans un cadre de détente et de convivialité. Or, il en gauchit les
proportions en l’étirant en longueur afin d’établir un rapport de contiguïté entre le jeu sur le terrain et
sa version sur table. Cet allongement – 700 x 70 x 120 cm – du jeu traditionnel permet en effet à deux
équipes de onze joueurs de s’opposer, comme dans un véritable match de football. Cattelan use de
l’hyperbole qui caractérise traditionnellement la communication des matchs et la transpose ainsi dans
la forme. Or, en 1991, dans la galerie d’Art moderne de Bologne, la Cesena, équipe du championnat
régional italien, et l’AC Fornitore Sud – fournisseurs du sud – se sont affrontées sur ce baby-foot
géant. Par principe, les jeux agonistiques font appel aux aptitudes individuelles sur la base d’une
égalité formelle et utopique de tous devant les règles. Egalitaire quant à son fondement, le jeu apparaît
révélateur d’inégalités et, ce faisant, du dérèglement social11. Car l’AC Fornitore Sud est une équipe
d’immigrants sénégalais en situation irrégulière, composée par Cattelan lui-même. Une équipe
totalement fictive qui relance la question du racisme en Italie, particulièrement exacerbé dans les
stades. Il ne semble pas anodin que l’artiste organise cette rencontre à Bologne, en Italie du Nord, qui
a toujours fait preuve d’ostracisme envers l’Italie du Sud, pauvre et pourvoyeuse main d’œuvre bon
marché, d’où le nom dont Cattelan baptise son équipe, par référence explicité à l’exploitation des
minorités ethniques. En constituant une équipe composée uniquement de Sénégalais, Cattelan pousse à
son paroxysme l’attitude ségrégationniste des Italiens, révélée en particulier dans le sport de compéti-
tion, pourtant réputé reposer sur le mérite et le fair play. L’artiste subvertit en effet un règle nullement
remise en cause dans la péninsule, qui veut que le sport le plus populaire du pays ne comporte dans ses
équipes que des Italiens d’origine. Contre toute évidence, les dirigeants du football italien, fermant les
yeux sur les récupérations politiques dont ce sport fait l’objet, se refusent à l’intégration dans ses rangs
des immigrants. Ainsi les joueurs de Cattelan portent des maillots barrés du slogan néo-nazi « Races ».
Perturbatrice, une telle œuvre détient une puissance de dévoilement. Elle épingle de façon satirique le
problème crucial de l’immigration et anticipe sur l’inconscient collectif d’un pays, arguant, lors de la
Coupe du Monde de 1998 par exemple, qu’il n’avait non point perdu contre la France, mais contre
l’Afrique, c’est-à-dire non pas contre un pays mais contre un continent, vu le nombre de joueurs issus
de l’immigration dans la sélection française. Ce faisant, l’équipe de Cattelan, composée de Sénégalais,
ne peut que jouer sur un ersatz du football. Mais, en bon manager, l’artiste transforme ce dernier afin
que toute l’équipe puisse jouer. Il détourne un jeu populaire, miniature du jeu véritable et tout à la fois
son miroir grossissant. Aussi, une mise en abyme s’opère dans la mesure où il s’agit d’un modèle
réduit surdimensionné. Par ce gauchissement des proportions, Cattelan propose une mise en pers-
pective sociale de l’agôn ludique, tout comme il carnavalise le réel. Jouant contradictoirement sur la
miniaturisation et l’agrandissement, l’œuvre s’interprète sur le mode de la satire, comme une mise en
exergue fulgurante. L’agôn appuyé par le jeu des métaphores reproduit en l’exacerbant un conflit réel.
Néanmoins, en choisissant le modèle réduit, il invite les joueurs et, par la suite, les spectateurs, à
10 Maurizio Cattelan, Stadium, 1991. Bois, métal et verre. Milan, collection Cellula et Galleria Massimo de
Carlo.
11 « La recherche de l’égalité des chances au départ, souligne Caillois, est si manifestement le principe essentiel
de la rivalité qu’on la rétablit par un handicap entre des joueurs de classe différente, c’est-à-dire qu’à l’intérieur
de l’égalité des chances d’abord établie, on ménage une inégalité seconde, proportionnelle à la force relative
supposée des participants. » In Les jeux et les hommes, op. cit., p. 51.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%